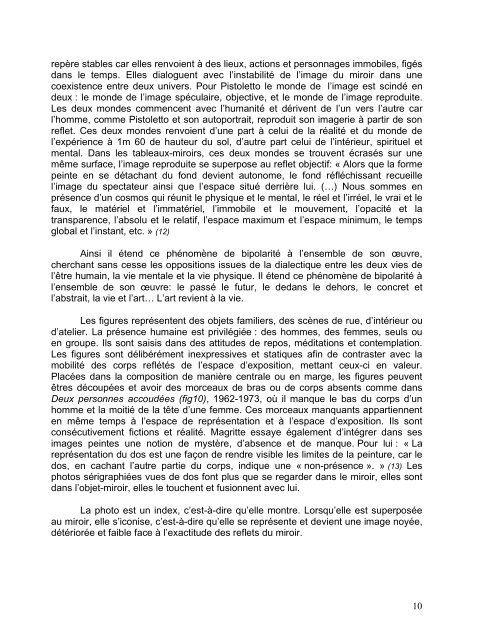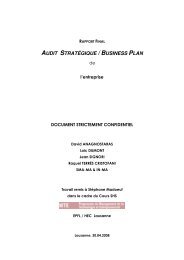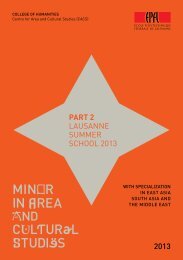Le miroir dans l'œuvre de Michelangelo Pistoletto - CDH
Le miroir dans l'œuvre de Michelangelo Pistoletto - CDH
Le miroir dans l'œuvre de Michelangelo Pistoletto - CDH
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
epère stables car elles renvoient à <strong>de</strong>s lieux, actions et personnages immobiles, figés<br />
<strong>dans</strong> le temps. Elles dialoguent avec l’instabilité <strong>de</strong> l’image du <strong>miroir</strong> <strong>dans</strong> une<br />
coexistence entre <strong>de</strong>ux univers. Pour <strong>Pistoletto</strong> le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’image est scindé en<br />
<strong>de</strong>ux : le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’image spéculaire, objective, et le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’image reproduite.<br />
<strong>Le</strong>s <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s commencent avec l’humanité et dérivent <strong>de</strong> l’un vers l’autre car<br />
l’homme, comme <strong>Pistoletto</strong> et son autoportrait, reproduit son imagerie à partir <strong>de</strong> son<br />
reflet. Ces <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s renvoient d’une part à celui <strong>de</strong> la réalité et du mon<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’expérience à 1m 60 <strong>de</strong> hauteur du sol, d’autre part celui <strong>de</strong> l’intérieur, spirituel et<br />
mental. Dans les tableaux-<strong>miroir</strong>s, ces <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s se trouvent écrasés sur une<br />
même surface, l’image reproduite se superpose au reflet objectif: « Alors que la forme<br />
peinte en se détachant du fond <strong>de</strong>vient autonome, le fond réfléchissant recueille<br />
l’image du spectateur ainsi que l’espace situé <strong>de</strong>rrière lui. (…) Nous sommes en<br />
présence d’un cosmos qui réunit le physique et le mental, le réel et l’irréel, le vrai et le<br />
faux, le matériel et l’immatériel, l’immobile et le mouvement, l’opacité et la<br />
transparence, l’absolu et le relatif, l’espace maximum et l’espace minimum, le temps<br />
global et l’instant, etc. » (12)<br />
Ainsi il étend ce phénomène <strong>de</strong> bipolarité à l’ensemble <strong>de</strong> son œuvre,<br />
cherchant sans cesse les oppositions issues <strong>de</strong> la dialectique entre les <strong>de</strong>ux vies <strong>de</strong><br />
l’être humain, la vie mentale et la vie physique. Il étend ce phénomène <strong>de</strong> bipolarité à<br />
l’ensemble <strong>de</strong> son œuvre: le passé le futur, le <strong>de</strong><strong>dans</strong> le <strong>de</strong>hors, le concret et<br />
l’abstrait, la vie et l’art… L’art revient à la vie.<br />
<strong>Le</strong>s figures représentent <strong>de</strong>s objets familiers, <strong>de</strong>s scènes <strong>de</strong> rue, d’intérieur ou<br />
d’atelier. La présence humaine est privilégiée : <strong>de</strong>s hommes, <strong>de</strong>s femmes, seuls ou<br />
en groupe. Ils sont saisis <strong>dans</strong> <strong>de</strong>s attitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> repos, méditations et contemplation.<br />
<strong>Le</strong>s figures sont délibérément inexpressives et statiques afin <strong>de</strong> contraster avec la<br />
mobilité <strong>de</strong>s corps reflétés <strong>de</strong> l’espace d’exposition, mettant ceux-ci en valeur.<br />
Placées <strong>dans</strong> la composition <strong>de</strong> manière centrale ou en marge, les figures peuvent<br />
êtres découpées et avoir <strong>de</strong>s morceaux <strong>de</strong> bras ou <strong>de</strong> corps absents comme <strong>dans</strong><br />
Deux personnes accoudées (fig10), 1962-1973, où il manque le bas du corps d’un<br />
homme et la moitié <strong>de</strong> la tête d’une femme. Ces morceaux manquants appartiennent<br />
en même temps à l’espace <strong>de</strong> représentation et à l’espace d’exposition. Ils sont<br />
consécutivement fictions et réalité. Magritte essaye également d’intégrer <strong>dans</strong> ses<br />
images peintes une notion <strong>de</strong> mystère, d’absence et <strong>de</strong> manque. Pour lui : « La<br />
représentation du dos est une façon <strong>de</strong> rendre visible les limites <strong>de</strong> la peinture, car le<br />
dos, en cachant l’autre partie du corps, indique une « non-présence ». » (13) <strong>Le</strong>s<br />
photos sérigraphiées vues <strong>de</strong> dos font plus que se regar<strong>de</strong>r <strong>dans</strong> le <strong>miroir</strong>, elles sont<br />
<strong>dans</strong> l’objet-<strong>miroir</strong>, elles le touchent et fusionnent avec lui.<br />
La photo est un in<strong>de</strong>x, c’est-à-dire qu’elle montre. Lorsqu’elle est superposée<br />
au <strong>miroir</strong>, elle s’iconise, c’est-à-dire qu’elle se représente et <strong>de</strong>vient une image noyée,<br />
détériorée et faible face à l’exactitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s reflets du <strong>miroir</strong>.<br />
10