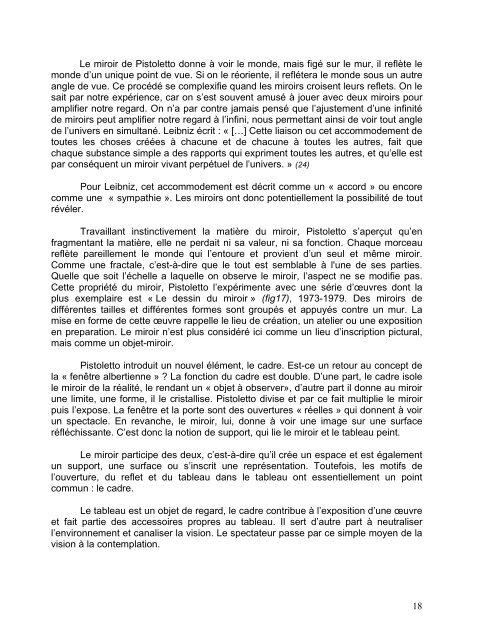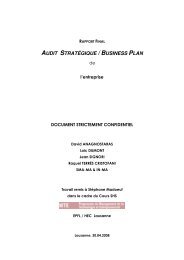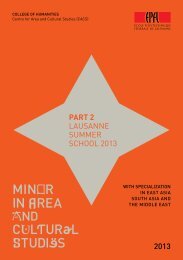Le miroir dans l'œuvre de Michelangelo Pistoletto - CDH
Le miroir dans l'œuvre de Michelangelo Pistoletto - CDH
Le miroir dans l'œuvre de Michelangelo Pistoletto - CDH
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Le</strong> <strong>miroir</strong> <strong>de</strong> <strong>Pistoletto</strong> donne à voir le mon<strong>de</strong>, mais figé sur le mur, il reflète le<br />
mon<strong>de</strong> d’un unique point <strong>de</strong> vue. Si on le réoriente, il reflétera le mon<strong>de</strong> sous un autre<br />
angle <strong>de</strong> vue. Ce procédé se complexifie quand les <strong>miroir</strong>s croisent leurs reflets. On le<br />
sait par notre expérience, car on s’est souvent amusé à jouer avec <strong>de</strong>ux <strong>miroir</strong>s pour<br />
amplifier notre regard. On n’a par contre jamais pensé que l’ajustement d’une infinité<br />
<strong>de</strong> <strong>miroir</strong>s peut amplifier notre regard à l’infini, nous permettant ainsi <strong>de</strong> voir tout angle<br />
<strong>de</strong> l’univers en simultané. <strong>Le</strong>ibniz écrit : « […] Cette liaison ou cet accommo<strong>de</strong>ment <strong>de</strong><br />
toutes les choses créées à chacune et <strong>de</strong> chacune à toutes les autres, fait que<br />
chaque substance simple a <strong>de</strong>s rapports qui expriment toutes les autres, et qu’elle est<br />
par conséquent un <strong>miroir</strong> vivant perpétuel <strong>de</strong> l’univers. » (24)<br />
Pour <strong>Le</strong>ibniz, cet accommo<strong>de</strong>ment est décrit comme un « accord » ou encore<br />
comme une « sympathie ». <strong>Le</strong>s <strong>miroir</strong>s ont donc potentiellement la possibilité <strong>de</strong> tout<br />
révéler.<br />
Travaillant instinctivement la matière du <strong>miroir</strong>, <strong>Pistoletto</strong> s’aperçut qu’en<br />
fragmentant la matière, elle ne perdait ni sa valeur, ni sa fonction. Chaque morceau<br />
reflète pareillement le mon<strong>de</strong> qui l’entoure et provient d’un seul et même <strong>miroir</strong>.<br />
Comme une fractale, c’est-à-dire que le tout est semblable à l'une <strong>de</strong> ses parties.<br />
Quelle que soit l’échelle a laquelle on observe le <strong>miroir</strong>, l’aspect ne se modifie pas.<br />
Cette propriété du <strong>miroir</strong>, <strong>Pistoletto</strong> l’expérimente avec une série d’œuvres dont la<br />
plus exemplaire est « <strong>Le</strong> <strong>de</strong>ssin du <strong>miroir</strong> » (fig17), 1973-1979. Des <strong>miroir</strong>s <strong>de</strong><br />
différentes tailles et différentes formes sont groupés et appuyés contre un mur. La<br />
mise en forme <strong>de</strong> cette œuvre rappelle le lieu <strong>de</strong> création, un atelier ou une exposition<br />
en preparation. <strong>Le</strong> <strong>miroir</strong> n’est plus considéré ici comme un lieu d’inscription pictural,<br />
mais comme un objet-<strong>miroir</strong>.<br />
<strong>Pistoletto</strong> introduit un nouvel élément, le cadre. Est-ce un retour au concept <strong>de</strong><br />
la « fenêtre albertienne » ? La fonction du cadre est double. D’une part, le cadre isole<br />
le <strong>miroir</strong> <strong>de</strong> la réalité, le rendant un « objet à observer», d’autre part il donne au <strong>miroir</strong><br />
une limite, une forme, il le cristallise. <strong>Pistoletto</strong> divise et par ce fait multiplie le <strong>miroir</strong><br />
puis l’expose. La fenêtre et la porte sont <strong>de</strong>s ouvertures « réelles » qui donnent à voir<br />
un spectacle. En revanche, le <strong>miroir</strong>, lui, donne à voir une image sur une surface<br />
réfléchissante. C’est donc la notion <strong>de</strong> support, qui lie le <strong>miroir</strong> et le tableau peint.<br />
<strong>Le</strong> <strong>miroir</strong> participe <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux, c’est-à-dire qu’il crée un espace et est également<br />
un support, une surface ou s’inscrit une représentation. Toutefois, les motifs <strong>de</strong><br />
l’ouverture, du reflet et du tableau <strong>dans</strong> le tableau ont essentiellement un point<br />
commun : le cadre.<br />
<strong>Le</strong> tableau est un objet <strong>de</strong> regard, le cadre contribue à l’exposition d’une œuvre<br />
et fait partie <strong>de</strong>s accessoires propres au tableau. Il sert d’autre part à neutraliser<br />
l’environnement et canaliser la vision. <strong>Le</strong> spectateur passe par ce simple moyen <strong>de</strong> la<br />
vision à la contemplation.<br />
18