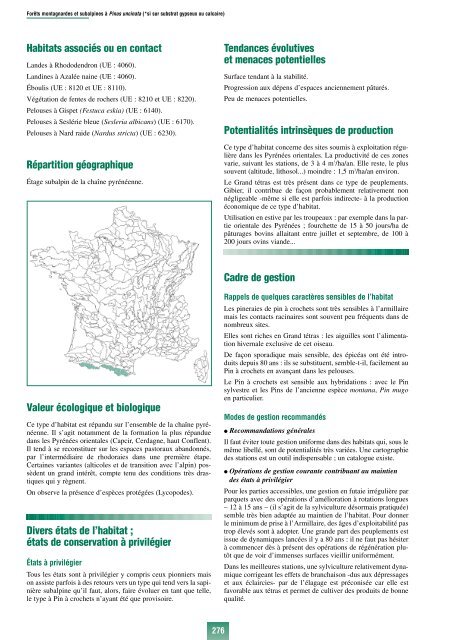- Page 1 and 2:
Connaissance et gestion des habitat
- Page 3 and 4:
Montagnard 9130-7 Hêtraies, hêtra
- Page 5 and 6:
9230 = 41.6 Chênaies galicio-portu
- Page 8 and 9:
Avant-propos Le Muséum national d'
- Page 10 and 11:
Remerciements et contributions Coor
- Page 12 and 13:
13 Notice
- Page 14 and 15:
Figure 1 : Schéma d’organisation
- Page 16 and 17:
« Cahiers d’habitats » et docum
- Page 18 and 19:
La végétation, par son caractère
- Page 20 and 21:
En complément, la conservation des
- Page 22 and 23:
Restauration des terrains de montag
- Page 24 and 25:
La pose de drains est par contre à
- Page 26 and 27:
Contenu des fiches Contenu de la fi
- Page 28:
Fiches de synthèse 29
- Page 31 and 32:
Forêt de l’Europe tempérée •
- Page 33 and 34:
Hêtraies du Luzulo-Fagetum Hêtrai
- Page 35 and 36:
Hêtraies du Luzulo-Fagetum Cadre d
- Page 37 and 38:
Hêtraies du Luzulo-Fagetum Hêtrai
- Page 39 and 40:
Hêtraies du Luzulo-Fagetum La tran
- Page 41 and 42:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 43 and 44:
Hêtraies du Luzulo-Fagetum DELAHAY
- Page 45 and 46:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 48 and 49:
Forêt de l’Europe tempérée Hê
- Page 50 and 51:
Forêt de l’Europe tempérée GEH
- Page 52 and 53:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 54 and 55:
Hêtraies atlantiques, acidophiles
- Page 56 and 57:
Hêtraies atlantiques, acidophiles
- Page 58 and 59:
Hêtraies atlantiques, acidophiles
- Page 60 and 61:
Hêtraies atlantiques, acidophiles
- Page 62 and 63:
Hêtraies atlantiques, acidophiles
- Page 64 and 65:
Hêtraies atlantiques, acidophiles
- Page 66 and 67:
Forêt de l’Europe tempérée Hê
- Page 68 and 69:
Forêt de l’Europe tempérée PFE
- Page 70 and 71:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 72 and 73:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum H
- Page 74 and 75:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum
- Page 76 and 77:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 78 and 79:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum H
- Page 80 and 81:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum p
- Page 82 and 83:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 84 and 85:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum H
- Page 86 and 87:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum C
- Page 88 and 89:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 90 and 91:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum H
- Page 92 and 93:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum
- Page 94 and 95:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 96 and 97:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum S
- Page 98 and 99:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum L
- Page 100 and 101:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 102 and 103:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum S
- Page 104 and 105:
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum B
- Page 106:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 109 and 110:
Forêt de l’Europe tempérée CUS
- Page 111 and 112:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 113 and 114:
Hêtraies subalpines médio-europé
- Page 115 and 116:
Hêtraies subalpines médio-europé
- Page 117 and 118:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 120 and 121:
Forêt de l’Europe tempérée Hê
- Page 122 and 123:
Forêt de l’Europe tempérée PET
- Page 124 and 125:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 126 and 127:
Hêtraies calcicoles médio-europé
- Page 128 and 129:
Hêtraies calcicoles médio-europé
- Page 130 and 131:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 132 and 133:
Hêtraies calcicoles médio-europé
- Page 134 and 135:
Hêtraies calcicoles médio-europé
- Page 136 and 137:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 138 and 139:
Hêtraies calcicoles médio-europé
- Page 140 and 141:
Hêtraies calcicoles médio-europé
- Page 142 and 143:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 144 and 145:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 146 and 147:
Hêtraies calcicoles médio-europé
- Page 148:
Hêtraies calcicoles médio-europé
- Page 151 and 152:
Forêt de l’Europe tempérée Bib
- Page 153 and 154:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 155 and 156:
Chênaies pédonculées ou chênaie
- Page 157 and 158:
Chênaies pédonculées ou chênaie
- Page 159 and 160:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 162 and 163:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 164 and 165:
Chênaies-charmaies du Galio-Carpin
- Page 166 and 167:
Chênaies-charmaies du Galio-Carpin
- Page 168:
Chênaies-charmaies du Galio-Carpin
- Page 171 and 172:
Forêt de l’Europe tempérée Til
- Page 173 and 174:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 175 and 176:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 177 and 178:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 179 and 180:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 181 and 182:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 183 and 184:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 185 and 186:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 187 and 188:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 189 and 190:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 191 and 192:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 193 and 194:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 195 and 196:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 197 and 198:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 199 and 200:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 201 and 202:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 203 and 204:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 205 and 206:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 207 and 208:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 209 and 210:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 211 and 212:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 213 and 214:
Forêts de pentes, éboulis, ravins
- Page 215 and 216:
Forêt de l’Europe tempérée Bib
- Page 217 and 218:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 220 and 221:
Forêt de l’Europe tempérée Tou
- Page 222 and 223:
Forêt de l’Europe tempérée Bou
- Page 224 and 225:
Tourbières boisées* Boulaies pube
- Page 226 and 227:
Tourbières boisées* Divers états
- Page 228 and 229:
Tourbières boisées* Boulaies pube
- Page 230 and 231:
Tourbières boisées* ● Engins lo
- Page 232 and 233:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 234 and 235:
Tourbières boisées* Pineraies tou
- Page 236 and 237:
Tourbières boisées* (scolytes) :
- Page 238 and 239:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 240 and 241:
Forêt de l’Europe tempérée For
- Page 242 and 243:
Forêt de l’Europe tempérée BOT
- Page 244 and 245:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 246 and 247:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 248 and 249:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 250 and 251:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 252 and 253:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 254 and 255:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 256 and 257:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 258 and 259:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 260 and 261:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 262 and 263:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 264 and 265:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 266 and 267:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 268 and 269:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 270 and 271:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 272 and 273:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 274 and 275:
Forêts alluviales à Alnus glutino
- Page 276 and 277:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 278 and 279:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 280 and 281:
Forêt de l’Europe tempérée PAG
- Page 282 and 283:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 284 and 285:
Forêts mixtes de Quercus robur, Ul
- Page 286 and 287:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 288 and 289:
Forêts mixtes de Quercus robur, Ul
- Page 290 and 291:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 292:
Forêts mixtes de Quercus robur, Ul
- Page 295 and 296:
Forêts méditerranéennes à feuil
- Page 297 and 298:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 299 and 300:
Chênaies galicio-portugaises à Qu
- Page 301 and 302:
Chênaies galicio-portugaises à Qu
- Page 303 and 304:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 305 and 306:
Source : D’après RAMEAU et al.,
- Page 307 and 308:
Brunifié : qualifie un sol présen
- Page 309 and 310:
Évapotranspiration potentielle (ET
- Page 311 and 312:
Lessivé : se dit d’un sol ou d
- Page 313 and 314:
Pseudogley : faciès d’engorgemen
- Page 315 and 316:
X Xérique : qualifie un milieu tr
- Page 317 and 318:
◆ Primulo elatiori-Quercetum robo
- Page 319 and 320:
◆ Vaccinio uliginosi-Betuletum pu
- Page 321 and 322:
Carex montana : 124, 125, 127, 130,
- Page 323 and 324:
Melittis melissophyllum : 73, 82, 9
- Page 325 and 326:
Ulmus minor : 5, 21, 174, 177, 269,
- Page 327 and 328:
Filipendulo ulmariae-Alnetum glutin
- Page 330 and 331:
Table des matières des « Cahiers
- Page 332 and 333:
Landes et fourrés tempérés 4010
- Page 334 and 335:
Autres habitats rocheux 8310 - Grot
- Page 336 and 337:
1608 - Rouya polygama, la Thapsie d
- Page 338 and 339:
Insectes Coléoptères 1079 - Limon
- Page 340 and 341:
92A0-5 Aulnaies-Tillaies de Provenc
- Page 342 and 343:
9530-1.5* Peuplements cévenoles m
- Page 345:
Préface La France, située au carr
- Page 348 and 349:
La directive « Habitats » constit
- Page 350 and 351:
Bernard CABANNES (CRPF Languedoc-Ro
- Page 352 and 353:
Présentation générale des « Cah
- Page 354 and 355:
Pour quelques rares « Cahiers d’
- Page 356 and 357:
Les programmes des « Cahiers d’h
- Page 358 and 359:
● Fragmentation des zones favorab
- Page 360 and 361:
Relations entre forêts et ongulés
- Page 362 and 363:
La gestion de ces espaces ne peut
- Page 364 and 365:
La définition de ces zones est tr
- Page 366 and 367:
Conclusion Le programme « Cahiers
- Page 369 and 370:
Landes alpines et subalpines Fourr
- Page 371 and 372:
Fourrés à Pinus mugo et Rhododend
- Page 373 and 374:
Fourrés à Pinus mugo et Rhododend
- Page 375 and 376:
Fourrés à Pinus mugo et Rhododend
- Page 377 and 378:
Fourrés à Pinus mugo et Rhododend
- Page 379 and 380:
Forêts méditerranéennes à feuil
- Page 381 and 382:
Forêts méditerranéennes à feuil
- Page 383 and 384:
Forêts à Castanea sativa Châtaig
- Page 385 and 386:
Forêts à Castanea sativa Potentia
- Page 387 and 388:
Forêts à Castanea sativa Châtaig
- Page 389 and 390:
Forêts à Castanea sativa menace
- Page 391 and 392:
Forêts à Castanea sativa Châtaig
- Page 393 and 394:
Forêts à Castanea sativa - dével
- Page 395 and 396:
Forêts à Castanea sativa Châtaig
- Page 397 and 398:
Forêts à Castanea sativa Tendance
- Page 399 and 400:
Forêts à Castanea sativa Châtaig
- Page 401 and 402:
Forêts à Castanea sativa bois que
- Page 403 and 404:
Forêts à Castanea sativa Confusio
- Page 405 and 406:
Forêts à Castanea sativa Châtaig
- Page 407:
Forêts à Castanea sativa Les châ
- Page 410 and 411:
Forêts méditerranéennes à feuil
- Page 412 and 413:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 414 and 415:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 416 and 417:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 418 and 419:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 420 and 421:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 422 and 423:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 424 and 425:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 426 and 427:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 428 and 429:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 430 and 431:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 432 and 433:
Forêts galeries à Salix alba et P
- Page 435 and 436:
Forêts méditerranéennes à feuil
- Page 437 and 438:
Galeries et fourrés riverains mér
- Page 439 and 440:
Galeries et fourrés riverains mér
- Page 441 and 442:
Galeries et fourrés riverains mér
- Page 443 and 444:
Forêts sclérophylles méditerran
- Page 445 and 446:
Forêts à Olea et Ceratonia Peuple
- Page 447 and 448:
Forêts à Olea et Ceratonia bilit
- Page 449 and 450:
Forêts à Olea et Ceratonia Habita
- Page 451 and 452:
Forêts à Olea et Ceratonia Peuple
- Page 453 and 454:
Forêts sclérophylles méditerran
- Page 455 and 456:
Forêts à Quercus suber Suberaies
- Page 457 and 458:
Forêts à Quercus suber - la dynam
- Page 459 and 460:
Forêts à Quercus suber Répartiti
- Page 461 and 462:
Forêts à Quercus suber Suberaies
- Page 463 and 464:
Forêts à Quercus suber Potentiali
- Page 465 and 466:
Forêts à Quercus suber Habitats a
- Page 467 and 468:
Forêts à Quercus suber Suberaies
- Page 469 and 470:
Forêts sclérophylles méditerran
- Page 471 and 472:
Forêts sclérophylles méditerran
- Page 473 and 474:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 475 and 476:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 477 and 478:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 479 and 480:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 481 and 482:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 483 and 484:
Hêtraies calcicoles médio-europé
- Page 485 and 486:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 487 and 488:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 489 and 490:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 491 and 492:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 493 and 494:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 495 and 496:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 497 and 498:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 499 and 500:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 501 and 502:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 503 and 504:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 505:
Forêts à Quercus ilex et Quercus
- Page 508 and 509:
Forêts sclérophylles méditerran
- Page 510 and 511:
Forêts d’Ilex aquifolium Dynamiq
- Page 512 and 513:
Forêts d’Ilex aquifolium Chênai
- Page 514 and 515:
Forêts d’Ilex aquifolium Potenti
- Page 516 and 517:
Forêts d’Ilex aquifolium Habitat
- Page 518 and 519:
Forêts d’Ilex aquifolium Dynamiq
- Page 521 and 522:
Forêts de Conifères subalpines et
- Page 523 and 524:
Forêts de Conifères subalpines et
- Page 525 and 526:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 527 and 528:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 529 and 530:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 531 and 532:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 533 and 534:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 535 and 536:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 537 and 538:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 539 and 540:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 541 and 542:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 543 and 544:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 545 and 546:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 547 and 548:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 549 and 550:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 551 and 552:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 553 and 554:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 555 and 556:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 557:
Forêts acidophiles à Picea des é
- Page 560 and 561:
Forêts de Conifères subalpines et
- Page 562 and 563: Forêts alpines à Larix decidua et
- Page 564 and 565: Forêts alpines à Larix decidua et
- Page 566 and 567: Forêts alpines à Larix decidua et
- Page 568 and 569: Forêts alpines à Larix decidua et
- Page 570 and 571: Forêts alpines à Larix decidua et
- Page 572 and 573: Forêts alpines à Larix decidua et
- Page 574 and 575: Forêts alpines à Larix decidua et
- Page 576 and 577: Forêts alpines à Larix decidua et
- Page 578 and 579: Forêts alpines à Larix decidua et
- Page 581 and 582: Forêts de Conifères subalpines et
- Page 583 and 584: Forêts de Conifères subalpines et
- Page 585 and 586: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 587 and 588: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 589 and 590: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 591 and 592: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 593 and 594: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 595 and 596: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 597 and 598: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 599 and 600: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 601 and 602: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 603 and 604: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 605 and 606: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 607 and 608: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 609 and 610: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 611: Forêts montagnardes et subalpines
- Page 616 and 617: Forêts méditerranéennes de Conif
- Page 618 and 619: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 620 and 621: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 622 and 623: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 624 and 625: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 626 and 627: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 628 and 629: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 630 and 631: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 633 and 634: Forêts méditerranéennes de Conif
- Page 635 and 636: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 637 and 638: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 639 and 640: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 641 and 642: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 643 and 644: * Pinèdes (sub-)méditerranéennes
- Page 645 and 646: Forêts méditerranéennes de Conif
- Page 647 and 648: Forêts méditerranéennes de Conif
- Page 649 and 650: Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 651 and 652: Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 653 and 654: Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 655 and 656: Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 657 and 658: Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 659 and 660: Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 661 and 662: Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 663 and 664:
Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 665:
Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 668 and 669:
Forêts méditerranéennes de Conif
- Page 670 and 671:
Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 672 and 673:
Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 674 and 675:
Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 676 and 677:
Forêts méditerranéennes de Conif
- Page 678 and 679:
Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 680 and 681:
Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 682 and 683:
Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 684 and 685:
Pinèdes méditerranéennes de pins
- Page 687 and 688:
Forêts de Conifères méditerrané
- Page 689 and 690:
Forêts de Conifères méditerrané
- Page 691 and 692:
Forêts de Conifères méditerrané
- Page 693 and 694:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 695 and 696:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 697 and 698:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 699 and 700:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 701 and 702:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 703 and 704:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 705 and 706:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 707 and 708:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 709 and 710:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 711 and 712:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 713 and 714:
* Forêts endémiques à Juniperus
- Page 715 and 716:
Forêts de Conifères méditerrané
- Page 717 and 718:
* Bois méditerranéens à Taxus ba
- Page 719 and 720:
* Bois méditerranéens à Taxus ba
- Page 721 and 722:
* Bois méditerranéens à Taxus ba
- Page 723 and 724:
A A : désigne en pédologie les ho
- Page 725 and 726:
D Débardage : transfert des bois p
- Page 727 and 728:
H Hallier : gros buisson touffu (ro
- Page 729 and 730:
O O : désigne en pédologie les ho
- Page 731 and 732:
Stade : (1) au sens physiologique,
- Page 733 and 734:
Extrait du prodrome 17 des végéta
- Page 735 and 736:
❍ Galio rotundifolii-Abietenion a
- Page 737 and 738:
A Abies alba : 22, 23, 186, 187, 18
- Page 739 and 740:
Chamaerops humilis : 110, 112 Chrys
- Page 741 and 742:
Geum urbanum : 91, 176 Globularia a
- Page 743 and 744:
Petrorhagia saxifraga : 366, 376 Pe
- Page 745 and 746:
Silene italica : 51, 363 Silene nut
- Page 747 and 748:
A Adenocarpo complicatae-Ericetum a
- Page 749:
R Rhamno lycioidis-Quercion coccife
- Page 752 and 753:
Dunes maritimes et intérieures Dun
- Page 754 and 755:
Landes et fourrés tempérés 4010
- Page 756 and 757:
8230 - Roches siliceuses avec vég
- Page 758 and 759:
1604 - Eryngium alpinum, le Panicau
- Page 760:
Insectes Coléoptères 1079 - Limon