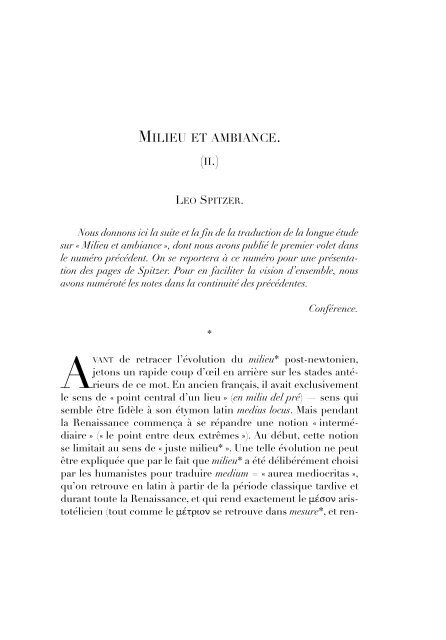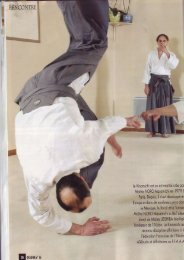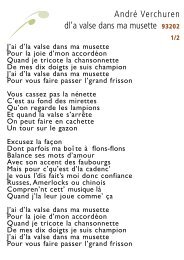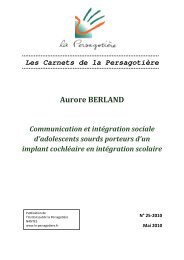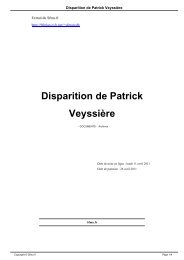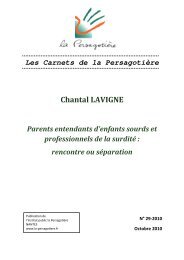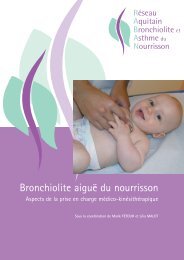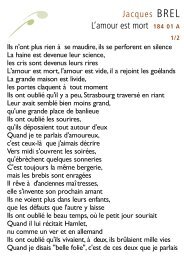Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>MILIEU</strong> <strong>ET</strong> <strong>AMBIANCE</strong>.<br />
(II.)<br />
LEO SPITZER.<br />
Nous donnons ici la suite et la fin de la traduction de la longue étude<br />
sur « Milieu et ambiance », dont nous avons publié le premier volet dans<br />
le numéro précédent. On se reportera à ce numéro pour une présentation<br />
des pages de Spitzer. Pour en faciliter la vision d’ensemble, nous<br />
avons numéroté les notes dans la continuité des précédentes.<br />
*<br />
Conférence.<br />
AVANT de retracer l’évolution du milieu* post-newtonien,<br />
jetons un rapide coup d’œil en arrière sur les stades antérieurs<br />
de ce mot. En ancien français, il avait exclusivement<br />
le sens de « point central d’un lieu » (en miliu del pré) — sens qui<br />
semble être fidèle à son étymon latin medius locus. Mais pendant<br />
la Renaissance commença à se répandre une notion « intermédiaire<br />
» (« le point entre deux extrêmes »). Au début, cette notion<br />
se limitait au sens de « juste milieu* ». Une telle évolution ne peut<br />
être expliquée que par le fait que milieu* a été délibérément choisi<br />
par les humanistes pour traduire medium = « aurea mediocritas »,<br />
qu’on retrouve en latin à partir de la période classique tardive et<br />
durant toute la Renaissance, et qui rend exactement le ¥Ä«∑μ aristotélicien<br />
(tout comme le ¥Ä…ƒ§∑μ se retrouve dans mesure*, et ren-
406<br />
CONFÉRENCE<br />
voie à une qualité morale). On voit que le mot latin lui-même était<br />
familier aux humanistes français dans l’utilisation qu’en fait Brantôme,<br />
qui l’introduit dans un passage écrit en français : « le medium<br />
qu’il faut tenir en tout » (cf. Pline : medium quiddam tenere, et un<br />
emploi similaire chez Thomas d’Aquin). Le premier emploi du<br />
mot français milieu en ce sens attesté par Littré est tiré de Satire,<br />
X, de Régnier : « Ce milieu, des vieux tant rebattu (!), Où l’on mit<br />
par dépit à l’abri la vertu ». La même idée est contenue pour l’essentiel<br />
dans l’exemple qu’il prend à Corneille (quoiqu’il choisisse<br />
de le séparer du milieu* de Régnier) : « Et nous verrons après s’il<br />
n’est point de milieu entre le charmant et l’utile » 41 .<br />
Dans tous ces exemples où il est question du « juste milieu », il<br />
s’agit d’un terme appartenant aux moralistes. Mais sous la connotation<br />
particulière ne s’en trouve pas moins une référence géométrique<br />
essentielle : le point central déterminé par deux extrêmes.<br />
Et c’est dans cette acception géométrique qu’on le trouve dans le<br />
célèbre fragment de Pascal définissant la position de l’homme<br />
entre les deux abîmes extrêmes de « l’infiniment grand » et de<br />
« l’infiniment petit » 42 .<br />
41 On peut noter la persistance, des siècles plus tard, de ce « juste<br />
milieu » moral quand Edmond de Goncourt écrit (Journal, IX, 64) :<br />
« l’aspect un peu sévère de la femme, le sérieux de sa physionomie, le<br />
milieu de gravité mélancolique dans lequel elle se tenait…»<br />
42 Exposant sa théorie des monades, Leibniz développe cette idée de<br />
l’infiniment petit et de l’infiniment grand (« Considérations sur les Principes<br />
de Vie et sur les Natures Plastiques » [1702-16]) :<br />
Il est raisonnable aussi, qu’il y ait des substances capables de perception<br />
au dessous de nous, comme il y en a au dessus ; et que nostre Ame,<br />
bien loin d’estre la derniere de toutes, se trouve dans un milieu dont on<br />
puisse descendre et monter.<br />
La même pensée avait été exprimée avant Pascal par le Français<br />
Charles de Bovelles, cf. Dietrich Mahnke, Unendliche Sphäre, p.109;et
LEO SPITZER<br />
407<br />
Bornés en tout genre, cet état qui tient le milieu entre deux<br />
extrêmes se trouve en toutes nos puissances (Pensées, II, 72, édition<br />
Brunschvicg).<br />
…rien ne peut fixer le fini entre les deux infinis, qui l’enferment<br />
et le fuient. Cela étant bien compris, je crois qu’on se tiendra<br />
en repos, chacun dans l’état où la nature l’a placé. Ce milieu<br />
qui nous est échu en partage étant toujours distant des extrêmes,<br />
qu’importe qu’un homme ait un peu plus d’intelligence des<br />
choses (ibid.).<br />
Ainsi ce mot ne suggère plus du tout une relation à désirer : le<br />
milieu* de Pascal, ce lieu déterminé selon les deux pôles de l’absolu,<br />
est un lieu dans lequel l’homme fini est « condamné », et<br />
duquel il ne pourra jamais s’échapper — il ne peut que se résigner,<br />
ce roseau pensant*! 43<br />
Cependant, même si le mot milieu* recouvre essentiellement<br />
une notion géométrique, il n’est pas une pure abstraction ; dans<br />
la conception de l’humana natura en tant que creatura media… ut per<br />
ipsum medium omnia conniventur extrema remonte à Francisco Georgius<br />
Venetus (Zorzi), et à Nicolas de Cuse (ib.).<br />
43 Quelle différence entre cette conception de la position intermédiaire<br />
de l’homme et celle de Dante ! Quand Pascal voit l’homme isolé, exclu<br />
des deux extrêmes (et en même temps terrifié par l’infini qu’il ne peut<br />
connaître : « le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie ! »), le poète<br />
médiéval le voit se réjouissant sereinement d’une position médiane avantageuse<br />
à partir de laquelle il peut être en relation avec les extrêmes :<br />
Si erga homo medium quoddam est corruptibilium et incorruptibilium,<br />
cum omne medium capiat naturam extremorum… (De Mon., III, 16)<br />
(Selon la volonté de Dieu, l’homme a deux objets : l’un temporel,<br />
l’autre spirituel ; c’est pourquoi il doit être gouverné par deux pouvoirs<br />
divins délégués — le Monarque et le Pape). Il y a une allusion à cette<br />
aurea mediocritas qui n’existe pas du tout chez le tragique Pascal. —
408<br />
CONFÉRENCE<br />
l’exemple ci-dessus, il est clair que Pascal pense à un lieu réel<br />
dans lequel vit l’homme. Et plus sa description s’anime, plus<br />
concret devient [le] milieu*:<br />
Voilà notre état véritable : c’est ce qui nous rend incapables de<br />
savoir certainement et d’ignorer absolument. Nous voguons sur un<br />
milieu vaste, toujours incertains et flottants, poussés d’un bout vers<br />
l’autre. Quelque terme où nous pensions nous affermir, il branle et<br />
nous quitte (ibid.).<br />
Dans ce très beau passage où Pascal fait de la poésie sur sa<br />
propre géométrie, une abstraction prend corps, un lieu devient un<br />
vaste océan — l’océan de la vie sur lequel nous voguons 44 . Il est<br />
Peut-être que la conception du genre humain de ce dernier — enfermé<br />
et contrarié entre deux infinis — lui a été suggérée par Montaigne,<br />
dans son portrait de l’homme pris entre les deux abîmes du Passé et de<br />
l’Avenir :<br />
Nous n’avons aulcune communication à l’estre parce que toute<br />
humaine nature est toujours au milieu, entre le naistre et le mourir… et<br />
si, de fortune, vous fichez votre pensee a vouloir prendre son estre, ce<br />
sera ne plus ne moins que qui vouldroit empoigner l’eau… ne pouvant<br />
rien apprehender de subsistant et permanent, parce que tout ou vient<br />
en estre et n’est pas encore du tout, ou commence a mourir avant qu’il<br />
soit né. (Apologie de Raimond Sebond)<br />
Par ailleurs, tout comme chez Pascal le dualisme de la situation<br />
humaine n’existe pas pour Dieu, de même chez Montaigne Dieu est<br />
présenté comme hors du temps, contrairement à l’homme.<br />
44 Dans l’emploi que fait Pascal de notre terme réside un concept géométrique<br />
sous-jacent attesté par Littré, qui inclut cet exemple de milieu<br />
sous le titre (13) « le lieu idéal où se passe la vie des hommes ». Une telle<br />
interprétation empêche cependant de définir la nature de ce lieu qui,<br />
selon la théorie de Pascal, est irrémédiablement fixé entre deux<br />
extrêmes, équivalents à deux infinis. De plus, par cette tentative même,
LEO SPITZER<br />
409<br />
vrai que la poésie adoucit à peine la rigidité de la géométrie euclidienne,<br />
l’homme doit toujours naviguer entre deux infinis sans<br />
jamais atteindre le refuge d’un port. Mais le caractère concret<br />
dont ce terme est capable ne doit pas être négligé : il est la preuve<br />
peut-être de la transparence du lieu* dans le mot milieu* — un<br />
facteur qui pourrait se présenter à nouveau, et dont pourraient<br />
dépendre les derniers stades de l’évolution de milieu* tel que<br />
nous le connaissons aujourd’hui.<br />
Dans cet usage de milieu* (« point ou lieu intermédiaire »), il<br />
n’y a rien qui pourrait expliquer le choix du mot français de<br />
rendre compte de la fonctionnalité du medium newtonien ; et<br />
comme pour milieu* au sens des moralistes, le juste milieu* totale-<br />
il est délicat d’associer une définition de base (le « lieu géométrique ») à la<br />
mention particulière de ce mot. Celui-ci peut difficilement être défini<br />
comme signifiant « un lieu où l’homme passe sa vie » simplement parce<br />
que dans la métaphore pascalienne, un lieu devient l’océan de la vie. —<br />
Le second exemple (une addition de Saint-Simon au Journal de Dangeau)<br />
convient encore moins à cette interprétation, qu’il inclut sous (13) :<br />
Le malheur de la France fut tel que ce grand homme [Louvois] fut employé<br />
dans un milieu qui fit le malheur du royaume pour plus d’un siècle.<br />
Là encore, les deux extrêmes ne sont pas seulement ignorés – ce milieu<br />
de Louvois n’était pas son habitat. Il est plutôt évident que, d’après le<br />
contexte, les deux extrêmes sont Colbert et Louis XIV. Le milieu renvoie<br />
à une situation déterminée en fonction de ces deux personnages<br />
— à la situation que Louvois devait adopter envers Louis XIV, étant<br />
donné que Colbert s’opposait à lui. En termes astronomiques, une telle<br />
relation serait rendue par le mot conjoncture* — et en effet, au début du<br />
même passage, ce même mot est employé pour renvoyer à l’infortunée<br />
situation du Ministre de la guerre :<br />
M. de Louvois étoit le plus grand homme en son genre qui ait paru<br />
depuis plusieurs siècles, mais dont les talents ont été aussi les plus<br />
funestes à la France par les conjonctures où il s’est trouvê.
410<br />
CONFÉRENCE<br />
ment non-scientifique est plus éloigné encore, si faire se peut, du<br />
sens du medium newtonien. Pourtant, c’est justement cet emploi<br />
moraliste de milieu*, en un sens, qui peut éclairer sa dernière évolution<br />
: le lien entre le mot latin et le mot français que les humanistes<br />
avaient établi (s’il n’y en a qu’un) ne pouvait être défait :<br />
une équivalence medium = milieu* était devenue possible, qui allait<br />
être exploitée dans quelque champ de recherche qu’on voulût 45 .Il<br />
se trouve que ce champ de recherche fut la science.<br />
45 À vrai dire, le mot français dont l’évolution fut telle qu’il put fournir<br />
l’équivalent le plus proche du Medium de Newton fut (le) moyen. Ce terme,<br />
à l’origine adjectival (medianus) possédait depuis le début, et contrairement<br />
à milieu, une idée exclusivement « intermédiaire » dans la mesure où<br />
l’on pouvait le distinguer de l’idée de milieu que proposait medius : en<br />
latin post-classique, medianus mons (= « la montagne au milieu ») pouvait<br />
servir à distinguer, par différence, medius mons (= « le milieu de la montagne<br />
»). Pour une étude d’expressions telles que medius [summus, inferior,<br />
etc.] mons, cf. Sommer, Zum attributiven Adjektivum, Münchner Sitzungsberichte,<br />
1938. L’idée « intermédiaire » de medianus s’est prolongée en ancien<br />
français avec moyen, et la forme substantivée évolua progressivement vers<br />
une interprétation fonctionnelle : « moyen », « véhicule » (moyen de communication*).<br />
Que ce mot ait été négligé, et que milieu ait été préféré semblerait<br />
suggérer que la correspondance, établie de longue date arbitrairement<br />
entre le latin medium et le français milieu, restait présente à l’esprit<br />
des savants. — Cependant, une autre raison a très bien pu travailler<br />
contre le choix de moyen, c’est sa trop franche connotation fonctionnelle.<br />
Une telle connotation en effet, toujours latente chez Newton, avait été<br />
réduite au point que medium pouvait être régulièrement traduit par « élément<br />
» ; pour la même traduction moyen, avec sa tonalité exclusivement<br />
fonctionnelle, pouvait sans doute difficilement servir. — Quant aux mots<br />
français plus tardifs renvoyant à l’idée d’« intermédiaire », intermède fut le<br />
premier à apparaître, et était réservé spécifiquement pour désigner<br />
l’« entracte* », et fut de ce fait mis hors circuit. Les mots intermédiaire,<br />
intermédiat, créés au dix-septième siècle, entrèrent dans la langue beaucoup<br />
trop tard pour défier milieu, lequel possédait l’avantage d’un profond<br />
enracinement ainsi qu’une variété de significations en réserve : le<br />
proverbe « on ne prête qu’aux riches* » se vérifie aussi en linguistique.
LEO SPITZER<br />
Je ne me permettrai pas de déterminer jusqu’à quel point<br />
cette exploitation avait été réalisée avant Mme du Chatelet, mais<br />
on voit clairement à travers l’exemple de La Fontaine qui va<br />
suivre, où le terme de milieu* est employé pour représenter le<br />
concept (antique) de « milieu de perception », que, déjà au<br />
XVII e siècle, ce mot s’était répandu dans le vocabulaire des physiciens<br />
français :<br />
Que j’ai toujours haï les pensers du vulgaire !<br />
Qu’il me semble profane, injuste, et téméraire,<br />
Mettant de faux milieux entre la chose et lui,<br />
Et mesurant par soi ce qu’il voit en autrui ! (Fable XXVI)<br />
Cet exemple permet à la traduction de Mme du Chatelet de<br />
franchir facilement un palier, puisqu’elle montre que milieu* est<br />
accepté comme l’équivalent général du puissant mot-outil de<br />
Newton — medium.<br />
Mais il est intéressant de noter que parmi les quelques mediums<br />
qu’on pouvait distinguer chez Newton, c’est le fade et superficiel<br />
ambient medium qui devait fleurir le plus vigoureusement une fois<br />
transplanté dans le terreau français. Une expression telle que « le<br />
milieu interstellaire » à laquelle Lalande 46 renvoie familièrement fait<br />
à peine partie du langage courant. Et des définitions telles que (n° 7)<br />
« tout ce qui sert à établir une communication » ou (n° 15) « tout<br />
corps, soit solide, soit fluide, qui peut être traversé par un autre<br />
corps, spécialement la lumière » que l’on trouve dans Littré sont<br />
fondées sur des exemples de milieu* du dix-huitième siècle. L’expression<br />
qui devait survivre et s’enraciner si profondément dans la<br />
langue au point de ne cesser de donner de nouveaux fruits est :<br />
« milieu ambiant » = « l’élément qui entoure immédiatement un<br />
46 Vocabulaire de la philosophie,s.v.milieu ; le passage en question constitue<br />
le résumé des observations de MM. Beaulavon, Couturat, LeRoy.<br />
L’expression milieu interstellaire est dite « …assez ancienne ; elle<br />
remonte au moins (!) à l’époque de Newton ».<br />
411
412<br />
CONFÉRENCE<br />
corps donné » 47 . Au cours du dix-huitième siècle, cette expression<br />
(ou le mot milieu* seul) s’est limitée à la terminologie des physiciens ;<br />
47 On trouve aussi, avec la même signification, substance ambiante, corps<br />
ambiant, etc. Selon Michaëlsson la forme substantivée les ambiants<br />
(= « les corps ambiants* ») se trouve chez Leibniz et dans certaines traductions<br />
de Newton. — Cet adjectif technique s’est très vite vulgarisé<br />
au dix-huitième siècle, comme le montre l’expression les maisons<br />
ambiantes attestée par Gohin : cette vulgarisation a été encouragée par<br />
un fossé syntaxique en français : quand en anglais on peut dire simplement<br />
the houses around, en allemand die Häuser rundherum, l’expression<br />
française correspondante — les maisons autour* — a été interdite par le<br />
veto des grammairiens. — Plus tard, on notera une évolution plus<br />
poussée de cet ambiant technique (de même que milieu, son associé<br />
attitré, évolue lui-même en rapport). Mais il convient à présent d’attirer<br />
l’attention sur cet autre ambiant qui ne doit rien à Newton, et même<br />
qui s’était fermement enraciné dans la langue au cours des deux siècles<br />
précédant la traduction de ses œuvres. C’est ambiant tel qu’on le trouve<br />
dans l’expression singulière air ambiant, sur laquelle Michaëlsson luimême<br />
porte son attention. Employée par Paré, elle devait être au premier<br />
chef une expression scientifique. Mais à cause de son large<br />
domaine de référence, parce qu’elle décrivait l’air que chacun respire,<br />
elle ne pouvait rester indéfiniment une expression technique. Ainsi<br />
nous trouvons dans la poésie de Lamartine une référence à « l’air<br />
ambiant et pur ». — Dans le passage de Rousseau qui suit (qui aurait<br />
exercé son élève Émile à posséder « des yeux au bout de ses doigts »<br />
avec lesquels s’orienter dans l’obscurité), on voit avec plus de force<br />
encore la connotation subjective de l’air ambiant :<br />
Êtes-vous enfermé dans un édifice au milieu de la nuit, frappez des<br />
mains ; vous apercevrez, au résonnement du lieu, si l’espace est grand<br />
ou petit, si vous êtes au milieu ou au coin. À demi-pied d’un mur, l’air<br />
moins ambiant et plus réfléchi vous porte une autre sensation au visage.<br />
Si l’on se réfère à la signification originelle d’air ambiant (« l’air qui<br />
entoure toutes choses »), une qualification telle que moins ambiant<br />
serait une absurdité. Ou encore, la connotation étroitement locale de
LEO SPITZER<br />
quant à son évolution au siècle suivant, étudions le résumé donné<br />
par Berthelot, cité par Lalande :<br />
l’ambient newtonien ne pourrait s’appliquer ici : car l’air proche du coin<br />
du mur ne serait pas moins ambiant* mais plus ambiant* ! Il semblerait<br />
que la seule manière d’interpréter cet ambiant de Rousseau fût d’oublier<br />
à la fois Paré et Newton, et de le recevoir comme une épithète évoquant<br />
l’idée d’un espace libre et ouvert : un mot reflétant la réaction<br />
d’un être humain devant ce qu’il conçoit comme « l’air ». Ainsi le Dictionnaire<br />
de l’Académie oublie de prendre acte du statut réel du mot au<br />
dix-huitième et au début du dix-neuvième siècle lorsqu’il recense air<br />
ambiant en tant que « terme de physique » uniquement (dans l’édition<br />
de 1776, restée inchangée lors des éditions de 1778 ou de 1825). Ambiant<br />
était capable de connotation poétique, « aérienne » (une connotation qui<br />
a pu jouer son rôle, plus tard, dans l’évolution d’ambiance). — De même<br />
en italien et en espagnol, l’expression abrégée ambiente (raccourcie à<br />
partir d’aria, aire ambiente) signifiait l’« air » (attesté dans ce sens dans le<br />
dictionnaire historique de l’Académie espagnole de 1692 à nos jours).<br />
La description des tableaux essentiels du Palais Royal de Madrid, écrite<br />
en italien par le peintre de cour Mengs en 1776, contient l’affirmation<br />
selon laquelle Corrège, Velasquez et Rembrandt, tous trois doués dans<br />
« l’artifice de la perspective aérienne », avaient compris la nature transparente<br />
de l’air et étaient par conséquent capables de figurer « cette<br />
ambiance qui distingue les objets même dans l’ombre, et permet de saisir<br />
la distance qui les sépare les uns des autres » (je cite d’après la version<br />
anglaise utilisée par J. López-Rey, Gazette des Beaux-Arts, 1946,<br />
p. 138 : le mot italien traduit par « ambiency » [un mot anglais par<br />
ailleurs inconnu de moi] devait être ambiente). Goya lui-même affirmait<br />
qu’il visait à obtenir « la magie d’une ambiance [ambiency] dans un<br />
tableau » (ibid.). Au cours du dix-huitième siècle, ambiente a été accepté<br />
par les peintres comme terme technique (le dictionnaire historique de<br />
l’Académie espagnole le recense ainsi, mais sans donner d’exemples :<br />
« Pint. Efecto de la perspectiva aérea que presta corporeidad a lo pintado<br />
y finge las distancias »). La conquête de l’air et de l’espace par les<br />
artistes renaissants et baroques avait enfin trouvé un équivalent terminologique<br />
tardif.<br />
413
414<br />
CONFÉRENCE<br />
De la langue des physiciens, ce mot a passé à la langue des biologistes<br />
sous l’influence de Geoffroy Saint-Hilaire dont une des<br />
idées dominantes était de transporter à l’étude des êtres vivants les<br />
procédés et les concepts en usage dans la physique et la chimie. Il<br />
disait d’habitude en ce sens, « milieu ambiant » 47a .<br />
Il s’est introduit ensuite dans le langage des sciences morales<br />
par deux voies indépendantes. Auguste Comte, qui l’avait<br />
emprunté au naturaliste Blainville, en a fait un fréquent usage.Voir<br />
notamment Cours de philosophie positive, leçon XL, 13 et suiv.<br />
« Milieu » y est imprimé d’abord en italiques, et n’est employé<br />
qu’après une explication préalable de l’idée qu’il représente. —<br />
D’autre part, Taine, qui a plus que tout autre vulgarisé ce terme,<br />
l’avait emprunté à l’Avant-propos de la Comédie Humaine de Balzac<br />
(1841) 48 où celui-ci assimile la société à la nature et les variétés indi-<br />
47a Cf. la lettre de George Sand (1835) citée par Baldensperger, Le franc.<br />
mod., VI, 253 : « Tout, dans les choses extérieures (dans le monde<br />
ambiant, comme disait Geoffroy Saint-Hilaire), m’appelait à cette vie ».<br />
48 Des années avant son invention du terme sociologique milieu (une<br />
invention, selon Berthelot, indépendante de celle de Comte), Balzac<br />
emploie le mot en un sens très différent : dans l’extrait de Louis Lambert<br />
(1822) qui suit où il décrit le système psycho-physique de son protagoniste,<br />
milieu est employé pour désigner le siège de l’activité cérébrale :<br />
À des idées nouvelles, des mots nouveaux ou des acceptions de mots<br />
anciens élargies, étendues, mieux définies ; Lambert avait donc choisi,<br />
pour exprimer les bases de son système, quelques mots vulgaires qui<br />
déjà répondaient vaguement à sa pensée. Le mot de VOLONTÉ servait<br />
à nommer le milieu où la pensée fait ses évolutions ; ou, dans une<br />
expression moins abstraite, la masse de force par laquelle l’homme<br />
peut reproduire, en dehors de lui-même, les actions qui composent sa<br />
vie extérieure. La VOLITION, mot dû aux réflexions de Locke, exprimait<br />
l’acte par lequel l’homme use de la volonté. Le mot de PENSÉE,<br />
pour lui le produit quintessentiel de la volonté, désignait aussi le milieu<br />
où naissaient les IDÉES auxquelles elle sert de substance. L’IDÉE,<br />
nom commun à toutes les créations du cerveau, constituait l’acte par<br />
lequel l’homme use de la pensée. Ainsi la volonté, la pensée, étaient les
LEO SPITZER<br />
viduelles de l’homme aux espèces zoologiques, dépendant de leur<br />
« milieu ». Balzac l’avait pris lui-même directement à Étienne Geoffroy<br />
Saint-Hilaire.<br />
D’un rapide coup d’œil, on peut ainsi observer l’évolution de<br />
l’expression de laboratoire milieu (ambiant)* au terme sociologique<br />
complexe de Taine et des autres 49 .<br />
415<br />
deux moyens générateurs ; la volition, l’idée, étaient les deux produits.<br />
La volition lui semblait être l’idée arrivée de son état abstrait à un état<br />
concret, de sa génération fluide à une expression quasi solide, si toutefois<br />
ces mots peuvent formuler des aperçus si difficiles à distinguer.<br />
Selon lui, la Pensée et les idées sont le mouvement et les actes de notre<br />
organisme intérieur, comme les volitions et la volonté constituent ceux<br />
de la vie extérieure.<br />
On doit préciser que ce passage n’est pas vraiment inspiré de l’application<br />
du mot milieu à la biologie qu’en fait Saint-Hilaire. On dirait qu’ici<br />
on a encore affaire à un terme de physique : un écho du medium newtonien<br />
(et du mezzo ove si crea de Léonard). Il faut remarquer qu’il est<br />
assimilé au moyen générateur et à masse de forces. Un recueil d’exemples<br />
du mot milieu tel que l’emploie Balzac est proposé par El. Kredel,<br />
« Hundert französische Schlagwörter », p. 119 — où cependant on ne<br />
retrouve pas la référence à l’extrait sus-cité. — Il ne m’a pas été possible<br />
de trouver le français milieu employé pour fluide nerveux* où sont<br />
supposé baigner les fibres irritables des nerfs, d’après les théories physiologiques<br />
qui avaient cours depuis la découverte de la circulation du<br />
sang par Harvey et Sanctorius (cf. Schkommodau, Der franz. psycholog.<br />
Worschatz der zweiten Hälfte des 18. Jhs., Leipzig, 1933, p. 22) : ce fluide<br />
nerveux était appelé medium en allemand (Herder [1778] : « dass auch<br />
hier bei den Sinnen ein Medium, ein gewisses geistige Band stattfinde » —<br />
cf. l’expression flüssiges Band employée par Goethe à la même époque).<br />
L’idée de √μ|◊¥` — esprits vitaux* fut relancée tardivement dans le<br />
fluide nerveux*.<br />
49 Il est impossible de dire d’après ce passage cité par Lalande si Berthelot<br />
reconnaissait l’ambient medium de Newton dans milieu ambiant.<br />
Si c’était le cas, alors Lalande propose deux théories contradictoires au
416<br />
CONFÉRENCE<br />
Le premier palier noté par Berthelot semble d’abord n’indiquer<br />
aucun changement de sens : milieu ambiant* renvoie toujours<br />
à « l’élément entourant un corps donné » – en termes biologiques,<br />
les media dans lesquels on poursuivait les expériences de culture<br />
microbienne. Mais à présent, cet « élément entourant » est celui<br />
qui entoure non pas une substance inerte, comme en physique,<br />
mais un être vivant ; milieu ambiant représente un élément dans<br />
lequel vit un organisme, lequel dépend de lui pour sa subsistance<br />
50 (un √|ƒ§Ä¤∑μ à une échelle infinitésimale !). C’est pourquoi<br />
sujet de l’origine du milieu moderne sachant que, dans le « résumé » qui<br />
précède son analyse de Berthelot, on est amené à comprendre que ce<br />
mot doit être expliqué en référence à un « milieu interstellaire* ». —<br />
Aujourd’hui, milieu ambiant est complètement abandonné en France :<br />
dans Le Français moderne (1941), Dauzat recense la formule parmi<br />
d’autres expressions « illogiques » de la part de personnes incultes ! Si,<br />
par l’emploi du mot « illogique » Dauzat voulait dire « ce qui est au<br />
milieu ne peut entourer », alors il faudrait admettre que non seulement<br />
milieu ambiant mais milieu lui-même, employé communément pour<br />
désigner l’« environnement », est illogique : de toute évidence, Dauzat<br />
ne s’est pas arrêté à l’analyse de ce mot bien implanté — qui représente<br />
simplement la troisième étape de son évolution sémantique :<br />
« milieu » [middle] — « entre » [between] — « alentour » [surrounding]. —<br />
La signification originale de « milieu » ne subsiste pas seulement dans<br />
le mot abstrait de référence spatiale mais aussi en tant que référence<br />
concrète à un « centre mouvant » utilisé sur les tables de salles à manger<br />
(l’appareil connu en anglais sous le nom de « lazy Susan » [plateau<br />
tournant]). Ce sont ces deux significations totalement divergentes<br />
(« environnement », « table-centre ») que le mot milieu est le plus apte à<br />
rendre pour un Français d’aujourd’hui.<br />
50 Le néologisme biologique milieu (ambiant) n’est pas une idée « nouvelle<br />
» ; le concept d’un milieu biologique existait avant l’invention du<br />
mot. On doit en effet se rappeler l’extrait déjà cité de Paré dans lequel<br />
l’air est le lieu de reproduction des parasites. Brissaud lui-même (cf.<br />
note 20), tout en reléguant ce débat en notes, reconnaît l’anticipation
LEO SPITZER<br />
le passage du mot dans le vocabulaire des biologistes lui donne<br />
un sens nécessairement plus riche 51 .<br />
Le second palier (de la biologie à la sociologie) semble inévitable<br />
quand on étudie la tendance générale de l’époque : un<br />
demi-siècle avant Comte, Cabanis avait proclamé que les barrières<br />
entre la science naturelle et la science sociale étaient tombées, et<br />
un sentiment toujours plus fort de la solidarité de l’homme et de<br />
de Paré sur la bactériologie moderne dans les lignes suivantes, où il<br />
emploie une terminologie du dix-neuvième pour décrire cette théorie<br />
du seizième :<br />
417<br />
on leur (i. e. aux parasites) assignait un milieu d’existence, en quelque<br />
sorte une humeur de culture et un mode de propagation déterminés<br />
d’avance, tantôt l’air, tantôt la terre… Malheureusement le parasite est,<br />
en réalité, un infiniment petit ; sa forme et ses moyens d’action sont<br />
inappréciables à l’œil nu. Force est de s’en prendre à son « milieu ».<br />
Dans le mot de Delacroix (1845, cité par Baudelaire dans L’art romantique,<br />
1868) : « Comme un rêve est placé dans une atmosphère colorée<br />
qui lui est propre, de même une conception, devenue composition, a<br />
besoin d’un milieu coloré qui lui soit particulier », je ne puis dire si l’expression<br />
soulignée renvoie au milieu = « milieu d’existence* » ou = le<br />
« juste milieu* ».<br />
51 Ce glissement vers la biologie peut être retracé au-delà même de<br />
Geoffroy Saint-Hilaire : M. Henry Deku a attiré mon attention sur une<br />
lettre de Leibniz à De Volder (Gerhardt éd., II, 250) dans laquelle il<br />
s’oppose à la théorie de la discrimination des corps matériels selon<br />
leur position dans l’espace, au motif que des concepts aussi abstraits<br />
que « l’espace », la « ligne mathématique », etc., inventés par les philosophes,<br />
n’embrassent pas la nature complète des choses (« scilicet non<br />
nisi incompletas abstractas adhibuere notiones sive mathematicas,<br />
quas cogitatio sustinet sed quas nudas non agnoscit natura »). Dans la<br />
nature réelle, dit Leibniz, deux corps ne sont pas égaux en même<br />
temps (selon le point de vue mathématique) ni similaires (qualitativement)<br />
; il poursuit : « Etiam quae loco differunt, opportet locum suum,<br />
id est ambientia exprimere, atque adeo non tantum loco seu sola extrin-
418<br />
CONFÉRENCE<br />
la nature existait toujours (Histoire* + Nature* = une histoire naturelle*).<br />
En corollaire à ce sentiment, il y avait la croyance que le<br />
physique et le biologique devaient être les bases pour une étude<br />
complète de l’homme. Comte déclare dans sa Leçon XLVI de son<br />
Cours de philosophie positive [1826] intitulée « Physique sociale » que<br />
relativement à la biologie, la profonde subordination philosophique<br />
de la science sociale est tellement incontestable… À toute<br />
époque de l’évolution humaine, un aperçu sociologique direct ne<br />
saurait donc être scientifiquement admis… s’il est contradictoire<br />
aux lois connues de la nature humaine…<br />
Dans la partie à laquelle Berthelot se réfère (Leçon XL : « Sur<br />
l’ensemble de la biologie »), on voit le sociologue Comte parler<br />
seca denominatione distingui ». Ainsi, lorsqu’on la définit seulement en<br />
termes d’extension ou de diminution, la matière ne peut expliquer les différences<br />
entre les phénomènes : on doit y ajouter un autre « principium<br />
variationis distinctionisque » consistant en une altération ou une homogénéité<br />
qualitatives. — Dans une précédente lettre à la même personne<br />
(1702, ib. p. 240), Leibniz s’était déjà expliqué : « in loco esse non est nuda<br />
extrinseca denominatio : imo nulla datur denominatio adeo extrinseca ut<br />
non habeat intrinsecam pro fundamento, quod ipsum quoque mihi est<br />
inter ≤υƒß`» {∫∂`» ». La vue extrinsèque est pour lui la vue officielle, abstraite,<br />
des mathématiciens. La vue intrinsèque voit, dirait-on, le « principium<br />
individuationis » dans la nature particulière des choses — dans ses<br />
éléments biologiques, pour ainsi dire. Il est intéressant de voir combien<br />
Leibniz anticipe sur l’ambiance moderne ; « être en un certain lieu » signifie<br />
pour un corps « exprimer son milieu » ; son individualité est concrètement<br />
déterminée par ce qui l’entoure. À la vérité, ambientia signifie toujours<br />
ici « les choses particulières entourant un objet particulier », mais<br />
l’évolution d’« environnement » vers son sens moderne est latente dans ce<br />
contexte. De plus, l’importance du mot exprimere est primordiale : tout<br />
objet singulier, en tant qu’il est relié au tout, évoque ce tout. Ici, nous<br />
sommes passés de l’âge mathématique ou cartésien de l’abstraite raison<br />
« nue », à l’âge biologique où le concret sera étudié « dans sa chair » —<br />
l’âge qui verra le concret entrer en histoire (Dilthey !) et qui absorbera de<br />
nos jours la physique dans la biologie.
LEO SPITZER<br />
419<br />
comme un biologiste ; et cependant, décrivant l’« organisme », il<br />
est évident qu’il parle également de l’homme. Cette évidence est<br />
particulièrement confirmée dans le passage où il définit le<br />
« milieu » de cet organisme :<br />
Il serait superflu, j’espère, de motiver expressément l’usage fréquent<br />
que je ferai désormais, en biologie, du mot milieu, pour désigner<br />
spécialement, d’une manière nette et rapide, non seulement le fluide<br />
où l’organisme est plongé, mais, en général, l’ensemble total 52 des circonstances<br />
extérieures, d’un genre quelconque, nécessaires à l’existence<br />
de chaque organisme déterminé. Ceux qui auront suffisamment<br />
médité sur le rôle capital que doit remplir, dans toute biologie positive,<br />
l’idée correspondante, ne me reprocheront pas, sans doute, l’introduction<br />
de cette expression nouvelle. Quant à moi, la spontanéité avec<br />
laquelle elle s’est si souvent présentée sous ma plume, malgré ma<br />
52 Le mot français ensemble passa à l’anglais d’abord comme terme technique<br />
dans la peinture. Le dictionnaire d’Oxford cite un passage (1703)<br />
qui définit ce que les peintres appellent « l’accord [agreement] du tout<br />
ensemble ». En ce qui concerne le mot français pris dans ce sens, tous les<br />
passages cités par Littré (qui atteste qu’aucun exemple hors de cet emploi<br />
n’a pu se rencontrer avant le dix-huitième siècle) contiennent une insistance<br />
sur la « tonalité générale » d’une peinture produite par ses détails ;<br />
le mot suggère une harmonie sous-jacente à l’œuvre d’art. L’emprunt de<br />
ce mot français reflète peut-être le besoin d’un terme qui pourrait renvoyer<br />
non seulement au tout (à la totalité) mais au tout en tant que produit<br />
de ses parties : l’agrégation des parties plus leur relation au tout. La<br />
faveur dont a joui le mot ensemble fut à n’en pas douter influencée par la<br />
théorie de Hegel et par celle de Durkheim selon lesquelles le Tout possède<br />
des qualités que n’ont pas les parties qui le constituent. Un tel mot<br />
pouvait évidemment se prêter facilement à de nombreux objets : dans<br />
l’extrait cité plus haut, il réfère au domaine biologico-sociologique. En<br />
anglais, Spencer l’appliqua à la psychologie (1855). Encore une fois, il a pu<br />
devenir trivial, limité à une référence spécifique, comme l’allemand<br />
l’illustre dans son application à une troupe théâtrale ou, en anglais, à un<br />
costume comprenant une robe et un manteau (assortis). En anglais, la<br />
connotation originale et plus abstraite subsiste encore ; en allemand,
420<br />
CONFÉRENCE<br />
constante aversion pour le néologisme systématique, ne me permet<br />
guère de douter que ce terme abstrait ne manquât réellement jusqu’ici<br />
à la science des corps vivants.<br />
Ainsi, le sens de ce mot biologico-sociologique s’étend plus<br />
encore jusqu’à inclure « l’ensemble total des circonstances extérieures,<br />
d’un genre quelconque, nécessaires à l’existence de chaque<br />
organisme déterminé ». Et Balzac, lui aussi, dans son Introduction<br />
(1841) à son œuvre colossale dans laquelle il essaya (comme il le fit<br />
dans plusieurs de ses Physiologies [!]) d’analyser la relation existant<br />
entre l’environnement physique et social et les sujets humains de<br />
son étude 52a , employa le mot milieu* en ce sens plus large.<br />
Mais les différentes étapes de l’évolution de ce mot impliquaient<br />
bien plus qu’une extension de son sens : quand le terme<br />
est employé pour renvoyer à l’environnement d’un être vivant —<br />
elle est représentée, outre le mot français, par l’expression puriste<br />
propre à cette langue de das Gesamt (sur le modèle de das All), créée par<br />
le cercle de Stefan George. On peut comparer à das Gesamt l’italien<br />
l’insieme qui, de même, semble représenter une abstraction moderne<br />
d’un vieux terme, employé pour rendre le français ensemble ; cf. le commentaire<br />
de Mussafia des vers du Décameron (III a gior., introd.):<br />
parendo loro …di maravigliosa bellezza tutto insieme, più intentamente<br />
le parti di quello (un palais) cominciarono a guardare.<br />
D’après l’éditeur : « Oggi si direbbe pessimamente (!) nell’insieme o nel<br />
suo insieme ».<br />
52a E. Auerbach, dans son ouvrage Mimesis (1946), p. 420, a judicieusement<br />
commenté cette introduction, et ce passage significatif dans Le<br />
Père Goriot : « Toute sa personne [Mme Vauquer] explique la pension<br />
comme la pension implique sa personne… L’embonpoint blafard de<br />
cette petite femme est le produit de cette vie, comme le typhus est la<br />
conséquence des exhalaisons d’un hôpital » — un passage qui devrait<br />
être rapproché de la fameuse phrase de Taine : « Le vice et la vertu sont<br />
des produits comme le vitriol et le sucre ».
LEO SPITZER<br />
qu’il soit homme ou bête — c’est pour donner nécessairement<br />
une importance à l’influence déterminante et efficace du milieu*,<br />
car celui-ci est indispensable à la vie de l’organisme. Même pour<br />
Comte, la relation entre l’organisme et son milieu* est vue comme<br />
bienfaisante. Ce qui détermine la vie est une protection, s’unissant<br />
avec ce qu’elle enveloppe. Comte parle souvent de l’harmonie<br />
existant entre les deux (faisant ainsi écho à la « sympathie »<br />
des Anciens) : « …une telle harmonie entre l’être vivant et le<br />
milieu correspondant… tout ce qui entoure ( !) les corps vivants »<br />
(cf. également pp. 206, 210, 276). On doit cependant remarquer<br />
qu’il parle « de milieu correspondant* », pensant par conséquent à<br />
l’harmonie idéale à obtenir. Mais les disciples de Comte sont<br />
moins intéressés par le « milieu correspondant* », de même que<br />
toute idée d’harmonie entre les deux tend à disparaître. Le milieu<br />
tout-puissant est indifférent à l’homme, lequel est son produit<br />
fini, sa créature. Selon Taine, l’état moral* d’un peuple est soumis<br />
à la mécanique (« Il n’y a ici comme partout qu’un problème de<br />
mécanique ») 53 . Il était incapable de voir dans la nature autre<br />
53 Introduction à Histoire de la littérature anglaise (1863). Taine dit<br />
ensuite que, tout comme une rivière qui prend sa source au sommet<br />
d’une colline écoulera progressivement son eau jusqu’à ce que la totalité<br />
du sol de la plaine en soit pénétré, de même la disposition mentale<br />
d’un peuple se répand à tous les aspects de sa civilisation. — En relation<br />
avec ces deux affirmations, j’aimerais citer un passage antérieur<br />
dans lequel Taine développe son thème de race, de milieu et de moment<br />
comme des facteurs déterminants pour l’homme :<br />
421<br />
Lorsqu’on a ainsi constaté la structure intérieure d’une race, il faut<br />
considérer le milieu dans lequel elle vit. Car l’homme n’est pas seul<br />
dans le monde ; la nature l’enveloppe et les autres hommes<br />
l’entourent ; sur le pli primitif et permanent viennent s’étaler les plis<br />
accidentels et secondaires, et les circonstances physiques ou sociales<br />
dérangent ou complètent le naturel qui leur est livré. Tantôt le climat a<br />
fait son effet. … — Tantôt les circonstances politiques ont travaillé. …
422<br />
CONFÉRENCE<br />
chose que des forces déterminant la vie humaine : pour lui,<br />
comme l’écrit Brunetière, un paysage n’est pas un paysage… mais<br />
un “ milieu” — un empiètement étrangement anthropomorphique<br />
— Que l’on regarde autour de soi les instincts régulateurs et les facultés<br />
implantées dans une race … on y découvrira le plus souvent<br />
l’œuvre de quelqu’une de ces situations prolongées, de ces circonstances<br />
enveloppantes, de ces persistantes et gigantesques pressions<br />
exercées sur un amas d’hommes… lorsque nous avons considéré la<br />
race, le milieu, le moment, c’est à dire le ressort du dedans, la pression<br />
du dehors et l’impulsion déjà acquise, nous avons épuisé… toutes les<br />
causes possibles du mouvement.<br />
À quel emprunt inconsidéré aux sciences naturelles Taine a recours dans<br />
son débat sur les sciences sociales et morales ! La nature les enveloppe*, les<br />
circonstances enveloppantes* (échos d’ambiens et de √|ƒ§Ä¤∑μ !) sont fondées<br />
sur des expressions biologiques antérieures et sont elles-mêmes,<br />
avec Taine, fondues dans des références à la géologie (le pli permanent* —<br />
les plis accidentels*). De nouveau, le moment réunit la vitesse acquise<br />
[momentum], l’élan des physiciens avec l’idée du « moment » : « l’impulsion<br />
déjà acquise* » (ailleurs on trouve « …outre l’impulsion permanente<br />
et le milieu donné, il y a la vitesse acquise »). Si l’on ajoute à cela le<br />
recours mentionné plus haut à la mécanique et à l’érosion des sols, on<br />
obtient un extraordinaire fatras de métaphores et d’analogies, dont<br />
aucune à part soi ne convient, et dont l’accumulation tend précisément à<br />
contrecarrer cette vigueur et cette force que le grand Positiviste désirait<br />
si ardemment introduire dans son traitement de la théorie sociale. —<br />
Dans un article au sujet des trois fameux facteurs de Taine, M. Winthrop<br />
H. Rice (Romanic Review, XXX, 273) a cherché à démontrer que le<br />
moment* devrait être éliminé en tant que partie constituante du système<br />
tainien dans la mesure où il est lui-même le produit des deux autres.<br />
Dans sa démonstration, il renvoie aux hésitations de Taine et de ses commentateurs<br />
pour ce qui concerne la relation exacte à l’œuvre entre les<br />
trois facteurs. — Affirmer, comme le fait M. Rice, que le moment* est le<br />
produit de la race et du milieu, comme l’eau est le produit de l’hydrogène<br />
et de l’oxygène (c’est son analogie chimique), revient à trahir un manque<br />
de sens historique et à mettre Taine à l’écart de l’application de la
LEO SPITZER<br />
423<br />
de la mécanique sur la nature alors même que celle-ci avait fourni<br />
toutes ses lois à celle-là ! On ne s’étonnera pas, alors, que les<br />
romanciers* se soient intéressés à l’analyse mécanique de<br />
science naturelle à la science sociale. Les « hésitations » de Taine, à savoir<br />
son emploi élastique de termes qui empêchent une interprétation<br />
« mutuellement exclusive », représentent plutôt une felix culpa : ce positiviste<br />
avait au moins un grand sens de l’histoire pour savoir qu’on ne<br />
pouvait le réduire à un nombre donné d’éléments séparés de l’absolutisme<br />
de la chimie. Et c’est sans doute sans remords pour sa très généreuse<br />
adhésion au parallèle entre la science naturelle et la science sociale<br />
que Taine introduisit l’élément temporel avec ceux de race et de milieu,<br />
sauvant de ce fait quelque chose des droits de l’histoire. Le moment* n’est<br />
pas superflu dans le système de Taine, mais représente la reconnaissance<br />
de la nécessité de prendre en considération l’impondérable. — Ce fut<br />
cependant une reconnaissance partielle, et ni l’introduction de ce terme<br />
ni ses « hésitations » salutaires ne suffisaient à compenser son adhésion<br />
encore trop rigide à des parallèles naturalistes — dont l’erreur fondamentale<br />
est clairement exposée par Hermann Gmelin, « Französische<br />
Geistesform in Sainte-Beuve, Renan und Taine » (1934), p. 75 :<br />
Am schwierigsten endlich gestaltet sich die Zusammendrängung der<br />
unendlich abgewandelten biographisch-biologischen Entwicklungszustände<br />
in den einen Knoten des Moments. Sainte-Beuve hatte hier<br />
biologisch empfindend an bestimmte glückliche oder unglückliche<br />
Wachstumsstadien gedacht, Taine mechanisch-physikalisch an die<br />
Kräfte-zusammenwirkung der Rasse- und Milieukomponenten, deren<br />
Produkt « Moment » dann selbst wieder als Kausalitätskomponente<br />
aufgefasst werden kann.<br />
Gerade bei der Betrachtung dieses Momentbegriffs erhebt sich am<br />
dringendsten die Frage, ob die drei berühmten methodischen Grundbegriffe<br />
als gestaltende kräfte oder als methodische Gesichtspunkte zu<br />
betrachten sind, ob sie Triebfedern eines Mechanismus oder Hilfsmittel<br />
der Zergliederung und Darstellung sein sollen. Taine selbst hat auf<br />
diese Frage verschiedene Antworten gegeben und sich von einer<br />
mathematisch-mechanischen Auffassung zu eine vorsichtigeren biomechanischen<br />
« gewandelt ».
424<br />
CONFÉRENCE<br />
l’homme ; Zola, à partir de Taine, se proposa pour tâche d’exposer<br />
dans son roman expérimental « les rouages des manifestations<br />
intellectuelles et sensuelles, telles que la physiologie nous les<br />
On aurait pu s’attendre à ce que la théorie de Taine fût anticipée par<br />
un penseur tel que Machiavel étant donné que pour ce dernier les<br />
« états » sont comparables à des produits de la nature :<br />
Come tutte l’altre cose della natura che nascono e crescono presto …<br />
non possono avere le barbe e correspondenzie loro in modo, che il<br />
primo tempo avverso non le spenga.<br />
Mais l’Italien était davantage préoccupé par le problème de l’étiologie<br />
des choses (le cagioni delle cose), et convaincu que, les conditions<br />
humaines étant partout les mêmes, l’histoire devait donc se répéter.<br />
C’est pourquoi en vertu de ce courant de pensée causal, il ne pouvait<br />
envisager le contraste qui existait entre l’ensemble des conditions physiques<br />
et mentales que l’histoire avait entraîné, et le phénomène isolé ;<br />
Luigi Russo (Ritratti e disegni storici, p. 80) discute le point de vue<br />
moderne (opposé au point de vue machiavélien) :<br />
Noi moderni veniamo abbandonando questo rapporto di causalità e le<br />
cause, nel loro valore causale esterno, spariscono per cedere alla logica<br />
interna che nasce e si sviluppa nell’intimo delle cose stesse e degli<br />
avvenimenti.<br />
D’un autre côté Machiavel (comme Guicciardini) acceptait l’existence<br />
des forces occultes de la nature, forces distinctes [unfused] de celles qui<br />
travaillent au cœur des choses elles-mêmes ; il croyait que les esprits<br />
flottaient dans l’air, influençant la forme des choses à venir (grâce à<br />
« …quella virtù superiore che muove tutto » — Guicciardini, Ricordi<br />
politici e civili n° 211) ; il n’avait pas encore atteint la conception de Descartes<br />
selon laquelle une union entre des influences aériennes et les<br />
forces à l’œuvre dans l’homme était accomplie — par la matière subtile*.<br />
— Vico, le père italien de la Geisteswissenschaft moderne, pouvait encore<br />
moins envisager la conception de Taine : pour lui, la « nature » est identique<br />
à l’« histoire » (natura–nascimento) — la nature est historicisée
LEO SPITZER<br />
425<br />
expliquera, sous 54 les influences de l’hérédité et des circonstances<br />
ambiantes 55 … puis montrer l’homme vivant dans 54 le milieu<br />
social… » Et en effet, on peut envisager l’homme comme la victime<br />
[historized] ; ou bien, selon les mots d’Auerbach dans son article sur<br />
natura chez Vico (Arch. rom., XXI, 177) :<br />
Die Natur der Dinge ist nichts für sich selbst ; sie ist identisch mit der<br />
jeweiligen geschichtlichen Lage, aus der die Dinge entstehen.<br />
Vico, le fanatique de la « nature historicisée » [historicized], s’oppose aux<br />
deux historiens naruralistes, Taine et Machiavel.<br />
54 Les locutions adverbiales de ce type, introduites par sous*, dans*, etc.,<br />
offrent des exemples de ce que j’ai appelé « inszenierende Adverbialbestimmungen<br />
» (Stilstudien, I, 7). De telles expressions servent de<br />
déterminants au « milieu » et, apparaissant avec les naturalistes comme<br />
Zola, Huysmans, etc., révèlent l’influence d’une Weltanschauung sur le<br />
style. Taine lui-même, passé romancier, employa le même appareil stylistique<br />
dans son Thomas Graindorge :<br />
Un juge : il s’est desséché dans une salle trop chaude, sous le bavardage<br />
des avocats, parmi les physionomies basses et inquiètes, dans les mauvaises<br />
exhalaisons, parmi les odeurs douteuses.<br />
Ce passage met très nettement en évidence l’activité du « milieu »<br />
comme déterminant de l’individu.<br />
55 Ambiant, qu’on retrouve dans cette expression de Zola et dans d’autres<br />
similaires (système ambiant, nature ambiante, circonstances ambiantes de<br />
Comte, Leçon XL, pp. 201-202), représente très probablement la continuation<br />
de l’épithète technique qui auparavant accompagnait milieu (medium<br />
ambiens). Bien que cet adjectif soit devenu rare en association avec milieu<br />
une fois que ce nom eut recouvert une dimension sociologique (cf. cependant<br />
le milieu ambiant physiologico-sociologique de Claude Bernard ciaprès),<br />
il semble raisonnable de supposer que leur longue association ait<br />
rendu possible la suggestion de milieu dans sa nouvelle acception par<br />
ambiant : en effet, il ne serait pas malencontreux de traduire les circonstances<br />
ambiantes* par « les circonstances du milieu* ».
426<br />
CONFÉRENCE<br />
de son environnement, en tant que ce qui détermine et modifie la<br />
vie devient l’ennemi de l’individu vivant. Déjà, dans les romans<br />
d’un contemporain de Comte, Balzac, on rencontre beaucoup de<br />
victimes de ce genre 56 .<br />
Mais l’importance du déterminisme si fortement présente<br />
dans le mot scientifique milieu* (car cela reste un terme scientifique,<br />
quoique employé par le biologiste-sociologue Comte, ou<br />
56 L’usage étendu du mot anglais mentality et de ses descendants mentalité<br />
et Mentalität est dû probablement au désir du dix-neuvième siècle<br />
de donner une base ferme et scientifique à l’étude de l’esprit humain :<br />
mentality est une « disposition de l’esprit » qui est elle-même non-créatrice<br />
mais le produit d’influences. Il est significatif que ce mot anglais,<br />
inventé au dix-septième siècle et signifiant originellement « le fait<br />
d’être intellectuel » (cf. personnalité [personality] — « le fait d’être une<br />
personne »), en vint à acquérir une connotation fataliste dans les<br />
langues européennes qui l’empruntèrent comme un terme de psychologie<br />
(un emprunt dont Emerson fut largement responsable : cf.<br />
“ Hudibras has the same hard mentality ” — 1865). Mentality est inévitablement<br />
relié à un pays, une situation sociale, une profession, etc., particuliers<br />
; sa restriction au « type » lui donna une connotation péjorative.<br />
Selon Dauzat (Dictionnaire étymologique) Edmond Scherer († 1880)<br />
fulmina contre ce néologisme en France ; et André Thérive (Querelles de<br />
langage I [1929] pp. 168-169) raconte l’anecdote suivante qui révèle la<br />
nuance de défaitisme contenue dans le mot mentalité (en particulier<br />
lorsqu’il est associé au a-t-on* et à résigné* : on a une certaine mentalité,<br />
par destin) :<br />
La dernière après-midi qu’il vécut, (31 juillet 1914), Jaurès rencontra à la<br />
buvette de la Chambre M. Bonnefous qui lui dit :<br />
— Quelle mentalité a-t-on dans les milieux ouvriers ?<br />
On est résigné, répondit Jaurès avec émotion.<br />
Mais il se ressaisit et ajouta : « Pourquoi employez-vous ce mot mentalité<br />
?»<br />
C’est un mot mal fait, obscur, qui ne peut pas signifier ce qu’on entend<br />
lui faire dire dans le langage courant, où il a pris une place qu’il tient<br />
mal et ne mérite pas.
LEO SPITZER<br />
427<br />
par le romancier Balzac) a sa part de responsabilité dans une<br />
autre évolution de son emploi : l’idée d’un « milieu influent »<br />
[conditioning medium] finit par prévaloir sur l’idée spatiale — « ce<br />
Thérive affirme que ce mot « pédant » signifie simplement « état d’esprit,<br />
humeur, caractère, tour d’esprit, nature » et qu’il n’ajoute rien à<br />
ces termes ; j’objecterai cependant qu’il ajoute précisément la connotation<br />
de fatalisme. Dauzat prétend que le mot devint plutôt banal en<br />
France après la Première guerre mondiale, mais Proust témoigne des<br />
premiers commencements de son épanouissement au moment de l’affaire<br />
Dreyfus ; son duc de Guermantes, enclin à introduire tous les<br />
néologismes dans son discours parce qu’ils rendent un son progressiste,<br />
dit :<br />
Ah ! mentalité ! j’en prends note, je le resservirai… Mentalité me plaît !<br />
Il y a comme cela des mots nouveaux qu’on lance, mais ils ne durent<br />
pas…<br />
Cette prophétie cependant ne s’est pas accomplie ; pour l’année 1909, on<br />
trouve des phrases attestées telles que Cl. de Hohenlohe avait une mentalité<br />
de souverain* (Bebernitz, Neubildungen u. Neuerscheinungen der frz. Spr.);en<br />
1905, un pamphlet était publié par Émile Durkheim sous le titre « “ L’Allemagne<br />
au-dessus de tout ”, la mentalité allemande et la guerre ». On peut<br />
également voir la persistance de la nuance fataliste de mentalité dans l’emploi<br />
par Lévy-Bruhl de l’expression mentalité primitive en référence à ces<br />
tendances et ces habitudes qui dominent et déterminent l’esprit primitif<br />
(« …actives au plus profond de nous-mêmes, rebelles à l’analyse, irréductibles<br />
à la pensée claire », Nouv. Rev. Fr., XLI, 352). — En allemand, Mentalität,<br />
emprunté à son tour au français, est attesté pour la première fois<br />
dans les œuvres de H. S. Chamberlain, l’Anglais devenu Allemand, à qui<br />
l’on peut peut-être attribuer son emploi étendu et postérieur (« das Denken<br />
und Empfinden des Franzosen, das, was er mit einem schlechten,<br />
dem amerikanischen ( !) English entnommenen Wort la mentalité nennt » ;<br />
cf. Schulz-Baseler, Fremdwörterbuch). Les accents pessimistes du terme, en<br />
particulier quand il est appliqué à un certain groupe pour désigner celui<br />
qui est étranger aux autres, se reflètent dans des passages comme le<br />
suivant, extrait de von Bülow (1917) : « …vermag sich schwer in die
428<br />
CONFÉRENCE<br />
qui entoure », de sorte que Claude Bernard put créer un milieu<br />
intérieur* (organique*, interne*, intime*) 57 , qu’il introduisit en<br />
contrepoint au « milieu* » environnant qu’il prenait soin de nom-<br />
M. anderer hineinzudenken. Diese Schwierigkeit, die Denkweise der<br />
andern zu verstehen… », ou extrait de Lewinsohn (1925) : « die Mentalität<br />
der Inflationszeit, an der die deutsche Wirtschaft seit der Stabilisierung<br />
krankt und die sie noch nicht überwunden hat » (cf. également une<br />
expression comme Berufsmentalität, 1926). Les termes des puristes (Geistesrichtung)<br />
qui conservent quelque chose de la connotation féconde de l’allemand<br />
Geist, Geistigkeit illustrent ce fatalisme à un degré bien inférieur.<br />
— En italien, mentalità remonterait également au français. Dans son<br />
Dizionario moderno (1927), Panzini donne cet exemple caractéristique : « La<br />
mentalità dei tedeschi è diversa della nostra ». La mentalité n’est pas un<br />
don des dieux, mais une pomme de discorde ; elle sépare l’humanité au<br />
lieu de la réunir. Cette connotation restrictive peut se deviner dans un<br />
grand nombre de slogans de Mussolini : « Bisogna che gli Italiani a poco a<br />
poco si facciano una mentalità insulare » ; « gli Italiani debbono farsi una<br />
mentalità autarchica » (E. Adami, La lingua di Mussolini, p. 105) ; on peut<br />
noter ici le tour volontaire donné par les fabricants d’autocratie aux<br />
expressions d’origine fataliste — tout comme le fit Barrès avec climat. —<br />
La découverte initiale de mentality en Angleterre fut suivie par la découverte,<br />
en Allemagne, de « l’homme… » (der gothische Mensch, Worringer ;<br />
der ökonomische Mensch, Spranger) : à savoir un homme de type racial,<br />
social, « conditionné » par des facteurs objectifs. Le nom de cet « homme »<br />
remonte en un certain sens à des expressions comme celle de Bacon —<br />
homo faber ; mais tandis que ceci suggère avec optimisme une qualité de<br />
faber caractéristique de l’homme en général, notre moderne homo oeconomicus,<br />
gothicus, etc., provient de la science des zoologistes et des botanistes<br />
qui opèrent par classement selon des espèces et des sous-espèces.<br />
57 L’évolution vers une référence spatiale illustrée par l’expression<br />
milieu intérieur* peut être comparée au développement du mot quintessence*<br />
(= « la cinquième essence »). L’ancienne physique employait ce<br />
terme pour désigner l’air (i. e. le cinquième élément) qui entourait un<br />
objet ; cependant, à cause de la conception alchimiste de l’air représentant<br />
la « part » la plus subtile d’un objet, se développa le sens de « qualité<br />
innée, intime » (l’« essence ») : ce qui à l’origine se trouvait dehors
LEO SPITZER<br />
429<br />
mer le milieu extérieur* (cosmique*, ambiant*). Ces termes sont précisés<br />
dans les passages suivants tirés de son Introduction à l’étude<br />
de la médecine expérimentale (1865), dans lesquels il renvoie à une<br />
de ses théories dont il avait au préalable tracé les contours dans<br />
ses cours de physiologie à l’École de Médecine à Paris (et en particulier<br />
dans son cours d’introduction du 17 décembre 1856) :<br />
Dans l’expérimentation sur les corps bruts, il n’y a à tenir<br />
compte que d’un seul milieu, c’est le milieu cosmique extérieur :<br />
tandis que chez les êtres vivants élevés, il y a au moins deux<br />
milieux à considérer : le milieu extérieur, ou extra-organique, et le<br />
milieu intérieur ou intra-organique (p. 108).<br />
Chez tous les êtres vivants, le milieu intérieur, qui est un véritable<br />
produit de l’organisme, conserve des rapports nécessaires<br />
d’échanges et d’équilibres avec le milieu cosmique extérieur ; mais<br />
à mesure que l’organisme devient plus parfait, le milieu organique<br />
se spécialise et s’isole en quelque sorte de plus en plus du milieu<br />
ambiant (p. 110).<br />
Le milieu intérieur de l’animal à sang chaud se met plus difficilement<br />
en équilibre avec le milieu cosmique extérieur (p. 106).<br />
Les phénomènes extérieurs sont le résultat d’une foule de<br />
propriétés intimes d’éléments organiques dont les manifestations<br />
sont liées aux conditions physicochimiques de milieux internes dans<br />
lesquels ils sont plongés (p. 107) 58 .<br />
est à présent dedans. — Pourtant, l’évolution en question est plus complexe<br />
encore que ne l’est celle du mot quintessence : quand milieu perd<br />
sa référence à l’« extérieur » pour renvoyer à l’« intérieur », ce n’est que<br />
pour retrouver son sens originel : encore une fois, avec Claude Bernard,<br />
ce mot signifie « ce qui est au centre ».<br />
58 En effet, la circulation du sang et de la lymphe engendrée par le<br />
corps dans les plus hauts organismes correspond, pour les cellules de<br />
cet organisme, à ce que l’eau courante est pour les animaux et les<br />
plantes inférieurs : les cellules sont fixées à leur place comme ces organismes<br />
végétaux ou animaux qui se développent dans un habitat fixe.<br />
Et ce courant de vie qui est un milieu extérieur pour les cellules est,<br />
bien entendu, le milieu intérieur des animaux supérieurs — et du plus
430<br />
CONFÉRENCE<br />
Ainsi le déterminisme s’insinue même sous la peau de l’individu.<br />
L’homme est non seulement à la merci du milieu extérieur* dont il est<br />
le produit, mais également du milieu intérieur* 59 que son propre organisme<br />
a produit (toute possibilité d’équilibre et d’harmonie entre les<br />
deux milieux* n’est offerte qu’aux ordres inférieurs de la création) ;<br />
supérieur, l’Homme (le concept d’environnement intérieur devait être<br />
élaboré plus tard par Haldane et Cannon : cf. « The Wisdom of the Body »,<br />
par ce dernier). — La création même du substantif innéité* est une anticipation,<br />
par rapport à la théorie du milieu intérieur de Bernard. L’adjectif<br />
fut longtemps enraciné dans le langage (cf. les idées innées de Descartes),<br />
mais la formation du nom abstrait, pour désigner ce qui est inné en tant<br />
qu’entité fixe, devait attendre le phrénologiste Gall qui l’inventa en 1810<br />
(Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier).<br />
Ainsi la création du terme innéité a non seulement un arrière-plan<br />
physique mais est également le fruit d’une attitude déterministe (la phrénologie<br />
!) devant la capacité en puissance [potential capacity] d’un individu.<br />
— En ce sens, il est intéressant d’examiner le concept oriental<br />
ancien de Karman ; l’érudit sanscrit, le Professeur Dumont de l’Université<br />
John Hopkins, m’a écrit l’analyse suivante :<br />
L’idée du « milieu intérieur » comme facteur déterminant dans le comportement<br />
de l’individu est étrangement semblable à la théorie du Karman dans<br />
la philosophie indienne — en particulier à la théorie Samskara du système<br />
du Yoga de Patañjati (on peut définir les Samskaras comme les impressions<br />
ou les tendances subconscientes de l’individu). Toute action (karman),<br />
chaque sensation, chaque expérience laisse son empreinte dans l’esprit<br />
d’un être, et de telles impressions, accumulées au cours d’une vie, constituent<br />
une agrégation de tendances qui représentent un facteur constant. De<br />
plus, ces tendances sont susceptibles de renaissance dans des existences<br />
ultérieures : après la mort d’un individu, son Karman, constituant la somme<br />
de tous les Samskaras qui sont le produit de ses (bonnes ou mauvaises)<br />
actions, l’accompagne dans sa nouvelle existence où, à leur tour, ils déterminent<br />
jusqu’à un certain point ce que son comportement, bon ou mauvais,<br />
devra être.<br />
59 Le critique catholique Charles Du Bos a récemment employé le<br />
terme inventé par Claude Bernard dans son article « Sur le “ milieu
LEO SPITZER<br />
l’homme doit comprendre qu’il est le résultat déterminé d’une addition.<br />
À présent, milieu* a une connotation tragique, et la vie quotidienne,<br />
avec ses aspirations spirituelles, sa lutte inepte contre les<br />
« taupes » du milieu*, prend un tour tragicomique. (Cf. E. Auerbach et<br />
son étude sur Flaubert dans Mimesis ; quant au terme allemand der<br />
Alltag, Sainte-Beuve éprouva le besoin de trouver un équivalent français,<br />
et inventa le tous-les-jours* par lequel rendre la nuance bovaryenne<br />
de la grisaille écrasante de l’ennui.)<br />
intérieur ” chez Flaubert » (Approximations I, 1923). Il y analyse le<br />
« milieu intérieur » de Flaubert en tant que représentant non pas l’essence<br />
créatrice du romancier mais les éléments passifs, déterministes<br />
de sa nature ; et comme représentant une sorte de côté matériel [earthiness]<br />
inné et de brutalité fatale que seule la volonté du grand artiste<br />
qu’était Flaubert pouvait à la fin surmonter. Du Bos analyse comme<br />
suit le passage extrait de la Correspondance de Flaubert :<br />
431<br />
« Au fond, je suis l’homme des brouillards et c’est à force de patience et<br />
d’étude que je me suis débarrassé de toute la glaire blanchâtre qui<br />
noyait mes muscles. »<br />
On ne saurait mieux décrire le « milieu intérieur » qui dans le cas de<br />
Flaubert est donné : une masse imposante par son seul volume, mais<br />
indifférenciée et comme engourdie, qui laisse voir à l’examen des milliers<br />
de mouvements infinitésimaux dont chacun intéresse l’ensemble<br />
de la masse elle-même : une bête allongée où se surprend en tous sens<br />
le travail aveugle des animalcules qui la composent. Mens agitat molem ;<br />
mais ici c’est la moles seule dont, à l’origine, on constate la présence ; la<br />
mens y est encore toute engluée, toute abîmée. Nulle trace de ces<br />
accents, de ces différences de relief, de ces naissantes directions<br />
de cours d’eau par où le plus souvent le génie promis à la<br />
maîtrise dessine les premiers linéaments de sa carte de géographie<br />
future (p. 160).<br />
Il est significatif que ce soit ce Flaubert terre-à-terre qui soit choisi<br />
comme exemple de « milieu intérieur » typique. (On a pu remarquer<br />
dans cet extrait un mélange de métaphores, à la manière de Taine,<br />
créées à partir de différentes sciences naturelles.)
432<br />
CONFÉRENCE<br />
On peut raisonnablement supposer que ceux qui soutenaient<br />
la « théorie du milieu » trouvaient du plaisir dans leur propre<br />
croyance, qu’ils aimaient en exposer « les rouages » et qu’ils<br />
étaient fiers d’expliquer l’homme comme le produit de facteurs<br />
déterminants. Et beaucoup de ceux qui les lurent accueillirent<br />
peut-être favorablement cet enseignement qui délivrait l’homme<br />
de toute responsabilité. Nietzsche en fit ironiquement la<br />
remarque en 1885 : « La “ théorie du milieu ” est actuellement la<br />
plus satisfaisante : tout a une influence et le résultat est l’homme<br />
lui-même » (cf. également : « die Theorie vom milieu, eine wahre<br />
Neurotiker-Theorie »). Mais il y en avait pour qui elle était tout<br />
oppressante et contre quoi ils se rebellèrent. Peu après la publication<br />
de l’Histoire de la littérature anglaise de Taine où il cherchait à<br />
« expliquer » les artistes eux-mêmes, une manifestation s’est élevée<br />
contre lui — par les artistes eux-mêmes ! Dans le Journal des<br />
frères Goncourt (III, 9) on trouve un déni de l’inévitable triomphe<br />
du milieu* sur l’individu :<br />
Taine proclame que tous les hommes de talent sont des produits<br />
de leur milieu. Nous soutenons le contraire… Gautier vient<br />
à notre appui, et soutient que la cervelle d’un artiste est la même<br />
du temps des Pharaons que maintenant ! Quant aux bourgeois,<br />
qu’il appelle des néants fluides, il se peut que leur cervelle se soit<br />
modifiée…<br />
Cela équivaut difficilement à une complète répudiation de la<br />
« théorie du milieu » étant donné qu’ici, il n’est question que de<br />
« l’homme de talent » seul ; en fait, Gautier semble plutôt désireux<br />
de laisser les masses à leur destin, tant que l’artiste échappe à<br />
l’emprise du milieu*. Il y a cependant moins de snobisme chez les<br />
Goncourt. Ils voyaient évidemment les conséquences que cette<br />
théorie entraînait pour l’humanité en général.<br />
Leur scepticisme [disbelief] devant les dogmes fatalistes de<br />
leur temps peut se retrouver dans l’emploi qu’ils font du mot
LEO SPITZER<br />
433<br />
milieu* lui-même qui, dans les lignes ci-dessous, n’a aucune<br />
connotation fataliste ni matérialiste. Il est employé poétiquement<br />
pour suggérer un climat ou une atmosphère spirituels agréables :<br />
La description matérielle des choses et des lieux n’est point<br />
dans le roman, telle que nous la comprenons, la description pour<br />
la description. Elle est le moyen de transporter le lecteur dans un<br />
certain milieu favorable à l’émotion morale qui doit jaillir de ces<br />
choses et de ces lieux.<br />
Zola lui-même, décrivant la technique des Goncourt, évoque<br />
la force avec laquelle ils pensaient que l’homme appartient à son<br />
milieu :<br />
Ils le [i.e. un homme] voient dans son milieu, dans l’air où il<br />
trempe avec le rire de son visage, le coup de soleil qui le frappe, le<br />
fond 60 … sur lequel il se détache de tout ce qui le circonstancie et<br />
lui sert de cadre. L’art nouveau est là : on n’étudie plus les hommes<br />
comme de simples curiosités… dégagés de la nature ambiante.<br />
60 Il est intéressant de voir que dans ce passage, fond* est employé en<br />
alternance avec milieu car en anglais, et plus particulièrement en<br />
anglais américain, le mot background a plutôt cette connotation de<br />
« milieu ». Le mot anglais, introduit au dix-septième siècle comme<br />
moyen de traduire fond* (quelque peu avant l’allemand Hintergrund),<br />
était à l’origine (tout comme ensemble*, tout-ensemble*) un terme de critique<br />
d’art ou de mise en scène ; aujourd’hui, plutôt démodé dans cet<br />
usage, le mot français décor* tend à le remplacer. Il peut également renvoyer,<br />
en tant que terme artistique, à l’agrégat, au collectif par opposition<br />
au détail. Dans un commentaire que je lus sur une exposition de<br />
peinture à la National Gallery de Washington, le critique écrivait à propos<br />
de certains tableaux remarquables : « Ce sont des pièces dont probablement<br />
l’on se souviendra le mieux et le plus longtemps, sans pour<br />
autant qu’ils fassent de l’ombre à l’arrière-plan [background] contre<br />
lequel ils sont construits. C’est cet « arrière-plan » [background] collectif,<br />
un mot très inapproprié, j’en suis conscient, dont se souviendra le
434<br />
CONFÉRENCE<br />
— il lui appartient, non pas comme un prisonnier appartiendrait<br />
à son geôlier, mais comme un homme à sa maison. Et on retrouve<br />
au bout du compte, dans l’expression résumant le programme des<br />
Goncourt, l’étreinte chaleureuse du √|ƒ§Ä¤∑μ : « l’habitant et la<br />
coquille, l’homme et le milieu ».<br />
C’est en 1891 qu’on rencontre chez Edmond de Goncourt l’expression<br />
l’ambiance des milieux*:<br />
On soutenait que l’homme de l’Occident était une individualité<br />
plus entière, plus détachée, plus en relief sur la nature, moins<br />
,<br />
visiteur, sans doute pas en détail mais comme un splendide panorama<br />
de la peinture ». Ici, background est presque assimilé à « panorama ». —<br />
On peut peut-être expliquer la manière dont ce terme artistique en<br />
vint à exprimer l’idée d’un « arrière-plan culturel » [cultural background]<br />
par l’influence du langage de cette école « narrative » d’historiens français<br />
(Thierry, Michelet), qui aimaient esquisser un arrière-plan (culturel,<br />
historique) pour leurs « tableaux historiques » ; d’où la popularité<br />
de l’expression « arrière-plan historique ». Et à cause de cette insistance<br />
« historique », le mot background employé dans un contexte culturel<br />
est toujours rétrospectif ; « un homme sans éducation » [a man of<br />
no background], « un homme cultivé » [a man of college background], etc.,<br />
est une personne qui donne le sentiment d’avoir (ou de ne pas avoir)<br />
vécu dans un certain « milieu » auparavant. Encore une fois, l’« arrièreplan<br />
» d’un individu lui est bien plus intimement associé que ne le<br />
serait son « milieu » ; cela représente la part du milieu de chacun que<br />
celui-ci a absorbée, qu’il peut transporter — un « milieu extérieur »<br />
devient un « milieu intérieur » (on possède un arrière-plan, on vit dans<br />
un milieu). Pour cette raison, le mot peut presque servir d’équivalent à<br />
« formation » (Webster’s Dictionary, éd. de 1940, l’inclut parmi les différentes<br />
définitions de background). Ce rapprochement est sensible dans<br />
l’expression « un homme cultivé » [a man of college background] (même<br />
si un « milieu » reste suggéré) ; et l’on peut même dire « elle a (ou même<br />
« …est en train d’acquérir ») une formation en statistique [a background<br />
for statistical work] ».
LEO SPITZER<br />
435<br />
mangée par l’ambiance des milieux, par cela même une individualité<br />
plus déteneuse d’une volonté propre que l’homme de<br />
l’Orient 61 .<br />
Cet extrait présente la conception de l’homme occidental<br />
triomphant de son environnement (au moins quand on le compare<br />
à son frère oriental), possédant une volonté et une individualité<br />
d’un relief évident ; sa (relative) indépendance est assurée non<br />
seulement par les séries d’expressions introduites par plus* mais<br />
également dans l’expression « moins mangée par l’ambiance des<br />
milieux ». Et pourtant, dans cette terrible expression, le tableau<br />
que nous voyons (même si son application à l’homme occidental<br />
est refusée) est celui de l’homme mangé par la chose qui l’a<br />
engendré : on voit le « milieu » de Taine à l’œuvre — et de manière<br />
plus vivace que les dogmes des sociologues peuvent le montrer.<br />
Nous n’entendons pas la voix d’un scientifique mais celle d’un<br />
homme qui s’aligne sur l’humanité souffrante — un homme qui<br />
est aussi un artiste ingénieux et un maître de style.<br />
C’est en effet techniquement une manœuvre stylistique qui<br />
est impliquée dans l’expression l’ambiance des milieux*. D’abord, il<br />
est évident qu’il y a eu renversement des rôles en ce qui concerne<br />
le nom et le modificatif : l’adjectif ambiant*, naguère employé<br />
pour modifier milieu*, et plus tard conservé comme épithète évocatrice<br />
de la qualité du « milieu », est devenu à présent l’élément<br />
prédominant. La qualité, l’essence du « milieu » a été réalisée,<br />
faite souveraine ; une situation factuelle a été réduite à son principe<br />
abstrait, par l’affirmation d’une entité : l’ambiance des<br />
milieux* ; une définition a été accomplie. Nommer simplement<br />
une situation malheureuse nous libère en quelque sorte de son<br />
61 Ce passage, tiré de l’ouverture de l’année 1891 dans le Journal,<br />
signale la plus ancienne occurrence du mot ambiance en français,<br />
d’après ce dont témoignent les exemples de Michaëlsson.
436<br />
CONFÉRENCE<br />
oppression ; la formulation d’un principe, même détestable, a partie<br />
liée avec la liberté foncière de la pensée humaine.<br />
Cela aurait pu même être réalisé par la simple substantivation<br />
de l’adjectif : *l’ambiant des milieux 62 . Mais une invention comme<br />
l’ambiant* n’était plus possible au dix-neuvième siècle : le procédé<br />
illustré par des formations comme l’expédient*, l’inconvénient*, etc.<br />
(jadis créés par les thomistes pour correspondre à la substantivation<br />
du participe neutre latin) était tombé en désuétude. Un autre<br />
procédé était nécessaire ; il serait trouvé par Goncourt (ou la personne<br />
qui, selon ce qu’il en rapporte, emploie cette expression)<br />
avec le suffixe -ance. Lequel permit à son substantif nouvellement<br />
créé d’être doté d’une connotation bien plus forte que celle<br />
qu’aurait pu avoir l’ambiant*, étant donné que -ance (dérivé du<br />
participe neutre pluriel substantivé -ant-ia, et d’une formation<br />
particulièrement caractéristique du français [cf. Y. Malkiel, Development<br />
of the Lat. suffixes -antia and -entia, 1945]) a toujours évoqué<br />
la perpétuation d’un état de l’être, même si cet état était le résultat<br />
d’un acte lui-même éphémère : la souvenance* est un éternel<br />
résidu. Remis au goût du jour par les Romantiques qui se plaisaient<br />
à voir l’éternel jusque dans le transitoire 63 , ce suffixe a<br />
gardé sa vigueur grâce aux Symbolistes et aux Impressionnistes<br />
qui les ont suivis ; ainsi Goncourt pouvait créer un mot qui représenterait<br />
non seulement une essence mais une essence en acte [an<br />
essence given form] — une qualité ayant une existence, une substance<br />
et une chair propres. Car la simple interversion du sub-<br />
62 La formulation d’un principe est toujours impliquée lorsqu’un<br />
modificatif d’autrefois prend la fonction d’un substantif abstrait : ému<br />
par le tragique de leur situation à la place de …leur situation tragique. Mais<br />
ceci ne s’applique pas pour des cas tels que des luisants de satin (Daudet),<br />
car des luisants ne renvoie pas à une abstraction, à une qualité —<br />
mais à une activité : « glimmerings of satin ».<br />
63 Cf. l’expression inventée par Chateaubriand : l’unissonance des vagues,<br />
qui semble supposer une sorte d’harmonie pré-établie, une « consonance<br />
», dans les sonorités fortuites [casual sounds] des vagues.
LEO SPITZER<br />
437<br />
stantif et du modificatif peut simplement soulever une sensation<br />
passagère hors du flux des choses, dans sa relative et éphémère<br />
autonomie ; dans l’extrait suivant des Frères Zemmgano d’Edmond<br />
de Goncourt :<br />
Tous les émois anxieux et les frissonnements qui se lèvent des<br />
choses contemporaines, et sous le gris et le sans couleur des apparences,<br />
leur tragique, leur dramatique, leur poignant morne, elle (la<br />
clownerie anglaise) en a fait sa proie pour les resservir au public<br />
dans l’acrobatisme,<br />
une essence, une idée sont formulées (le gris des choses au lieu<br />
des choses qui sont grises), mais c’est l’idée de l’éphémère : le gris<br />
est volatil, c’est une bulle de savon ; extrait des choses, il est libre<br />
de disparaître. De même, l’invention d’un *ambiant des milieux a<br />
besoin de montrer qu’une essence a été remarquée, qu’elle a produit<br />
une sensation sur le moment. Mais dans l’expression qui<br />
nous concerne, le phénomène de l’« ambient », jadis senti, a reçu<br />
substance et éternité — un corps incorruptible 64 .<br />
Une fois créé, ambiance* entama une brillante carrière (retracée<br />
par Michaëlsson) dans le langage littéraire, — c’était un mot<br />
évocateur d’un climat spirituel, d’une atmosphère 65 , émanant d’un<br />
64 On doit noter qu’avec les Goncourt, le suffixe –ance était rare ; en<br />
effet, en bons impressionnistes nerveux, ils cherchaient rarement à<br />
fixer l’éternel et l’immobile, mais plutôt à souligner, pendant un<br />
moment, les éléments générateurs de sensation d’une scène fugitive<br />
(même dans leurs titres on les voit insister sur la sensation d’où ils<br />
tirent une idée : « Idées et sensations » !).<br />
65 Les mots atmosphère et climat, qui peuvent de même renvoyer à une<br />
atmosphère psychique, sont proches d’ambiance. Il est intéressant de<br />
noter que la différence qu’il y a entre les deux au plan naturel existe<br />
également au plan spirituel. L’« atmosphère* » d’un groupe ou d’un<br />
lieu peut être sujette au changement perpétuel, de même que l’atmosphère<br />
qu’on respire ; mais le « climat* », cet ensemble d’éléments
438<br />
CONFÉRENCE<br />
milieu, planant au-dessus de lui — ou même d’une chose (Charles<br />
Bally dit du mot français chef : « [il] m’apparaît enveloppé d’une<br />
ambiance littéraire ») ; c’est un mot de pure poésie, et qui reflète<br />
une fois de plus la connotation chaude et englobante [embracing]<br />
du √|ƒ§Ä¤∑μ. Il serait bon à présent de savoir (ce que Michaëlsson<br />
ne fait pas) comment l’expression amère de Goncourt, inventée<br />
pour définir et exorciser une chose mauvaise, ait pu amener à<br />
l’ambiance* aérienne et brumeuse qu’on connaît aujourd’hui —<br />
un mot offrant non pas une définition mais une fuite dans la poésie<br />
du vague et de l’impondérable : l’antithèse du milieu (ambiant)*<br />
déterministe.<br />
indéfinissables dans quoi l’âme de l’homme va se développer ou s’atrophier<br />
(comme l’a si profondément analysé Maurois récemment) est un<br />
facteur relativement constant. — Le mot atmosphère fut créé par les<br />
physiciens du dix-septième siècle en dehors du matériau lexical classique,<br />
selon l’usage de l’époque. Selon le NED, « le nom fut inventé<br />
pour désigner l’anneau ou l’orbe de vapeur ou d’“ air vaporeux ”, la<br />
partie d’une planète que le corps de celle-ci était censé exhaler —<br />
toutes choses que l’air lui-même ne désignait pas pas ; il fut étendu à la<br />
portion d’air alentour occupé par elle, ou supposément, de quelque<br />
manière, “ au sein de la sphère d’activité ” de la planète (Phillips, 1896),<br />
et finalement, avec le progrès de la science, à l’environnement aériforme<br />
supposé limité de la terre, de tout autre corps planétaire ou stellaire<br />
». — Cet « air environnant » nous rappelle l’aer ambiens. — Le<br />
transfert au domaine spirituel est peut-être dû aux explications naturalistes<br />
contemporaines de l’évolution des particularités mentales,<br />
comme la théorie de l’abbé du Bos selon laquelle le génie dépend<br />
apparemment de « l’air » : cela à son tour est supposé dépendre « …de<br />
la qualité des émanations que l’air enveloppe. Suivant que la terre est<br />
composée, l’air qui l’enserre est différent » — les « émanations » de la<br />
terre, i. e. l’atmosphère de la terre, conditionnent l’évolution mentale<br />
de l’homme (c’est la thèse de Montesquieu) ; en conséquence, il doit<br />
exister différentes atmosphères mentales. — La traduction littérale<br />
de atmo-sphaera en allemand est Dunstkreis ; ce mot est bien connu
LEO SPITZER<br />
439<br />
Il serait intéressant d’imaginer que l’ambiance (des milieux)*,<br />
une fois créé, ait pu briser son lien syntaxique et son association<br />
spirituelle avec le milieu* technique, autorisé par son suffixe à une<br />
existence indépendante, et débarrassé de ses connotations âpres<br />
par le fait qu’il représentait une essence — et une essence est toujours<br />
spirituelle. Ainsi, on peut le considérer comme une<br />
depuis le Faust de Goethe, dans un passage qui décrit l’atmosphère<br />
particulière de la chambre de Gretchen : Méphistophélès, évaluant la<br />
probable influence sur Faust de la sensuelle atmosphère du lit de Gretchen,<br />
crée les vapeurs qui plus tard feront prisonnier le « sinnlichübersinnlicher<br />
Freier » :<br />
Sie (= Gretchen) wird bei einer Nachbarin sein.<br />
Indessen könnt Ihr ganz allein<br />
An aller Hoffnung künftiger Freuden<br />
In ihrem Dunstkreis satt Euch weiden<br />
Sur l’emploi méraphorique de Dunstkreis et de Atmosphäre, cf. Schulz (-<br />
Baseler) (il cite par exemple le Noah de Bodmer : Atmosphär des Stern ;<br />
dans le même ouvrage, on trouve aussi Dunstkreis der Erde, Luftkreis um<br />
den Kometen, et même Dunstmeer, welches die Sonn’aus ihn [la comète]<br />
herauszieht) ; en général, Dunstkreis semble en être arrivé à contenir un<br />
sens plus péjoratif qu’Atmosphäre (bien que, au temps de Herder,<br />
Atmosphäre fût plutôt péjoratif : « [die Muse] hat sich aus der Sphäre des<br />
Lebens in die Atmosphäre der Katheder versezt ») : par exemple der Dunstkreis<br />
der Politik suggère les vapeurs méphitiques des troubles intrigues.<br />
Cependant Atmosphäre ne s’accorde pas avec le mot français ni<br />
anglais ; c’est plutôt Stimmung (ce mot intraduisible) qui comporte<br />
l’évocation et la large référence qu’atmosphère a acquises dans ces<br />
langues. — J’ai lu qu’un café à Caracas, fréquenté par des émigrés allemands,<br />
portait le nom de Café Atmósfera : je me demande si ce nom<br />
n’est pas un pauvre ersatz de Café Stimmung. D’un autre côté, le mot<br />
Atmosphäre était employé dans le monde du cinéma allemand et renvoyait<br />
aux figurants qui assuraient l’arrière-plan historique d’un film<br />
(par ex., A. Polgar, Schwarz auf Weiss, Berlin, 1929 : « Statisterie der
440<br />
CONFÉRENCE<br />
revanche poétique assouvie sur le milieu* des sociologues. Mais<br />
c’est une supposition audacieuse, de manière générale — et supposer<br />
que l’évolution évoquée avait déjà pris place une année<br />
plus tard est peut-être plus audacieux encore ; en 1892, on rapporte<br />
que Daudet aurait dit à Goncourt :<br />
niedersten Rangklasse [welche in der Kinosprache sehr fein “ Atmosphäre<br />
” heisst] » ; Stimmung aurait été dans ce cas trop subjectif). — En<br />
comparant avec le mot climat, on doit se référer à Michaëlsson ainsi<br />
qu’à l’article de Miss Burkart, Arch. rom. XXI, 185, à quoi je voudrais<br />
ajouter l’emploi un peu plus ancien de climate of opinion, dans Vanity of<br />
Dogmatizing (1661) de Joseph Glanvill, p. 227 : « les grandes âmes, celles<br />
qui ont parcouru les divers Climats d’opinion [Climates of opinions],<br />
sont plus prudentes dans leurs résolutions, et plus modérées pour se<br />
décider » — un emploi laissé en sommeil pendant trois siècles jusqu’à<br />
ce que Whitehead le réintroduise de nos jours. De plus, on doit remarquer<br />
un emploi curieux de climat par Thibaudet (un emploi autre que<br />
celui que discute Miss Burkart), qui implique le « conditionnement<br />
géographique » des phénomènes spirituels. — En réalité, dans la préface<br />
à son Histoire de la littérature française posthume (1936), Thibaudet<br />
confère au mot climat une signification temporelle (= « zone temporelle<br />
»), en l’employant comme synonyme du mot empires que Bossuet,<br />
dans son Discours sur l’Histoire universelle, appliquait aux civilisations<br />
sucessives des anciens empires assyriens, perses, gréco-macédoniens et<br />
romains. De même, Thibaudet évoque les quatre grands climats successifs*<br />
(le Moyen Âge, l’Humanisme, le Classicisme et le Romantisme) ; il<br />
existe également les quatre grandes natures (ou ordres) littéraires*, ou les<br />
ensembles* des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième<br />
siècles en France. Avec cet écrivain, on assiste à la tendance à harmoniser<br />
les phénomènes naturels et historiques, une tendance qui s’exprime<br />
elle-même dans l’association par paires de natures*, climats* avec<br />
empires*, ordres* — et qui culmine dans l’ultime phrase de son œuvre<br />
qui contient une tétralogie des époques du développement physique.<br />
D’esprit beaucoup plus géométrique que Spengler, Thibaudet se<br />
délecte des positions homologues des phénomènes et du symbolisme<br />
numérique :
LEO SPITZER<br />
C’est très curieux, moi, les gens, je les juge par le regard, par<br />
l’observation… Vous, c’est par une sorte d’intuition de l’ambiance.<br />
(Les cinq derniers mots sont soulignés.)<br />
441<br />
L’histoire d’une littérature symbolise avec le fait élémentaire d’une<br />
personne : fait tellement élémentaire qu’il pourrait être incorporé à<br />
l’état civil et religieux comme la vie, la naissance, le mariage et la mort.<br />
Le dérivé verbal de climat, s’acclimater*, est attesté pour la première fois<br />
en 1787-88 (en anglais, to acclimate apparaît en 1792, tandis que l’allemand<br />
akklimatisieren et l’espagnol aclimatarse apparaissent dans la<br />
seconde moitié du dix-huitième siècle) ; il signifiait à l’origine « s’habituer<br />
à un certain climat ». Cependant, en même temps que le champ<br />
d’application de climat s’élargissait, le verbe en vint à adopter le sens<br />
élargi « s’adapter aux conditions ». Selon F. Gohin (« Les transformations<br />
de la langue française pendant la deuxième moitié du XVIII e siècle »,<br />
p. 253) le sens figuratif est attesté pour la première fois dans l’œuvre de<br />
Delille, Les Jardins (je n’ai pu retrouver le passage en question). On<br />
trouve chez Gaudy (1839) le même emploi de l’allemand sich akklimatisieren<br />
; comparé à l’usage moderne, j’ai le sentiment que c’est l’authentique<br />
sich einleben allemand, à l’origine employé pour suggérer ce que<br />
l’on appelle aujourd’hui Einfühlung — « empathie » (sich einleben in eine<br />
Zeit, eine Dichtung) qui, dans un emploi moins important, a pris la place<br />
de sich akklimatisieren (par ex. wie haben Sie sich in diesem Milieu eingelebt,<br />
Herr Kollege ?) — ceci formant un parallèle avec l’emploi moins<br />
fréquent d’Umwelt comme traduction du milieu français. (De toute évidence,<br />
ceci ne veut pas dire que l’idée de s’adapter à son environnement<br />
ne pouvait pas être exprimée avant la formulation d’une expression<br />
aussi déterministe que s’acclimater* ; on trouve ainsi dans le<br />
dictionnaire Espagnol-Français d’Oudin [édition de 1675], à l’article<br />
estar hallado [littéralement : « être dans un état de s’être trouvé (soimême)<br />
»] : « quand un Estranger s’apprivoise & s’accomode hors de son<br />
pays » (cet exemple est instructif pour les deux langues). — Enfin, il est<br />
intéressant de noter l’emploi métaphorique d’un autre mot de signification<br />
similaire : température*. A. Grégoire (Mélanges Bally, 1939) a judicieusement<br />
souligné la tendance des financiers à se référer à la hausse
442<br />
CONFÉRENCE<br />
— il semble ici que nous ayons déjà notre mot moderne. Il y a<br />
d’autres explications plus convaincantes que celle que nous avons<br />
essayé de suggérer :<br />
Peut-être que l’ambiance* de l’expression de Goncourt ne<br />
représente pas l’apparition originelle du mot ; on doit remarquer<br />
qu’il n’était pas imprimé en italiques comme l’étaient la plupart<br />
des néologismes, et il est fort probable qu’avant lui fut inventée<br />
une « ambiance aérienne » (fondée sur l’air ambiant* à la place de<br />
et à la baisse de la Bourse en termes de thermomètre et de baromètre :<br />
la température de la Bourse* (un Allemand dirait die Stimmung der Börse ;<br />
Michaëlsson attire l’attention sur l’emploi du mot ambiance également<br />
dans ce contexte).Voilà donc la Bourse dotée des qualités imprévisibles<br />
et capricieuses du temps (ou des personnes : les Français parlent également<br />
des humeurs de la Bourse*). Michaëlsson, dans son analyse de l’ambiance<br />
de la Bourse*, souligne ce facteur mystérieux et imprévisible<br />
attribué à la Bourse, et a arraché à Dauzat, son critique, cette remarque<br />
sarcastique (Le français moderne, XVIII, 188) : « Je ne vois pas les financiers<br />
cherchant à exprimer le mystère et l’indicible ». Un tel commentaire<br />
me semble pourtant trop illustrer l’attitude du Français sans mystère*,<br />
qui ne perçoit pas que derrière la façade* de l’homme d’affaires<br />
terre-à-terre [matter-of-fact] vit un être primitif et superstitieux qui<br />
regarde les fluctuations du marché boursier comme l’homme primitif<br />
lui-même regardait jadis le jeu des éléments, conscient que des forces<br />
occultes et néfastes le transcendent, qu’il ne peut comprendre — mais<br />
qu’il voit à l’œuvre. Pour autant qu’il le sache lui-même, ce que ce<br />
boursicoteur cherche réellement à* faire, c’est jouer le rôle d’une personne<br />
habile, ingénieuse, pragmatique — et c’est ainsi qu’il s’imagine<br />
lui-même ; mais il favorise involontairement la vision d’une imprévisible<br />
et mystérieuse divinité dont on peut observer les humeurs sans<br />
pouvoirs les déterminer. Par conséquent, s’il parle de la température de<br />
la Bourse*, il se pose en météorologiste capable de prévoir les variations<br />
du temps — tout en avouant secrètement son scepticisme quant à la<br />
possibilité de prévoir la météorologie de la Bourse*. (Une conséquence<br />
plus considérable encore est impliquée dans l’expression climat de<br />
la Bourse* : ici, nous ne devons pas simplement composer avec les
LEO SPITZER<br />
443<br />
milieu ambiant* — moins aérien) qui représenterait l’origine d’ambiance*<br />
tel qu’on l’employait généralement — peut-être l’origine<br />
de l’expression de Daudet. Que cela fût possible ne changerait<br />
rien à l’explication de l’expression de Goncourt : l’ambiance des<br />
milieux* ne pouvait pas se fonder sur une ambiance* aussi hypothétique<br />
— tout simplement parce qu’une « ambiance aérienne »<br />
ne dévore pas. Si l’on pose une ambiance* plus ancienne, on peut<br />
seulement supposer que l’ambiance des milieux* représente une<br />
expression individuelle imprévue et sans écho.<br />
fluctuations d’un climat donné, mais avec le changement d’un climat à<br />
un autre : de la zone torride à la zone glaciale.) — On rencontre également<br />
le mot température* dans l’expression température morale*, dans<br />
un sens proche du « climat moral », d’« ambiance » ou de « milieu »<br />
— dans la Philosophie de l’art de Taine, on le trouve en réalité associé à<br />
milieu (on ne doit pas oublier la juxtaposition, en grec, de ≤ƒk«§»<br />
— dont température* est une traduction littérale — avec √|ƒ§Ä¤∑μ)<br />
De même qu’on étudie la température physique pour comprendre l’apparition<br />
de telle ou telle espèce de plantes …de même il faut étudier la<br />
température morale pour comprendre l’apparition de telle espèce d’art<br />
…Les productions de l’esprit humain, comme celles de la nature<br />
vivante, ne s’expliquent que par leur milieu.<br />
Dans le dix-neuvième siècle allemand, j’ai trouvé de fréquentes occurrences<br />
de Temperatur dans un emploi comparable à celui qu’atmosphère*<br />
a acquis : le Ministre de la guerre, von Roon, disait en s’adressant<br />
au Parlement prussien en 1862 :<br />
Ich habe bereits zweimal Gelegenheit gehabt, die angenehme Temperatur,<br />
welche in diesem Hause in Betreff jener grossen Massregel (une<br />
note sur un service auxiliaire) herrschte, zu fühlen…<br />
pendant que Bismarck, à moitié ironique, parlait de la « sehr behagliche<br />
Temperatur der Demokratie » (cf. H. Blümner, « Bismarck’s Sprache »,<br />
p. 172) ; l’effet comique provient peut-être de l’association actuelle
444<br />
CONFÉRENCE<br />
Encore une fois, il est possible que l’expression d’Edmond de<br />
Goncourt représente effectivement la première occurrence du<br />
mot ambiance*, et qu’elle n’ait eu aucune influence sur l’évolution<br />
ultérieure du mot ; c’est peut-être après lui, sinon avant, que l’invention<br />
d’une « ambiance aérienne » devrait être envisagée<br />
comme la véritable origine.<br />
Finalement, l’hypothèse originale pourrait être acceptée —<br />
avec une réserve : ambiance des milieux* peut représenter à la<br />
fois la première apparition et l’origine réelle du moderne<br />
entre « température » et « thermomètre » (et peut-être aussi de l’expression<br />
courante chez les médecins, die Temperatur fühlen). Il se peut que<br />
Bismarck, le Realpolitiker, lui qui avait découvert « das ganze Gewicht<br />
der Imponderabilien, die viel schwerer wiegen als die materiellen<br />
Gewichte », soit tout à fait conscient, avec cet emploi ironique de Temperatur,<br />
de la contradiction qu’impliquait la transformation de l’impondérable<br />
en pondérable. — On peut voir peut-être une autre allusion<br />
métaphorique au temps ou à l’atmosphère dans des expressions,<br />
courantes dans les langues de l’Europe moderne, telles que there is<br />
something in the air, etwas ist in der Luft, quelque chose est dans l’air. Elles<br />
sont généralement employées pour évoquer une idée, une découverte,<br />
un événement dont on ne peut retrouver l’origine — et encore moins<br />
une origine humaine. En effet, on s’en remet d’habitude à l’« air » afin<br />
d’exclure une telle possibilité : pour nier par exemple qu’une personne<br />
ait emprunté les idées d’une autre, on dira « c’était simplement dans<br />
l’air ». J’ignore totalement l’ancienneté de telles expressions, et même<br />
où l’on peut en chercher l’explication exacte. Il est toutefois très possible<br />
qu’à l’origine il y ait une comparaison avec la foudre ou la tempête<br />
(toujours latentes dans l’air, déterminées par les conditions de<br />
l’air) : l’« éclair » d’une idée, la « tempête » d’un mouvement historique.<br />
En allemand, on peut rapprocher ces expressions de celles comme<br />
etwas liegt in der Luft “ eine strömung, ein regen, ein ungewitter ”<br />
(DWb., s.v.Luft, 3 f.);es war ich weiss nicht was, das einem seltsam bang<br />
und schwer macht, in der Luft (Wieland) ; das beste was man lernt, muss in<br />
der Luft der Zeit liegen (Auerbach) : expressions tirées du Deutsches Wb.
LEO SPITZER<br />
445<br />
ambiance* — cependant l’évolution ultérieure du mot fut assurément<br />
influencée par cet « autre » ambiant* dont nous avons<br />
parlé, et qui était un terme si poétique chez Rousseau et<br />
Lamartine. Le mot ambiance* seul, employé hors de son<br />
contexte dans l’extrait de Goncourt, pouvait aisément suggérer<br />
quelque chose de tout à fait autre que ce qu’il avait l’intention<br />
d’évoquer au moment de sa création. — Quoi qu’il en soit,<br />
quatre explications témoignent simplement de l’échec, jusqu’à<br />
présent, pour trouver la bonne — dont la découverte doit être<br />
laissée à l’avenir.<br />
sous le titre « geistige Atmosphäre », et expliquées comme « eine geistige<br />
oder gemütliche strömung oder auch druck ». (Cf. l’air du temps,<br />
note 18.) — Concevoir une analogie entre des conditions atmosphériques<br />
et le mûrissement d’une idée est la preuve d’une conception<br />
irrationnelle du travail de l’esprit. Aujourd’hui, rien de cette analogie<br />
ne subsiste lorsque nous disons avec désinvolture « à cette époque, la<br />
théorie de la relativité était dans l’air » ; avec cette expression stéréotypée<br />
et intellectualisée, nous sommes loin de toute conception « orageuse<br />
» de la vie de l’esprit. Il revint à Herr Hitler, dans son emploi de<br />
in der Luft, d’accomplir un retour à cette connotation « orageuse », en<br />
lui ajoutant une emphase activiste, masquée bien qu’elle fît partie d’un<br />
tour de phrase irrationnaliste, à prétention poétique ; dans mon quotidien<br />
du 26 février 1941 je lis :<br />
Quand Hitler déclara avec un humour sinistre qu’« en ce moment particulièrement<br />
je me sens mieux que jamais » parce que « je sens que le<br />
printemps est dans l’air », il aborde le sujet qui concerne le monde tout<br />
autant qu’un auditoire nazi consciencieux et enthousiaste. Le printemps<br />
est dans l’air, et nous savons tous que dans la météorologie militaire<br />
du Reich, cela signifie que l’heure d’une nouvelle action est bientôt<br />
arrivée.<br />
C’est un homme de cette sorte qui, à partir de l’air, réussit à transformer<br />
la poésie des Frühlingsrauchen en la réalité des orages de mort.
446<br />
CONFÉRENCE<br />
Si ambiance* semble, même aujourd’hui, se cantonner au langage<br />
littéraire, milieu* finit par devenir la propriété du peuple. Un<br />
tel transfert fut facilité par l’existence du type du bourgeois décrit<br />
dans Bouvard et Pécuchet, type qui se complaisait dans l’emploi de<br />
termes abstraits ou scientifiques (cf. l’exemple paradigmatique<br />
donné par Flaubert : « une promenade sera salutaire » à la place<br />
du simple « faisons un tour ») — qui devinrent de ce fait moins<br />
abstraits et seulement pseudo-scientifiques 66 . Ce milieu* populaire<br />
conservait peu de la connotation tainienne ou comtienne du mot ;<br />
ce qui autrefois était un « facteur » dans l’évolution biologique ou<br />
culturelle d’une espèce devint plutôt « un lieu où l’on peut (plus<br />
ou moins confortablement) vivre » ; c’est-à-dire que le lieu*<br />
(« endroit ») éternellement latent était revenu sur le devant de la<br />
scène 67 . Aussi important, toutefois, est l’accent sur le mi de<br />
66 Un exemple intéressant, et extrême, de la vulgarisation de ce mot se<br />
trouve dans son emploi comme référence spécifique au « milieu des prostituées<br />
et des malfrats ». Que milieu soit devenu fréquent dans cette association<br />
particulière (au point que des dictionnaires intitulés L’Argot du<br />
“ Milieu ” soient rédigés par des linguistes — par ex. Lacassagne) est le<br />
signe indubitable que les sociologues, qui donnèrent tant d’importance à<br />
ce mot, étaient eux-mêmes très largement intéressés par l’influence d’environnements<br />
sordides ; c’est le Jukes et Kallikaks qui offre le matériau le<br />
plus vivace à l’étude. D’après le vocabulaire de ces sociologues, milieu a<br />
très bien pu passer dans ce qu’André Thérive a appelé le « parler gendarme*<br />
» ; le sergent de police qui doit faire un rapport a sans aucun<br />
doute entendu des expressions ironiques et compatissantes comme<br />
« dans le milieu des malfaiteurs, des prostituées, tout est permis* » et, pour<br />
montrer sa familiarité avec cette terminologie apprise, fait référence au<br />
« milieu » par excellence*. Plus tard encore, ce mot est absorbé par les habitants<br />
de ce milieu eux-mêmes, pour la plus grande fierté des prostituées<br />
et des malfrats : ils acceptent le mot parce qu’ils ont accepté leur condition<br />
(cf. l’histoire du mot français gueux).<br />
67 On peut objecter que la phonétique populaire qui a transformé la<br />
prononciation de ce mot irait contre la renaissance de la fonction étymologique<br />
de lieu : le groupe phonétique -li- est devenu -y- : miyeu (cf.
LEO SPITZER<br />
447<br />
milieu* : celui-ci reflète une attitude du sujet comme étant « au<br />
cœur de, entouré par » 68 — attitude toujours renaissante chez<br />
l’homme qui aime se sentir protégé par une coquille, attitude qui<br />
également escalier > escayer) ; de plus, milieu a été attaqué par la dissimilation<br />
populaire i-i > e-i qui part du latin vulgaire (vicinus > roman *vecinus)<br />
pour s’étendre jusqu’à la langue moderne (dessiper au lieu de dissiper):le<br />
Petit Dictionnaire du peuple de Desgranges (1821) met en garde contre des<br />
prononciations fautives comme « Meilieu ou Meyeu pour milieu, fautes.<br />
Dites : C’est au mi-lieu, un juste mi-lieu » ; et déjà, dès le dix-septième<br />
siècle, la même forme dissimilée est attestée comme « parisienne » (cf.<br />
G. Gougenheim, « La langue populaire dans le premier quart du<br />
XIX e siècle », p. 7). — Mais si cette évolution phonétique est elle-même la<br />
preuve que lieu n’est plus ressenti comme un élément vivant du milieu<br />
moderne, alors on doit aussi ajouter que, au dix-septième siècle, quand<br />
milieu avait le sens très évident de « partie, lieu médian », personne ne<br />
considérait plus lieu (ni mi) dans le mot ! C’est absurde, évidemment :<br />
quelle que soit sa prononciation, milieu, aujourd’hui comme au dix-septième<br />
siècle, suggère assurément « l’endroit » (et « le cœur » [midst]). On<br />
doit remarquer combien lieu et milieu se rencontrent associés dans un jeu<br />
de mots : « Sa place partout était faite. Il ne modifie nullement sa manière<br />
selon les lieux et les milieux » (Sainte-Beuve, dans son essai sur Taine). Il est<br />
en outre significatif que Faguet, « Politiques et moralistes », III, 265,<br />
résume la théorie de Taine dans l’expression « (un homme) de telle race,<br />
de tel lieu, et de telle date* ». — En fait, je suis convaincu que c’est milieu<br />
qui aide à garder vivant le mot dont il est dérivé ; lieu lui-même a atteint<br />
une étape décadente, employé pour l’essentiel dans un contexte artificiel<br />
guindé ou technique : « le juge d’instruction se rendit sur le lieu du<br />
crime ; la représentation n’aura pas lieu », etc. Ce sont les mots endroits* et<br />
place* qui dans l’usage moderne renvoient à un lieu propre. Le français<br />
place (à l’origine « le lieu occupé » < platea = « rue, plaza ») évoque aujourd’hui<br />
l’idée d’un lieu appartenant à une personne, et endroit, d’après son<br />
étymologie, renvoyait autrefois au « bon endroit ». Ainsi le locus naturalis<br />
repousse le locus à l’arrière-plan.<br />
68 Ce qui était autrefois « au milieu », « un lieu médian », est à présent le<br />
lieu au-milieu-duquel l’on se trouve !
448<br />
CONFÉRENCE<br />
fait qu’il préfère dormir dos au mur, ou avoir les portes de sa<br />
chambre (et même de son bureau) fermées derrière lui. Ainsi, le<br />
mot est non seulement moins technique, mais aussi moins déterminant,<br />
à présent que la « victime » elle-même l’applique à son<br />
propre environnement. Sa signification péjorative [sous-entendue]<br />
a été atténuée et ce qu’il en reste (car il en reste peut-être<br />
toujours quelque chose) est accepté avec philosophie. Le<br />
concierge ronchon qui s’écrie « on peut pas viv’ dans c’miyeu-là »<br />
admet volontiers qu’il ne vit pas dans l’environnement idéal pour<br />
sa personne en particulier — mais alors, « on peut pas choisir son<br />
miyeu ! » Le mot a baissé la garde, mais aucun mouvement populaire<br />
ne voudrait réagir contre cela, comme les littérateurs* ont pu<br />
réagir contre le « milieu » de Taine 69 .<br />
69 La maturation de milieu ne peut cependant pas indiquer l’abandon<br />
de l’attitude déterministe envers l’homme en société ; d’autres mots<br />
s’offrent comme des substituts au moins partiels au « milieu » de Taine<br />
au moment où la lutte sociale se durcit. L’expression cadre social* par<br />
exemple, dans les écrits de C. Bouglé, est employée pour rendre au<br />
mieux la même idée que Durkheim et son milieu social* — bien que,<br />
selon le sociologue français, l’individu ne soit pas « créé » mais seulement<br />
modifié par le cadre social*. Cette expression connote fortement<br />
une volonté d’ordre et de discipline. L’individu, ou son état d’esprit, est<br />
pensé comme un être dominé par un « cadre » social qui lui est imposé<br />
d’en haut ; même la lutte pour l’amélioration de sa propre condition<br />
doit être abandonnée à des forces organisées qui le dépassent. Plus<br />
encore, selon Halbwachs dans ses études sur le suicide (il est également<br />
l’auteur d’un essai sur « Les cadres sociaux de la mémoire »), ce<br />
cadre est nécessaire à l’équilibre psychique de l’individu, lequel est<br />
conduit au suicide en conséquence d’un désencadrement* social, ou<br />
d’une désintégration, d’un vide social* (le vieux vide de la physique<br />
s’applique ici à la sociologie). — Les implications de cette expression<br />
ne peuvent être pleinement comprises que si l’on se rappelle son origine<br />
militaire, glissant de là à la terminologie politique (de la bureaucratie<br />
militaire à la bureaucratie politique !), et si l’on garde à l’esprit<br />
la fonction du cadre* militaire. On dit qu’un bataillon comprend un
LEO SPITZER<br />
449<br />
Il existe une autre connotation dans ce milieu* du concierge<br />
(comme dans celui des Goncourt peut-être) ; ce terme ne désigne<br />
pas seulement un lieu mais un lieu « rempli ». Le milieu d’un individu<br />
(comme le monde que Stevenson présenta à l’enfant) est<br />
« empli d’une quantité de choses ». L’individu se pense comme au<br />
milieu d’un milieu*, entouré d’éléments, de choses familières —<br />
« encadrement » d’officiers, qui peut toujours être remplacé par un<br />
autre de construction identique, si les individus eux-mêmes sont<br />
balayés dans le combat (le terme correspondant en allemand est<br />
« Ersatzbataillon »). De même les cadres sociaux* ne favorisent pas seulement<br />
la discipline mais ont également le pouvoir de persister tels quels<br />
dans l’abstrait, indépendamment des individus. Ils doivent persister<br />
parce que le cadre* en tant que tout, la classe sociale en tant que tout,<br />
doit conquérir — doit soumettre cette colline ou abandonner cette<br />
position selon la stratégie établie par les dirigeants du parti à l’esprit<br />
militaire. — Même le mot climat* en est venu à signifier, chez quelques<br />
auteurs, non plus une essence émanant librement d’un milieu ou d’un<br />
groupe de personnes, mais un facteur pouvant être manipulé, exploité<br />
par ceux qui voudraient exercer une influence sur leurs semblables. Il<br />
suffit de comparer avec une expression comme élevés dans le climat du<br />
régime fasciste* (citée par M lle R. Burkart dans son article sur « climat » in<br />
Archivum Romanum, XXI, 1937). Il y a quelque chose de cela chez Barrès<br />
quand il écrit : « climat de la terre* » ; car bien que le climat moral soit<br />
inhérent à « la terre et les morts* », il est possible pour les forces<br />
conscientes du passé et de ses conséquences de susciter ce climat au<br />
service de leurs propres intentions. (Une telle attitude vient de l’approche<br />
de l’histoire de Taine, que Bourget [Revue des deux mondes,<br />
XLIV, 249] décrit : « …que le problème des milieux à créer et à conserver<br />
devrait être le premier objet du législateur ».) On peut expliquer que<br />
cette altération, due à l’intervention d’un élément volontaire, n’ait pas<br />
eu lieu avec atmosphère* par le fait que l’« atmosphère », naturelle ou<br />
morale, est variable par nature, et ne peut pas être contrainte de la<br />
sorte. De plus, ce mot n’a jamais été pensé comme possédant les qualités<br />
d’efficacité et de conditionnement qui avaient été accordées au<br />
« climat* » pendant deux siècles.
450<br />
CONFÉRENCE<br />
chacune d’elles constituant la qualité finale de son milieu particulier,<br />
et sur chacune d’entre elles il laisse une empreinte de luimême<br />
: elles font partie d’un tout, mais sont également une partie<br />
de lui, et lui une part d’elles 70 . C’est ainsi que partout dans le<br />
« milieu » il y a contact.<br />
70 Ce sentiment est admirablement illustré par les Goncourt dans l’extrait<br />
suivant :<br />
Se trouver en hiver, dans un endroit ami, entre des murs familiers, au<br />
milieu de choses habituées au toucher distrait de vos doigts, sur un fauteuil<br />
fait à votre corps… (Journal, III, 9)<br />
Ce sont des descriptions de décors intérieurs comme celle-ci qui présentent<br />
avec le plus de force l’idée de « milieu » (environnant et « rempli<br />
») ; on a le milieu immédiat de l’individu. On doit se rappeler la<br />
mode des peintures de ce type au siècle précédent — des intérieurs*<br />
décrivant le confort et l’atmosphère douillette des résidences<br />
humaines bien équipées. Et assurément il n’est pas étonnant que les<br />
Goncourt eux-mêmes se plussent à cet aspect de l’art du dix-huitième<br />
siècle. — La coupole métaphysique embrassant le monde [worldembracing<br />
cupola] qui jadis enveloppait l’humanité a disparu, ne reste<br />
qu’un univers infini dans lequel l’homme est perdu. C’est pourquoi il<br />
cherche en premier lieu à remplir de Choses son environnement physique<br />
immédiat. — Il est remarquable que Rilke, avec sa sensibilité<br />
maladive, se sente plus hostile à la surpopulation d’un « milieu » que lié<br />
d’amitié à ce qui le remplit : la Nature elle-même, lorsqu’elle est bondée,<br />
lui rappelle le milieu d’un appartement (lettre de Capri, 6<br />
décembre 1906) : « Garten und Villas sind etwas gedrängt und überfüllt<br />
in der besten Absicht. Aber die ganze Insel… hat so etwas Überfülltes,<br />
teilweise durch die vielen Villen und Hotels, die im Anschluss an das<br />
Städtchen sich breit oder vielmehr eng machen, teilweise auch schon<br />
durch das Auf und Ab des Terrains ; zu viel Berge auf zu engem<br />
Raum… Ein Milieu, an das man sich irgendwie ampassen muss, wie an<br />
eine ein wenig überfüllte Wohnung. » Une île, pour lui, est assassinée<br />
par l’espace, pour ainsi dire, que ce soit Capri ou une île de la Mer du<br />
Nord (Gesamm. Werke, III, 94) : « Nah ist nur Inneres ; alles andre fern. /
LEO SPITZER<br />
Ce « milieu » accueillant, capitonné, nous entraîne très loin du<br />
terme original des physiciens – milieu ambiant*. En ce qui<br />
concerne le terme de milieu* plus général, autrefois employé<br />
comme un équivalent du moyen de transmission de forces attractives<br />
de Newton — ce milieu, comme nous l’avons vu, représentait<br />
un concept qui n’a eu aucune influence dans l’évolution du terme<br />
moderne. En réalité, le mot lui-même (milieu = medium) a pratiquement<br />
disparu du langage des physiciens qui ont adopté le<br />
« champ » de Maxwell. En conséquence, toute trace matérielle<br />
d’un lien ayant autrefois existé (medium ambiens – medium aetherium)<br />
a disparu.<br />
Et pourtant, de manière assez curieuse, on trouve le mot<br />
milieu* employé par Valéry, poète-scientifique (« Essai d’introduction<br />
à la méthode de Léonard de Vinci », Variété I) 71 , dans un débat<br />
sur la physique moderne. Au premier abord, cela pourrait sembler<br />
Und dieses Innere gedrängt und täglich / mit allem überfüllt und ganz<br />
unsäglich. Die Insel ist wie ein zu kleiner Stern, / welchen der Raum<br />
nicht merkt und stumm zerstört/ in seinem unbewussten Furchtbarsein...<br />
» (on remarquera la récurrence de « überfüllt » et de « gedrängt »,<br />
épithètes qui suggèrent un appartement). Et tout ce qui est eng<br />
(« étroit ») évoque pour lui Angst et Bange [Be-ange], deux mots dont il<br />
ne soupçonnait probablement pas le lien étymologique : dans une<br />
lettre de Paris (du 28 septembre 1902), il se plaint de son hôtel d’étudiant<br />
dans le Quartier Latin, de « diese enge Gasse mit den Fenstern<br />
vis-à-vis, mit den vielen eingerahmten fremden Lebensmomenten,<br />
deren Zeuge man fortwährend zu sein gezwungen wird ; gerade in den<br />
Augenblicken, da man den Blick nach Fernen hebt, Engen begegnend,<br />
die bange machen ».<br />
71 Il est significatif qu’on ait dû, dans les extraits d’écrivains des dixneuvième<br />
et vingtième siècles (Balzac, Taine, Zola, Valéry), si fréquemment<br />
citer à partir d’« Introductions ». La formulation rationnelle de<br />
programmes dans le champ de la science ou de l’art est un trait typiquement<br />
français parfaitement analysé par Curtius dans son ouvrage<br />
sur la civilisation française.<br />
451
452<br />
CONFÉRENCE<br />
être dans la continuité du vieux milieu = medium ; mais en réalité<br />
cela ne prolonge aucunement un terme scientifique — c’est une<br />
nouvelle application du terme « humanisé » de la sociologie, appliqué<br />
précisément au concept moderne de « champ » 72 , la sphère où<br />
les forces sont à l’œuvre. Car, pour le physicien moderne ayant<br />
abandonné l’infinitisme newtonien ainsi que sa théorie de l’« activité<br />
à distance », l’espace est à présent empli de particules contiguës<br />
; dans le champ, le contact existe partout. C’est pourquoi<br />
Valéry fut inspiré d’employer ce milieu* populaire, évocateur de<br />
l’intimité entre les parties d’un arrière-plan « rempli », lorsqu’il<br />
fait référence à la nouvelle vision de Faraday, lequel, doté de la<br />
logique pleine d’imagination de Léonard, voyait<br />
72 Le concept moderne de champ [field] adopté par les physiciens est<br />
esquissé dans l’affirmation suivante de Leopold Infeld, collaborateur<br />
d’Einstein — extraite de son livre « Quest » (New York, 1941, p. 257) :<br />
L’ancienne théorie affirme : les particules et les forces qui les séparent<br />
sont les concepts de fondamentaux. La nouvelle théorie affirme : les<br />
changements dans l’espace, se répandant dans le temps à travers tout<br />
l’espace, sont les concepts fondamentaux de nos descriptions. Ces<br />
changements fondamentaux caractérisent le champ [field].<br />
Les phénomènes électriques ont été la source du concept de champ.<br />
Tous les mots employés pour parler des ondes radiophoniques —<br />
envoyées, propagées, reçues — impliquent des changements dans l’espace<br />
et par conséquent un champ. Non pas les particules dans certains<br />
points de l’espace, mais l’ensemble de l’espace continu constitue le<br />
décor des événements qui changent avec le temps.<br />
La transition de la physique des particules à la physique des champs<br />
est assurément un des plus grands, et même selon Einstein, le plus<br />
grand pas que l’histoire de la pensée humaine ait jamais accompli. Il a<br />
fallu un grand courage et beaucoup d’imagination pour faire passer la<br />
responsabilité des phénomènes physiques des particules à l’espace<br />
préalablement vide et pour formuler des équations mathématiques qui<br />
décrivent les changements dans l’espace et dans le temps.
LEO SPITZER<br />
par les yeux de son esprit, des lignes de force traversant tout l’espace,<br />
où les mathématiques voyaient des centres de force s’attirant<br />
à distance ; Faraday voyait un milieu où ils ne voyaient que la distance.<br />
Et il poursuit, en comparant la macro- et la microphysique :<br />
453<br />
…Je vois un objet ; comment puis-je comprendre son existence ? Du<br />
point de vue d’une théorie mécanique, la réponse serait évidente : l’objet<br />
est composé de petites particules tenues ensembles par les forces.<br />
Mais on peut considérer un objet comme on le fait d’une partie de l’espace<br />
où le champ est particulièrement dense. Les mécanistes disent :<br />
voici l’objet situé à ce point de l’espace. Les physiciens du champ<br />
disent : le champ est partout, mais il diminue hors de cette partie si<br />
rapidement que mes sens ne le perçoivent que dans cette partie précise<br />
de l’espace.<br />
C’est bien connu, ce « grand pas » en physique est dû aux recherches<br />
de Faraday et de Maxwell. Le premier, avec sa théorie de la « polarisation<br />
diélectrique » des substances non-conductrices qui servit à expliquer<br />
l’« activité à distance » (ainsi dénommée) de l’électricité, avait anticipé<br />
la théorie des « champs ». Le Professeur Cox, mon collègue<br />
physicien, m’informe que Faraday, qui appartenait à la secte des Sandemaniens,<br />
a pu emprunter son idée aux spéculations théologiques de<br />
Swedenborg, qui croyait que l’Enfer et le Paradis existaient en tension<br />
polaire, et qu’on ne pouvait concevoir l’un sans concevoir l’autre. Son<br />
mot, diélectrique, n’exprime cependant rien de l’idée qui prend forme,<br />
ne représentant qu’une alternative hellénisée de medium. Cf. « Je pense<br />
que l’induction électrique est une action des particules contiguës de<br />
l’isolant medium ou diélectrique » (1939), à quoi s’arrête une note : « J’emploie<br />
le mot diélectrique pour exprimer cette substance par ou à travers<br />
laquelle les forces électriques agissent ». — C’est Maxwell qui, en 1887,<br />
inventa le terme de champ électrique (d’après le modèle du champ<br />
magnétique (1863) — et du « champ du microscope » plus ancien encore<br />
[1747]), où le mot champ indique une « zone ou une sphère d’action, une<br />
zone ou un espace sous l’influence de, ou dans le rayon d’un agent ».
454<br />
CONFÉRENCE<br />
L’étude du milieu…, siège des actions électriques et lieu des<br />
relations intermoléculaires, demeure la principale occupation de<br />
la physique moderne… Cet esprit ne fait aucun effort pour passer<br />
de l’architecture cristalline à celle de pierre ou de fer ; il<br />
retrouve dans nos viaducs, dans les symétries des trabes et des<br />
entretoises, les symétries de résistance que les gypses et les<br />
quartz offrent à la compression, au clivage — ou, différemment,<br />
au trajet de l’onde lumineuse… Grâce aux vues moins simplistes<br />
des physiciens d’aujourd’hui, l’espace, dès que nous voulons<br />
nous le figurer, cesse aussitôt d’être vide, se remplit d’une foule<br />
Cette métaphore anthropomorphique originale évoque peut-être<br />
moins le champ sur lequel travaillait le laboureur que le champ d’entraînement<br />
d’une unité d’artillerie (cf. en anglais range), mais il est permis<br />
de supposer que les deux connotations existaient dans ce mot de<br />
physicien ; dans les deux cas, ceci suggérerait l’idée de forces à l’œuvre.<br />
Cela représente également l’idée d’un tout à l’intérieur duquel les parties<br />
forment un système cohérent, chacune conditionnant et étant<br />
conditionnée fonctionnellement par les autres (ici vient à l’esprit la<br />
comparaison de l’échiquier du linguiste Saussure). Cela implique également<br />
l’idée d’une zone clairement circonscrite qui peut être « couverte<br />
» sachant que la nouvelle physique tend, à l’opposé de la physique<br />
de Bruno ou de Newton, vers le finitisme. — La description de<br />
l’objet dans le champ donnée par Infeld montre que la conception de<br />
la substance a été abandonnée et remplacée par celle de la fonction —<br />
une substitution que le Dr. Gurwitsch note également dans la Gestalttheorie<br />
des physiologistes modernes. Quand une tache colorée se distingue<br />
de son environnement, on doit (selon cette école) analyser la<br />
structure de la res isolée dans la totalité du champ. (Lichtenberger, dès<br />
le XVIII e siècle, avait dit : « Wenn wir auf einem Gegenstand hinsehen,<br />
so sehen wir noch viele andre zugleich mit, aber weniger deutlich » —<br />
cité par F. H. Mautner, PMLA LVI, 694.) — Le concept de « champ » des<br />
physiciens a été appliqué à la sémantique par une école allemande de<br />
linguistique (J. Trier, Weisgerber) : un Bedeutungsfeld représente l’ensemble<br />
des synonymes qui existent à une certaine époque dans un certain<br />
langage ; un tel ensemble détermine le fonctionnement des parties
LEO SPITZER<br />
455<br />
de constructions arbitraires et peut, dans tous les cas, se remplacer<br />
par la juxtaposition de figures qu’on sait rendre aussi petites<br />
qu’il est nécessaire. Un édifice, si complexe qu’on pourra le<br />
concevoir, multiplié et proportionnellement rapetissé, représentera<br />
l’élément d’un milieu dont les propriétés dépendront de<br />
celles de cet élément.<br />
Ainsi, au contact de la main d’un poète, un cycle est achevé :<br />
de la physique à la biologie, à la sociologie, à la parole populaire<br />
— et de là, à la physique moderne 73 . Quelle constance admirable<br />
dans la matérialité d’un mot, survivant au flux de conceptions<br />
changeantes ! Tout se passe comme si l’homme occidental était<br />
davantage disposé à multiplier les ombres et les connotations,<br />
les richesses internes d’un mot à portée de main, plutôt qu’à<br />
créer un nouveau matériau verbal ; c’est comme si une pensée<br />
nouvelle cherchait à se vêtir des vieux ornements familiers.<br />
Vossler a dit un jour que « der Gedanke nicht anders zum<br />
Begriff werden kann, als indem er aus der Larve seines sprachlichen<br />
Vorlebens ausschlüpft und die tote Puppe abwirft ». Mais il<br />
a négligé la vérité selon laquelle dans le langage la chrysalide<br />
peut survivre, avec le papillon. Nous transportons pour toujours<br />
du champ sémantique, tout autant qu’il est déterminé par lui, révélant<br />
les forces qui dominent dans la zone sémantique (cf. A. Götze dans<br />
Behaghel-Festschrift, p. 171). Selon les termes d’E. Börling commentant<br />
la Charakterologie de L. Klages, « …der gesamte Kosmos, auch die sogenannte<br />
tote Welt, ist ein ungeheures Ausdrucksfeld » (« Darstellung u.<br />
Kritik der Charakterologie von L. Klages », Giessen, 1929).<br />
73 — seulement si on le trouve dans une expression individualiste. Évidemment,<br />
ce terme sociologique vulgarisé n’a pas été accepté dans le<br />
vocabulaire de la physique moderne — de même qu’il est impossible<br />
d’imaginer que milieu, avec ses connotations de stabilité et de finitude,<br />
puisse jamais servir à la place de champ. Mais dans ce passage, il a été<br />
choisi par Valéry parce qu’il convenait au mieux pour s’opposer à la<br />
vacuité de l’univers newtonien.
456<br />
CONFÉRENCE<br />
avec nous les chrysalides, les « coquilles » primitives de la pensée<br />
humaine 74 .<br />
*<br />
Cet article a essayé de suivre les reflets du grec<br />
√|ƒ§Ä¤∑μ à travers les siècles. Nous avons d’un côté cherché à<br />
suivre l’histoire d’un mot : le mot √|ƒ§Ä¤∑μ, prolongé par l’ambiens<br />
des langues romanes : « ce qui embrasse [embraces], enveloppe,<br />
entoure [enfolds] ». Ce √|ƒ§Ä¤∑μ -ambiens a connu des péripéties<br />
dignes de l’essor et de la chute des empires de l’histoire décrits<br />
par Bossuet : jadis expression de la sympathie et de l’harmonie<br />
entre les hommes et l’univers, il est devenu, dans les mains de<br />
Newton, une épithète stéréotypée et banale pour désigner toute<br />
substance nécessaire à une expérience. Alors, revitalisé par les<br />
biologistes, et son contact avec le genre humain également renouvelé,<br />
il a retrouvé finalement son vieil héritage de chaleur et de<br />
sympathie ; ambiance est notre √|ƒ§Ä¤∑μ spirituel.<br />
D’un autre côté, notre intérêt pour √|ƒ§Ä¤∑μ impliquait davantage<br />
que l’étude d’un mot ; puisque √|ƒ§Ä¤∑μ était employé pour<br />
renvoyer à l’espace, il a été nécessaire d’envisager les conceptions<br />
variables du cosmos qui se sont développées — de l’univers clos<br />
des penseurs antiques et médiévaux à l’espace interstellaire de<br />
Newton et au champ gravitationnel d’Einstein. Dans la continuité<br />
74 Dans cet article, s’est révélée une forte preuve de la solidarité européenne<br />
qui a existé partout : solidarité dans la matière du mot (qui était<br />
celle des anciens exclusivement), et solidarité dans les développements<br />
sémantiques qui, à travers les époques, ont apporté leur pierre à l’édifice<br />
de la matière originelle. — De cela doit découler une hypothèse<br />
pratique : l’organisation en départements de la philologie repose sur<br />
une base artificielle. La « philologie moderne », ou les philologies<br />
modernes, cela n’existe pas ; elles tendent toutes à se fondre en une<br />
Philologie occidentale unifiée qui aurait pour vocation de retracer les<br />
évolutions des deux millénaires et demi de la vie culturelle occidentale.
LEO SPITZER<br />
457<br />
de cette évolution, ambiens a de temps en temps été perdu de vue,<br />
mais nous sommes tombés sur un autre grand mot — medium.<br />
Nous avons alors vu que chacun en était arrivé à avoir une relation<br />
étrange et indissoluble : assurément indissoluble, mais jamais<br />
constante ni de tout repos. Ils se sont rencontrés de temps en<br />
temps (même en grec, le √|ƒ§Ä¤∑μ était le ¥Ä«∑μ de la perception),<br />
juste pour s’effleurer, et comme électrisés par ce contact, chacun<br />
repart de nouveau dans sa propre direction. Dans l’italien renaissant,<br />
mezzo et ambiente étaient souvent comparables, quoique<br />
jamais identiques ; en français, l’épithète subordonnée ambiant,<br />
d’abord absorbée par milieu 75 , réapparaît dans l’expression synonyme<br />
circonstances ambiantes de Comte et de Taine, et réalise ultimement<br />
son autonomie dans le substantif ambiance, distinct de<br />
milieu — mais seulement comme l’âme du corps se distingue<br />
d’une même entité.<br />
En effet, tandis que, comme nous l’avons dit, ambiance est un<br />
√|ƒ§Ä¤∑μ spirituel, milieu est bien plus concret, plus terrestre, plus<br />
limité que ne l’était le terme grec ; ainsi rien ne s’approche du<br />
concept de √|ƒ§Ä¤∑μ — un concept peut-être perdu à jamais. Mais<br />
des deux mots, c’est milieu qui s’en rapproche le plus et, ce qui est<br />
intéressant, c’est en lui — le nouvel arrivant dans l’orbite de<br />
√|ƒ§Ä¤∑μ-ambiens, que se reflète cette ancienne idée de la<br />
« coquille ». Pour les Grecs, c’était un espace où l’humanité était<br />
protégée comme dans un récipient, de même qu’au Moyen Âge<br />
l’homme vivait dans les limites [confines] d’un univers clos objet<br />
de l’amour divin. Ces limites ont été dissoutes pour toujours par<br />
la science de la Renaissance — cependant l’idée d’un récipient<br />
revient à nouveau quelques siècles plus tard, sous la forme modi-<br />
75 Avant que cette intégration n’ait eu lieu, pendant que milieu ambiant<br />
était une expression en réserve des physiciens, medium et ambiens<br />
vivaient en fait ensemble. Mais, comme il arrive souvent dans les<br />
mariages, cette association n’a fait ressortir que les qualités triviales,<br />
mineures de chacun des deux partenaires.
458<br />
CONFÉRENCE<br />
fiée du milieu (ambiant)* biologique. Lorsque ce terme s’est appliqué<br />
à l’humanité, cette même idée y a été rattachée en dépit de<br />
Taine, par le peuple et les poètes : « l’habitant et la coquille,<br />
l’homme et le milieu ».<br />
Naturam expellas furca, tamen usque recurret. Et véritablement,<br />
la récurrence de ce concept est due à la nature — notre nature<br />
humaine : il semble qu’il y ait en son fond une Urgedanke émanant<br />
d’un Urgefühl, une idée-mère* née avec l’homme — une projection<br />
du sentiment de l’enfant dans sa coquille, protégé comme<br />
il l’est dans l’utérus maternel. Ce fut ce même sens, salutaire, qui<br />
amena Goethe un jour à défier la cosmologie de Newton en projetant<br />
son sentiment de protection à tout l’univers lui-même.<br />
Aujourd’hui, l’homme se satisfait d’un récipient plus modeste,<br />
qui n’a pas besoin d’être tout-protecteur tant qu’il peut se sentir<br />
« à sa place » quelque part dans ce monde moderne chaotique et<br />
complexe 76 .<br />
76 Karl Jaspers a prophétiquement défini en 1931 « die geistige Situation<br />
der Zeit » comme essentiellement « ungeborgen » (« sans<br />
défense ») ; de manière significative, son livre a été traduit en espagnol<br />
par Ramón de la Serna sous le titre « Ambiente espiritual de nuestro<br />
tiempo » (1939) — de sorte que ce qui devrait soi-disant nous protéger<br />
(ambire, √|ƒ§Ä¤|§μ) se caractérise par un défaut de protection.
LEO SPITZER<br />
APPENDICE : SYNONYMES DU <strong>MILIEU</strong><br />
DE TAINE DANS D’AUTRES LANGUES.<br />
I. EN ITALIEN.<br />
459<br />
Avec l’arrivée du concept tainien de « milieu » en Italie, il a<br />
suffi aux Italiens de reprendre leur ambiente d’origine — l’« élément<br />
entourant », le « medium », qui avait été un mot si vivant<br />
dans cette langue. Au même moment cependant, cet ambiente ressuscité<br />
donnait l’impression d’un mot nouveau ; cf. :<br />
Ogni opera d’arte… è in qualche modo il prodotto di elementi<br />
soggettivi ed oggettivi, e a determinare la natura… contribuiscono<br />
da una parte la mente e l’anima dell’artista, dall’altra quella somma<br />
di circostanze esterne che noi, con parola novissima, chiamiamo<br />
l’ambiente.<br />
Cet extrait d’Il poema cavalleresco, II, 3, de Foffano montre<br />
qu’aussi tardivement qu’en 1904, ambiente (dans sa nouvelle signification<br />
de « milieu ») n’était pas senti comme tout à fait acclimaté en<br />
italien, bien qu’il ait été réintroduit dans cette langue quelques<br />
décennies plus tôt. Le Professeur Salvemini témoigne même qu’il a<br />
entendu son maître, Pasquale Villari, à Florence, employer ambiente<br />
pour le « milieu » tainien en 1890 ; et le Professeur Migliorini a l’intention<br />
d’écrire une étude sur l’ambiente italien dans laquelle il<br />
confirmera l’influence du « milieu » tainien sur le mot italien 1 .<br />
1 L’article a paru depuis dans Rassegna d’Italia, 1947, n° 2.
460<br />
CONFÉRENCE<br />
À partir de la collection d’exemples que ce dernier a eu l’amabilité<br />
de m’envoyer, et de ceux que Torraca a publiés en 1894 (dans<br />
le volume Nuove rassegne, p. 56), je conclus qu’ambiente selon le<br />
sens de Taine était plutôt courant chez Carducci, Isidoro del<br />
Lungo, Tabarrini, Mamiani et Mestica. Le plus vieil exemple est<br />
offert par Migliorini, et on le trouve dans Le “ figurine ” de Faldella<br />
(1875) : « Guardando una gallina mezzana fra la razza bastracona e<br />
la razza minutina, quella gallina mi pare il miluogo, il punto fermo<br />
della specie, proporzionato al cielo, all’atmosfera, a che so io,<br />
insomma a ciò che dicono l’ambiente del paese » (p. 210, dans l’édition<br />
reprint de Bompiani en 1942). Cet exemple renvoie plutôt à<br />
« atmosphère », ≤ƒk«§» , √|ƒ§Ä¤∑μ qu’au milieu restreint de Taine<br />
et atteste une continuation populaire (« ciò che dicono ») de l’ambiente<br />
ancien. Même dans le passage de Scarfoglio, Il processo di<br />
Frine (1884, apud Pancrazi, Racc. e novelle dell’800, p. 819) le lien<br />
avec « air, atmosphère » semble prévaloir : « bastò l’aspetto suo [du<br />
vieux vicaire] per purificare l’ambiente [du tribunal] dal fluido<br />
afrodisiaco che cominciava a propagarvisi ». Quelle que soit sa<br />
« nouveauté », l’ambiente tainien devait déjà exister à cette époque<br />
étant donné qu’en 1886, F. Cazzaniga écrivit L’ambiente, monografia<br />
(Cremona), un ouvrage dont la préface renvoie au « ricorrere<br />
ognor più frequente, nei nostri discorsi, della parola ambiente »<br />
dans le sens récent (« recentissima ») d’« un medium morale e<br />
sociale » — que l’auteur, en effet, oppose à l’ancien usage<br />
d’« atmosphère, climat » : « Al di là di ciò che circonda fisicamente<br />
l’uomo e i suoi aggregati v’ha un altro medium… è l’ambiente<br />
sociale… ambiente s’usa come sinonimo di mondo, di un essere<br />
complesso, fornito di vita propria… ». On sent encore chez Carducci<br />
une opposition à ce nouvel emploi d’ambiente ; dans<br />
« Ceneri e faville », il fustige l’usage social d’ambiente (et ici nous<br />
sommes renvoyés à la remarque ironique de Nietzsche sur le<br />
milieu : voir plus haut) derrière lequel il voit l’esprit couard de<br />
ceux qui laissent faire tout vice en son nom : « La colpa è di quel<br />
che dicon l’ambiente, communale parola che scusa e maschera alla
LEO SPITZER<br />
461<br />
communal gente tanti vizi d’educazione, tante reità e debolezze e<br />
viltà di mente e di cuore ». C’est seulement avec hésitation qu’en<br />
1895 il semble accepter l’emploi mélioratif de l’ambiente sociologique<br />
: « naturalmente Firenze, su tutte le città italiane, ha, come si<br />
direbbe oggi,l’ambiente dantesco » (Opere, X, 430).<br />
Carducci lui-même a tenté de rendre plus littéralement le français<br />
milieu par un mot authentiquement italien. Dans la préface à ses<br />
Letture del Risorgimento 1a , afin de représenter l’idée de « milieu intellectuel*<br />
» (ou, comme Panzini le définit : « focolare di operosità e<br />
produzione intellettuale »), il emploie miluogo (« milieu » [middle]).<br />
D’après Paolo Monelli (Barbaro Dominio, 1933, p. 204), il avait trouvé<br />
ce mot chez le toscan trecentista Frate Giordano da Rivolta (on peut<br />
le trouver plus tôt dans le Novellino, et plus tard chez Varchi [Tomm.-<br />
Bell.] et chez Léonard de Vinci, cf. note 4 de l’article principal) ; c’est<br />
ainsi qu’à cause de son caractère archaïque, il avait l’apparence d’un<br />
mot authentiquement italien (alors que c’est linguistiquement parlant<br />
un gallicisme) tout en représentant une traduction littérale de<br />
(la signification originale de) milieu 1b . Mais nous n’avons ici qu’une<br />
tentative isolée. Il était bien plus cohérent que le pur mot italien<br />
ambiente, connu depuis Galilée et qui avait tout le temps été le frère<br />
jumeau du milieu des physiciens, prît également pour lui-même le<br />
sens que milieu avait acquis grâce aux biologistes et aux sociologues,<br />
au lieu que revécût ce miluogo patiné — un mot qui partageait avec<br />
milieu la seule signification que ce dernier avait perdue.<br />
Il devient parfois difficile de savoir si nous avons affaire à<br />
l’ambiente ancien de Galilée, ou au nouvel ambiente « milieu », ce<br />
qu’on voit dans l’extrait suivant du Trionfo della morte (1894), p. 60,<br />
de D’Annunzio :<br />
1a — d’après Panzini : je n’ai pu trouver le passage en question dans la<br />
réimpression de cette préface dans Opere, XII, 482.<br />
1b Nous avons rencontré miluogo dans le texte moderne de Faldella où<br />
ambiente avait également la signification, plus traditionnelle, de « juste<br />
milieu », « moyenne ».
462<br />
CONFÉRENCE<br />
Il benessere ambiente non era favorevole a quello sforzo interiore<br />
[de l’amour]. Un senso di benessere gli avvolgeva lo spirito<br />
come una fascia molle.<br />
En effet, c’était précisément un procédé magistral de la part<br />
de cet habile magicien de la langue de faire revivre un mot italien<br />
profondément enraciné (avec toute sa souplesse — servant soit de<br />
nom, soit d’adjectif) sans l’exposer au poids de l’exotisme. Sa<br />
tournure de phrase, ne révélant aucune inspiration étrangère,<br />
était de cette façon des plus heureuses, illustrant le thème horacien<br />
: « Multa renascentur quae jam cecidere… vocabula » (la<br />
devise du Vocabolario della prosa dannunziana, 1913, de Passerini).<br />
On sait combien D’Annunzio pouvait employer un matériau lexical<br />
archaïque afin d’inventer des mots pour désigner les créations<br />
modernes, où la nouveauté prenait place dans une ancienne tradition<br />
(verbale) (on se rappelle sa proposition de velívolo pour<br />
« avion » — cf. B. Migliorini, « Gabriele D’Annunzio e la lingua italiana<br />
», 1939). Cependant, en employant dans l’extrait ci-dessus il<br />
benessere ambiente, il fait entendre une nouvelle note par quoi,<br />
sous couvert d’archaïsme, il introduit un sentiment clairement<br />
moderne, très fin de siècle* : la conscience de la rupture entre<br />
l’homme et le milieu (ce que Croce a appelé le côté « fragmentaire<br />
» de son être face aux choses [Letteratura della nuova Italia,IV,<br />
52]). D’Annunzio lui-même a dit de son roman Trionfo della morte :<br />
« Io ho circumfuso di luce, di musica e di profumo le tristezze e le<br />
inquietudini del morituro » ; il a artificiellement tissé un ambiente<br />
autour de son personnage : l’homme et le milieu sont à présent<br />
réunis.<br />
L’italien ambiente a fini par hériter assez naturellement de<br />
toutes les significations que recouvrait milieu en français : on a<br />
ambiente sociale, ambiente morale ; dans certains cas en effet, ce<br />
n’est pas tant l’environnement concret de l’homme que le mot<br />
semble exprimer que l’humeur subjective dans laquelle il est
LEO SPITZER<br />
463<br />
enveloppé — on le traduirait mieux, dans ce cas, par Stimmung.<br />
C’est ainsi que Terracini écrit dans Vox romanica,V, 204, paraphrasant<br />
Charles Bally :<br />
…la lingua [en tant qu’opposée au dialecte]… è ricca di sfumature<br />
affettive (gatto : micio) o di connotazioni di ambiente (gatto :<br />
felino). Siamo d’accordo sulla più ricca sfumatura di ambiente,<br />
legata alla maggior complicazione sociale rappresentata appunto<br />
da una lingua.<br />
D’une part, le mot (sfumature affettive) doit être compris par<br />
l’(ambiente) sociale de la ligne suivante. Cependant, il semble que<br />
quelques pages plus loin il y ait une identification preque parfaite<br />
entre ton (l’humeur) et ambiente :<br />
Qui [selon un emploi journalistique d’un mot noble à l’origine]<br />
siamo in presenza di una specie di anacoluto tonale, di un<br />
salto troppo brusco di ambiente.<br />
D’autre part, ambiente semble avoir pénétré dans le monde<br />
trivial des affaires et de la bureaucratie : Migliorini atteste son<br />
emploi contemporain comme synonyme de « pièce » (una casa di<br />
cinque ambienti), autant que membro, locale et vano (ce dernier<br />
contenant une nuance de froideur et d’objectivité, et ayant un<br />
usage plus large). L’emploi d’ambiente pour « pièce » peut évidemment<br />
s’expliquer par la psychologie des propriétaires et des<br />
agents immobiliers qui cherchent à offrir des « pièces à atmosphère<br />
» à leurs clients, anticipant « empathiquement » les propres<br />
sentiments de ces derniers (c’est la même psychologie qui, aux<br />
États-Unis, impose l’emploi dés-affecté [un-sentimental] de l’affectif<br />
[sentimental] home, à la place de house, plus terne [a lovely eightroom<br />
home for sale] ; et effectivement : quiconque possède une<br />
maison est toujours désigné comme un « home-owner », jamais<br />
comme un « house-owner »).
464<br />
CONFÉRENCE<br />
II. EN ESPAGNOL.<br />
En Espagne, où le milieu de Taine fut emprunté, et où le mot<br />
italien (et espagnol) ambiente et le medio indigène (cf. Diccionario<br />
de Autoridades s.vv.) permettaient aussi d’exprimer ce concept, un<br />
nouveau terme fut inventé par Ortega y Gasset (« Meditaciones<br />
del Quijote » 2 ), lequel devait, comme le français ambiance, être<br />
2 Cf. par exemple p. 194 :<br />
El organismo es inserto en el medio físico, como una figura en el tapiz.<br />
Ya no es él quien se mueve, sino el medio en él. El medio es el unico<br />
protagonista. Se habla de producir el « ambiente ».<br />
On peut remarquer que le mot ambiente, tel qu’Ortega l’emploie, apparaît<br />
régulièrement entre guillemets ; lorsqu’il parle en media vox, il<br />
emploie medio. — Circunstancia n’a pas encore été assimilé par la plupart<br />
des écrivains espagnols, qui continuent à employer ambiente et<br />
medio — ce dernier davantage selon le sens de Taine de milieu social<br />
(medio social, etc.), tandis que le premier l’est selon les connotations<br />
plus vagues d’« atmosphère », de Stimmung. Pedro Salinas (Literatura<br />
española siglo XX, Mexico, 1941, p. 43) cite un extrait poétique d’Azorín<br />
sur les jardins qui, dans l’heure calme de la nuit, « entran en harmonía<br />
y communión íntima con el ambiente y con las cosas que las rodean ». Salinas<br />
lui-même emploie parfois le neutre lo circunstancial en référence au<br />
caractère abstrait d’ambiente (comparer el prosáico ambiente moderno,<br />
p. 90 avec al amparo de lo circunstancial, p. 128), réintroduisant par là<br />
dans la seule langue romane qui ait conservé un neutre l’équivalent du<br />
…ª √|ƒ§Ä¤∑μ grec abstrait. — Avec García Lorca ambiente doit avoir une<br />
connotation de « lumière », étant donné que ce qu’il appelle « entonación<br />
» et « tonos » (= nuances de lumière) dans les indications scéniques<br />
d’un acte, devient « ambiente (oscuro) » pour celles d’un autre.<br />
— Le mot ambiente a eu une évolution sémantique particulière en<br />
Argentine ; comme le montre Castro avec une évidente désapprobation
LEO SPITZER<br />
465<br />
libre de la nuance de déterminisme sociologique. Cf. « ¡La circunstancia<br />
! ¡Circum-stantia ! ¡Las cosas mudas que están en nuestro<br />
próximo derredor ! » 3<br />
Selon ce penseur conservateur, si soucieux des valeurs espagnoles,<br />
la tâche devant laquelle l’homme se trouve aujourd’hui<br />
consiste à faire revivre le logos, la signification des « choses silencieuses<br />
» dans notre environnement immédiat : celles qui sont<br />
devenues « absurdes » ou insignifiantes pour ceux qui subissent<br />
l’influence des tendances biologico- et socio-politiques du dixneuvième<br />
siècle : « Yo soy yo y mi circumstancia… Benefac loco illi<br />
quo natus es ». Par opposition avec la connotation menaçante,<br />
déterministe de milieu, les mots la circunstancia, lo circunstante<br />
illustrent la « donnée » librement consentie de l’évolution historique :<br />
ainsi, selon Ortega, les deux écrivains espagnols Bajora et Azorín<br />
sont deux « circumstancias » espagnoles, tout aussi véritables que<br />
la sierra de Guadarrama près de Madrid.<br />
Ortega peut n’avoir pas été conscient de la nuance menaçante<br />
contenue dans le circumstare latin (cf. note 12) ; je suis convaincu<br />
que, familier qu’il était avec la philosophie et la poésie allemandes,<br />
il a simplement traduit l’Umwelt allemand (ces « choses<br />
silencieuses » ne nous rappellent-elles pas Rilke ?) en même<br />
temps qu’il introduisait quelque chose de sa philosophie « méditerranéenne<br />
» selon laquelle la « présence » d’un phénomène a<br />
(La peculiaridad lingüística rioplatense, p. 116), il est employé comme une<br />
expression recherchée pour « pièce » [room] (= habitacion en espagnol<br />
métropoplitain). C’est de toute évidence un italianisme, cf. supra, p.28.<br />
— Chez les écrivains portugais, meio, employé pour milieu (littéralement<br />
« le centre » [the middle]), apparaît encore aujourd’hui entre<br />
guillemets, ce qui indique clairement que la conception de Taine a<br />
pénétré à un faible degré la pensée du grand public.<br />
3 L’immédiateté actuelle suggérée par circunstancia doit nécessiter l’exclusion<br />
de ce halo d’imprécision qui entoure l’ambiance des symbolistes<br />
français.
466<br />
CONFÉRENCE<br />
plus d’importance que son « essence ». La circunstancia a autant de<br />
« présence » que le moi : l’homme, vivant avec son moi dans la circunstancia<br />
doit rétablir son importance et par là se libérer de la<br />
tyrannie de la biologie. Parlant de la manière égotiste de philosopher<br />
d’Ortega, Américo Castro commente : « L’esprit ibère ne<br />
peut jamais décoller du sol vital auquel il est attaché » — ce qui<br />
conduit à son affirmation finale sur la civilisation espagnole :<br />
« pour l’Espagnol, l’homme et le milieu constituent une unité<br />
vitale » — affirmation à interpréter à la lumière du yo y mi circunstancia<br />
d’Ortega 4. .<br />
III. EN ANGLAIS.<br />
La première attestation du mot anglais environment, créé par<br />
Carlyle, apparaît dans un curieux contexte — un contexte ignoré<br />
du New English Dictionary. Le passage dans lequel il apparaît est<br />
extrait de l’article de Carlyle sur Goethe, Miscellanies (1827), où il<br />
est particulièrement intéressant de voir que les vers en question<br />
sont eux-mêmes une traduction de Goethe (Dichtung und Wahrheit,<br />
livre XIII) : à la suite d’un passage dans lequel Goethe avait<br />
insisté sur la tristesse de la « littérature poétique » en Angleterre,<br />
intervient un nouveau paragraphe (séparé du précédent par des<br />
astérisques pour marquer la suppression de certains vers) :<br />
Au sein d’un tel élément, avec un tel environnement de circonstances,<br />
avec un savoir et des goûts de cette sorte ; écrasé de désirs insatisfaits…<br />
; avec la seule perspective de voir s’éterniser une vie languide,<br />
veule, tout juste sociale [il est aisé de comprendre que les<br />
jeunes Allemands comme Werther soient attirés par le suicide].<br />
4 Au sujet de la conception de circunstancia, cf. H. D. Casanueva, Das<br />
Bild vom Menschen bei Ortega y Gasset, Jena diss. 1937 ; dans cet ouvrage,<br />
l’auteur cherche à accorder la philosophie espagnole aux tendances<br />
pédagogiques modernes en Allemagne.
LEO SPITZER<br />
467<br />
Les mots soulignés sont une traduction de Goethe : « In<br />
einem solchen Element, bei solcher Umgebung 4a , bei Liebhabereien<br />
und Studien dieser Art… » Cependant, l’Element et l’Umgebung<br />
de Goethe sont à comprendre uniquement en référence aux<br />
vers que Carlyle a supprimés — un passage où Goethe affirme<br />
qu’Ossian a trouvé un « endroit » parfait pour la mélancolie<br />
anglaise : la lande, une « nuit calédonienne » sous la lumière de la<br />
lune, quand les héros morts et les belles demoiselles d’autrefois<br />
[maidens once fair] reviennent à la vie fantomatique. C’est ainsi que<br />
Goethe, pensant au paysage ossianique, parlait d’un « élément » de<br />
la nature, tandis qu’Umgebung représentait un terme médian entre<br />
l’environnement naturel et l’environnement spirituel (ce qu’on<br />
voit clairement dans les mots qui suivent — Liebhabereien et Studien,<br />
qui ont évidemment trait au spirituel) 5 .<br />
4a En ancien allemand, umbgehende Luft était la traduction d’aer<br />
ambiens, cf. le passage de Geschichtsklitterung de Fischart cité par Jean<br />
Paul dans Vorschule der Ästhetik : « [une jeune fille avait] rosenblühsame<br />
Wänglein, die auch den umbgehenden Luft mit ihrem Gegenschein als<br />
ein Regenbogen klärer erläuterten wie die alten Weiber, wan sie aus<br />
dem Bad kommen » (les joues rosées de la jeune fille reflètent la teinte<br />
de l’air ambiant).<br />
5 Gundolf a raison d’affirmer dans sa biographie de Goethe (pp. 406 ff.<br />
620 ff.) que ce dernier ne concevait pas sa propre autobiographie selon<br />
la théorie du « milieu » qui pense l’homme comme une victime passive<br />
de circonstances objectives, mais au contraire qu’il voyait dans sa personnalité<br />
la « Geistwerdung… auch der aussermensschlichen Wesenheiten<br />
» ; les forces naturelles et culturelles que Gundolf lui-même<br />
nomme Umwelt (entre guillemets — le milieu de Taine), signifiaient<br />
pour Goethe les « Geist und Atmosphäre der unpersönlichen Welt » ;<br />
pour Goethe, la Mère Nature et le Père Spirituel étaient en paix : ils ne<br />
formaient qu’un élément matériel-spirituel (« geistigstofflich »). Ainsi, le<br />
décor imaginaire d’Ossian dont parle Goethe est pour lui à la fois un<br />
passage et un climat spirituels (« Lokal », « Element », « Umgebung ») —<br />
aussi fidèle que son propre décor de Francfort.
468<br />
CONFÉRENCE<br />
La traduction de Carlyle n’est donc pas une véritable interprétation<br />
: l’expression emphatique et surchargée environment of circumstances<br />
est assez impuissante à rendre l’imperceptible flux goethéen<br />
d’un climat naturel à un climat spirituel — et l’élément qu’il ajoute<br />
pour faire bonne mesure a été placé dans un contexte qui ne lui<br />
convient pas : il reste ironiquement isolé. On peut probablement<br />
expliquer le remplacement du pléonastique (et impropre) environment<br />
of circumstances par l’influence sur Carlyle de la recherche biologique<br />
française contemporaine sur le problème du milieu<br />
ambiant*, de sorte que Goethe voit s’inscrire Umgebung dans une<br />
conception du « milieu » à laquelle il était fortement opposé. Quant à<br />
la nuance fataliste de l’expression de Carlyle, il ne fait aucun doute<br />
qu’elle a subi l’influence de la description par Goethe de ces causes<br />
qui ont donné une tournure fatale à la fièvre wertherienne de<br />
l’époque et à la vague de suicides qui a suivi. Cette étrange création<br />
dont la paternité revient ouvertement à Goethe semble avoir eu un<br />
grand succès ! Plus tard, Carlyle emploiera le mot environment dans<br />
un contexte purement géographique : Bayreuth, et son environnement<br />
pittoresque (1830) ; toute l’habitation [habitation] et ses alentours [environment]<br />
avaient l’air extrêmement coquet et joyeux (1831) : cela indiquerait<br />
que, dès le départ, le mot avait une nature plutôt bien circonscrite<br />
— sinon, tel qu’il est employé dans le premier extrait, il<br />
aurait difficilement eu besoin du complément « …of circumstances<br />
» : aujourd’hui, environment seul suffit.<br />
En anglais, le mot milieu est un emprunt au même mot français<br />
— indubitablement sous l’influence de la théorie de Taine,<br />
mais cet emprunt n’est pas plus tardif que l’expression de<br />
Carlyle : il est attesté en 1877. Cf. « …le milieu intellectuel et moral<br />
créé par les personnalités… qui formaient la force motrice du<br />
milieu » (Symonds). On trouve également le mot dans sa première<br />
acception biologique (« J’ai préparé un Milieu… auquel je désirais<br />
habituer le Microbe », Fortnightly Review, 1893).<br />
Bien que les deux mots milieu et environment soient souvent<br />
interchangeables, on peut cependant noter une différence d’in-
LEO SPITZER<br />
469<br />
tensité très nette dans leur emploi aujourd’hui (situation comparable<br />
à celle qui existe en allemand dans le cas d’Umwelt et de<br />
Milieu):milieu a une acception bien plus souple qu’environment et<br />
une connotation bien plus subjective que le mot anglais original.<br />
Tous deux évoquent une « qualité » inhérente aux environs<br />
— mais cette qualité devient plus intime et plus intangible avec<br />
milieu qu’avec environment, et moins déterministe : environment est<br />
le terme du sociologue qui pense en termes de facteurs fixes,<br />
milieu l’expression plus spontanée d’un être humain qui éprouve<br />
plus qu’il n’analyse. (D’après un reportage dans le New Yorker,un<br />
directeur du Jollity Building est nommé parce qu’« il comprend le<br />
milieu » — où il faut remarquer le verbe comprendre [understands]<br />
et l’insistance sur l’élément humain. Environment aurait été inapproprié.)<br />
De plus, on tend en quelque sorte à penser l’« environment<br />
» comme ayant déjà influencé l’individu (« l’enfant avait été<br />
élevé dans tel ou tel environnement » ; « son environnement<br />
initial »), alors que le « milieu » (plus subtilement déterminé) reste<br />
toujours présent.<br />
Le mot habitat a été employé par Galsworthy dans un sens<br />
biologique, dans Forsyte Saga, I (« The Man of Property », 1906,<br />
ch. 8) :<br />
Il est généralement admis que tous les Forsyte ont des<br />
coquilles comme ce petit animal extrêmement utile que l’on transforme<br />
en loukoum ; en d’autres termes, on ne les voit jamais sans<br />
habitats (et si on les voit, c’est sans les reconnaître), composés de<br />
circonstance, de propriété, de relations et de femmes qui semblent<br />
les accompagner dans leur passage à travers un monde composé<br />
de milliers d’autres Forsyte avec leurs habitats. Un Forsyte ne se<br />
conçoit pas sans habitat — ce serait comme un roman sans<br />
intrigue, ce qui, c’est bien connu, est une anomalie. Pour un Forsyte,<br />
les Bosinney n’avaient aucun habitat ; ils avaient l’air de ces<br />
hommes rares et infortunés qui passent leur vie entourés de circonstances,<br />
de propriétés, de relations et de femmes qui ne leur<br />
appartiennent pas.
470<br />
CONFÉRENCE<br />
Ce mot avait été employé auparavant dans le même sens par<br />
Lowell (1854) : « Mais tout n’est pas une Chose, et toutes les choses<br />
ne sont bonnes à rien sans leur habitat naturel » ; Santayana, dans<br />
The Idea of Christ (1946), l’emploie alternativement avec environment<br />
: « En nous préservant et en nous exprimant, nous pouvons<br />
transformer notre habitat ; mais c’est uniquement parce que nous<br />
nous sommes opportunément insérés dans cet habitat, mis en<br />
mesure de pouvoir par les puissances alentours ( !), et que nous<br />
avons consenti à devenir ce que cette occasion favorisait et que le<br />
furtif concours des événements était destiné à soutenir ».<br />
On sait bien que le nom habitat vient de la troisième personne<br />
du présent latin habitat — « il habite » —, qui, dans la classification<br />
de la flore et de la faune établie en latin au dix-huitième<br />
siècle, a introduit le nom signifiant « le lieu naturel de croissance<br />
ou d’apparition d’une espèce » (NED) ; par exemple : « Primevère<br />
commune — Habitat in sylvis… » (auparavant, le nom habitatio<br />
avait été employé dans la même fonction — cf. habitation dans le<br />
passage de Carlyle cité plus haut). …Au commencement, les Forsyte<br />
bien protégés sont inconcevables sans habitat, tout autant<br />
que la primevère commune. Et dans cette épopée de la mort du<br />
victorianisme, ils seront précisément soumis à des conditions qui<br />
briseront leurs « coquilles » naturelles.<br />
De même circumstance, après avoir signifié pendant des siècles<br />
« id quod circumstat » (cf. Sterne, Tristram Shandy, III, 2 : « …les<br />
circonstances dont toute chose au monde est entourée, lui donnent<br />
sa taille et sa forme »), a servi à rendre en anglais « environment »<br />
— avant que ce dernier ne soit fixé : Byron (1821) : « Les hommes<br />
sont le jouet des circonstances » ; « Je suis l’esclave absolu des circonstances<br />
». Disraeli (1827), à l’opposé de la parole d’Hérodote,<br />
dit : « L’homme n’est pas la créature des circonstances. Ce sont les<br />
circonstances qui sont les créatures de l’homme. » En 1887, F. Galton<br />
oppose education à circumstances. (Toutes les citations de ce<br />
paragraphe sont extraites du New Dict. of Quotations,s.v.nature vs.<br />
nurture, de Mencken.)
LEO SPITZER<br />
Surroundings, qui traduit le français les environs*, apparaît très<br />
rarement dans une signification proche de celle d’environment :<br />
Kim (le héros du roman de Kipling, 1901) sent que son âme n’est<br />
« plus en prise avec ce qui l’entoure [its surroundings] — comme<br />
une roue dentée séparée de son rouage, tout comme l’inutile roue<br />
dentée d’un broyeur de sucre de Beheea au rabais abandonné<br />
dans un coin ».<br />
En réaction contre l’élément déterministe qui prévalait dans<br />
environment, William James a employé le mot tone (dans le sens de<br />
…∫μ∑» « tension », tonique = « fortifiant », etc., avec en même temps<br />
un clin d’œil au ton musical) en référence à cette part de l’ambiente<br />
qui peut et, selon la philosophie activiste de James, qui<br />
devrait être créée par l’homme ; cf. aussi son essai Great Men and<br />
their Environment (1880) : « le ton créé par ces grands hommes est<br />
repris par d’autres ».<br />
IV L’UMWELT ALLEMAND.<br />
Le mot allemand Umwelt (qui n’est pas, au passage — et<br />
comme on pourrait le croire à première vue — une traduction,<br />
une Lehnübersetzung d’« ambiens [medium] ») a connu une histoire<br />
étrange. L’origine de ce mot a été l’occasion d’un problème :<br />
Götze, l’éditeur de l’édition définitive de l’Etymologisches Wörterbuch<br />
de Kluge, est convaincu qu’Umwelt a été emprunté au danois<br />
umverden (même si Kluge lui-même a exprimé son incertitude<br />
quant à la théorie de cette origine, dans sa Wortforschung und<br />
Wortgeschichte, 1912). Il est vrai que le mot danois n’est pas attesté<br />
avant 1822, alors qu’Umwelt, son fruit présumé, apparaît dès 1800.<br />
Mais l’attestation tardive de omverden a été plutôt négligée (probablement<br />
sur l’hypothèse selon laquelle un mot peut avoir été en<br />
usage quelque temps avant son apparition en littérature) en<br />
faveur d’une autre, jugée probante : cet Umwelt apparaît d’abord<br />
dans la poésie (en allemand) d’un poète danois, Baggesen ; ce<br />
471
472<br />
CONFÉRENCE<br />
même Baggesen employait de plus omland (de formation parallèle<br />
à omverden, qui apparaîtra plus tard) lorsqu’il écrivait en danois.<br />
Ainsi, en tenant pour acquise l’existence d’un omverden non<br />
attesté, on a présupposé un modèle danois (renforcé par omland),<br />
de sorte que le mot allemand Umwelt a été accepté comme issu de<br />
ce modèle.<br />
Personnellement, je suis convaincu qu’Umwelt ne vient pas<br />
d’omverden, mais que c’est le contraire. En premier lieu, la dernière<br />
attestation de omverden est douteuse : assez curieusement le<br />
mot omland, qui n’a pas influencé le mot allemand, se rencontre<br />
dès 1807, et l’on doit se demander pourquoi omverden, en tant<br />
qu’origine de Umwelt, aurait dû attendre 1822 pour entrer en littérature.<br />
De plus, c’est un fait reconnu que ce n’est pas le danois<br />
qui a enrichi l’allemand mais le contraire, et que l’on ait créé un<br />
omverden vient probablement de l’emploi d’Umwelt — et en particulier<br />
de son emploi chez Goethe. Enfin, même si ce mot est<br />
attesté pour la première fois chez un Danois, c’est en écrivant sa<br />
poésie en allemand que Baggesen a employé ce mot. Et c’est dans<br />
la poésie allemande que je pense que la clé de l’origine d’Umwelt<br />
doit être cherchée.<br />
Baggesen admirait Voss (un de ses poèmes est dédié au poète<br />
allemand) lequel, comme Klopstock avant lui, avait imité dans ses<br />
vers l’hexamètre homérique qui demande un spondée au dernier<br />
mètre. Ces deux poètes avaient insisté sur l’importance de ce pied<br />
spondaïque final. Klopstock avait dit : « Der Schluss mit den langen<br />
oder kurzen Silben ist nicht gleichgültig », et l’on sait qu’il a<br />
corrigé une fin de vers telle que Pforten der Tiefe en Pforten des<br />
Abgrunds. Voss poursuivit dans la même veine : « Keine Gleichförmigkeit<br />
der Endungen, zumal in Schlussrythmen, wo das leidige<br />
–en sich so gern einstellt ». (La thèse de E. Linckenheld, Der<br />
Hexameter bei Klopstock und Voss, Strassburg, 1906, p. 58, établit<br />
que seulement 8 % des vers de Luise de Voss comportent des<br />
rimes féminines.) Dans son enthousiasme pour les spondées,Voss<br />
ne s’est pas contenté de la syllabe finale, et il fut pris à partie par
LEO SPITZER<br />
473<br />
Jakob Minor pour cet emploi inconsidéré (in Neuhochdeutsche<br />
Metrik, p. 274), qui tourne en ridicule l’exemple : « Sechs Schilfsessel<br />
umstanden den Steintisch, welchen der Hausknecht… » Les<br />
effets de cette innovation dans les mains de poètes si influents ne<br />
peuvent être négligés : on eut besoin, dans le langage, de mots de<br />
deux syllabes qui entreraient dans la syllabe spondaïque — un<br />
besoin parfaitement comblé par Umwelt (et que, doit-on ajouter,<br />
seulement un mot composé pouvait combler). Il est intéressant<br />
aussi de voir que dans les deux passages de Baggesen contenant<br />
le mot Umwelt, celui-ci apparaît à la fin de l’hexamètre.<br />
Ainsi notre Umwelt est un néologisme allemand créé seulement<br />
incidemment afin de remplir les obligations de la métrique<br />
allemande. Car il est très douteux qu’il remplisse aussi le besoin<br />
d’un nouveau concept : il ajoute peu sinon rien (du moins au<br />
début de sa carrière) à la signification d’Aussenwelt (attesté dès le<br />
Moyen Âge) qui apparaît difficile à manier avec ses trois syllabes.<br />
Une fois créé cependant, il entrait admirablement dans la pensée<br />
philosophique allemande et, du point de vue grammatical, il est<br />
d’une formation qui entre aisément dans les modèles allemands<br />
déjà établis pour la composition des mots :<br />
(1) Um- : Umgang (= ambitus latin), Umfang (= circumferentia),<br />
Umstand (= circumstantia), Umlauf (= cursus circularis); et<br />
particulièrement MHG umbeschrank (= circumferentia),<br />
umbekreis der welte (« Umkreis »), umbesweif (« Kreislauf,<br />
Umkreis, Kreis-umfang ») et umbering (= gyrus, orbis)<br />
(2) -welt : Aussenwelt, Innenwelt, Welt. Les deux premiers avaient<br />
probablement une origine piétiste : Aussenwelt se trouve également<br />
dans les écrits de Bettina von Arnim et, après 1811,<br />
Innenwelt apparaît chez Goethe : « …daher war die höhere<br />
Mathematik ihm [Newton] als das eigentliche Organ gegeben,<br />
durch das er eine innere Welt und die äussere zu gewältigen<br />
sucht » (Sämtl. Werke, 35, p. 178). Avant cette période, il se<br />
contentait cependant de Welt pour exprimer l’idée d’un
474<br />
monde intérieur : « Das ist deine Welt, das heisst eine Welt »<br />
(Faust I ; noter l’emploi du pronom avec le premier Welt qui<br />
accentue son identité avec Innenwelt) ; « mein Busen war so<br />
voll und bang, von hundert Welten trächtig » (« Kenner und<br />
Enthusiast » ; ici, nous avons une conception du royaume<br />
intérieur de l’âme qui remonte en fin de compte à l’idée de<br />
microcosme — le « petit monde »). Je n’essaierai pas de retracer<br />
l’origine de la métaphore du « monde intérieur » : il suffit<br />
de dire que l’emploi piétiste d’Innenwelt repose, en définitive,<br />
sur la phrase augustinienne : noli foras ire, in interiore animae<br />
habitat veritas : l’âme s’empare de sa réalité véritable — i. e.<br />
Dieu — en elle-même. Le monde extérieur est un monde<br />
trompeur. Tout mouvement mystique (tel que celui des piétistes)<br />
devait renouveler cette conception.<br />
Ainsi l’« accident » métrique ex post ressemble à un développement<br />
nécessaire de la langue allemande.<br />
Au début Umwelt, tel que l’emploient Baggesen et Goethe,<br />
semble indiquer le monde extérieur en tant qu’opposé au monde<br />
intérieur :<br />
Baggesen :<br />
…dass von fern (!) erscheinet der Umwelt / Ein’ ätherische Feste<br />
die Schicksalshölle des Dichters (Elégie à Napoléon)<br />
...Hier auf dem blumigen Grase, wo rings euch schirmet die<br />
Wölbung / Schroffer Gebirgshöhe, fern von begegnenden Blicken<br />
der Umwelt (Alpenreise)<br />
Goethe :<br />
CONFÉRENCE<br />
Der Tag ist so lang, das Nachdenken ungestört, und die herbstlichen<br />
Bilder der Umwelt verdrängen keineswegs den poetischen<br />
Sinn, sie rufen ihn vielmehr, von Bewegung und freier Luft begleitet,<br />
nur desto schneller hervor (Italienische Reise)
LEO SPITZER<br />
475<br />
...ihm sei, durch einen... Freund, die Umwelt aufgeschlossen<br />
(Wilhelm Meisters Wanderjahre) 6<br />
Mais plus tard, sous l’influence du « milieu » biologico-sociologique<br />
de Taine, Umwelt fut détourné de son cours dans la direction<br />
de milieu. Ainsi, un second « accident » influença la carrière de<br />
6 Ce n’est sans doute pas une simple coïncidence qu’Umwelt soit<br />
attesté précisément dans le « Entwicklungsroman » Wilhelm Meister,<br />
pour lequel Elena Eberwein, Romanische Forschungen, LIII, 370 (1939), a<br />
raison de souligner que l’expression Entwicklung (« développement »)<br />
suppose une croissance organique de l’intérieur et implique une accusation<br />
du monde extérieur : après le Sturm und Drang qui nous apporta<br />
la séparation de l’individu et du monde, voyant « le chaos d’un monde<br />
devenu insensé » — la seule chose qui restait à l’artiste était « das, was<br />
dem Künstler nunmehr neu zu schöpfen ist (i. e. sa vie intérieure) » : le<br />
monde extérieur n’est nécessaire que pour renforcer le tempérament<br />
(lequel, cependant, se cristallise de l’intérieur) ; on se rappelle les vers<br />
de Goethe : « Es bildet das Talent sich in der Stille, Sich ein Charakter<br />
in dem Strom der Welt ». Il est significatif que le critique moderne<br />
A. Schirokauer, « Bedeutungswandel des Romans » (Mass und Wert III,<br />
597, [1940]) doive employer le mot Umwelt pour renvoyer au « Bildungsroman<br />
» Wilhelm Meister de Goethe ; pour le citer : « Das Auftreffen des<br />
Ausfahrenden und Lehrlings auf die Umwelt, seine Reaktionen auf<br />
allerlei Reize, die schleifsteinartig seinen Charakter zu klären und kristallisieren<br />
hatten… ». Ici, Umwelt est plutôt employé dans le sens de<br />
Gegenwelt : ce n’est rien d’informe qui puisse se fondre dans le tempérament<br />
de l’homme, mais cela résiste, opposant sa forte matérialité à la<br />
vie intérieure. « Ich kehre in mich selbst zurück, und finde eine Welt »,<br />
dit Werther, reprenant la terminologie augustinienne. L’idée de la<br />
nécessité de se retirer en soi reste très présente dans les expressions de<br />
nombreux érudits allemands : on peut noter, parmi des centaines<br />
d’exemples possibles, les idées du linguiste Porzig sur la « Sondersprache<br />
» — le titre de son article dans « Germanica, Festgabe Sievers »<br />
(1925) ; le préfixe sonder- évoque pour lui une véritable exclusion du<br />
monde extérieur : l’évolution sémantique est expliquée comme survenant<br />
dans le langage singulier de l’individu.
476<br />
CONFÉRENCE<br />
ce mot. Bien qu’il eût une signification vague et indéfinissable au<br />
début, il en vint à être investi de la tâche aiguë et circonscrite de traduire<br />
un terme technique de la science. Cependant Umwelt n’est<br />
jamais complètement entré dans l’orbite de milieu ; aujourd’hui<br />
encore, sa nuance subjective originelle n’a pas été perdue car elle ne<br />
renvoie pas simplement au « milieu » comme environnement objectif,<br />
mais aussi en tant qu’il est envisagé du point de vue de l’individu.<br />
Umwelt est également, même aujourd’hui, je crois, un mot plus poétique<br />
que le milieu technique, devenu prosaïque 7 .<br />
7 La transparence étymologique d’Umwelt, par contraste avec l’« opacité »<br />
d’ambiente, ambience, milieu (celui-ci dans une moindre mesure) et environment<br />
peut servir d’exemple à ce que Fichte, A.W. Schlegel et, plus récemment<br />
H. L. Chamberlain (avec beaucoup d’exagération) ont considéré<br />
comme un trait caractéristique de l’allemand : selon eux, c’est une « ursprüngliche<br />
Sprache », alors que les langues romanes sont de nature largement<br />
dérivée — et donc « à moitié mortes » (cf. Zufall – hasard*). La qualité<br />
de transparence étymologique reflète souvent une forte nuance de chaleur<br />
et d’intimité : en anglais où les mots des deux types alternent souvent,<br />
on peut rapprocher hearty et cordial, ou — plus en rapport avec<br />
notre propos — inner et interior. Et combien plus froids sont en français<br />
intérieur, extérieur qu’en allemand innerlich, äusserlich (cf. par exemple<br />
« das Äussere ist ein in Geheimniszustand erhobenes Inneres », « [l’âme]<br />
Berührungspunkt der äusseren und inneren Welt », Novalis) ; il est intéressant<br />
de voir que le Vocabulaire de la philosophie de Lalande n’a que des<br />
exemples insignifiants à offrir à l’article intérieur : l’expression monde intérieur<br />
= Innenwelt manque. — Pourtant le français a également été<br />
influencé par la transparence étymologique d’Umwelt, si l’on en juge<br />
d’après le titre du livre de Lintilhac, « Les Félibres à travers leur monde et<br />
leur poésie » (1895), où le « monde » représente un medium opaque que<br />
l’œil du critique serait capable de percer ; ou encore, par une expression<br />
comme monde social, telle que Bouglé l’emploie (l.c. p. 20) : « Un acte<br />
volontaire tend toujours à s’extérioriser, à n’agir sur le monde matériel<br />
que par l’intermédiaire d’un monde social » — l’auteur aurait tout aussi<br />
bien pu employer le néologisme français cadre social.
LEO SPITZER<br />
477<br />
Son emploi est également bien plus souple et plus étendu<br />
que celui de milieu. Cf. le passage suivant extrait de l’article de<br />
Petsch (de toute évidence influencé par Heidegger), « Der Aufbau<br />
der dramatischen Persönlichkeit und ihrer “ Welt ” » (Deutsche<br />
Vierteljahrsschrift, XIII, 229) :<br />
Hier (dans la pièce) wie in der Erzählung sind es ja « Menschen<br />
», von denen der Vorgang ausgeht, die ihn tragen oder erleiden<br />
; und hier wie dort stehen die Menschen in einer « Welt », die<br />
dem Vorgang seinen Boden bereitet, ihn mannigfach bestimmt<br />
und auch durch ihn verändert wird. Diese Welt ist zum Teil wieder<br />
von persönlicher Art : sie lebt in den Menschen, die den Helden<br />
umgeben, die aber im Vergleich zu seiner Persönlichkeit und<br />
Eigenkraft leicht etwas Mittelbares, Halb-Persönliches erhalten.<br />
An dieser « Als-Ob Persönlichkeit » hat aber auch, in verschiedenen<br />
und oft wechselnden Graden, die dingliche Umwelt teil (der<br />
Zeit-Raum der Handlung mit seinem « Milieu » und seiner « Atmosphäre<br />
») und vor allem jene Triebkräfte des Vorgangs, die wir unter<br />
dem Namen des « Schicksals » zusammenfassen.<br />
Ici, Milieu et Atmosphäre sont subordonnés au (dingliche) Umwelt<br />
qui constitue une partie du « Welt » de chaque personnage. Les<br />
deux mots Milieu et Umwelt vivent côte à côte dans la langue, tout<br />
comme le font en anglais environment et milieu — bien qu’environment,<br />
inventé par Carlyle pour rendre un terme biologique, ait été<br />
confiné dès le départ à une sphère plus étroite qu’Umwelt ; de<br />
plus, sa parenté lexicale avec le mot français, en fait un terme<br />
moins authentique [indigenous].<br />
Goethe lui-même, dans le but de rendre le milieu (ambiant)*<br />
des biologistes contemporains français, n’a pas employé Umwelt<br />
mais Umgebungen. Nous avons déjà noté un exemple de ce mot<br />
chez Goethe (en relation avec l’invention d’environment par Carlyle)<br />
; ci-dessous, on a quelques autres passages intéressants dans<br />
lesquels on peut le rencontrer :
478<br />
Saugamme und Wärterin, Vater oder Vormund, Lehrer und<br />
Aufseher sowie alle die ersten Umgebungen, an Gespielen, ländlicher<br />
oder städtischer Lokalität, alles bedingt die Eigentümlichkeit (« Tyche »)<br />
Jeder Irrtum, der aus den Menschen und aus den Bedingungen,<br />
die ihn umgeben, unmittelbar entspringt, ist verzeihlich (Sämtl.<br />
Werke, Cotta éd., 35, p. 181)<br />
Mängel (dans la Royal Society de Londres), die in der Umgebung<br />
und in der Zeit liegen (ibid., p. 142)<br />
— cette dernière expression est le titre d’un chapitre que Taine<br />
pourrait très bien paraphraser par le milieu et le moment : tout se<br />
passe comme si les circumstantiae avaient polarisé les erreurs fatalement<br />
déterminées de l’homme et ses insuffisances. Solger écrit<br />
dans une lettre examinant les Wahlverwandtschaften de Goethe<br />
(Nachgelassene Schriften, I, 1826) :<br />
Seht wohin selbst das Studium der Natur diesen wahrhaften<br />
Dichter des Zeitalters geführt hat ! In der Natur selbst erkennt er<br />
die Liebe, das sind die Wahlverwandtschaften. Eben dazu gehören<br />
die Details der Umgebungen. Gerade diese sind das sichtbare Kleid<br />
der Persönlichkeiten. Und sie haben noch eine andere hohe<br />
Bedeutung. Sie sind das tägliche Leben, worin sich die Persönlichkeit<br />
ausdrückt, sofern sie mit andern in äussere Berührung kommt<br />
und sich von ihnen unterscheidet.<br />
Et plus loin :<br />
CONFÉRENCE<br />
Über die Details der Umgebungen habe ich mich schon geäussert.<br />
So wie diese das ganz tägliche wirkliche Leben der Personen<br />
immer in gleicher Schwebung halten und gleichsam als Folie<br />
dienen...<br />
Ainsi, deux ans avant la naissance de Taine, nous avons l’essence<br />
de sa théorie du « milieu » qui se fonde sur l’idée que des<br />
influences déterminantes modèlent les individus. On peut remarquer<br />
également l’attitude exprimée ici envers « la vie de tous les
LEO SPITZER<br />
479<br />
jours » — son caractère accidentel, sa texture désagrégée (« détaillée<br />
» [detail-ed]). Mais le mot allemand Umgebungen n’était pas destiné<br />
à devenir représentatif de milieu 8 : sa forme singulière ne<br />
pouvait servir, le limitant à une référence purement géographique,<br />
de même que le pluriel ne convenait indubitablement pas<br />
pour rendre le singulier français. Ainsi Umwelt l’emporta — avec<br />
la restriction (ou plutôt l’extension) notée plus haut 9 .<br />
Les trois mots Umgebung, Umwelt et Innenwelt ont été analysés<br />
en rapport avec la vie animale par le biologiste von Uexküll<br />
8 En 1880 déjà, Alexandre von Villiers disait que Taine avait fondé « ein<br />
System der Umgebung » (« Briefe eines Unbekannten », p. 396), cf.<br />
p. 389 : « …die Neidung…, Werke der Dichter… in den Umgebungen, wo<br />
sie entstanden, zu lesen. …Dieses Zusammenwirken des ambierenden<br />
Mediums mit den darin entstandenen Geistesprodukten… ». Ainsi Villiers<br />
traduit le français milieu ambiant par le vieux mot allemand Umgebungen.<br />
J’ai également rencontré ce mot dans Vorlesungen über dramatische<br />
Kunst (1808) d’A. W. Schlegel, où il affirme que la peinture peut<br />
décrire l’homme dans son Umgebungen ; de même que dans les Tagebücher<br />
de Hebbel à la date 24 novembre 1843 : « Im Jardin des Plantes :<br />
jedes Tier hat eine Umgebung, wie in dem Lande, woher es kommt.<br />
Dem Renntier fehlt die Lappenhütte nicht usw » ; enfin chez Raimund<br />
(cf. l’introduction au Raimunds Leben und Werke, Fürst éd., p. xxii) : « Die<br />
Umgebungen, mit denen ich zu leben gezwungen bin, werden täglich<br />
abscheulicher… [il doit décider] die falschen Steine aus dem Ring seiner<br />
Umgebungen auszubrechen » [c’est-à-dire en évitant tout contact<br />
avec un certain compagnon de scène ; ici, « environnement » correspond<br />
clairement à un environnement humain].<br />
9 Le Dr. Max Weinreich me signale un emploi yiddish moderne, rappelant<br />
stämning-Stimmung, qui a pu être influencé par la théorie du<br />
milieu : le mot svive (d’origine hébraïque) — « alentour » [surrounding] a<br />
développé une signification qu’il me définit à l’aide de deux épithètes<br />
allemandes très proches de Stimmung : « gemütliche, anheimelnde<br />
Gesellschaft von Gleichgesinnten, ohne die das Leben hart und einsam<br />
scheint » (un journal littéraire comportant le nom Svive a récemment<br />
été trouvé).
480<br />
CONFÉRENCE<br />
(« Umwelt und Innenwelt der Tiere », 1909). Il oppose l’objectif<br />
Umgebung (les environs de l’animal), au subjectif Umwelt — cet<br />
ensemble de choses qu’il est capable de percevoir, un ensemble<br />
qui a besoin de varier bien plus largement pour chaque animal<br />
individuel que pour les êtres humains : « jedes Tier besitzt seine<br />
eigene Umwelt ». À ce monde personnel extérieur correspond<br />
l’Innenwelt (également appelé Gegenwelt, un mot probablement<br />
formé à partir de Gegenstand = objectum, Konterfei = « image,<br />
contrefaçon », etc.) qui comprend les images sensorielles du<br />
monde extérieur telles qu’elles existent dans l’esprit de l’animal.<br />
Von Uexküll poursuit et suggère que l’acte d’uriner contre les<br />
arbres et les poteaux chez le chien représente un type de délimitation<br />
délibérée de son Umwelt. Il suggère en outre que lorsque le<br />
chien exécute ce que nous aimons appeler « obéir à son maître »,<br />
il ne fait que réagir à un objet familier (le Maître) dans le cadre de<br />
son Umwelt (Montaigne s’est demandé il y a longtemps : « Quand<br />
je joue avec mon chat, qui sait s’il ne s’amuse pas plus de moi que<br />
je le fais de lui ? »). La perception donnée à l’être particulier<br />
(« alles was ein Subjekt merkt ») constitue son Merkwelt ; la sphère<br />
de ses activités (« alles was er wirkt ») constitue son Wirkwelt, de<br />
sorte qu’Umwelt = Merkwelt + Wirkwelt. Un autre travail d’Uexküll,<br />
un livre de vulgarisation scientifique publié en 1934, porte le titre<br />
de « Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen,<br />
ein Bilderbuch unsichtbarer Welten », et contient un exemple<br />
intéressant du pluriel d’Umwelt jusqu’ici inutilisé, mais assez<br />
logique dans le système de l’auteur (« à chaque animal son Umwelt<br />
propre ») ; il illustre également la vieille relation entre Umwelt et le<br />
monde intérieur « invisible » 10 .<br />
10 Sauf le défaut d’infini dans son système des « mondes », les conceptions<br />
de von Uexküll rappellent la « monadologie » de Leibniz ; cf. « il y<br />
a comme autant de différents univers, qui ne sont pourtant que les<br />
perspectives d’un seul* » ; « l’univers n’est pas un : il se reproduit<br />
autant de fois qu’il existe des substances* ». Un animal est une monade
LEO SPITZER<br />
481<br />
On voit la même affinité entre Umwelt et Welt dans l’« Existenzphilosophie<br />
» de Heidegger pour qui Welt implique le fait<br />
d’être-au-monde (en parallèle avec l’évolution que nous avons<br />
notée « être au milieu* », }μ ¥Ä«È > « le milieu, ¥Ä«∑μ »). Ce Welt<br />
peut renvoyer soit à « die öffentliche Wir-Welt » soit à « die<br />
“ eigene ” und nächste (häusliche) Umwelt » ; cf. Sein und Zeit, I,<br />
66 :<br />
Die nächste Welt des alltäglichen Daseins ist die Umwelt. Die<br />
Untersuchung nimmt den Gang von diesem existenzialen Charakter<br />
des durchschittlichen In-der-Welt-seins zur Idee von Weltlichkeit<br />
überhaupt. Die Weltlichkeit der Umwelt (die Umweltlichkeit)<br />
qui « perçoit » tout comme vous et moi — à la différence qu’il perçoit<br />
selon le point de vue* d’un animal : d’où l’expression de Leibniz points<br />
métaphysiques*, synonyme de « monades » ; la monade, « ut anima, est<br />
velut mundus quidam proprius », c’est un « univers concentré* » (ici, c’est à<br />
une ultime dérivation de l’idée de microcosme que nous avons affaire :<br />
mundo abreviado, petit monde*, monde abrégé*, etc.). H. Heimsoeth, Die<br />
sechs grossen Themen der abendländischen Metaphysik (1934), p. 100, parle<br />
de l’univers de Leibniz comme « diese Welt Realität gewordener<br />
Blicke » : un monde de points de vue devenus réels, et que le Créateur<br />
considère, « es gleichsam drehend nach allen Seiten » ; (p. 137) « Die<br />
Seele ist nicht mehr im Raume… sondern die Aussenwelt… ist ein<br />
Erscheinen in der Seele ». — Dans le cas d’un certain Volksmärchen<br />
raconté par Musäus, un satiriste allemand du dix-huitième siècle, on<br />
trouvera peut-être l’influence des monades de Leibniz : Rübezahl, l’esprit<br />
malveillant qui ne peut garder en mémoire l’image d’une belle<br />
princesse qu’il avait autrfois vue en train de se baigner, décide, afin de<br />
la retrouver, de devenir corbeau — mais pour s’apercevoir alors qu’il<br />
voit tout avec les yeux d’un corbeau, qu’il éprouve les sentiments d’un<br />
corbeau (un nid de mulots l’intéresse davantage qu’une nymphe au<br />
bain). C’est seulement après s’être à nouveau métamorphosé, cette fois<br />
en jeune homme, qu’il est capable de se rappeler et de comprendre<br />
l’idéal parfait d’une magnifique jeune fille. Voici la morale de<br />
l’histoire : « die Seele wirkt in ihrem Denken und Wollen nie anders als<br />
in Gemässheit des Körpers, der sie umgibt » (= corpus ambiens).
482<br />
CONFÉRENCE<br />
suchen wir im Durchgang durch eine ontologische Interpretation<br />
des nächstbegegnenden inner-inweltlichen Seienden. Der Ausdruck<br />
Umwelt enthält in dem « Um » einem Hinweis auf Räumlichkeit.<br />
Das « Umherum », das für die Umwelt konstitutiv ist, hat<br />
jedoch keinen primär « räumlichen » Sinn. Der einer Umwelt<br />
unbestreitbar zugehörige Raumcharakter ist vielmehr erst aus der<br />
Struktur der Weltlichkeit aufzuklären. Von hier aus wird die...<br />
Räumlichkeit des Daseins phänomenal sichtbar. Die Ontologie hat<br />
nun aber gerade versucht, von der Räumlichkeit aus das Sein der<br />
« Welt » als res extensa zu interpretieren. Die extremste Tendenz zu<br />
einer solchen Ontologie der « Welt » und zwar in der Gegenorientierung<br />
an der res cogitans, die sich weder ontisch noch ontologisch<br />
mit Dasein deckt, zeigt sich bei Descartes. Durch die<br />
Abgrenzung gegen diese ontologische Tendenz kann sich die hier<br />
versuchte Analyse der Weltlichkeit verdeutlichen.<br />
Heidegger discute la conception cartésienne de l’espace<br />
comme contenant qui comprend le « Welt » ; pour lui, il est évident<br />
(p. 101) :<br />
11 On peut remarquer la dette dont Heidegger est redevable à son<br />
maître Husserl ; tout ce dont nous avons besoin pour faire le rapprochement<br />
se trouve dans l’article de L. Landgrebe, « The World as a<br />
Phenomenological Problem » (Philosophy and Phenomenological<br />
Research, I, 39 ff.). Husserl avait commencé avec la théorie de la « perception<br />
» ; c’est d’après lui une « exception », où l’objet perçu se distingue<br />
d’un arrière-plan plus ou moins distinctement perçu. Il parle<br />
d’un « horizon » éternel autour de l’objet perçu : d’abord, un horizon<br />
spatial, notre monde environnant. Élargissant les proportions étroites<br />
de cette théorie de la perception, il envisage « le monde » comme « la<br />
base doxique tout embrassante [all-embracing], l’horizon total qui<br />
comprend tout être-posé particulier », « l’horizon de toute notre disposition<br />
à être [attitude] ». Pour citer un extrait significatif des<br />
« Ideen », § 27-28 (« Die Welt der natürlichen Einstellung : Ich und<br />
meine Umwelt ») :
LEO SPITZER<br />
483<br />
wie das Umhafte der Umwelt, die spezifische Räumlichkeit des in<br />
der Umwelt begegnenden Seienden selbst durch die Weltlichkeit<br />
der Welt fundiert und nicht umgekehrt die Welt ihrerseits im<br />
Raum vorhanden ist 11 .<br />
Aber auch nicht mit dem Bereiche dieses anschaulich klar oder dunkel,<br />
deutlich oder undeutlich Mitgegenwärtigen, das einen beständigen<br />
Umring des aktuellen Wahrnehmungsfeldes ausmacht, erschöpft sich<br />
die Welt, die für mich in jedem wachen Moment bewusstseinsmässig<br />
‘vorhanden’ ist. Sie reicht vielmehr in einer festen Seinsordnung ins<br />
Unbegrenzte. Das aktuell Wahrgenommene, das mehr oder minder klar<br />
Mitgegenwärtige oder Bestimmte ist teils durchsetzt, teils umgeben von<br />
einem dunkel bewussten Horizont unbestimmter Wirklichkeit… In dieser<br />
Weise finde ich mich im wachen Bewusststein allzeit, und ohne es je<br />
ändern zu können, in Beziehung auf die eine und selbe, obschon dem<br />
inhaltlichen Bestande nach wechselnde Welt. Sie ist immerfort für<br />
mich “ vorhanden ”, und ich selbst bin ihr Mitglied. Dabei ist diese<br />
Welt für mich nicht da als eine blosse Sachenwelt, sondern in derselben<br />
Unmittelbarkeit als Wertewelt, Güterwelt, praktische Welt. [C’est Husserl<br />
qui souligne.]<br />
Les « différents mondes » qui entourent divers individus, formés par<br />
les communautés particulières auxquelles les individus appartiennent<br />
« ici », et distincts selon les critères de distance et les degrés de familiarité<br />
qui s’ensuivent (Ichnähe – Ichferne), sont eux-mêmes absorbés dans<br />
le Monde, ou la Nature, qui étreint tout [all-embracing World] (« Sein in<br />
der Welt » est la caractéristique principale de la « natürliche Einstellung<br />
»). — Le choix du mot Horizont s’explique par le fait que Husserl<br />
est parti d’une théorie de la perception : il est évident qu’il a transféré<br />
la théorie des champs (cf. les Notizen zur Raumkonstruktion publiées<br />
posthumément dans Philosophy and Phenomenological Research) d’abord<br />
à la perception elle-même (comme l’indique l’expression allemande<br />
Gesichtsfeld, Wahrnehmungsfeld), ensuite au « monde » lequel, dans<br />
l’usage restreint qu’en fait Husserl, équivaut en général à l’Umwelt.<br />
Ainsi Umwelt triomphe pendant que Welt est oublié — preuve saisissante<br />
de l’isolement méditatif de ce penseur allemand au milieu d’un
484<br />
CONFÉRENCE<br />
Ainsi Umwelt, avec ses connotations quasi-spatiales (comme<br />
l’indique le préfixe um- 12 ), devient le caractère constitutif de l’existence<br />
humaine. Aussi bien dans sa vie quotidienne que dans l’en-<br />
monde qui n’a jamais été si large ni si ouvert ! Ce Welt de Husserl (qui<br />
est l’Umwelt privé du préfixe √|ƒ§), Landgrebe le traduit en anglais par<br />
« life-world – le monde de la vie » (une création qui signifie simplement<br />
« le monde dans lequel nous vivons ») ; ce faisant, il est involontairement<br />
retourné à l’étymologie de world (« wer-alt », « époque, vie de<br />
l’homme », « saeculum »). Le terme ne signifie pas « environnement »,<br />
ni même « milieu » : il touche essentiellement à la théorie des<br />
« champs » et, dans la terminologie de Husserl, il est le mieux placé<br />
pour traduire ce terme technique de la physique (contrairement à<br />
milieu qui, nous l’avons vu, n’est pas entré dans le vocabulaire de la<br />
science moderne). — Il est bien connu que Husserl, en accord avec<br />
l’aphorisme de Condillac « Une science n’est qu’une langue bien<br />
faite », a formé pour ses besoins son propre langage en rendant explicites<br />
des connotations revenant aux mots allemands, parfois en restaurant<br />
leurs usages littéraux ou archaïques (pour un exemple de ce dernier<br />
fait, cf. le umbering médiéval qu’on retrouve dans Umring cité plus<br />
haut) ; il n’a cependant pas cédé à ce procédé dans la même excessive<br />
proportion qui caractérise Heidegger. — Celui-ci, qui adopta de<br />
manière générale l’approche de son maître, ne s’est pas intéressé au<br />
concept de « champ » (c’est pourquoi chez lui il y a une insistance sur<br />
le préfixe de Um-welt) ; il nous montre l’homme s’enracinant désespérément<br />
dans son Umwelt ; Umhaftes der Welt est la caractéristique principale<br />
de son Dasein = In-der-Welt-sein : avec lui, √|ƒ§- est rétabli dans<br />
toute sa force. Le propos de Heidegger n’est pas de révéler les structures<br />
au grand jour au point de se concentrer sur « l’environnementalité<br />
» [surroundedness] de l’homme. Il n’est pas surprenant qu’il ait abandonné<br />
l’Horizont de Husserl : il se pourrait qu’un mot étranger ne<br />
convînt pas à ses goûts linguistiques. Mais plus encore, ce terme, si<br />
attaché à la nature, révèle clairement son lien avec la théorie de la perception<br />
; il a de plus des connotations d’éloignement, alors que Heidegger<br />
préfère plutôt le « pathos de la proximité » ; il est fasciné davantage<br />
par les phénomènes manifestant Ichnähe : « Im dasein liegt eine
LEO SPITZER<br />
485<br />
semble de son existence, l’homme vit dans un um- ; il ne reste de<br />
la vision cosmique du « monde-jaune d’œuf » que l’idée d’être « à<br />
l’intérieur-du-jaune d’œuf ». L’opposition entre le ego cogitans de<br />
wesenhafte Tendenz auf Nähe ». Pour lui, la radio est le symbole de<br />
l’absorption du monde par l’homme (une « Ent-fernung »), qui alors<br />
élargit son Umwelt (bien que cette manifestation si typique d’universalité<br />
puisse tout autant être pensée en termes d’absorption de l’homme<br />
dans les ondes et la distance — une « Fernung »). — Et donc, afin de se<br />
libérer de son sentiment de confinement [boxed-in feeling], Heidegger a<br />
besoin d’imiter les grands mouvements désespérés de son Führer, en<br />
se tournant brusquement vers l’activisme, ce qui est fort éloigné de<br />
l’attitude méditative de Husserl : il conduit le praktische Welt de son<br />
maître vers le Lebensraum d’une Allemagne maître du monde via un<br />
Arbeitswelt. Ainsi, Welt acquiert une nouvelle universalité, née de<br />
l’étroitesse et du désespoir. — La spatialisation d’Umwelt, évidente<br />
chez Husserl, est mise en œuvre par l’attitude animiste d’un autre de<br />
ses étudiants, le linguiste H. Ammann, qui voit dans le « il » impersonnel<br />
de es ist kalt « die räumliche Umwelt schlechthin », le « Lebensraum<br />
» (Festschrift E. Husserl, 1929, pp. 1 ff.) ; et dans celui de es dämmert<br />
[« il fait jour » – it dawns] « das immer gegenwärtige Antlitz der Welt » :<br />
« Als tiefste Wurzel des verbalen Ausdrucks fühlen wir das Verbundensein<br />
mit der Welt, das Durchdrungensein von ihrem Pusschlag ». (Nous<br />
sommes à présent familiers de l’expression « la pulsion de vie » ; ici,<br />
c’est Welt [qui, comme chez Husserl, équivaut à Umwelt] qui « palpite ».)<br />
— (Dans son article « Quevedo und Heidegger » [Deutsche Vierteljahrsschr.,<br />
XVII (1939), 403] Pedro Laín Entralgo a opposé l’héroïsme morbide<br />
de Heidegger devant le Rien, son absence totale du sentiment de<br />
la Renaissance — « Moi et le Monde », à la philosophie de Quevedo<br />
qui, tout en représentant le déclin de ce même sentiment de la Renaissance,<br />
connaît néanmoins une consolation pour l’homme : donec<br />
requiescat in Te.)<br />
12 L’interprétation du mot Umwelt par Heidegger se fonde sur son sentiment<br />
personnel au sujet du langage vivant : il ne se préoccupe pas de<br />
l’histoire des mots. Un tel procédé est parfaitement légitime étant<br />
donné que la philosophie vise en général à l’éclaircissement des usages
486<br />
CONFÉRENCE<br />
Descartes et la res extensa a disparu. Cette philosophie spatialise<br />
l’esprit humain, représentant à cet égard le développement de<br />
l’Untergangsstimmung de Spengler bien plus que celle de la philo-<br />
du discours humain afin de remonter au jour ses tendances cachéees ;<br />
de plus, et dans ce cas précis, le Urgefühl de « l’être-au-monde » tend<br />
même à se soutenir. Dans d’autres cas pourtant, Heidegger a recours à<br />
l’étymologie historique comme quand, en accord avec Jakob Grimm, il<br />
analyse les prépositions in et an (anglais on, français sur) pour montrer<br />
l’empreinte de « l’être-au-monde » dans le langage :<br />
« in » stammt von innen-wohnen, habitare, sich aufhalten ; « an »<br />
bedeutet : ich bin gewohnt, vertraut mit, ich pflege etwas ; es hat die<br />
Bedeutung von colo im Sinn von habito und diligo… Der Ausdruck<br />
« bin » hängt zusammen mit « bei » ; « ich bin » besagt wiederum : ich<br />
wohne, halte mich auf bei… der Welt, als dem so und so Vertrauten.<br />
Quoique ces spéculations étymologiques soient fortement discutables<br />
(ich bin par exemple s’explique aujourd’hui comme égal à ⁄Õ∑¥`§—<br />
« devenir » ; bei = a¥⁄§- , amb-, umbi-), Heidegger a raison dans sa perspective<br />
de restituer son atmosphère originelle, la « chaleur du milieu »,<br />
à une préposition aussi banale que in (comparable, dans sa relation à<br />
l’anglo-saxon inne — « maison », anglais inn, au français chez — casa<br />
« dans la maison de »). Mais je reste sceptique devant l’emploi de l’étymologie<br />
quand un philosophe choisit arbitrairement un barreau particulier<br />
de l’échelle sémantique dans l’intention de justifier sa propre<br />
philosophie à l’aide des « leçons que nous enseigne la langue ». À propos<br />
de um-, Heidegger s’en tient aux significations suggérées par<br />
l’usage allemand actuel, ignorant l’idée originelle présente dans la<br />
racine indo-européenne (nous avons déjà discuté de la relation du grec<br />
a¥⁄§- , du latin amb- avec e¥⁄›, ambo qui suggère l’idée « des deux<br />
côtés » [cf. beide, « both — les deux » et « by — à côté »], et non pas<br />
« autour » comme circum) ; quant aux prépositions in, an, bin, il se rend<br />
coupable de conjecture linguistique fantaisiste sous couvert d’histoire<br />
des mots. S’il a raison de définir comme il l’entend tout terme donné<br />
selon son emploi dans le langage courant, il n’est pas acceptable de
LEO SPITZER<br />
487<br />
sophie idéaliste allemande : alors que cette dernière était caractérisée<br />
par une vision cosmique (Schelling), Heidegger installe le<br />
siège du « monde » dans l’existence de l’individu à l’intérieur de<br />
laquelle le um- est vivant. Avec lui alors, la vieille idée mystique et<br />
piétiste de l’Innerweltlichkeit (d’un Nicolas de Cuse qui comprendrait<br />
l’univers et Dieu intra regionis suae circulum, ou d’un Ruysbroeck<br />
dont le monde intérieur autant que son « ambiente » est<br />
empli de Dieu : « In mir got, buissen mir got, umle mich und<br />
umbrings got, Alles Got, ich en weyss nit sonder got ») est poussée<br />
à un tel point d’existentialisme que le « milieu », en tant que réalité<br />
objective, disparaît entièrement. L’essence de l’existence telle<br />
que la voit Heidegger correspond à sa « tension d’intentionnalité<br />
», à son « sein zu ». L’existence est orientée vers la mort et il<br />
n’existe qu’une seule possibilité de libération pour une vie dont<br />
le sens est la mort — c’est la « vie héroïque » qui accepte la mort.<br />
De manière assez ironique, il a suffi d’une légère modification<br />
pour transformer cet Umwelt sans substance en un Lebensraum 13<br />
donner l’impression que les mots du langage de quiconque (ici l’allemand)<br />
ont, par nature, le sens que chacun voudrait leur attribuer. De plus, l’universalité<br />
des affirmations de Heidegger est sapée lorsqu’il essaie d’étayer sa<br />
philosophie au moyen de la relation étymologique des mots dans une seule<br />
langue : il frôle le faiseur de calembours pseudo-philosophiques, le rhétoriqueur*<br />
contre qui le rire rabelaisien était une saine attitude.<br />
13 L’idée de « Lebensraum » et de « Umwelt » existait dans une certaine<br />
mesure dans le Peter Schlemihl (1814) de von Chamisso — l’histoire d’un<br />
homme sans ombre. En réponse à ceux qui s’inquiétaient de la signification<br />
de l’ombre le romancier, également un scientifique, répliqua :<br />
l’ombre représente un solide dont la forme dépend à la fois de celle du<br />
corps lumineux, de celle du corps opaque et de la position de celui-ci à<br />
l’égard du corps lumineux… Mon imprudent ami a convoité l’argent<br />
dont il connaissait le prix, et n’a pas songé au solide ; la leçon qu’il a<br />
chérement payée, il veut qu’elle nous profite, et son expérience nous<br />
crie : songez au solide ! (Préface à la traduction française de 1838.)
488<br />
CONFÉRENCE<br />
très concret que l’homme, c’est-à-dire le peuple allemand, était en<br />
droit de revendiquer, et transformer l’Innerweltlichkeit allemande<br />
en une volonté de domination du monde. Dans un article de Der<br />
Il y a ici la notion d’un halo autour de la personnalité : un halo né avec<br />
la personnalité et comparable à un corps solide. Tel que ce demiromantique<br />
l’emploie, le mot « ombre » nous renvoie plutôt à la psychologie<br />
pré-logique des contes populaires primitifs, et à la conception<br />
chrétienne de « l’ombre » = « l’âme » (l’âme, si elle est vouée au diable,<br />
n’est qu’une ombre, irréelle). — Le mot Lebensraum quant à lui semble<br />
être de l’invention de Goethe ; le DWb. (et non le Goethe-Wörterbuch de<br />
Fischer) répertorie cet extrait (que je n’ai pu situer dans les éditions<br />
modernes) : « in einem solchen gedränge treten zuletzt alte gewohnheiten,<br />
alte neigungen wieder hervor, um die zeit zu tödten und den<br />
Lebensraum auszufüllen » — à partir duquel il est évident qu’avec<br />
Goethe, ce mot voulait désigner l’analogon spatial du temps alloué à<br />
l’individu : « l’espace entourant et donné naturellement à l’individu »,<br />
avec une insistance sur le sentiment personnel de cet espace : Lebensraum<br />
signifiait assurément ici (comme il convient à l’attitude tranquille<br />
et souveraine du Lebensgefühl de Goethe) « l’espace auquel l’homme<br />
pense lui-même avoir droit » ; c’est, pour ainsi dire, un récipient spacieux<br />
qu’il possède naturellement, et qu’il peut emplir de diverses<br />
façons ; il ressemble à la Lebenskreis, au Spielraum ou à la Spielkreis* –<br />
l’espace dans lequel les enfants jouent librement (ou bien où jouent les<br />
forces naturelles, avec la liberté des enfants). On emploie encore<br />
Lebensraum avec le sens de « la grandeur naturelle de l’environnement<br />
de l’homme » (Börne, vers 1830, dans Fastenpredigt über die Eifersucht),<br />
qui oppose la maladie de la jalousie à des affections mineures comme<br />
la scarlatine : la première emplit entièrement « die grossen Lebensräume<br />
des ausgebildeten Mannes und Weibes », la seconde ne faisant que<br />
rider la surface de la vie humaine.<br />
[* Spielkreis lui-même pouvait servir de synonyme de milieu ambiant :<br />
en 1836, Adolf Schöll écrit au sujet d’Eichendorff (cf. Eichendorff<br />
Werke, R. Dietze éd., I, 323) que « seine Gestalten und Handlungen ihre<br />
Gründe und farbigen Spielkreise mit sich bringen, die umfassende Natur
LEO SPITZER<br />
489<br />
Alemanne (III, 1934), Heidegger, alors philosophe nazi, cherche à<br />
expliquer ce que le paysage bien-aimé autour du Scharzwald<br />
représentait pour lui — ce paysage qu’il a refusé d’abandonner<br />
nur die begleitende Ruhe der Bewegung… ist ». L’épithète farbige suggère<br />
que l’écrivain continue de voir dans le mot Spielkreise quelque<br />
chose de l’univers de jeu des enfants.]<br />
Si l’on voulait que naisse une pensée géopolitique, il fallait qu’intervînt<br />
la notion de Raumgefühl du géographe allemand Ratzel dans son application<br />
à des entités nationales et géographiques (une application que<br />
l’école française des géographes a toujours rejetée) : l’idée selon<br />
laquelle il existe des nations plus « sensibles » que d’autres à l’espace<br />
qu’elles occupent. Sur la récente évolution du Lebensraum, on est<br />
informé au mieux et de la manière la plus capitale par Erik Vögelin,<br />
Journal of Politics, II, 191, qui analyse de la façon suivante :<br />
…le mot Lebensraum ne peut être traduit en langage occidental. Si on<br />
le traduit par « espace vivant » [living space], on indique par là que le traducteur<br />
peut utiliser un dictionnaire, mais c’est tout… Aucune combinaison<br />
de mots anglais ne peut communiquer pleinement les connotations<br />
biologiques, collectivistes, géopolitiques et métaphysiques du mot<br />
allemand.<br />
note : L’argument de ce paragraphe pourrait sembler reposer indûment<br />
sur des subtilités philologiques. On doit cependant comprendre que le<br />
vrai problème de la traduction d’un ensemble de symboles d’une<br />
langue dans une autre consiste dans la différence des valeurs culturelles<br />
telles que la langue les manifeste. L’allemand, en tant qu’instrument<br />
en évolution de processus culturels allemands, a développé<br />
depuis la deuxième moitié du dix-huitième siècle un univers de significations<br />
néo-païennes qui n’a pas son équivalent dans tout l’Occident…<br />
En effet, Lebensraum (ainsi que d’autres inventions néo-païennes<br />
comme raumgeistig, Blutgedanke, Leibseelentum) trahit une tendance<br />
contraire au reditus in se ipsum : il suggère un mouvement hors de l’âme<br />
solitaire et isolée cherchant l’espace dans lequel elle pourrait s’affir-
490<br />
CONFÉRENCE<br />
même pour un poste à l’Université de Berlin. Ce n’était pas<br />
quelque chose à « apprécier » ni à « contempler » ; c’était son<br />
« Arbeitswelt » dans lequel il devait agir et travailler. Cet Arbeitswelt<br />
mer et perdre sa séparation d’avec le monde — et un mouvement corporel<br />
plutôt que spirituel. Mais à présent, les Allemands dotent l’espace<br />
de spiritualité païenne : ils furent geistig, ils sont maintenant<br />
raumgeistig – une fusion paradoxale des deux Allemagne*! — Lebensraum<br />
est fort éloigné de ce Weltinnenraum (dans quoi l’âme devait<br />
croître comme un arbre) tel que le concevait Rilke, Gesamm. Werke, III,<br />
452 : « Durch alle Wesen reicht der eine Raum : / Weltinnenraum. Die<br />
Vögel fliegen still / durch uns hindurch. O, der ich wachsen will, / ich<br />
seh hinaus, und in mir wächst der Baum ». On peut dire que Rilke avait<br />
une obsession de « l’espace » (on l’a vu plus haut [n. 70] dans son aversion<br />
pour le milieu [selon lui nécessairement surpeuplé]) : la croissance<br />
naturelle (comme celle de l’arbre) n’usurpe pas l’espace ; pour Rilke, la<br />
seule manière convenable d’« occuper l’espace » consiste à renoncer à<br />
l’espace « spatial », pour le transformer en espace « intérieur » et communicant<br />
de ce fait avec l’univers par le biais d’un « espace-monde<br />
intérieur ». Cela, les roses peuvent nous l’enseigner (ib. 110) : « Lautlos<br />
Leben, Aufgehn ohne Ende, / Raumbrauchen, ohne Raum von Jenem<br />
Raum / zu nehmen, den die Dinge rings verringern, / fast nicht Umrissen-sein<br />
wie Ausgespartes / und lauter Inners, viel seltsam Zartes / und<br />
Sich-Bescheidendes bis an den Rand… / Und sind nicht alle so, nur<br />
sich enthaltend, / wenn Sichenthalten heisst : die Welt da draussen /<br />
und Wind und Regen… / bis auf den vagen Einfluss ferner Sterne / in<br />
eine Hand voll Innres zu verwandeln ? » On peut remarquer l’ambivalence<br />
de sich enthalten :1.se abstinere, « renoncer » = 2. se continere,<br />
« contenir la totalité de son moi » : le renoncement est la ruse métaphysique<br />
de la rose, par quoi le rejet d’un développement extérieur se<br />
transforme en vie intérieure puissante [potentiated] et débordante (cf.<br />
également le poème « Das Roseninnere » : « Sie können sich selber<br />
kaum / halten ; viele liessen / sich überfüllen und fliessen über von<br />
Innenraum… ») ; (p.441) : « Raum greift aus uns und übersetzt die<br />
Dinge : / dass dir das Dasein eines Baums gelinge, / wirf Innenraum um<br />
ihn, aus jenem Raum, / der in dir west. Umgib ihn mit Verhaltung. / Er
LEO SPITZER<br />
491<br />
(un mot inventé d’après Arbeitsfeld — et peut-être également<br />
d’après le Wirkwelt d’Uexküll) fournit le chaînon manquant entre<br />
l’Umwelt — « le monde autour de l’individu tel qu’il est vu par<br />
grenzt sich nicht. Erst in der Eingestaltung / in dein Verzichten wird er<br />
wirklich Baum » — la rime Raum-Baum définit le problème de l’espace<br />
rilkéen : l’arbre a un « espace intérieur » autour de lui parce qu’il est<br />
auto-suffisant [self-contained]. — Seuls les arbres, les fleurs, les animaux,<br />
les enfants et les dieux vivent dans un espace extérieur pur et<br />
inchangé (qui est vierge [unpossessed]) : (p. 293, 8 e élégie) : « Wir haben<br />
nie, nicht einen einzigen Tag, / den reinen Raum vor uns, in den die<br />
Blumen / unendlich aufgehn. Immer ist es Welt / und niemals Nirgends<br />
ohne Nicht : / das Reine, Unüberwachte, das man atmet und / unendlich<br />
weiss und nicht begehrt ». (p. 398) : « wer darf noch an den Nachtraum<br />
/ die Stirne lehnen wie ans eigne Fenster ? / … / Wir lassen Götter<br />
stehn um goren Abfall, / denn Götter locken nicht. Sie haben<br />
Dasein/ und nichts als Dasein, Überfluss von Dasein… ». La nuit<br />
étoilée délivre l’espace de sa puissance obsédante, le remplaçant par<br />
son propre visage intérieur ; (p. 418) : « Statt in die Kissen, / weine<br />
hinauf. Hier, an dem weinenden schon, / an dem endenden Antlitz, /<br />
um sich greifend, beginnt der hinreissende Weltraum / … / Atme das<br />
Dunkel der Erde und wieder / aufschau ! Wieder, leicht und gesichtlos,<br />
/ lehnt sich von oben Tiefe dir an. Das gelöste / nachtenthaltne Gesicht<br />
gibt dem deinigen Raum ». — Rilke est capable de donner une dimension,<br />
un poids et une finitude [finiteness] locale à cet espace illimité<br />
(« lehnt sich von oben Tiefe an »). Il décrit son idole Rodin (qu’il admirait<br />
précisément pour sa maîtrise de l’espace) avec les mêmes dimensions<br />
intérieures et les mêmes connotations locales de l’intériorité de<br />
l’arbre : « Tief in sich trug er eines Hauses Dunkel, Zuflucht und Ruhe,<br />
und darüber war er selbst Himmel geworden und Wald herum und<br />
Weite und grosser Strom, der immer vorüberfloss. O was für ein Einsamer<br />
ist dieser Greis, der versenkt in sich selbst, voller Säfte steht wie<br />
ein alter Baum im Herbst. Er ist tief geworden ; seinem Herzen hat er<br />
eine Tiefe gegraben, und sein Schlag kommt fernher wie aus eines<br />
Gebirges Mitte. Seine Gedanken gehen in ihm umher und füllen<br />
ihn an mit Schwere und Süssigkeit und verlieren sich nicht an die
492<br />
CONFÉRENCE<br />
celui-ci » — et le Lebensraum — « le monde dans lequel il doit lui<br />
(et son peuple avec lui) être permis de vivre », c’est-à-dire un<br />
monde qu’il doit développer par la conquête. Le monde intérieur<br />
des mystiques est devenu extraverti : dans l’index de l’Einführung<br />
in die Völkerpsychologie (1938) de Willy Helpach, le précédent candidat<br />
démocrate à la présidence du Reich qui devint nazi, on trouve<br />
« Umwelt, pp. 42 f. » (en caractères gras), renvoyant ostensiblement<br />
Oberfläche. Er ist stumpf geworden und hart gegen das Unwichtige,<br />
und, wie von einer alten Rinde umgeben, steht er unter den Menschen<br />
» (lettre du 8 août 1903). Si « l’arbre » Rodin a également plus de<br />
profondeur que de hauteur, c’est à cause de l’idée mystique suggérée<br />
par l’expression in sich selbst versenkt, de chute dans son propre lieu ou<br />
son propre « sol » (cf. note 10 de l’article principal) ; c’est un arbre qui<br />
croît vers ses racines. — Et c’est justement l’effort de Rilke (lettre du 11<br />
novembre 1906) de croître vers ses racines, et d’acquérir un espace<br />
intérieur et des choses intérieures, au détriment d’un développement<br />
vers l’extérieur et des biens extérieurs : « Es gibt vielleichts nichts so<br />
Eifersüchtiges wie meinen Beruf ; und nicht ein Mönchsleben wäre<br />
meines in eines Klosters Zusammenschluss und Abtrennung, wohl<br />
aber muss ich sehen, nach und nach zu einem Kloster auszuwachsen<br />
und so dazustehn in der Welt, mit Mauern um mich, aber mit Gott und<br />
den Heilligen in mihr, mit sehr schönen Bildern und Geräten in mihr,<br />
mit Höfen, um die ein Tanz von Säulen geht, mit Fruchtgärten, Weinbergen<br />
und Brunnen, deren Grund gar nicht zu finden ist. » Ainsi,<br />
Rilke, fidèle à la tradition augustinienne, a enrichi le nombre des sens<br />
intérieurs d’un « Raumsinn », dépouillé de tout élément possessif et<br />
impérialiste. Il est « profond » et non « superficiel ». — La même tendance<br />
« vers l’extérieur » a-rilkéenne de l’emploi de Lebensraum peut<br />
être observée dans l’emploi du mot Reich. On trouve dans la terminologie<br />
chrétienne de l’allemand l’expression Reich der Seele, en accord<br />
avec l’importance du monde intérieur du « royaume » dans l’Évangile<br />
(mein Reich ist nicht von dieser Welt — mon royaume n’est pas de ce monde).<br />
Le maintien par la République allemande de l’expression officielle<br />
Deutsches Reich était caractéristique dans son insistance sur la continuité<br />
des prétentions mondiales de l’Allemagne. Le Professeur Wörrer,
LEO SPITZER<br />
493<br />
au passage principal où l’idée de milieu est traitée. Et voici ce qu’il<br />
est écrit p. 42 : « Der Volkslebensraum : Klima und Landschaft » !<br />
Dans Beiträge zur Gesch. d. deutschen Sprache und Lit., 1940, un<br />
article porte le titre suivant : « Die politische Umwelt des deutschen<br />
Rolandsliedes », et annonce son propos : « die Umwelt und<br />
den Raum seiner Entstehung zu erschliessen ». Aujourd’hui,<br />
Umwelt n’est rien d’autre qu’une paraphrase à la mode pour<br />
« lieu », « endroit » (dans le changement radical de l’Innerweltlichkeit<br />
vers le local, on peut peut-être sentir une certaine correspondance<br />
avec la conception, chez les physiciens modernes, d’un<br />
« objet-dans-le-champ [object-in-the-field] », et avec leur abandon<br />
de l’infinitisme) 14 .<br />
Leo SPITZER.<br />
(Traduit de l’anglais par Olivier Moroni.)<br />
dans une Reichsgründungsfeier d’après guerre, chercha à tout le moins à<br />
fixer l’expression das innere Reich, comme pour compenser la perte de<br />
son empire extérieur par un patriotisme du monde intérieur [innerworldly<br />
patriotism] de la part des Allemands (Würzburg, 1928). Cependant<br />
l’école de Stefan George employait le mot Reich, ce qui implique<br />
la domination et un souverain en termes de nation et de pays ; ainsi, à<br />
ce sujet du moins, ils peuvent être considérés comme ceux qui ont<br />
donné son allure au nouvel impérialisme de ceux qui prenaient plaisir<br />
aux foras ire…<br />
14 On peut montrer comment les idées métaphysiques à la base de la<br />
physique contemporaine peuvent gagner jusqu’à la pensée politique à<br />
travers un parallèle russe.Voici un épisode tiré de « Darkness at Noon »<br />
(1940) d’A. Köstler : une victime des procès politiques en Russie est<br />
assaillie à l’heure de sa mort par la tentation de se laisser aller à l’expérience<br />
mystique qui consiste à se fondre dans l’univers (un sentiment<br />
qu’il appelle le « sens océanique » ; la personne en extase se dissout<br />
comme du sel dans la mer), quand alors l’image d’une page d’un article<br />
sur la finitude [finitism] dans l’astrophysique moderne qu’il avait lu des<br />
années auparavant lui traverse l’esprit comme un éclair. Faisant alors le
494<br />
CONFÉRENCE<br />
parallèle, il se rappelle les exaltations mystiques dont le Parti l’avait<br />
accusé :<br />
Le Parti désapprouvait ces états. Il les appelait du mysticisme petit bourgeois*,<br />
refuge dans une tour d’ivoire… Le « sens océanique » était<br />
contre-révolutionnaire. Car dans la lutte, on doit avoir ses deux jambes<br />
fermement rivées au sol. Le Parti enseignait à chacun comment y parvenir.<br />
L’infini était une quantité politiquement suspecte, le « moi » une qualité<br />
suspecte.<br />
Avec la solidification de l’espace dans la physique moderne se<br />
découvre dans la pensée esthétique moderne une conception proche<br />
de celle des Anciens : dans son traité sur la danse (« Die Welt des Tänzers<br />
», Stuttgart, 1920), Rudolf von Laban parle en des termes rappelant<br />
Aristote, d’un Raumkörper comme d’une sorte de « champ cristallisé ».<br />
K. E. Gilbert rend compte de ses théories dans The Journal of Aesthetics<br />
and Art Criticism, I, 112, dans les termes suivants :<br />
La suite de geste… nécessite un récipient propre pour la contenir. Le récipient<br />
est ce que l’on appelle le Raumkörper. Le corps spatial, qui<br />
occupe le lieu d’un ordre signifiant, doit lui-même s’harmoniser avec<br />
l’expression… ; il doit même prendre part à celle-ci, car il joue un rôle<br />
dans la danse tout autant qu’il la contient. C’est ainsi que l’espace tridimensionnel<br />
dans lequel le danseur dessine ses figures n’est pas fonctionnel.<br />
Ce qui l’entoure est un environnement indifférent, non un<br />
partenaire malléable. L’ordre dans l’espace signifie pour lui une piste<br />
sur le sol, un ensemble de figures linéaires, les cinq positions, comme<br />
on les appelle, qui orientent les seules relations acceptées de ses deux<br />
pieds entre eux, et ses propres trois dimensions… « Le Raumkörper, le<br />
corps-espace, dit Elizabeth Selden, a pour le danseur autant de consistance<br />
et de réalité que le corps physique »…<br />
La danse de Mary Wigman, premier et principal disciple de von Laban,<br />
a beaucoup de liens, selon Gilbert, avec celle de son maître : elle met<br />
en évidence le Raumkörper, les tensions déterminantes et la cristallisation<br />
dans le medium chorique [choric medium].