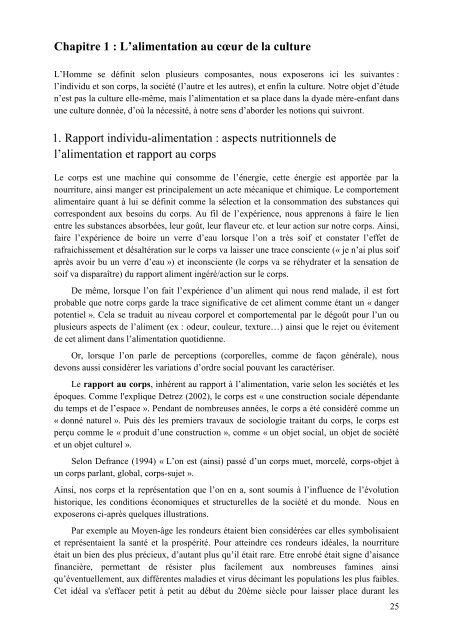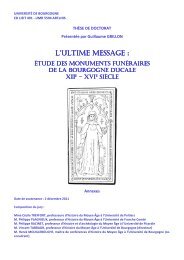La mère, son bébé et la nourriture - Université de Bourgogne
La mère, son bébé et la nourriture - Université de Bourgogne
La mère, son bébé et la nourriture - Université de Bourgogne
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Chapitre 1 : L’alimentation au cœur <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture<br />
L‟Homme se définit selon plusieurs composantes, nous exposerons ici les suivantes :<br />
l‟individu <strong>et</strong> <strong>son</strong> corps, <strong>la</strong> société (l‟autre <strong>et</strong> les autres), <strong>et</strong> enfin <strong>la</strong> culture. Notre obj<strong>et</strong> d‟étu<strong>de</strong><br />
n‟est pas <strong>la</strong> culture elle-même, mais l‟alimentation <strong>et</strong> sa p<strong>la</strong>ce dans <strong>la</strong> dya<strong>de</strong> <strong>mère</strong>-enfant dans<br />
une culture donnée, d‟où <strong>la</strong> nécessité, à notre sens d‟abor<strong>de</strong>r les notions qui suivront.<br />
1. Rapport individu-alimentation : aspects nutritionnels <strong>de</strong><br />
l‟alimentation <strong>et</strong> rapport au corps<br />
Le corps est une machine qui consomme <strong>de</strong> l‟énergie, c<strong>et</strong>te énergie est apportée par <strong>la</strong><br />
<strong>nourriture</strong>, ainsi manger est principalement un acte mécanique <strong>et</strong> chimique. Le comportement<br />
alimentaire quant à lui se définit comme <strong>la</strong> sélection <strong>et</strong> <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong>s substances qui<br />
correspon<strong>de</strong>nt aux besoins du corps. Au fil <strong>de</strong> l‟expérience, nous apprenons à faire le lien<br />
entre les substances absorbées, leur goût, leur f<strong>la</strong>veur <strong>et</strong>c. <strong>et</strong> leur action sur notre corps. Ainsi,<br />
faire l‟expérience <strong>de</strong> boire un verre d‟eau lorsque l‟on a très soif <strong>et</strong> constater l‟eff<strong>et</strong> <strong>de</strong><br />
rafraichissement <strong>et</strong> désaltération sur le corps va <strong>la</strong>isser une trace consciente (« je n‟ai plus soif<br />
après avoir bu un verre d‟eau ») <strong>et</strong> inconsciente (le corps va se réhydrater <strong>et</strong> <strong>la</strong> sensation <strong>de</strong><br />
soif va disparaître) du rapport aliment ingéré/action sur le corps.<br />
De même, lorsque l‟on fait l‟expérience d‟un aliment qui nous rend ma<strong>la</strong><strong>de</strong>, il est fort<br />
probable que notre corps gar<strong>de</strong> <strong>la</strong> trace significative <strong>de</strong> c<strong>et</strong> aliment comme étant un « danger<br />
potentiel ». Ce<strong>la</strong> se traduit au niveau corporel <strong>et</strong> comportemental par le dégoût pour l‟un ou<br />
plusieurs aspects <strong>de</strong> l‟aliment (ex : o<strong>de</strong>ur, couleur, texture…) ainsi que le rej<strong>et</strong> ou évitement<br />
<strong>de</strong> c<strong>et</strong> aliment dans l‟alimentation quotidienne.<br />
Or, lorsque l‟on parle <strong>de</strong> perceptions (corporelles, comme <strong>de</strong> façon générale), nous<br />
<strong>de</strong>vons aussi considérer les variations d‟ordre social pouvant les caractériser.<br />
Le rapport au corps, inhérent au rapport à l‟alimentation, varie selon les sociétés <strong>et</strong> les<br />
époques. Comme l'explique D<strong>et</strong>rez (2002), le corps est « une construction sociale dépendante<br />
du temps <strong>et</strong> <strong>de</strong> l‟espace ». Pendant <strong>de</strong> nombreuses années, le corps a été considéré comme un<br />
« donné naturel ». Puis dès les premiers travaux <strong>de</strong> sociologie traitant du corps, le corps est<br />
perçu comme le « produit d‟une construction », comme « un obj<strong>et</strong> social, un obj<strong>et</strong> <strong>de</strong> société<br />
<strong>et</strong> un obj<strong>et</strong> culturel ».<br />
Selon Defrance (1994) « L‟on est (ainsi) passé d‟un corps mu<strong>et</strong>, morcelé, corps-obj<strong>et</strong> à<br />
un corps par<strong>la</strong>nt, global, corps-suj<strong>et</strong> ».<br />
Ainsi, nos corps <strong>et</strong> <strong>la</strong> représentation que l‟on en a, <strong>son</strong>t soumis à l‟influence <strong>de</strong> l‟évolution<br />
historique, les conditions économiques <strong>et</strong> structurelles <strong>de</strong> <strong>la</strong> société <strong>et</strong> du mon<strong>de</strong>. Nous en<br />
exposerons ci-après quelques illustrations.<br />
Par exemple au Moyen-âge les ron<strong>de</strong>urs étaient bien considérées car elles symbolisaient<br />
<strong>et</strong> représentaient <strong>la</strong> santé <strong>et</strong> <strong>la</strong> prospérité. Pour atteindre ces ron<strong>de</strong>urs idéales, <strong>la</strong> <strong>nourriture</strong><br />
était un bien <strong>de</strong>s plus précieux, d‟autant plus qu‟il était rare. Etre enrobé était signe d‟aisance<br />
financière, perm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> résister plus facilement aux nombreuses famines ainsi<br />
qu‟éventuellement, aux différentes ma<strong>la</strong>dies <strong>et</strong> virus décimant les popu<strong>la</strong>tions les plus faibles.<br />
C<strong>et</strong> idéal va s'effacer p<strong>et</strong>it à p<strong>et</strong>it au début du 20ème siècle pour <strong>la</strong>isser p<strong>la</strong>ce durant les<br />
25