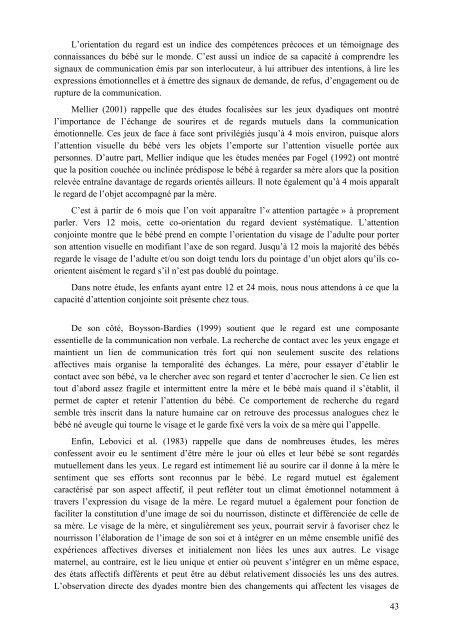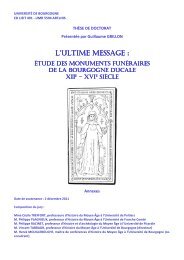La mère, son bébé et la nourriture - Université de Bourgogne
La mère, son bébé et la nourriture - Université de Bourgogne
La mère, son bébé et la nourriture - Université de Bourgogne
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L‟orientation du regard est un indice <strong>de</strong>s compétences précoces <strong>et</strong> un témoignage <strong>de</strong>s<br />
connaissances du <strong>bébé</strong> sur le mon<strong>de</strong>. C‟est aussi un indice <strong>de</strong> sa capacité à comprendre les<br />
signaux <strong>de</strong> communication émis par <strong>son</strong> interlocuteur, à lui attribuer <strong>de</strong>s intentions, à lire les<br />
expressions émotionnelles <strong>et</strong> à ém<strong>et</strong>tre <strong>de</strong>s signaux <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, <strong>de</strong> refus, d‟engagement ou <strong>de</strong><br />
rupture <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication.<br />
Mellier (2001) rappelle que <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s focalisées sur les jeux dyadiques ont montré<br />
l‟importance <strong>de</strong> l‟échange <strong>de</strong> sourires <strong>et</strong> <strong>de</strong> regards mutuels dans <strong>la</strong> communication<br />
émotionnelle. Ces jeux <strong>de</strong> face à face <strong>son</strong>t privilégiés jusqu‟à 4 mois environ, puisque alors<br />
l‟attention visuelle du <strong>bébé</strong> vers les obj<strong>et</strong>s l‟emporte sur l‟attention visuelle portée aux<br />
per<strong>son</strong>nes. D‟autre part, Mellier indique que les étu<strong>de</strong>s menées par Fogel (1992) ont montré<br />
que <strong>la</strong> position couchée ou inclinée prédispose le <strong>bébé</strong> à regar<strong>de</strong>r sa <strong>mère</strong> alors que <strong>la</strong> position<br />
relevée entraîne davantage <strong>de</strong> regards orientés ailleurs. Il note également qu‟à 4 mois apparaît<br />
le regard <strong>de</strong> l‟obj<strong>et</strong> accompagné par <strong>la</strong> <strong>mère</strong>.<br />
C‟est à partir <strong>de</strong> 6 mois que l‟on voit apparaître l‟« attention partagée » à proprement<br />
parler. Vers 12 mois, c<strong>et</strong>te co-orientation du regard <strong>de</strong>vient systématique. L‟attention<br />
conjointe montre que le <strong>bébé</strong> prend en compte l‟orientation du visage <strong>de</strong> l‟adulte pour porter<br />
<strong>son</strong> attention visuelle en modifiant l‟axe <strong>de</strong> <strong>son</strong> regard. Jusqu‟à 12 mois <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s <strong>bébé</strong>s<br />
regar<strong>de</strong> le visage <strong>de</strong> l‟adulte <strong>et</strong>/ou <strong>son</strong> doigt tendu lors du pointage d‟un obj<strong>et</strong> alors qu‟ils coorientent<br />
aisément le regard s‟il n‟est pas doublé du pointage.<br />
Dans notre étu<strong>de</strong>, les enfants ayant entre 12 <strong>et</strong> 24 mois, nous nous attendons à ce que <strong>la</strong><br />
capacité d‟attention conjointe soit présente chez tous.<br />
De <strong>son</strong> côté, Boys<strong>son</strong>-Bardies (1999) soutient que le regard est une composante<br />
essentielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> communication non verbale. <strong>La</strong> recherche <strong>de</strong> contact avec les yeux engage <strong>et</strong><br />
maintient un lien <strong>de</strong> communication très fort qui non seulement suscite <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions<br />
affectives mais organise <strong>la</strong> temporalité <strong>de</strong>s échanges. <strong>La</strong> <strong>mère</strong>, pour essayer d‟établir le<br />
contact avec <strong>son</strong> <strong>bébé</strong>, va le chercher avec <strong>son</strong> regard <strong>et</strong> tenter d‟accrocher le sien. Ce lien est<br />
tout d‟abord assez fragile <strong>et</strong> intermittent entre <strong>la</strong> <strong>mère</strong> <strong>et</strong> le <strong>bébé</strong> mais quand il s‟établit, il<br />
perm<strong>et</strong> <strong>de</strong> capter <strong>et</strong> r<strong>et</strong>enir l‟attention du <strong>bébé</strong>. Ce comportement <strong>de</strong> recherche du regard<br />
semble très inscrit dans <strong>la</strong> nature humaine car on r<strong>et</strong>rouve <strong>de</strong>s processus analogues chez le<br />
<strong>bébé</strong> né aveugle qui tourne le visage <strong>et</strong> le gar<strong>de</strong> fixé vers <strong>la</strong> voix <strong>de</strong> sa <strong>mère</strong> qui l‟appelle.<br />
Enfin, Lebovici <strong>et</strong> al. (1983) rappelle que dans <strong>de</strong> nombreuses étu<strong>de</strong>s, les <strong>mère</strong>s<br />
confessent avoir eu le sentiment d‟être <strong>mère</strong> le jour où elles <strong>et</strong> leur <strong>bébé</strong> se <strong>son</strong>t regardés<br />
mutuellement dans les yeux. Le regard est intimement lié au sourire car il donne à <strong>la</strong> <strong>mère</strong> le<br />
sentiment que ses efforts <strong>son</strong>t reconnus par le <strong>bébé</strong>. Le regard mutuel est également<br />
caractérisé par <strong>son</strong> aspect affectif, il peut refléter tout un climat émotionnel notamment à<br />
travers l‟expression du visage <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mère</strong>. Le regard mutuel a également pour fonction <strong>de</strong><br />
faciliter <strong>la</strong> constitution d‟une image <strong>de</strong> soi du nourris<strong>son</strong>, distincte <strong>et</strong> différenciée <strong>de</strong> celle <strong>de</strong><br />
sa <strong>mère</strong>. Le visage <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>mère</strong>, <strong>et</strong> singulièrement ses yeux, pourrait servir à favoriser chez le<br />
nourris<strong>son</strong> l‟é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> l‟image <strong>de</strong> <strong>son</strong> soi <strong>et</strong> à intégrer en un même ensemble unifié <strong>de</strong>s<br />
expériences affectives diverses <strong>et</strong> initialement non liées les unes aux autres. Le visage<br />
maternel, au contraire, est le lieu unique <strong>et</strong> entier où peuvent s‟intégrer en un même espace,<br />
<strong>de</strong>s états affectifs différents <strong>et</strong> peut être au début re<strong>la</strong>tivement dissociés les uns <strong>de</strong>s autres.<br />
L‟observation directe <strong>de</strong>s dya<strong>de</strong>s montre bien <strong>de</strong>s changements qui affectent les visages <strong>de</strong><br />
43