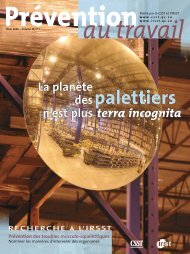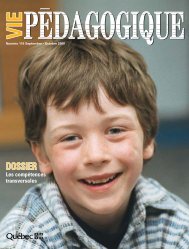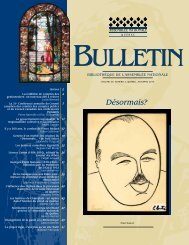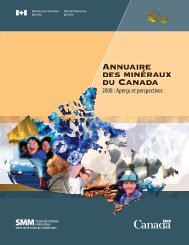DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
UNE QUÊTE PERSONNELLE<br />
L’adolescent doit s’approprier une<br />
démarche d’apprentissage en l’assimilant<br />
à ses propres schèmes de<br />
référence. Sa démarche doit être la<br />
sienne et non celle de la cité, de<br />
l’école ou de la compagnie. La préséance<br />
accordée par l’école à un<br />
système standardisé et critérié de<br />
performances scolaires demeure,<br />
dans bien des cas, aveugle à ce<br />
besoin d’indivi<strong>du</strong>ation et d’appropriation<br />
<strong>du</strong> savoir.<br />
L’adolescent se voit proposer de travailler<br />
en vue de réussir, de pro<strong>du</strong>ire<br />
et de s’établir dans la société.<br />
Pourtant, quand il se conforme et<br />
fait comme on lui dit, il peut ressentir<br />
un vide : vide <strong>du</strong> travail confiné à<br />
l’atteinte d’un rendement; vide de<br />
la réussite dans un climat de compétition.<br />
L’adolescent qui tente d’affranchir<br />
sa quête de savoir en se<br />
distançant de certains buts de réussite<br />
et de richesse se bute rapidement<br />
à de l’incompréhension. <strong>Les</strong><br />
modèles de connaissance que la<br />
cité moderne lui propose se révèlent<br />
souvent étrangers, voire contraires<br />
à cette attitude de dépouillement.<br />
L’école, pour maintenir le<br />
lien avec son élève, devra parfois<br />
accepter qu’il ne réponde pas toujours<br />
au système en vigueur de<br />
gra<strong>du</strong>ation et de quantification <strong>du</strong><br />
savoir. Elle examinera la situation<br />
de son élève, mais elle saura aussi,<br />
quand il le faut, mettre en perspective<br />
l’importance relative de certains<br />
buts ou de certaines valeurs<br />
qu’elle lui propose.<br />
DES LIENS D’AMITIÉ<br />
L’adolescent tentera d’établir son<br />
rapport à la connaissance dans un<br />
Photo : Denis Garon<br />
lien fraternel. Connaître devient<br />
ainsi un geste qui s’inscrit dans une<br />
réalité plus grande que lui-même.<br />
À l’école, le maître et l’élève cheminent<br />
l’un et l’autre vers une vérité<br />
qui les dépasse tous les deux.<br />
UN DIALOGUE<br />
L’adolescent tentera de fonder son<br />
acquisition de connaissances sur<br />
un rapport de réciprocité, sur un<br />
échange d’idées avec d’autres personnes.<br />
Il pourra en venir à se<br />
désengager de ses apprentissages si<br />
l’école lui propose une démarche<br />
qui ressemble trop à une compétition.<br />
Il peut aussi remettre en cause<br />
le maître pour qui le rôle de l’élève<br />
se cantonne à recevoir, à exécuter<br />
et à répéter la leçon. L’école percevra<br />
parfois ces questionnements<br />
comme une menace, alors qu’ils<br />
pourraient au contraire être l’occasion<br />
d’entamer un dialogue et d’approfondir<br />
le lien établi.<br />
DES RAPPORTS ÉQUITABLES<br />
L’adolescent peut refuser de s’associer<br />
à l’école quand elle lui propose<br />
des modèles de réussite qui entretiennent<br />
l’inégalité entre les indivi<strong>du</strong>s<br />
et les groupes sociaux. Il peut<br />
également juger incompatible avec<br />
sa quête de fraternité l’école qui,<br />
dans ses structures d’accueil, sélectionne<br />
uniquement les indivi<strong>du</strong>s performants,<br />
ou encore l’école qui ne<br />
fait pas de place aux élèves ne<br />
répondant pas aux critères de rendement<br />
et de comportement établis,<br />
et se contente de les exclure et<br />
même de les renvoyer injustement.<br />
POURQUOI PARLER DE SOCRATE?<br />
Pourquoi parler de Socrate? D’abord, parce qu’il est un grand é<strong>du</strong>cateur.<br />
La pensée qu’il livre, pourtant en des temps si reculés, permet de<br />
replacer certains enjeux modernes de l’école : 1) un questionnement,<br />
qui consiste à remettre en cause son propre savoir pour accéder à la<br />
vérité, à douter des idées que l’on tient pour vraies; 2) une intériorité,<br />
par laquelle la connaissance doit être en quelque sorte habitée, vécue<br />
de l’intérieur, permettant ainsi une certaine distanciation par rapport<br />
aux connaissances collectives; 3) un dialogue, puisque la vérité est<br />
atteinte par un désir commun de connaître et dépend, à cause de cela,<br />
des liens d’amitié tissés entre les personnes.<br />
Athènes, la cité qu’habite Socrate, est une sorte de canevas de la cité<br />
moderne. Cette cité se fonde sur les relations que les citoyens entretiennent<br />
entre eux, sur la notion d’un nécessaire échange de vues,<br />
d’un dialogue avec l’autre pour en arriver à un consensus. Le citoyen<br />
doit pouvoir discuter et convaincre et, pour cela, s’approprier des<br />
connaissances et la parole. La vérité, la connaissance, ne sont plus<br />
strictement édictées par les rois et les dieux. La personne n’a plus à se<br />
conformer en silence à leurs diktats. Grâce au savoir et à la raison,<br />
elle peut maintenant, par un retour en soi, guider sa con<strong>du</strong>ite.<br />
La cité moderne, typiquement la petite ville de banlieue, impersonnelle<br />
et froide, dont on a évacué tout sens de la communauté, a-t-elle<br />
per<strong>du</strong> l’esprit qui anime cette quête commune de vérité? Où trouver<br />
parmi ces maisons en rangées et ces centres commerciaux, un lieu<br />
propice à l’échange d’idées et au dialogue? Poussés par leur soif<br />
d’amitié et de vérité, les adolescents doivent peut-être trouver ailleurs<br />
des lieux propices où poursuivre leur quête.<br />
On ne connaît Socrate que par ce que ses amis en ont rapporté.<br />
Lui même n’a rien écrit. Il symbolise, à travers les âges, cet homme<br />
nouveau qui chemine vers la sagesse et entend, par le dialogue,<br />
accéder au savoir. Par son incessant questionnement, il oblige à réfléchir<br />
ceux qui posent les honneurs et la richesse comme les nouvelles<br />
icônes vers lesquelles doit se tourner la jeunesse.<br />
Pourquoi parler de Socrate? À cause de son histoire, celle d’un<br />
humble personnage engagé dans une quête personnelle de vérité qui<br />
le mène à être condamné par la cité. Son histoire trace la trame <strong>du</strong><br />
scénario que certains adolescents vivent sous nos yeux . Leur décrochage<br />
et leur marginalité revêtent alors une dimension rarement<br />
reconnue : celle d’une situation dramatique, historique et universelle.<br />
UN RAPPORT SOLIDAIRE<br />
Pour l’adolescent, les bienfaits<br />
résultant de la réussite, pourvu<br />
qu’elle s’inscrive dans un rapport<br />
fraternel, devraient rejaillir non<br />
seulement sur lui mais aussi sur ses<br />
camarades et sur le groupe tout<br />
entier. Il peut vouloir se retirer<br />
d’une école qui lui propose un modèle<br />
de réussite uniquement orienté<br />
vers l’obtention d’avantages personnels.<br />
La quête d’un lien fraternel<br />
peut aussi mener l’adolescent à<br />
joindre les rangs des marginaux,<br />
surtout si ces derniers sont perçus<br />
par lui comme victimes d’opprobre.<br />
Il peut aussi se montrer solidaire de<br />
ses camarades qui sont pauvres et<br />
qui, poussés par des contraintes<br />
économiques, échouent ou doivent<br />
laisser l’école.<br />
À l’école, l’adolescent doit établir<br />
des liens avec des personnes qui lui<br />
permettront de dépasser son propre<br />
point de vue. La connaissance<br />
qu’il acquiert seul sera toujours<br />
incomplète s’il ne peut l’exposer à<br />
autrui et échanger ses idées. S’il se<br />
montre parfois indifférent à son<br />
exclusion, c’est peut-être qu’il est<br />
convaincu que son rapport à l’école<br />
ne relève plus <strong>du</strong> dialogue et qu’une<br />
quête commune de vérité n’y est<br />
plus possible. Ce n’est pas tant qu’il<br />
refuse de faire valoir sa cause, mais<br />
plutôt qu’il estime qu’elle ne sera<br />
pas vraiment enten<strong>du</strong>e.<br />
L’ADOLESCENT S’APPROPRIE<br />
SA VIE INTÉRIEURE<br />
« Socrate est déclaré coupable. Il sait<br />
que ce verdict survient en fait pour<br />
d’autres motifs. Ce qui dérange les<br />
notables de la cité, c’est qu’il donne<br />
préséance à sa voix intérieure<br />
plutôt qu’aux cultes dominants. »<br />
L’éclosion de sa vie intérieure permet<br />
à l’adolescent d’établir des<br />
points de référence internes qui<br />
l’amèneront à faire des choix responsables,<br />
à exercer pleinement sa<br />
liberté. L’adolescent qui remet en<br />
cause l’école ne rejette pas nécessairement<br />
les buts qu’elle cherche à<br />
atteindre. <strong>Les</strong> idéaux qu’on lui propose,<br />
il doit les vivre de l’intérieur.<br />
Cette dimension intérieure se définit<br />
par le développement d’une prise<br />
de conscience et d’une sensibilité à<br />
l’égard de sa vie émotionnelle et<br />
affective, par un accès au monde <strong>du</strong><br />
rêve et de l’imaginaire et par une<br />
VIE 12 Vie pédagogique 118, février-mars<br />
2001