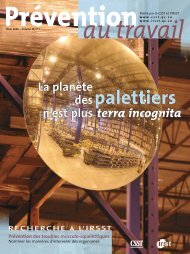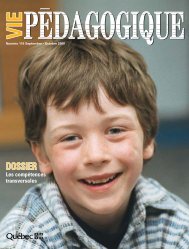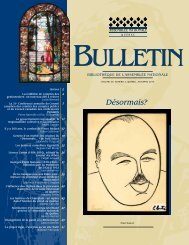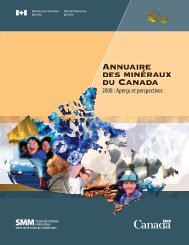DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
pas, exclusivement, la confirmation<br />
de la valeur de cette lecture, soit<br />
prouver que l’on a bien lu. Encore<br />
faut-il – et c’est vraiment la moindre<br />
des choses – que les questions<br />
posées ne soient pas compréhensibles<br />
qu’à celui qui connaît d’avance<br />
les réponses.<br />
Je terminerai par une caractéristique<br />
qui est sans doute — qui est<br />
sûrement, à mes yeux — la plus<br />
importante : il faut toujours mettre en<br />
question le plaisir ou le déplaisir,<br />
l’intérêt ou l’indifférence qu’éprouve<br />
l’élève. C’est en général une affaire<br />
de degré plutôt que de tout ou rien.<br />
<strong>Les</strong> réactions affectives et cognitives<br />
des adolescents ne manquent pas<br />
de nuances quand on leur laisse le<br />
temps de s’exprimer. Bien enten<strong>du</strong>,<br />
dire que l’on a aimé un texte un<br />
peu, beaucoup, passionnément, à la<br />
folie ou pas <strong>du</strong> tout, c’est juste faire<br />
un premier pas; il faudra encore<br />
expliquer — tenter d’expliquer —<br />
sa réaction aux autres. En mettant<br />
ainsi en commun les facteurs de<br />
plaisir ou de déplaisir, les facteurs<br />
d’intérêt ou de désintérêt, on<br />
apprend à se connaître, à s’ouvrir<br />
aux autres, à accepter les différences<br />
des goûts indivi<strong>du</strong>els. On<br />
peut ainsi devenir curieux des goûts<br />
d’autrui et se lancer dans un débat<br />
sur la valeur des textes. Du jugement<br />
de goût personnel, imperméable<br />
à la persuasion — nul ne<br />
peut me persuader que je n’ai pas<br />
aimé ce que j’ai aimé, ou que je me<br />
suis intéressé à ce qui m’a ennuyé<br />
—, on passe au jugement de valeur,<br />
interpersonnel, qui implique l’argumentation,<br />
la recherche de raisons<br />
susceptibles de fonder un accord.<br />
Jean-Louis Dumortier est professeur<br />
à la Faculté de philosophie<br />
et lettres de l’Université<br />
de Liège.<br />
1 J.L. DUMORTIER. Écrire le récit, Bruxelles-<br />
Paris-Gembloux, De Boeck-Duculot, 1986<br />
(Coll. Formation continuée).<br />
2. M. LEBRUN. « Le chaînon manquant entre<br />
la lecture et l’écriture : le journal de<br />
réponses personnelles », dans C. PRÉFON-<br />
TAINE, L. GODARD, et G. FORTIER, Pour<br />
mieux comprendre la lecture et l’écriture,<br />
Montréal, <strong>Les</strong> Éditions Logiques,<br />
1998, p. 99-121.<br />
3. Prise d’information quant au savoir-lire<br />
des élèves, en l’occurrence, et comparaison<br />
avec un référentiel, une manifestation<br />
de la compréhension estimée satisfaisante<br />
au terme d’une phase d’apprentissage.<br />
4. L’évaluation peut servir à certifier : 1°) en<br />
cours de formation, que l’apprenant est<br />
apte à poursuivre avec fruit son apprentissage,<br />
que ses acquis sont tels qu’il<br />
pourra tirer profit de la suite de la formation;<br />
2°) au terme de cette dernière, que<br />
l’apprenant est pourvu des compétences<br />
correspondant aux objectifs d’apprentissage<br />
de la formation visée. Dans le système<br />
scolaire de la Communauté française<br />
de Belgique, la certification implique l’évaluation<br />
continue et la prise en considération<br />
(mais, en principe tout au moins, pas<br />
l’addition pure et simple) d’un certain<br />
nombre de résultats obtenus à différentes<br />
épreuves qui jalonnent l’année scolaire.<br />
5. Pour plus de détails, on lira la remarquable<br />
synthèse de J. GIASSON, La compréhension<br />
en lecture, Boucherville<br />
(Québec), Gaëtan Morin, 1990.<br />
6. Voir, entre autres, D. MARTINS, <strong>Les</strong> facteurs<br />
affectifs dans la compréhension<br />
et la mémorisation des textes, Paris,<br />
P.U.F., 1993.<br />
7. Pour une synthèse sur les genres littéraires,<br />
on lira, entre autres, D. COMBE,<br />
<strong>Les</strong> genres littéraires, Paris, Hachette,<br />
1992 (Coll. Contours littéraires) ou<br />
Y. STALLONI, <strong>Les</strong> genres littéraires, Paris,<br />
Dunod, 1997 (Coll. <strong>Les</strong> topos). Pour une<br />
approche théorique et didactique, on se<br />
référera à K. CANVAT, Enseigner la littérature<br />
par les genres, Bruxelles, De Boeck<br />
et Larcier, 1999.<br />
8. R. JAKOBSON. Essais de linguistique<br />
générale, Paris, Éditions de Minuit, 1963.<br />
Je donne ici, et dans les références suivantes,<br />
la date de la première publication<br />
en langue française.<br />
9. E. BENVENISTE. Problèmes de linguistique<br />
générale, I, Paris, Gallimard, 1966;<br />
H. WEINRICH, Le temps, Paris, Le Seuil,<br />
1973.<br />
10. M. BAKHTINE. Esthétique de la création<br />
verbale, Paris, Gallimard, 1984; J.A.<br />
AUSTIN, Quand dire, c’est faire, Paris,<br />
Le Seuil, 1970; J.R. SEARLE, <strong>Les</strong> actes de<br />
langage, Paris, Hermann, 1972.<br />
11. J.M. ADAM. <strong>Les</strong> textes : types et prototypes,<br />
Paris, Nathan, 1992.<br />
12. J.-P. BRONKART et autres. Le fonctionnement<br />
des discours, Neuchâtel-Paris,<br />
Delachaux et Niestlé, 1985.<br />
en abrégé<br />
LE CURRICULUM :<br />
UNE MISE À L’ESSAI SUIVIE<br />
par Michel Carbonneau<br />
en<br />
abrégé<br />
Le texte qui suit a pour objet<br />
de cerner le sens et la portée<br />
<strong>du</strong> travail effectué dans les<br />
écoles ciblées. Pour bien comprendre<br />
la situation, il est essentiel de<br />
s’entendre sur le sens de quelques<br />
mots clés, tels réforme, curriculum,<br />
programme, expérimentation, évaluation<br />
et scientifique.<br />
D’abord le mot réforme. Qui dit<br />
réforme dit changement majeur en<br />
vue d’améliorer une situation. Une<br />
réforme engage des transformations<br />
profondes qui bousculent les habitudes<br />
et ne se présente donc, de<br />
façon générale, que lorsqu’un tel<br />
changement paraît nécessaire.<br />
La réforme engagée dans le système<br />
de l’é<strong>du</strong>cation découle d’une série<br />
de travaux qui ont fait ressortir une<br />
telle nécessité et qui ont suggéré<br />
diverses orientations à prendre. Il y<br />
a eu, pour mentionner les plus<br />
importants, le rapport Préparer les<br />
jeunes au 21 e siècle (1994) <strong>du</strong><br />
groupe de travail sur les profils de<br />
formation au primaire et au secondaire,<br />
présidé par Claude Corbo.<br />
Il y a eu le rapport <strong>Les</strong> États généraux<br />
sur l’é<strong>du</strong>cation 1995-1996<br />
dont la Commission était coprésidée<br />
par Robert Bisaillon et Lucie<br />
Demers. Il y a eu, enfin, le rapport<br />
Réaffirmer l’école (1997) <strong>du</strong> groupe<br />
de travail sur la réforme <strong>du</strong> curriculum<br />
présidé par Paul Inchauspé.<br />
La réforme actuelle n’est donc ni un<br />
caprice passager, ni le fruit de l’improvisation.<br />
Elle résulte d’un long<br />
processus d’analyse et de réflexion<br />
qui a été mené par des groupes réunissant<br />
des personnes d’horizons<br />
divers, professionnels, experts et<br />
autres et auquel de larges pans de<br />
la population ont eu l’occasion de<br />
participer, notamment lors des États<br />
généraux. Il a de plus été alimenté<br />
par les résultats provenant de la<br />
recherche dans les divers domaines<br />
qui définissent le champ de l’é<strong>du</strong>cation.<br />
Un consensus s’est dégagé<br />
autour de l’idée qu’il fallait recentrer<br />
la mission de l’école, ce qui impliquait<br />
des réajustements considérables.<br />
Si l’on s’entendait sur<br />
l’idée d’une réforme, la question<br />
des modalités n’était évidemment<br />
pas réglée pour autant. Il aurait<br />
d’ailleurs été impossible de toutes<br />
les prévoir.<br />
La notion de curriculum est une<br />
notion plus complexe. On connaît<br />
assez bien le curriculum vitae, le<br />
C.V., qui constitue en quelque sorte<br />
la feuille de route qu’une personne<br />
présente quand elle se cherche un<br />
emploi. Cette feuille de route réunit<br />
l’ensemble de ce qui la qualifie au<br />
regard de la formation et des<br />
diplômes, des expériences de travail,<br />
des réalisations personnelles,<br />
etc. Par analogie, le curriculum scolaire<br />
retient également l’idée d’une<br />
route que les élèves sont invités à<br />
parcourir vers la connaissance.<br />
À l’origine, le mot curriculum avait<br />
chez les anglo-saxons à peu près le<br />
même sens que le mot programme<br />
chez les francophones et il se rapportait<br />
à un ensemble de contenus<br />
d’apprentissage définis autour de<br />
grandes disciplines, appelées aussi<br />
matières, telles que la langue maternelle,<br />
les mathématiques, etc. Il a<br />
pris, depuis, un sens plus large et<br />
englobe, autant chez les uns que<br />
chez les autres, tous les éléments <strong>du</strong><br />
dispositif mis en place pour encadrer<br />
le parcours scolaire des élèves.<br />
<strong>Les</strong> programmes disciplinaires font<br />
dès lors partie <strong>du</strong> curriculum au<br />
sens large.<br />
Une réforme curriculaire est donc<br />
un changement important intro<strong>du</strong>it<br />
dans l’ensemble des mesures et services<br />
gérés par l’école pour favoriser<br />
le développement et l’apprentissage<br />
chez les élèves. Cela dépasse le<br />
choix des contenus disciplinaires<br />
pour englober les aspects liés à la<br />
pédagogie, à l’évaluation, aux mesures<br />
d’aide à l’apprentissage, etc.<br />
VIE 54 Vie pédagogique 118, février-mars<br />
2001