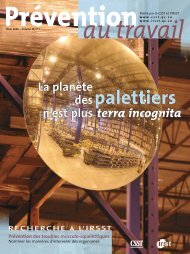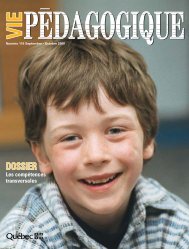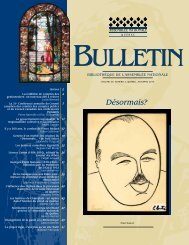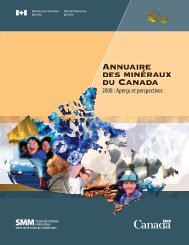DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
êtres humains. Notre idée, c’est que<br />
« objet humain » rejaillit sur tous<br />
les autres aspects de leur travail.<br />
V. P. – Est-ce que ça rejoint<br />
l’idée de ce qu’on appelle<br />
ailleurs les « helping professions<br />
»?<br />
M. T. et C. L. – Oui, tout à fait,<br />
ou des « service professions » ou<br />
encore des « service organisations<br />
», c’est-à-dire des gens qui<br />
accomplissent, même s’ils sont en<br />
bas de la pyramide <strong>du</strong> pouvoir au<br />
sein de l’organisation, la mission<br />
essentielle, la mission pleine de<br />
l’organisation, qui est celle de<br />
transformer des gens, d’en faire des<br />
apprenants.<br />
V. P. – Vous dites que ça n’a<br />
pas de rapport avec le travail<br />
in<strong>du</strong>striel dont les résultats<br />
sont immédiats et même qu’il<br />
y a peu de rapport avec les modèles<br />
dominants aujourd’hui :<br />
technologie, communication,<br />
pro<strong>du</strong>ction de connaissances.<br />
Pouvez-vous expliciter cela?<br />
M. T. et C. L. – D’une certaine<br />
manière, enseigner est un des plus<br />
vieux métiers <strong>du</strong> monde. C’est<br />
un métier qui procède beaucoup<br />
par persuasion, par sé<strong>du</strong>ction, par<br />
pouvoir, par exercice d’un pouvoir.<br />
En ce sens-là, ce n’est pas comme<br />
fabriquer une voiture, parce qu’on<br />
est constamment en train de convaincre<br />
quelqu’un que ce qu’on fait,<br />
c’est pour son bien et qu’on veut<br />
même qu’il y participe pleinement,<br />
qu’il assume pleinement sa part<br />
Photo : Denis Garon<br />
de responsabilité dans le travail.<br />
Toutes les pédagogies contemporaines,<br />
toutes les pédagogies nouvelles<br />
cherchent à responsabiliser<br />
l’élève par rapport à ses apprentissages,<br />
mais ça, c’est une transformation<br />
majeure de l’élève qui a<br />
naturellement – <strong>du</strong> moins dans certains<br />
milieux – tendance à résister<br />
au « bien » qu’on veut lui faire.<br />
Lorsqu’on fabrique un pro<strong>du</strong>it technologique,<br />
on n’a pas à lui demander<br />
ce qu’il en pense. Si on fait face<br />
à une résistance, c’est à celle <strong>du</strong><br />
matériau, ce n’est pas à celle d’un<br />
sujet qui est en train d’éclore. Dans<br />
l’enseignement, on a affaire à un<br />
sujet qui est en train d’éclore et<br />
dont on veut soutenir l’émergence<br />
et le développement. Ce n’est pas la<br />
même chose qu’un métier de communication<br />
où on transmet simplement<br />
de l’information. Le travail ne<br />
finit pas lorsqu’on a transmis un<br />
savoir. Et puis savoir structuré et<br />
transmis par l’école et information<br />
véhiculée par les médias sont deux<br />
choses dont on ne souligne pas<br />
assez la différence. Enseigner n’est<br />
pas non plus un travail de pro<strong>du</strong>ction<br />
de connaissances. Même si on<br />
peut dire que les enseignants pro<strong>du</strong>isent<br />
<strong>du</strong> savoir, enfin, notamment<br />
<strong>du</strong> savoir pédagogique ou didactique,<br />
l’objet de l’enseignement n’est<br />
pas de pro<strong>du</strong>ire un savoir nouveau.<br />
C’est plutôt de faciliter l’apprentissage<br />
de quelqu’un dans un contexte<br />
particulier, à la fois lui transmettre<br />
et lui faire apprendre des savoirs,<br />
mais aussi la valeur de cela. Enseigner,<br />
au sens le plus banal <strong>du</strong> terme,<br />
c’est entrer dans une classe et établir<br />
des interactions humaines avec<br />
un groupe d’élèves : les regarder,<br />
leur parler, se faire comprendre<br />
d’eux, essayer de comprendre ce<br />
qu’ils sont à cette étape de leur apprentissage,<br />
travailler avec eux, les<br />
écouter, les orienter, les encadrer,<br />
etc.<br />
V. P. – Vous dites qu’il y a une<br />
coloration affective dans le<br />
travail de l’enseignant et<br />
aussi une ambivalence entre<br />
aider au maximum et contrôler<br />
à un moment donné, faire<br />
échouer même. L’élément <strong>du</strong><br />
contrôle, est-ce que c’est ce<br />
que l’enseignant fait avec<br />
réticence, pour ne pas dire<br />
avec une certaine répugnance,<br />
comme malgré lui?<br />
M. T. et C. L. – Ça dépend des<br />
enseignants. Nous ne prétendons<br />
pas que tous les enseignants prennent<br />
un certain plaisir à exercer<br />
une contrainte ou un pouvoir sur<br />
des enfants, y compris un pouvoir<br />
négatif. Nous ne disons pas qu’ils le<br />
font tout le temps ou que tous les<br />
enseignants sont comme ça. Mais,<br />
ainsi que le souligne Perrenoud,<br />
parmi les non-dits de ce métier, il y<br />
a certainement celui portant sur<br />
l’exercice d’une certaine contrainte,<br />
d’une certaine sanction négative,<br />
bref d’un pouvoir.<br />
V. P. – Vous êtes proches de<br />
l’analyse pédagogique un peu,<br />
sur ces terrains-là…<br />
M. T. et C. L. – Oui. Revenons à la<br />
question de base : oui, il y a une<br />
dimension proprement affective<br />
dans l’enseignement, d’ailleurs<br />
peut-être plus au Québec que dans<br />
d’autres sociétés. On n’a pas fait<br />
d’analyse comparative, mais nous<br />
en sommes toujours étonnés. L’un<br />
d’entre nous était dans une école,<br />
il n’y a pas longtemps, où séjournaient<br />
des stagiaires belges. On leur<br />
a dit à cette école : la première<br />
chose qu’il faut que vous fassiez,<br />
avant de penser à transmettre des<br />
contenus ou à développer des compétences,<br />
c’est établir un rapport<br />
affectif avec les enfants. <strong>Les</strong> stagiaires<br />
belges étaient étonnés parce<br />
que, d’entrée de jeu, en Belgique ou<br />
dans une tradition européenne, la<br />
première chose à faire n’est pas<br />
d’établir un rapport affectif, c’est<br />
d’établir des règles, de se faire<br />
respecter, notamment sur le plan de<br />
sa compétence proprement pédagogique<br />
ou didactique. Le rapport<br />
affectif, il émergera, pudiquement<br />
dirions-nous, au fur et à mesure<br />
que la relation pédagogique se<br />
déroulera. Peut-être sommes-nous<br />
nord-américains sous cet aspect –<br />
et ce serait intéressant de regarder<br />
cela d’un point de vue comparatif –<br />
mais, dans notre culture et notamment<br />
au primaire, ici, le rapport<br />
affectif est extrêmement important.<br />
Qu’on appelle cela un « emotional<br />
labor » ou un travail affectif, ou<br />
qu’on dise que la ressource première<br />
qu’utilise l’enseignant, sa<br />
technologie, c’est lui-même comme<br />
personne, ça nous paraît typique<br />
de ce métier. Certainement, nos<br />
données confirment cela et nous<br />
croyons qu’il y a quelque chose de<br />
propre au Québec et à l’Amérique<br />
<strong>du</strong> Nord à cet égard.<br />
V. P. – Il y a une autre grande<br />
question qui, sans doute,<br />
vous a touchés à un moment<br />
donné, c’est la perception<br />
de dévalorisation des enseignants,<br />
une sorte de mésestime<br />
sociale. Comment se<br />
positionne le travail enseignant<br />
au Québec, d’après vos<br />
enquêtes? Est-ce que c’est une<br />
pure utopie de penser qu’ils<br />
devraient ou pourraient être<br />
plus valorisés socialement?<br />
M. T. et C. L. – Dans notre livre<br />
précédent, La Profession enseignante,<br />
nous avons beaucoup discuté<br />
de cette question. Dans cet<br />
ouvrage-ci, nous ne l’abordons pas<br />
directement, plutôt indirectement<br />
dans la troisième partie, qui porte<br />
sur le travail collectif et les rapports<br />
entre les enseignants et les parents,<br />
les directions d’école, les commissaires<br />
d’école, le Ministère et la<br />
société en général. Nous croyons<br />
que le statut des enseignants est<br />
certainement lié à une conjoncture<br />
défavorable : depuis une quinzaine<br />
d’années, les enseignants se sentent<br />
l’objet de critiques fréquentes et<br />
virulentes, et mal aimés. Cela est un<br />
fait et c’est plus fort aujourd’hui ou<br />
davantage ressenti qu’à l’époque <strong>du</strong><br />
rapport Parent et des années 60.<br />
Par contre, il faudrait nuancer. Plus<br />
on se rapproche de l’école, plus on<br />
se rapproche des parents, notamment<br />
des parents qui sont en relation<br />
avec les enseignants, moins le<br />
rapport avec l’environnement de<br />
l’école est vécu sur le mode négatif.<br />
Nous croyons que les enseignants<br />
en ont contre les faiseurs d’opinion,<br />
contre les médias. Cela, c’est clair.<br />
Ils se souviennent aussi très bien<br />
de la campagne de dénigrement<br />
dont ils ont été victimes au début<br />
des années 80.<br />
V. P. – Ils ont servi de boucs<br />
émissaires?<br />
M. T. et C. L. – Ils ont le sentiment<br />
d’avoir servi de boucs émissaires.<br />
Ils s’en rappellent, ils n’ont pas<br />
oublié cela. Mais sur le terrain quotidien,<br />
des relations à l’intérieur<br />
d’un milieu donné, nous ne croyons<br />
pas que ce soit vécu sur le mode de<br />
la honte et de la catastrophe. Il faut<br />
faire cette nuance. C’est le rapport<br />
symbolique à la société et à l’État<br />
qui est vécu sur un mode difficile et<br />
VIE 6 Vie pédagogique 118, février-mars<br />
2001