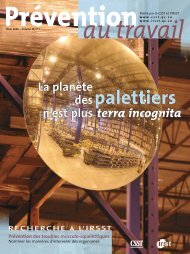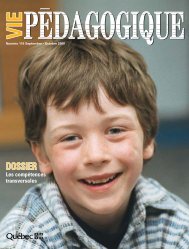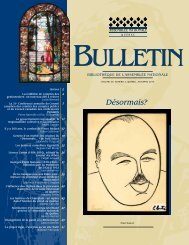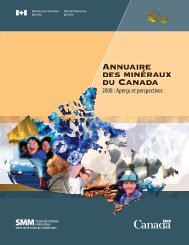DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
intellectuelle et affective, au monde<br />
<strong>du</strong> texte ainsi construit. Sur le plan<br />
intellectuel, par exemple, je juge ce<br />
monde vrai ou faux, vraisemblable,<br />
peu vraisemblable ou invraisemblable,<br />
probable, peu probable ou<br />
improbable, susceptible ou non<br />
d’entraîner mon accord, plus ou<br />
moins pourvu de vertu informative,<br />
logique ou illogique, etc. Sur le plan<br />
affectif, et toujours à titre d’exemple,<br />
je le juge original ou banal,<br />
surprenant ou atten<strong>du</strong>, émouvant<br />
(c’est-à-dire, entre autres, gai ou<br />
triste, effrayant ou apaisant, admirable<br />
ou détestable) ou froid, etc.<br />
Bien enten<strong>du</strong>, mes jugements sur le<br />
plan intellectuel et sur le plan affectif<br />
peuvent interférer.<br />
Y a-t-il entre la compréhension 1 et<br />
la compréhension 2 des relations<br />
d’influence unilatérale ou réciproque?<br />
La question n’est pas tranchée<br />
et elle ne le sera sans doute jamais<br />
en fonction de détermination proportionnelle<br />
(plus de ceci entraîne<br />
nécessairement moins de cela). Ce<br />
qu’il importe de retenir des études<br />
scientifiques sur cette question,<br />
c’est que la réaction affective au<br />
stimulus textuel peut influer d’une<br />
manière bénéfique sur la compréhension<br />
6 . Et, ce qu’il faut coûte<br />
que coûte mettre en évidence, c’est<br />
que le plaisir de lire ne se dissocie<br />
pas de la com-préhension, de l’engagement<br />
affectif et intellectuel dans<br />
l’élaboration de la représentation<br />
mentale. Si je n’ai aucun intérêt<br />
pour le monde <strong>du</strong> texte, aucun<br />
plaisir à m’y projeter en imagination,<br />
l’effort qu’exige de moi sa construction<br />
me paraît excessif; je n’y<br />
consens que sous la contrainte,<br />
dans une situation de lecturetravail,<br />
et il y a peu de chance alors<br />
que je mémorise avec facilité ce que<br />
je construis.<br />
LES PARTICULARITÉS ET<br />
LES SPÉCIFICITÉS DU TEXTE<br />
Quel qu’il soit, un texte présente<br />
des particularités (on dit aussi des<br />
propriétés) et des spécificités. Ces<br />
dernières sont les caractéristiques<br />
qu’il partage avec d’autres textes<br />
relevant d’une ou de plusieurs classes.<br />
<strong>Les</strong> premières sont, à l’inverse,<br />
des traits singuliers, des traits que<br />
l’on ne retrouve donc pas dans<br />
d’autres textes.<br />
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER<br />
POUR POSER DE BONNES QUESTIONS<br />
1. Qu’est-ce que je souhaite que les élèves comprennent?<br />
2. Est-ce que ce que je souhaite qu’ils comprennent :<br />
– est rapportable à des objectifs d’apprentissage précis?<br />
–peut leur resservir, est bien de nature à leur permettre de progresser?<br />
3. Est-ce que les questions que je pose sont pertinentes au regard de<br />
l’évaluation de ce que les élèves sont censés comprendre?<br />
4. Est-ce que je centre leur attention (exclusivement) sur les mots<br />
inconnus qui feraient obstacle à la compréhension de ce que je<br />
souhaite qu’ils comprennent?<br />
5. Est-ce que mon mode de questionnement :<br />
– permet au plus grand nombre d’élèves de manifester leur compréhension?<br />
– me permet d’évaluer effectivement les compétences de lecture,<br />
en d’autres mots évite le « parasitage » des habileté en lecture<br />
(manifestation des compétences lecturales) par les habiletés en<br />
écriture ou en expression orale?<br />
– amène les élèves à faire état de leur compréhension lors d’une<br />
première lecture?<br />
Si l’on ne questionne l’élève que<br />
sur les particularités d’un texte,<br />
il est clair que l’on ne fait pas<br />
grand-chose pour qu’il conquière,<br />
à terme, son autonomie de lecteur.<br />
Passant d’un texte à l’autre, il doit<br />
répondre à des questions toutes différentes<br />
et peut donc difficilement<br />
s’appuyer sur des lectures antérieures<br />
pour réagir d’une manière opportune.<br />
Or, je le répète, il s’agit bien<br />
de former des lecteurs autonomes,<br />
des lecteurs capables d’accomplir,<br />
en classe, une tâche-problème à<br />
fonction certificative, des lecteurs<br />
qui, en dehors de l’école, non seulement<br />
prendront eux-mêmes la<br />
décision de lire (plutôt que celle de<br />
s’informer, de se divertir par quelque<br />
autre moyen), mais encore<br />
décideront de lire de telle ou telle<br />
manière, en se satisfaisant de telle<br />
ou telle qualité de compréhension.<br />
La qualité de la compréhension est<br />
en partie déterminée par la reconnaissance<br />
de traits catégoriels qui<br />
in<strong>du</strong>isent un parcours pertinent,<br />
que l’on ait affaire à un texte factuel<br />
ou à un texte fictionnel. Par exemple,<br />
si je ne perçois pas, dans un<br />
article de presse, les traits d’un<br />
texte à fonction persuasive et à<br />
structure argumentative, ma lecture<br />
reste déten<strong>du</strong>e, erratique, naïve,<br />
bref inappropriée, car elle est de<br />
nature à me faire prendre les opinions<br />
d’autrui pour argent comptant.<br />
Au contraire, si je reconnais<br />
ces traits, mon comportement de<br />
lecteur change : mes facultés critiques<br />
sont en éveil, je m’attache à<br />
repérer les arguments, je juge de<br />
leur valeur, j’en conclus quelque<br />
chose quant à la valeur de la thèse<br />
et à celle de mes propres opinions<br />
sur la question. De même, si je ne<br />
perçois pas, dans un texte, l’intention<br />
artistique, je ne puis lui accorder<br />
une attention esthétique. Le texte<br />
littéraire que j’envisage peut certes<br />
m’intéresser, susciter en mon esprit<br />
de nombreuses questions, donner<br />
lieu à une discussion animée entre<br />
d’autres personnes et moi-même,<br />
mais ni cette discussion ni les questions<br />
que je me pose ne répondront<br />
à la demande de reconnaissance que<br />
m’adresse l’auteur, celle de considérer<br />
ce texte en tant qu’objet d’art.<br />
Il convient donc d’attirer, en posant<br />
des questions, l’attention des élèves<br />
sur les spécificités, sur les traits<br />
communs au texte considéré et à<br />
plusieurs autres. Ces traits sont en<br />
général nombreux. Pour les cerner,<br />
il faut avoir des connaissances relatives<br />
aux genres historiquement<br />
attestés (genres très codifiés comme<br />
le conte merveilleux, la fable, la<br />
tragédie, le roman d’énigme criminelle,<br />
le fait divers, l’article de dictionnaire,<br />
etc.; genres moins codifiés<br />
comme le conte fantastique,<br />
l’histoire drôle, le drame, le roman<br />
de formation, le billet d’humeur,<br />
l’essai, etc.) 7 . Il faut avoir en outre<br />
des connaissances relatives aux<br />
typologies savantes, élaborées plus<br />
ou moins récemment. Ces typologies<br />
reposent sur différentes bases :<br />
la base de la fonction dominante<br />
(Jakobson 8 ); la base de l’énonciation<br />
(Benveniste, Weinrich 9 );<br />
la base de l’intention ou de l’acte<br />
de langage (Bakhtine, Austin,<br />
Searle 10 ); la base de la superstructure<br />
(Adam 11 ); la triple base de<br />
l’intention, de l’énonciation et de la<br />
situation (Bronckart 12 ). Quoi qu’il<br />
en soit de l’état des connaissances<br />
des élèves (ou <strong>du</strong> professeur) à<br />
propos de ces classifications, l’habitude<br />
de chercher ce qui apparente<br />
un texte donné à un autre abordé<br />
avant, ainsi que ce qui l’en différencie,<br />
ne peut que favoriser l’« autonomisation<br />
» de ceux-ci et la mobilisation<br />
de leurs acquis. C’est en<br />
outre une activité de nature à exercer<br />
des compétences transversales<br />
d’ordre cognitif extrêmement importantes<br />
: analyse, synthèse, in<strong>du</strong>ction,<br />
comparaison.<br />
Cela dit, il ne faut jamais perdre de<br />
vue que les textes — les textes<br />
littéraires en particulier — sont<br />
des constructions sémantiques<br />
singulières, parfois très originales,<br />
que leurs particularités méritent de<br />
s’y attarder et que, à l’époque moderne<br />
entre autres, les écrits auxquels<br />
la postérité a attaché le plus<br />
de prix sont ceux qui ont transgressé<br />
les normes génériques. Il ne<br />
faut pas oublier non plus que la<br />
qualité d’un écrit peut tenir pour<br />
beaucoup à l’utilisation personnelle,<br />
singulière, des ressources linguistiques<br />
(au style stricto sensu).<br />
Des questions qui ne porteraient<br />
que sur les spécificités d’un texte<br />
pourraient donc être tout aussi critiquables<br />
que des questions uniquement<br />
centrées sur ses propriétés.<br />
En pratique, il est très souvent possible<br />
de questionner les élèves sur<br />
les particularités d’un texte en insistant<br />
sur le caractère exportable de<br />
la question, autrement dit sur le<br />
fait qu’elle est, mutatis mutandis,<br />
reposable si l’on considère un texte<br />
<strong>du</strong> même genre ou relevant <strong>du</strong><br />
même type.<br />
VIE 52 Vie pédagogique 118, février-mars<br />
2001