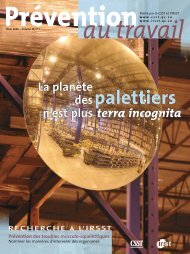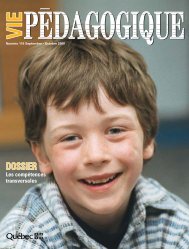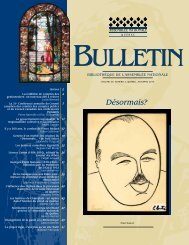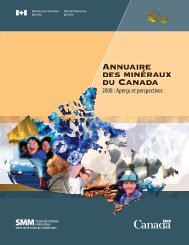DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
DOSSIER Les - Gouvernement du Québec
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>DOSSIER</strong><br />
quels types précis de problèmes il<br />
avait sans doute permis de répondre<br />
dans l’histoire. J’ai suivi et réussi<br />
d’autres cours de mathématiques<br />
par la suite, mais l’âme n’y était plus.<br />
Qu’est-ce qui distingue profondément<br />
ces deux enseignants? La culture?<br />
Non, car ils maîtrisaient tous<br />
les deux leur objet culturel respectif :<br />
le premier, la poésie; le second, les<br />
mathématiques. Si ce n’est pas la<br />
culture qui les différencie, alors<br />
qu’est-ce que cela peut être? Je<br />
risque une réponse : le rapport au<br />
savoir. Le premier a réussi à créer<br />
un rapport positif au savoir qui m’a<br />
mis en mouvement en tant qu’élève<br />
et donné le goût des lettres. Le second<br />
a pro<strong>du</strong>it un rapport négatif<br />
au savoir mathématique qui m’a<br />
con<strong>du</strong>it, en cette fin de mon adolescence,<br />
à ne plus rien vouloir savoir<br />
de cette discipline et à m’en exclure<br />
moi-même. Examinons le tout de<br />
plus près en méditant sur le sens<br />
que nous pouvons donner au concept<br />
de culture.<br />
LA CULTURE COMME OBJET<br />
ET COMME RAPPORT<br />
Il est possible d’abord de définir la<br />
culture en tant qu’« objet ». Fernand<br />
Dumont fournit un éclairage pertinent<br />
pour établir une première distinction<br />
par les concepts de culture<br />
première et de culture seconde. En<br />
effet, pour lui, la culture première<br />
renvoie à l’ensemble des caractéristiques<br />
<strong>du</strong> mode de vie d’une société<br />
ou d’une communauté d’acteurs, au<br />
réseau de significations familières<br />
dans lequel ils sont enracinés et<br />
qu’ils partagent au quotidien. En ce<br />
sens, la culture première est intériorisée<br />
au jour le jour par imprégnation,<br />
par osmose, comme si elle<br />
était un donné de la conscience.<br />
C’est ainsi que nous sommes tous<br />
des héritiers d’une culture première<br />
parce que nous avons appris, dès<br />
notre plus jeune âge et presque à<br />
notre insu, une langue, des con<strong>du</strong>ites<br />
sociales, des habitudes de vie, etc.<br />
La culture peut aussi être comprise<br />
autrement, c’est-à-dire comme une<br />
distanciation, comme un arrachement<br />
à la culture première. Ce<br />
deuxième sens fait référence à la<br />
culture seconde, c’est-à-dire à<br />
l’ensemble des œuvres pro<strong>du</strong>ites<br />
par l’humanité pour se comprendre<br />
elle-même. <strong>Les</strong> disciplines scientifiques,<br />
littéraires et artistiques, par<br />
exemple, sont autant de manières<br />
de s’arracher à sa culture première<br />
d’origine pour mieux saisir les significations<br />
<strong>du</strong> monde.<br />
En tant qu’institution vouée à la<br />
compréhension <strong>du</strong> monde, l’école<br />
est pour ainsi dire un cercle de<br />
culture seconde. Elle sélectionne,<br />
parmi les éléments de cette culture,<br />
ceux qui paraissent essentiels à la<br />
formation d’un être cultivé. Ainsi,<br />
on pourrait concevoir les programmes<br />
scolaires comme l’ensemble<br />
des éléments de culture seconde<br />
qu’une société choisit à un moment<br />
donné de son histoire pour former<br />
des êtres cultivés. <strong>Les</strong> États généraux<br />
sur l’é<strong>du</strong>cation, menés au cours des<br />
années 1995 et 1996, ont été l’occasion<br />
de débattre dans la société<br />
de ce qui devait faire partie de la<br />
culture seconde de l’école québécoise.<br />
À cet égard, par L’énoncé de<br />
politique é<strong>du</strong>cative (1997b), qui a<br />
conclu ce processus de consultation<br />
populaire, on a statué sur la<br />
nécessité d’enrichir les programmes<br />
des écoles et d’en rehausser<br />
ainsi la dimension culturelle.<br />
Mais se limiter à n’augmenter que<br />
la quantité des objets culturels à<br />
l’école aurait été, sans aucun doute,<br />
nettement insuffisant. On le com-<br />
prend aisément par l’exemple <strong>du</strong><br />
professeur de mathématiques cité<br />
plus haut. C’est pourquoi il est mentionné<br />
dans ce document qu’on<br />
devrait également favoriser une<br />
approche culturelle de l’enseignement<br />
(1997b, p. 13). Cette dernière<br />
recommandation touche les enseignants<br />
de manière complexe et profonde<br />
par rapport au rôle qu’ils<br />
auront à jouer et, par ricochet, leurs<br />
formateurs dans les programmes de<br />
formation initiale ou continue. Que<br />
peut donc signifier « une approche<br />
culturelle de l’enseignement »?<br />
Quelles en sont les conséquences<br />
pour les formateurs des maîtres?<br />
Pour tenter de répondre à cette<br />
question, il convient d’examiner<br />
au préalable un certain nombre<br />
d’éléments.<br />
Pour Charlot (1997), au-delà de sa<br />
constitution comme objet, la culture<br />
est aussi la construction d’un<br />
triple rapport : rapport au monde,<br />
à soi, aux autres. Par sa culture<br />
première, chaque enfant est déjà<br />
héritier <strong>du</strong> monde et porteur d’une<br />
constellation de significations. C’est<br />
ainsi qu’il intériorise à son insu des<br />
représentations de classes, des stéréotypes,<br />
des goûts, des normes de<br />
con<strong>du</strong>ite, etc. (rapport au monde).<br />
Ces représentations ont également<br />
un effet structurant sur son identité<br />
personnelle (rapport à soi). En ce<br />
sens, Paulo Freire, un é<strong>du</strong>cateur<br />
brésilien, a bien décrit l’intériorisation<br />
<strong>du</strong> statut de dominé chez le<br />
paysan qui croit être « né pour un<br />
petit pain ». Ce faisant, ce dernier<br />
accepte sa situation d’oppression<br />
comme si elle était naturelle et normale<br />
chez ceux de sa condition<br />
sociale (rapport à autrui).<br />
Dans mon exemple <strong>du</strong> départ, la<br />
poésie était, selon ma culture première,<br />
l’affaire des efféminés. L’enseignant<br />
de mon adolescence a<br />
réussi à modifier ce rapport au<br />
monde que j’avais et, partant, à<br />
transformer mon identité (j’étais un<br />
amant de la poésie et non un<br />
efféminé) qui, à son tour, a changé<br />
mon rapport à autrui (pouvoir parler<br />
de la poésie avec les copains,<br />
qu’ils soient considérés comme<br />
efféminés ou non). Ce professeur<br />
n’a pas ré<strong>du</strong>it son enseignement à<br />
ma culture première, mais il a su<br />
tisser à sa manière un lien entre<br />
mon monde et le sien.<br />
LA TÂCHE CULTURELLE<br />
DE L’ENSEIGNANT<br />
Si l’école peut être considérée<br />
comme un cercle de culture seconde,<br />
c’est qu’elle a précisément<br />
pour fonction de transformer ce<br />
rapport au monde, à soi et à autrui<br />
dont a hérité l’enfant et dont il est<br />
porteur par sa culture première,<br />
afin de le faire accéder à la culture<br />
seconde. Or, dans notre société<br />
contemporaine, la culture première<br />
de l’enfant n’est plus homogène<br />
comme autrefois, mais bien fortement<br />
éclatée. Le défi de l’enseignant<br />
est d’autant plus difficile à relever<br />
qu’il doit tenter de transformer ce<br />
rapport chez chacun de ses élèves.<br />
En tant qu’a<strong>du</strong>lte scolarisé, l’enseignant<br />
s’est progressivement détaché<br />
de sa culture première pour accéder<br />
à la culture seconde. En ce<br />
sens, il est doublement héritier :<br />
d’une culture première qui l’a façonné<br />
depuis sa tendre enfance et d’une<br />
culture seconde qu’il a acquise par<br />
la suite. Par ailleurs, au cours de sa<br />
formation, il a aussi peu à peu modifié<br />
son rapport au monde, à luimême<br />
et à autrui. La posture qu’il a<br />
acquise au fil <strong>du</strong> temps et de ses<br />
études peut finalement être fort<br />
éloignée de celle de chacun des<br />
élèves qui lui sont confiés. Sa tâche<br />
consistera donc à entrer en relation<br />
avec eux pour qu’ils établissent<br />
un nouveau rapport au monde, à<br />
eux-mêmes et à autrui et deviennent<br />
des êtres cultivés. L’apprentissage<br />
deviendra significatif pour les élèves<br />
quand l’enseignant réussira à tisser<br />
des liens avec leur contexte, leurs<br />
préoccupations et leurs repères afin<br />
de les faire accéder à d’autres rivages.<br />
C’est pourquoi, même si ce<br />
n’est pas la fonction de l’école d’enseigner<br />
la culture première, elle peut<br />
néanmoins partir de celle des élèves<br />
VIE 24 Vie pédagogique 118, février-mars<br />
2001<br />
Photo : Denis Garon