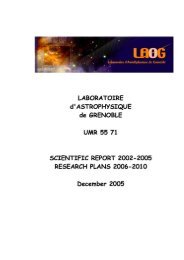Rapport quadriennal 2002 - Laboratoire d'Astrophysique de l ...
Rapport quadriennal 2002 - Laboratoire d'Astrophysique de l ...
Rapport quadriennal 2002 - Laboratoire d'Astrophysique de l ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Chapitre A<br />
Présentation générale<br />
activités pour les ingénieurs sont une source <strong>de</strong> motivation remarquable en complément <strong>de</strong>s projets<br />
instrumentaux lourds, où il s’agit principalement <strong>de</strong> réalisation même si il y a quelques points qui relèvent du<br />
défi technologique.<br />
La garantie d’un certain équilibre à ce niveau est probablement la clé pour maintenir la motivation <strong>de</strong>s<br />
ingénieurs et pérenniser l’ensemble <strong>de</strong> l’équipe.<br />
L’arrivée début <strong>2002</strong> d’un technologue <strong>de</strong>vrait nous permettre d’améliorer notre efficacité dans ce domaine,<br />
sachant que les collaborations que nous avons avec les laboratoires développant les technologies, qu’ils<br />
soient CNRS ou CEA, sont souvent limitées par la disponibilité <strong>de</strong> personnel spécialisé.<br />
Pour les activités du groupe technique le <strong>quadriennal</strong> à venir s’inscrit dans la continuité.<br />
Pour les grands projets instrumentaux: suite <strong>de</strong>s projets en cours: AMBER qui est en phase d’intégration et<br />
WIRCAM qui est en phase <strong>de</strong> démarrage. Pour l’avenir le LAOG participe aux réponses aux appels d’offre<br />
pour les instruments <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième génération du VLT pour l’optique adaptative associée par exemple à la<br />
coronographie ou pour l’interférométrie.<br />
La R&T se fera également dans la continuité <strong>de</strong>s actions actuelles, avec peut-être une implication à un niveau<br />
plus « système » pour les aspects optique adaptative, particulièrement dans le cadre <strong>de</strong> la future structure<br />
pour l’optique adaptative, ou le LAOG pourrait avoir un rôle moteur.<br />
Un <strong>de</strong>s développements qui <strong>de</strong>vra probablement être rediscuté durant les prochaines années est la poursuite<br />
du programme JSET, l’association actuelle avec le CEA et le CRTBT est fructueuse. Lorsque la phase <strong>de</strong><br />
validation actuelle aura été menée à bien, il faudra voir comment mettre en place une structure permettant <strong>de</strong><br />
développer un composant opérationnel pour l’astronomie.<br />
6.1.2 Pôle technologique régional<br />
Le LAOG participe à la réflexion sur les pôles technologiques régionaux initiée par l'INSU et le CNES en<br />
2000. La mutualisation envisagée <strong>de</strong> personnels techniques, éventuellement <strong>de</strong> moyens techniques, se ferait<br />
dans le cadre <strong>de</strong> la région "Grand Sud-Est" (GSE) regroupant Nice, Marseille, Lyon et Grenoble. Les autres<br />
laboratoires associés à cette réflexion localement sont le LPG est une équipe du LGGE.<br />
Le concept <strong>de</strong> pôle GSE intéresse le LAOG dans la mesure où il concernerait les grands projets <strong>de</strong><br />
l'astronomie sol et non pas seulement le spatial. Une <strong>de</strong>uxième contrainte provient <strong>de</strong> l'absolue nécessité <strong>de</strong><br />
conserver dans les laboratoires une variété <strong>de</strong> profils permettant <strong>de</strong> gérer localement <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> taille<br />
moyenne et <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r une proximité maximale avec les chercheurs instrumentalistes et la réflexion<br />
scientifique amont aux projets, propre aux laboratoires. De ce fait, et parce que le LAOG dispose d'une<br />
composante technique équilibrée, quasi-autonome sur <strong>de</strong> nombreux métiers, et <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> valeur, la notion <strong>de</strong><br />
pôle GSE <strong>de</strong>vrait s'accompagner du maintien d'une certaine capacité locale (Grenoble, éventuellement<br />
OSUG 5 , ou région Rhône-Alpes?).<br />
Un autre aspect <strong>de</strong>s réflexions menées est le lien éventuel avec le secteur astroparticule. Bien que<br />
l'appartenance à <strong>de</strong>s départements différents du CNRS représente une difficulté rajoutée, les collaborations<br />
potentielles et la similitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> moyens mis en œuvre plai<strong>de</strong> pour une telle approche. Sur Grenoble, et<br />
notamment pour le LAOG, les liens pré-existants avec l'IN2P3 (Structure "Cosm'Alpes" notamment, cf. A-<br />
3.3) sont une base objective permettant d'avancer dans cette voie.<br />
De la même manière, les liens avec le CEA dans les différentes régions, et donc entre CENG et le LAOG<br />
pour le pôle GSE (cf. C-1, 3 et 6), pourraient justifier une réflexion i<strong>de</strong>ntique. Les obstacles structurels<br />
semblent néanmoins importants malgré le cadre <strong>de</strong> départ fourni par la convention cadre entre UJF et CENG.<br />
6.2 Services d'observation<br />
Deux types <strong>de</strong> Services d'Observation (au sens du statut du CNAP) sont reconnus par l'INSU pour le LAOG:<br />
5 L'OSUG a commencé très récemment une réflexion sur une mutualisation interne, commune aux 7 laboratoires ou<br />
équipes <strong>de</strong> l'OSUG. Il ne va pas <strong>de</strong> soit que <strong>de</strong>ux mutualisations ainsi croisées puissent co-exister. Il sera donc nécessaire<br />
<strong>de</strong> clarifier les objectifs et avantages <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux concepts pour aboutir à un montage optimal.<br />
43