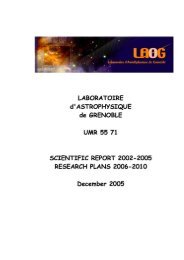Rapport quadriennal 2002 - Laboratoire d'Astrophysique de l ...
Rapport quadriennal 2002 - Laboratoire d'Astrophysique de l ...
Rapport quadriennal 2002 - Laboratoire d'Astrophysique de l ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Rapport</strong> d’activité 1999-2001<br />
LAOG<br />
5 Etoiles jeunes, disques et jets<br />
5.1 Composition <strong>de</strong> l’équipe<br />
Permanents: J. Bouvier - C. Dougados - F. Malbet - F. Ménard - J.-L. Monin<br />
Post-Doctorants: G. Duchêne - D. James<br />
Doctorants: R. Lachaume - E. Moraux<br />
5.2 Faits saillants<br />
• Découverte <strong>de</strong> nouveaux disques résolus par imagerie ˆ haute résolution angulaire autour d’étoiles jeunes<br />
• Première mesure angulairement résolue <strong>de</strong> la région interne (2 AU) <strong>de</strong>s disques d’accrétion <strong>de</strong>s étoiles<br />
jeunes par interférométrie à longue base dans le domaine infrarouge<br />
• Découverte <strong>de</strong> naines brunes isolées dans les régions <strong>de</strong> formation stellaire (Taureau, Serpent) et<br />
détermination <strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong> masse substellaire d’amas ouverts (Pléia<strong>de</strong>s, M35, Alpha Per, Blanco 1)<br />
• Premières spectro-images <strong>de</strong> microjets émanant d’étoiles T Tauri<br />
• Mise en évi<strong>de</strong>nce du rôle <strong>de</strong>s conditions initiales dans la formation <strong>de</strong> systèmes multiples<br />
5.3 Introduction<br />
L’équipe “Étoiles Jeunes, Disques et Jets” (« EJDJ » ) du LAOG étudie les processus physiques à l’œuvre<br />
dans les objets stellaires jeunes (1 million d’années) <strong>de</strong> faible masse (≤ 1 masse solaire), dans une phase où<br />
les réactions thermonucléaires principales (H) ne sont pas encore amorcées et où d’intenses phénomènes<br />
d’accrétion et d’éjection <strong>de</strong> matière sont observés dans un environnement circumstellaire complexe, autour<br />
d’objets souvent multiples.<br />
Ces étu<strong>de</strong>s s’éten<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la phase initiale <strong>de</strong> l’effondrement pour déterminer la fonction <strong>de</strong> masse initiale<br />
(IMF) —y compris substellaire— <strong>de</strong>s objets jeunes, jusqu’à la phase protoplanétaire ou le matériau présent<br />
dans le disque <strong>de</strong> l’étoile centrale s’agglomère en planètes, en passant par la structure et l’évolution <strong>de</strong>s<br />
disques, et la connexion accrétion – éjection.<br />
Nos travaux sont liés à ceux <strong>de</strong>s autres équipes du LAOG: « SHERPAS » pour l’application <strong>de</strong> modèles<br />
accrétion-éjection aux objets jeunes, le « GP» pour l’observation à haute résolution angulaire <strong>de</strong><br />
l’environnement, « DP2G » pour les questions liées à l’évolution <strong>de</strong>s disques circumstellaires, « ETFM »<br />
pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s naines brunes dans les régions <strong>de</strong> formation stellaire, « ES » pour les modèles théoriques<br />
d’évolution pré-séquence principale.<br />
5.4 Naines brunes jeunes et populations <strong>de</strong> très faible masse<br />
La Galaxie contient bien plus d’étoiles <strong>de</strong> faible masse que d’étoiles massives. La fonction <strong>de</strong> distribution<br />
<strong>de</strong>s masses stellaires, connue sous le nom <strong>de</strong> Fonction <strong>de</strong> Masse (IMF, Initial Mass Function), est<br />
relativement bien estimée pour les étoiles entre 1 et 60 M o: elle est généralement décrite par une loi <strong>de</strong><br />
puissance (dN/dM ∝ M -α ) dont l’exposant varie en fonction du domaine <strong>de</strong> masse. En revanche, sa<br />
détermination aux masses stellaires les plus faibles (0.08-0.5 M o ) et jusque dans le domaine substellaire <strong>de</strong>s<br />
naines brunes (0.01-0.08 M o , i.e., 10 à 80 masses <strong>de</strong> Jupiter) reste incertaine. En outre, la forme <strong>de</strong> la<br />
fonction <strong>de</strong> masse n’a pas aujourd’hui d’explication théorique. Des résultats récents, obtenus par Motte et<br />
André au CEA/Saclay, donnent à penser que la distribution <strong>de</strong>s masses stellaires résulte pour une part <strong>de</strong> la<br />
distribution en masse <strong>de</strong>s cœurs moléculaires <strong>de</strong>nses, précurseurs directs <strong>de</strong>s étoiles. Il est également<br />
76