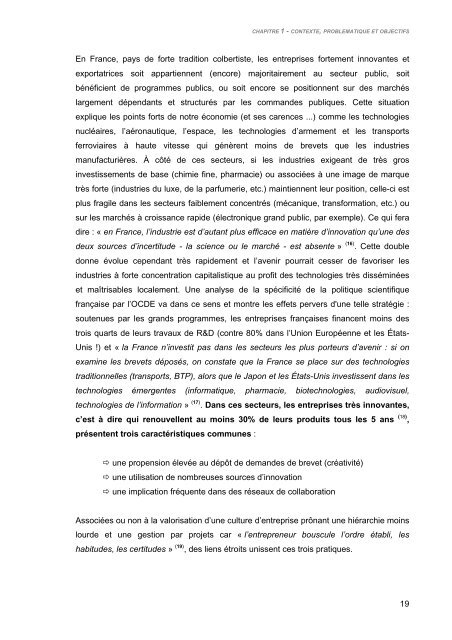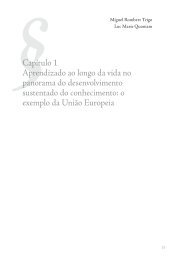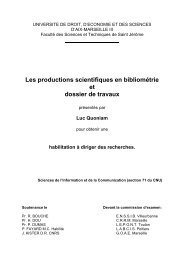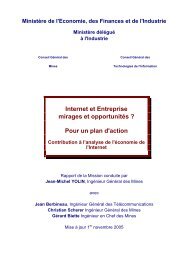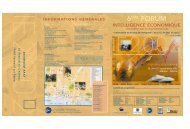Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CHAPITRE 1 - CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFSEn France, pays de forte tradition colbertiste, <strong>les</strong> entreprises fortement innovantes etexportatrices soit appartiennent (encore) majoritairement au secteur public, soitbénéficient de programmes publics, ou soit encore se positionnent sur <strong>des</strong> marchéslargement dépendants et structurés par <strong>les</strong> comman<strong>des</strong> publiques. Cette situationexplique <strong>les</strong> points forts de notre économie (et ses carences ...) comme <strong>les</strong> technologiesnucléaires, l’aéronautique, l’espace, <strong>les</strong> technologies d’armement et <strong>les</strong> transportsferroviaires à haute vitesse qui génèrent moins de brevets que <strong>les</strong> industriesmanufacturières. À côté de ces secteurs, si <strong>les</strong> industries exigeant de très grosinvestissements de base (chimie fine, pharmacie) ou associées à une image de marquetrès forte (industries du luxe, de la parfumerie, etc.) maintiennent leur position, celle-ci estplus fragile dans <strong>les</strong> secteurs faiblement concentrés (mécanique, transformation, etc.) ousur <strong>les</strong> marchés à croissance rapide (électronique grand public, par exemple). Ce qui feradire : « en France, l’industrie est d’autant plus efficace en matière d’innovation qu’une <strong>des</strong>deux sources d’incertitude - la science ou le marché - est absente » (16) . Cette doubledonne évolue cependant très rapidement et l’avenir pourrait cesser de favoriser <strong>les</strong>industries à forte concentration capitalistique au profit <strong>des</strong> technologies très disséminéeset maîtrisab<strong>les</strong> localement. Une analyse de la spécificité de la politique scientifiquefrançaise par l’OCDE va dans ce sens et montre <strong>les</strong> effets pervers d'une telle stratégie :soutenues par <strong>les</strong> grands programmes, <strong>les</strong> entreprises françaises financent moins <strong>des</strong>trois quarts de leurs travaux de R&D (contre 80% dans l’Union Européenne et <strong>les</strong> États-Unis !) et « la France n’investit pas dans <strong>les</strong> secteurs <strong>les</strong> plus porteurs d’avenir : si onexamine <strong>les</strong> brevets déposés, on constate que la France se place sur <strong>des</strong> technologiestraditionnel<strong>les</strong> (transports, BTP), alors que le Japon et <strong>les</strong> États-Unis investissent dans <strong>les</strong>technologies émergentes (informatique, pharmacie, biotechnologies, audiovisuel,technologies de l’information » (17) . Dans ces secteurs, <strong>les</strong> entreprises très innovantes,c’est à dire qui renouvellent au moins 30% de leurs produits tous <strong>les</strong> 5 ans (18) ,présentent trois caractéristiques communes :ð une propension élevée au dépôt de deman<strong>des</strong> de brevet (créativité)ð une utilisation de nombreuses sources d’innovationð une implication fréquente dans <strong>des</strong> réseaux de collaborationAssociées ou non à la valorisation d’une culture d’entreprise prônant une hiérarchie moinslourde et une gestion par projets car « l’entrepreneur bouscule l’ordre établi, <strong>les</strong>habitu<strong>des</strong>, <strong>les</strong> certitu<strong>des</strong> » (19) , <strong>des</strong> liens étroits unissent ces trois pratiques.19