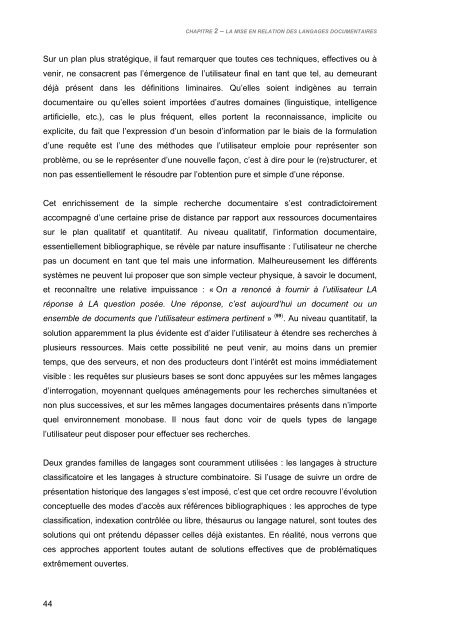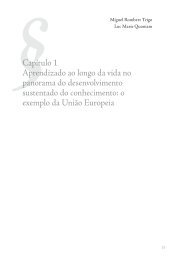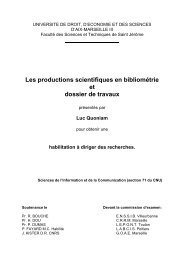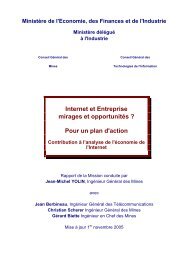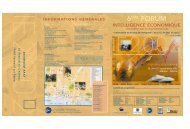Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CHAPITRE 2 – LA MISE EN RELATION DES LANGAGES DOCUMENTAIRESSur un plan plus stratégique, il faut remarquer que toutes ces techniques, effectives ou àvenir, ne consacrent pas l’émergence de l’utilisateur final en tant que tel, au demeurantdéjà présent dans <strong>les</strong> définitions liminaires. Qu’el<strong>les</strong> soient indigènes au terraindocumentaire ou qu’el<strong>les</strong> soient importées d’autres domaines (linguistique, intelligenceartificielle, etc.), cas le plus fréquent, el<strong>les</strong> portent la reconnaissance, implicite ouexplicite, du fait que l’expression d’un besoin d’information par le biais de la formulationd’une requête est l’une <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> que l’utilisateur emploie pour représenter sonproblème, ou se le représenter d’une nouvelle façon, c’est à dire pour le (re)structurer, etnon pas essentiellement le résoudre par l’obtention pure et simple d’une réponse.Cet enrichissement de la simple recherche documentaire s’est contradictoirementaccompagné d’une certaine prise de distance par rapport aux ressources documentairessur le plan qualitatif et quantitatif. Au niveau qualitatif, l’information documentaire,essentiellement bibliographique, se révèle par nature insuffisante : l’utilisateur ne cherchepas un document en tant que tel mais une information. Malheureusement <strong>les</strong> différentssystèmes ne peuvent lui proposer que son simple vecteur physique, à savoir le document,et reconnaître une relative impuissance : « On a renoncé à fournir à l’utilisateur LAréponse à LA question posée. Une réponse, c’est aujourd’hui un document ou unensemble de documents que l’utilisateur estimera pertinent » (99) . Au niveau quantitatif, lasolution apparemment la plus évidente est d’aider l’utilisateur à étendre ses recherches àplusieurs ressources. Mais cette possibilité ne peut venir, au moins dans un premiertemps, que <strong>des</strong> serveurs, et non <strong>des</strong> producteurs dont l’intérêt est moins immédiatementvisible : <strong>les</strong> requêtes sur plusieurs bases se sont donc appuyées sur <strong>les</strong> mêmes langagesd’interrogation, moyennant quelques aménagements pour <strong>les</strong> recherches simultanées etnon plus successives, et sur <strong>les</strong> mêmes langages documentaires présents dans n’importequel environnement monobase. Il nous faut donc voir de quels types de langagel’utilisateur peut disposer pour effectuer ses recherches.Deux gran<strong>des</strong> famil<strong>les</strong> de langages sont couramment utilisées : <strong>les</strong> langages à structureclassificatoire et <strong>les</strong> langages à structure combinatoire. Si l’usage de suivre un ordre deprésentation historique <strong>des</strong> langages s’est imposé, c’est que cet ordre recouvre l’évolutionconceptuelle <strong>des</strong> mo<strong>des</strong> d’accès aux références bibliographiques : <strong>les</strong> approches de typeclassification, indexation contrôlée ou libre, thésaurus ou langage naturel, sont toutes <strong>des</strong>solutions qui ont prétendu dépasser cel<strong>les</strong> déjà existantes. En réalité, nous verrons queces approches apportent toutes autant de solutions effectives que de problématiquesextrêmement ouvertes.44