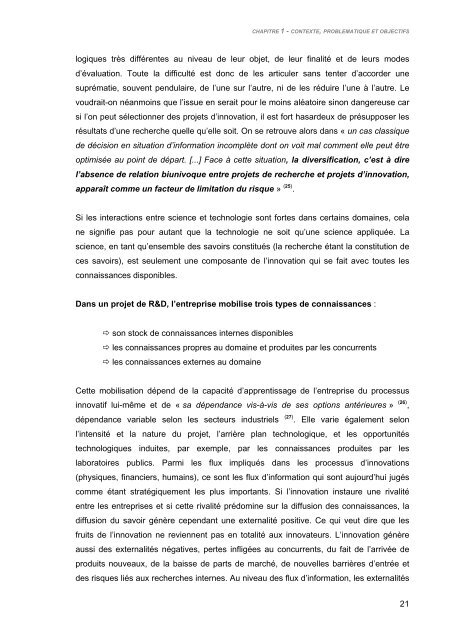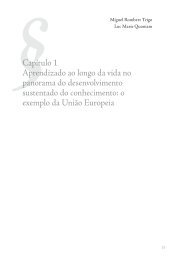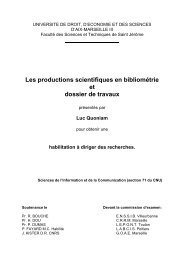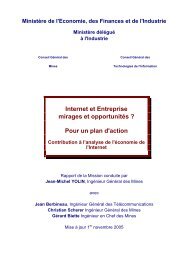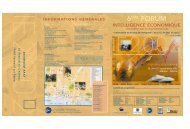Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CHAPITRE 1 - CONTEXTE, PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFSlogiques très différentes au niveau de leur objet, de leur finalité et de leurs mo<strong>des</strong>d’évaluation. Toute la difficulté est donc de <strong>les</strong> articuler sans tenter d’accorder unesuprématie, souvent pendulaire, de l’une sur l’autre, ni de <strong>les</strong> réduire l’une à l’autre. Levoudrait-on néanmoins que l’issue en serait pour le moins aléatoire sinon dangereuse carsi l’on peut sélectionner <strong>des</strong> projets d’innovation, il est fort hasardeux de présupposer <strong>les</strong>résultats d’une recherche quelle qu’elle soit. On se retrouve alors dans « un cas classiquede décision en situation d’information incomplète dont on voit mal comment elle peut êtreoptimisée au point de départ. [...] Face à cette situation, la diversification, c’est à direl’absence de relation biunivoque entre projets de recherche et projets d’innovation,apparaît comme un facteur de limitation du risque » (25) .Si <strong>les</strong> interactions entre science et technologie sont fortes dans certains domaines, celane signifie pas pour autant que la technologie ne soit qu’une science appliquée. Lascience, en tant qu’ensemble <strong>des</strong> savoirs constitués (la recherche étant la constitution deces savoirs), est seulement une composante de l’innovation qui se fait avec toutes <strong>les</strong>connaissances disponib<strong>les</strong>.Dans un projet de R&D, l’entreprise mobilise trois types de connaissances :ð son stock de connaissances internes disponib<strong>les</strong>ð <strong>les</strong> connaissances propres au domaine et produites par <strong>les</strong> concurrentsð <strong>les</strong> connaissances externes au domaineCette mobilisation dépend de la capacité d’apprentissage de l’entreprise du processusinnovatif lui-même et de « sa dépendance vis-à-vis de ses options antérieures » (26) ,dépendance variable selon <strong>les</strong> secteurs industriels (27) . Elle varie également selonl’intensité et la nature du projet, l’arrière plan technologique, et <strong>les</strong> opportunitéstechnologiques induites, par exemple, par <strong>les</strong> connaissances produites par <strong>les</strong>laboratoires publics. Parmi <strong>les</strong> flux impliqués dans <strong>les</strong> processus d’innovations(physiques, financiers, humains), ce sont <strong>les</strong> flux d’information qui sont aujourd’hui jugéscomme étant stratégiquement <strong>les</strong> plus importants. Si l’innovation instaure une rivalitéentre <strong>les</strong> entreprises et si cette rivalité prédomine sur la diffusion <strong>des</strong> connaissances, ladiffusion du savoir génère cependant une externalité positive. Ce qui veut dire que <strong>les</strong>fruits de l’innovation ne reviennent pas en totalité aux innovateurs. L’innovation génèreaussi <strong>des</strong> externalités négatives, pertes infligées au concurrents, du fait de l’arrivée deproduits nouveaux, de la baisse de parts de marché, de nouvel<strong>les</strong> barrières d’entrée et<strong>des</strong> risques liés aux recherches internes. Au niveau <strong>des</strong> flux d’information, <strong>les</strong> externalités21