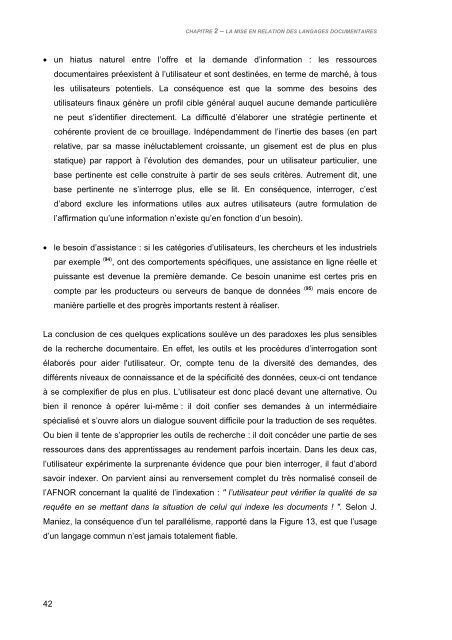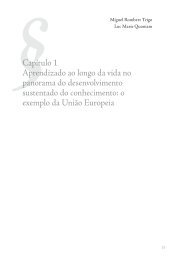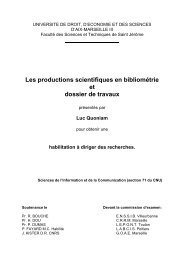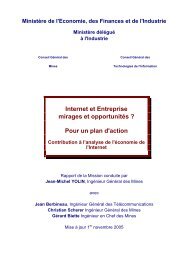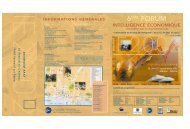Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
Tableau 15 JOPAL : répartition des sous-classes les ... - Luc Quoniam
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CHAPITRE 2 – LA MISE EN RELATION DES LANGAGES DOCUMENTAIRES• un hiatus naturel entre l’offre et la demande d’information : <strong>les</strong> ressourcesdocumentaires préexistent à l’utilisateur et sont <strong>des</strong>tinées, en terme de marché, à tous<strong>les</strong> utilisateurs potentiels. La conséquence est que la somme <strong>des</strong> besoins <strong>des</strong>utilisateurs finaux génère un profil cible général auquel aucune demande particulièrene peut s’identifier directement. La difficulté d’élaborer une stratégie pertinente etcohérente provient de ce brouillage. Indépendamment de l’inertie <strong>des</strong> bases (en partrelative, par sa masse inéluctablement croissante, un gisement est de plus en plusstatique) par rapport à l’évolution <strong>des</strong> deman<strong>des</strong>, pour un utilisateur particulier, unebase pertinente est celle construite à partir de ses seuls critères. Autrement dit, unebase pertinente ne s’interroge plus, elle se lit. En conséquence, interroger, c’estd’abord exclure <strong>les</strong> informations uti<strong>les</strong> aux autres utilisateurs (autre formulation del’affirmation qu’une information n’existe qu’en fonction d’un besoin).• le besoin d’assistance : si <strong>les</strong> catégories d’utilisateurs, <strong>les</strong> chercheurs et <strong>les</strong> industrielspar exemple (94) , ont <strong>des</strong> comportements spécifiques, une assistance en ligne réelle etpuissante est devenue la première demande. Ce besoin unanime est certes pris encompte par <strong>les</strong> producteurs ou serveurs de banque de données (95) mais encore demanière partielle et <strong>des</strong> progrès importants restent à réaliser.La conclusion de ces quelques explications soulève un <strong>des</strong> paradoxes <strong>les</strong> plus sensib<strong>les</strong>de la recherche documentaire. En effet, <strong>les</strong> outils et <strong>les</strong> procédures d’interrogation sontélaborés pour aider l'utilisateur. Or, compte tenu de la diversité <strong>des</strong> deman<strong>des</strong>, <strong>des</strong>différents niveaux de connaissance et de la spécificité <strong>des</strong> données, ceux-ci ont tendanceà se complexifier de plus en plus. L’utilisateur est donc placé devant une alternative. Oubien il renonce à opérer lui-même : il doit confier ses deman<strong>des</strong> à un intermédiairespécialisé et s’ouvre alors un dialogue souvent difficile pour la traduction de ses requêtes.Ou bien il tente de s’approprier <strong>les</strong> outils de recherche : il doit concéder une partie de sesressources dans <strong>des</strong> apprentissages au rendement parfois incertain. Dans <strong>les</strong> deux cas,l’utilisateur expérimente la surprenante évidence que pour bien interroger, il faut d’abordsavoir indexer. On parvient ainsi au renversement complet du très normalisé conseil del’AFNOR concernant la qualité de l’indexation : " l’utilisateur peut vérifier la qualité de sarequête en se mettant dans la situation de celui qui indexe <strong>les</strong> documents ! ". Selon J.Maniez, la conséquence d’un tel parallélisme, rapporté dans la Figure 13, est que l’usaged’un langage commun n’est jamais totalement fiable.42