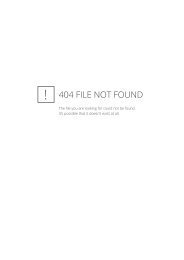[tel-00726959, v1] Caractériser le milieu interstellaire ... - HAL - INRIA
[tel-00726959, v1] Caractériser le milieu interstellaire ... - HAL - INRIA
[tel-00726959, v1] Caractériser le milieu interstellaire ... - HAL - INRIA
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
7.2 MODE INTERFÉROMÉTRIQUE 161<strong>tel</strong>-<strong>00726959</strong>, version 1 - 31 Aug 2012suffisemment large, au moins quelques minutes d’arc au carré. La figure 7.1 montre un exemp<strong>le</strong>récent spectaculaire, à savoir l’imagerie avec l’interféromètre du Plateau de Bure d’une surfacede 5 ′ × 3 ′ au centre de la célèbre galaxie spira<strong>le</strong> M51 à une résolution typique de 1 ′′ [C6]. Or, <strong>le</strong>santennes de 12m de l’interféromètre d’ALMA donnent un champ de vue instantané relativementpetit : 27 ′′ à 230 GHz et 9 ′′ à 690 GHz. L’interférométrie grand-champ est donc un enjeu essentielpour ALMA.Historiquement, <strong>le</strong>s interféromètres (sub)-millimétriques actuels (PdBI, CARMA, SMA) ontété construits pour démontrer la viabilité et la nécessité scientifique de l’interférométrie (sub)-millimétrique. L’importance de <strong>le</strong>urs résultats a conduit à la réalisation du projet ALMA. Encontre-partie, l’imagerie grand-champ n’a été un objectif important qu’une dizaine d’annéesaprès <strong>le</strong>ur mise en service. A l’inverse, l’imagerie grand-champ a été un objectif prioritaired’ALMA dès sa phase de conception. Durant <strong>le</strong>s années 2001 et 2002, j’ai étudié l’ajout auconcept initial (50 antennes de 12m) d’un réseau 12 antennes de 7m (dit ACA, Atacama CompactArray) pour améliorer des performances d’imagerie grand-champ de l’instrument [M20,M21, M22]. En effet, comme tout interféromètre multiplicatif, ALMA filtre <strong>le</strong>s fréquences spatia<strong>le</strong>sinférieures à environ 1.5 fois <strong>le</strong> diamètre des antennes (ici 18m) et l’utilisation des antennesen mode puissance tota<strong>le</strong> (auto-corrélation) ne permet de récupérer que la fréquence spatia<strong>le</strong> à0m. L’objectif du réseau ACA est de comb<strong>le</strong>r <strong>le</strong> manque de mesures des fréquences spatia<strong>le</strong>s auxa<strong>le</strong>ntours de 10m. Ces études réalisées en collaboration avec F. Gueth (IRAM) et S. Guilloteau(alors “Project Scientist” d’ALMA) ont été essentiel<strong>le</strong>s dans la décision de l’ajout d’ACA au projetde base pour un coût estimé entre 100 et 150 Meuros. Les outils que nous avons développésont été par la suite utilisés par nos collègues japonais pour affiner <strong>le</strong> design d’ACA [M14].Par ail<strong>le</strong>urs, l’imagerie grand-champ en interférométrie millimétrique est aujourd’hui obtenueavec une technique classique, dite “stop-and-go mosaicing”. Cette technique est comparab<strong>le</strong>au “raster mapping” avec une antenne unique. Bien qu’el<strong>le</strong> permette de faire de l’imagerie grandchamp,cette technique limite à la fois l’efficacité 2 et <strong>le</strong> champ de vue observab<strong>le</strong>. L’imageriegrand-champ est ainsi aujourd’hui au même point en mode interférométrique qu’el<strong>le</strong> l’était enmode té<strong>le</strong>scope unique au début des années 1990. Nous sommes donc potentiel<strong>le</strong>ment à la veil<strong>le</strong>d’une révolution dans ce domaine avec l’introduction du mode d’observation OTF en interférométrie.Hormis <strong>le</strong>s problèmes techniques (synchronisation d’antennes en mouvement simultané,augmentation importante du débit de données, etc...), l’absence d’algorithmes d’imagerie et dedéconvolution dédiés est une des raisons principa<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong> mode d’observation OTFn’a, à notre connaissance, jamais été utilisé auparavant sur un interféromètre millimétrique. Dans<strong>le</strong> traitement d’observations classiques (“stop-and-go mosaicing”), <strong>le</strong>s visibilités sont imagéesindépendamment champ par champ avant que <strong>le</strong>s images produites ne soient combinées linéairement.La quantité de données produites par <strong>le</strong>s observations OTF exclut une <strong>tel</strong><strong>le</strong> approche.Je propose avec N. Rodriguez-Fernandez un traitement dans <strong>le</strong>quel <strong>le</strong>s visibilités observées surdiverses positions du ciel sont rééchantillonnées sur une gril<strong>le</strong> régulière à la fois dans <strong>le</strong> plandu ciel et dans <strong>le</strong> plan uv 3 avant d’être imagées et déconvoluées [A7]. Cette inversion des opérationspermet de traiter <strong>le</strong> problème par une réduction de la quantité de données d’au moinsun ordre de grandeur. Plus fondamenta<strong>le</strong>ment, nous montrons qu’el<strong>le</strong> introduit aussi un changementconceptuel important dans la manière de penser l’imagerie grand-champ en interférométriemillimétrique.2 Car <strong>le</strong> signal n’est pas intégré lorsque <strong>le</strong>s antennes passent d’une position à une autre.3 Le plan uv est l’espace où sont mesurées <strong>le</strong>s visibilités interférométriques. Ce plan est lié au plan de Fourier.


![[tel-00726959, v1] Caractériser le milieu interstellaire ... - HAL - INRIA](https://img.yumpu.com/50564350/161/500x640/tel-00726959-v1-caractacriser-le-milieu-interstellaire-hal-inria.jpg)