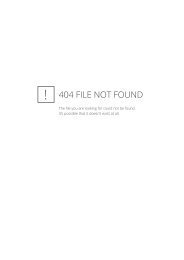[tel-00726959, v1] Caractériser le milieu interstellaire ... - HAL - INRIA
[tel-00726959, v1] Caractériser le milieu interstellaire ... - HAL - INRIA
[tel-00726959, v1] Caractériser le milieu interstellaire ... - HAL - INRIA
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4.2 ETUDES DIRECTES EN ÉMISSION 19<strong>tel</strong>-<strong>00726959</strong>, version 1 - 31 Aug 2012absorbante, indépendamment de tout transfert de rayonnement (un photon continuum absorbééga<strong>le</strong> une molécu<strong>le</strong> absorbante).H. Liszt (NRAO, USA) et R. Lucas (Joint ALMA Office, Chili) ont donc adapté cette méthodeen radio-astronomie millimétrique avec l’étude de l’absorption par <strong>le</strong> gaz galactique del’émission continuum brillante de quelques dizaines de quasars extragalactiques, assurant unemesure non-biaisée (par la source continuum) des propriétés du gaz diffus. Ce travail, que j’ai rejointen 2003, a conduit à de nombreuses surprises, parmi <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s une importante (mais néanmoinslimitée) chimie polyatomique : détection de HCO + , CCH, C 3 H 2 , CN, HCN, HNC, H 2 CO,NH 3 [A27, et références citées dans cet artic<strong>le</strong>] ; non-détection de CH 3 OH et HC 5 N [A16]. Cettechimie a parfois lieu dans des régions incapab<strong>le</strong>s d’exciter CO à des niveaux d’émission détectab<strong>le</strong>s.Les modè<strong>le</strong>s standards de la chimie des nuages diffus prévoit des abondances chimiquesinférieures d’au moins un ordre de grandeur à ce qui est observé. Les profils de raies ne montrentpas de traces évidentes de processus énergétiques (des chocs par exemp<strong>le</strong>), qui permettraientd’activer une chimie chaude. En résumé, nous avons vu une chimie extraordinaire dans <strong>le</strong> gazdiffus, mais <strong>le</strong>s données ne donnent pas encore de suggestions claires qui puissent l’expliquer.L’étape suivante est la recherche en émission de la structure du gaz par observation des nuagesporteurs. Un des buts majeurs de ce travail est de comprendre si la cinématique des raies signa<strong>le</strong><strong>le</strong> dépôt d’énergie en quantité suffisante pour provoquer la chimie observée en absorption.4.2 Etudes directes en émissionPour former des nuages moléculaires géants, il faut dissiper loca<strong>le</strong>ment l’énergie turbu<strong>le</strong>nte etmagnétique responsab<strong>le</strong> du support des nuages diffus contre l’effondrement gravitationnel. Bienque ces processus de dissipation soient mal connus, ils sont une source potentiel<strong>le</strong> d’énergie pourprovoquer la chimie du <strong>milieu</strong> diffus [A36]. Durant mon service militaire et ma thèse, j’ai mis aupoint avec D. Lis (Caltech, USA) et E. Falgarone (LERMA) des outils d’étude de la cinématiquedes raies de CO, permettant de caractériser la dissipation de la turbu<strong>le</strong>nce [A33, A38, A39]. Lesrésultats de ces outils statistiques sont d’autant plus probants que la tail<strong>le</strong> de l’échantillon étudiéest plus grande. Deux possibilités s’offrent dans <strong>le</strong> cadre du <strong>milieu</strong> inters<strong>tel</strong>laire. Soit on augmen<strong>tel</strong>a tail<strong>le</strong> de la région étudiée à résolution constante : la limite vient du risque d’étudier desrégions soumises à des conditions physiques différentes. Soit on augmente la résolution à tail<strong>le</strong>de région fixée : il est alors naturel de faire de l’imagerie grand-champ avec des interféromètres.Avec P. Hily-Blant et E. Falgarone, nous avons réalisé <strong>le</strong>s deux options dans la même région duciel appelée Polaris [A9, A18]. Les données du Plateau de Bure nous ont permis en particulier demettre en évidence de nouvel<strong>le</strong>s structures CO à très petite échel<strong>le</strong> (milli-parsec) : il s’agit de gradientsd’émission très aigus à la fois spatia<strong>le</strong>ment et en vitesse, aux bords de régions où l’émissionCO est relativement continue. Les gradients de vitesse locaux, jusque 780 km s −1 pc −1 , sont<strong>le</strong>s plus grands jamais mesurés dans une région sans formation active d’étoi<strong>le</strong>. Une interprétationpossib<strong>le</strong> est que ces structures sont un lieu de dissipation de l’énergie turbu<strong>le</strong>nte à l’origine duCO vu en émission.4.3 Combiner <strong>le</strong>s deux approches


![[tel-00726959, v1] Caractériser le milieu interstellaire ... - HAL - INRIA](https://img.yumpu.com/50564350/19/500x640/tel-00726959-v1-caractacriser-le-milieu-interstellaire-hal-inria.jpg)