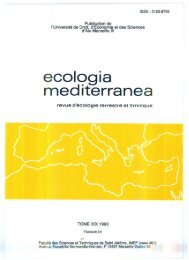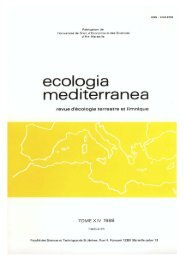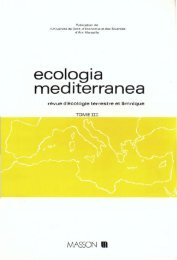Princ;p.ul - Ecologia Mediterranea
Princ;p.ul - Ecologia Mediterranea
Princ;p.ul - Ecologia Mediterranea
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
116<br />
repercute pas par une avancée sensible du littoral.<br />
5°) Une dernière période débute vers - 2,50 m. A ce niveau, l'action humaine commence à se<br />
répercuter de façon plus sensible dans le diagramme.<br />
En effet, on observe alors une brusque cassure dans la courbe du Pin d'Alep. Comment ne pas<br />
relier cette disparition momentanément totale de l'espèce à des incendies d'origine humaine et c<strong>ul</strong>turale<br />
dont la responsabilité incombe aux premiers agric<strong>ul</strong>teurs chasséens qui se sont établis sur les plateaux<br />
au-dessus des plaines côtières (M. Escalon de Fonton, 1969).<br />
Par ailleurs, le déclin du Chêne pubescent s'accélère. Quant au Chêne vert, après un court accident,<br />
sa représentation demeurera à peu près étale. L'action humaine hâte dans le même temps la<br />
disparition de Tilia, Ulmus, Fagus, Bet<strong>ul</strong>a et i\bies. Tous ces faits se reflètent au niveau du diagramme<br />
dans la courbe des AP qui ne dépasse plus 50% et décrit un plateau relativement rég<strong>ul</strong>ier jusqu'à<br />
nos jours indiquant donc un paysage forestier globalement assez voisin de la végétation actuelle. Les<br />
effets du pâturage s'ajoutent vraisemblablement à l'agric<strong>ul</strong>ture qui s'intensifie, se fixe et ne se borne<br />
plus à une simple exploitation locale et épisodique. La pratique agricole s'affirmant, du pollen de céréales<br />
s'observe dans le diagramme ainsi que les courbes qui signent la c<strong>ul</strong>ture de l'Olivier et du Noyer.<br />
Par contre, dans les niveaux supérieurs du diagramme, l'abandon de l'agric<strong>ul</strong>ture sur les terrasses en<br />
«bancaou» se traduit par une augmentation de la garrigue à Pin d'Alep dans une période qui correspond<br />
certainement aux dernières décennies. De même, parmi les Herbacées, l'abondance des Chénopodiacées<br />
dans les 60 derniers centimètres est à rattacher aux abandons récents de marais salants tout proches.<br />
Vers - 2m les Cupressacées reprennent de l'importance. Outre Juniperus L. pouvant marquer<br />
les vicissitudes de la c<strong>ul</strong>ture, il s'agit vraisemblablement, pour l'essentiel, du Cyprès, c<strong>ul</strong>tivé comme<br />
arbre d'ornement, arbre de protection contre le vent, au moins dans la deuxième partie de la courbe où<br />
les pourcentages sont plus substantiels. De même, les pourcentages dans les 60 cm superficiels de<br />
Pinus pinea L. observés semblent indiquer une recrudescence rés<strong>ul</strong>tant de plantations venant s'ajouter<br />
aux rares stations naturelles.<br />
Il est à noter qu'une courbe presque continue de Callune caractérise la période agraire. Il est<br />
difficile d'imaginer la localisation des groupements correspondants. Peut-être s'agissait-il de groupements<br />
transitoires sur des surfaces où, en Crau notamment, le processus régressif de la végétation prolongeait<br />
la destruction de la forêt. Quant à la représentation des autres Ericacées qui est plus importante<br />
dans cette dernière phase elle est à mettre au compte essentiellement de la structure plus ouverte<br />
de la pinède subissant l'action humaine.<br />
A la base de cette période la transgression versilienne ne se manifeste plus par un rapprochement<br />
du littoral, et tout laisse à penser que le niveau marin actuel est atteint vers - 2,50 m, ce qui<br />
correspond à une date approximative de 2000 BP (E. Bonifay, 1973), au moment où se manifeste la présence<br />
de sable dans la tourbe. D'ailleurs, à partir de cette même profondeur - 2,50 m la courbe des<br />
Chénopodiacées commence à progresser traduisant un élargissement de la zone halophile séparant le<br />
marais de la mer. Cet élargissement rés<strong>ul</strong>te d'un mécanisme complexe faisant intervenir le jeu de<br />
nombreux facteurs: la vitesse de transgression tendant à s'ann<strong>ul</strong>er, l'ingression marine est compensée<br />
et même dépassée par la sédimentation continentale avec, en partic<strong>ul</strong>ier, les apports latéraux rhodaniens.<br />
A travers cette zone, de petits passages permettent à la mer, par gros temps, de rejoindre le<br />
marécage qui est donc temporairement salé.<br />
CHRONOLOGI E<br />
DISCUSSION<br />
L'ensemble des données énoncées précédemment ainsi que le datage C14 du niveau - 4,10 m<br />
permettent de tenter de situer par rapport à la chronologie classiquement adoptée en Europe moyenne<br />
les différentes périodes analysées dans le diagramme.<br />
Les plus profonds niveaux du sondage sont bien antérieurs au milieu de l'Atlantique, mais le<br />
début de l'émiettement dunaire rés<strong>ul</strong>tant d'une accélération de la transgression ( - 4,30 m) ne peut pas<br />
être relié de façon simple avec un événement climatique général, si bien qu'il est délicat de le corréler<br />
avec, par exemple, le passage Atlantique A - Atlantique B (M. Couteaux, 1969). Par contre, l'épisode<br />
climatique situé à -3,50m - -3,lOm semble bien correspondre à la limite Atlantique-Subboréal, d'autant<br />
qu'il est suivi par une période de stabilité sur près d'un mètre répondant bien aux caractéristiques