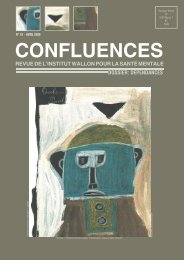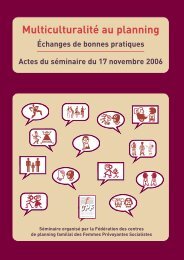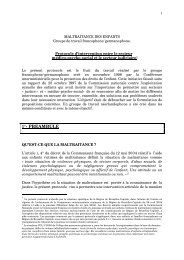Ouvrir le Confluence 24 en pdf - Institut wallon pour la santé mentale ...
Ouvrir le Confluence 24 en pdf - Institut wallon pour la santé mentale ...
Ouvrir le Confluence 24 en pdf - Institut wallon pour la santé mentale ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Créer <strong>le</strong>s li<strong>en</strong>s, tisser <strong>le</strong> réseau autour de <strong>la</strong> personne<br />
Au-delà de <strong>la</strong> fragm<strong>en</strong>tation administrative et des idéologies <strong>en</strong> cours se prés<strong>en</strong>te un<br />
travail d’artisan tisserand où il convi<strong>en</strong>t de retrouver chaque nœud ess<strong>en</strong>tiel afin de<br />
pouvoir construire <strong>la</strong> trame d’un circuit de soins sans fail<strong>le</strong>… Vu de F<strong>la</strong>ndre.<br />
Johan DE GROEF 1<br />
Pédagogue et Psychanalyste,<br />
Directeur général du VZW Zonnelied à Roosdaal 2 ,<br />
Présid<strong>en</strong>t d’un circuit de soin <strong>en</strong> Brabant f<strong>la</strong>mand et à Bruxel<strong>le</strong>s<br />
<strong>pour</strong> des personnes avec un handicap m<strong>en</strong>tal (doub<strong>le</strong> diagnostic)<br />
L’appel<strong>la</strong>tion « doub<strong>le</strong> diagnostic » évoque<br />
une problématique pluriel<strong>le</strong> ou une doub<strong>le</strong><br />
pathologie. De par son contexte et son<br />
origine, el<strong>le</strong> est anglo-saxonne et assez<br />
réc<strong>en</strong>te : el<strong>le</strong> date du début des années 1990.<br />
Depuis, <strong>le</strong> nombre de ces personnes étiquetées<br />
« doub<strong>le</strong> diagnostic » ne cesse d’augm<strong>en</strong>ter sur<br />
<strong>le</strong>s listes d’att<strong>en</strong>te, avec <strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ce, des<br />
retards de traitem<strong>en</strong>t de plus <strong>en</strong> plus importants.<br />
Parallè<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t donc à une idéologie « inclusive »<br />
dominante, un mouvem<strong>en</strong>t d’exclusion de <strong>la</strong><br />
personne, doub<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t diagnostiquée, s’insinue<br />
subrepticem<strong>en</strong>t.<br />
L’institution échappe<br />
à <strong>la</strong> désinstitutionalisation<br />
Sans al<strong>le</strong>r trop loin dans l’archéologie de cette<br />
notion de doub<strong>le</strong> diagnostic, il est tout de même<br />
important de préciser que ce concept, purem<strong>en</strong>t<br />
administratif au départ, soulève un questionnem<strong>en</strong>t<br />
éthique. Implicitem<strong>en</strong>t, il nous conduit<br />
dans <strong>le</strong> champ sémantique de « ce qui convi<strong>en</strong>t,<br />
de ce qui est adapté ». Ou <strong>en</strong>core, dans l’association<br />
du « qui », du « quoi » et du « où ».<br />
En d’autres termes, <strong>le</strong> concept de doub<strong>le</strong> diagnostic<br />
pose <strong>la</strong> question fondam<strong>en</strong>ta<strong>le</strong> de l’image de<br />
l’homme qu’il implique. Quel<strong>le</strong> conception de<br />
l’homme <strong>pour</strong> quel concept ?<br />
Propos mis <strong>en</strong> forme par Christine GOSSELIN - IWSM<br />
A cet égard, cette notion <strong>pour</strong>rait être<br />
significative de quelque chose qui se serait perdu<br />
dans <strong>le</strong> glissem<strong>en</strong>t opéré d’un modè<strong>le</strong> médical à<br />
un modè<strong>le</strong> citoy<strong>en</strong>. En effet, jusqu’<strong>en</strong> 1970<br />
<strong>en</strong>viron, <strong>le</strong>s personnes avec un handicap intel<strong>le</strong>ctuel<br />
étai<strong>en</strong>t considérées comme ma<strong>la</strong>des et<br />
vulnérab<strong>le</strong>s puisque des facteurs héréditaires ou<br />
des dégradations organiques <strong>en</strong>traînai<strong>en</strong>t des<br />
limitations dans <strong>le</strong>ur comportem<strong>en</strong>t. El<strong>le</strong>s<br />
devai<strong>en</strong>t être isolées d’une vie socia<strong>le</strong> à <strong>la</strong>quel<strong>le</strong><br />
el<strong>le</strong>s ne pouvai<strong>en</strong>t s’intégrer et dont il conv<strong>en</strong>ait<br />
de <strong>le</strong>s protéger. Entièrem<strong>en</strong>t dép<strong>en</strong>dantes d’un<br />
accompagnem<strong>en</strong>t médical, ces personnes étai<strong>en</strong>t<br />
surtout soignées dans un institut conçu sur un<br />
modè<strong>le</strong> hospitalier.<br />
Il faudra att<strong>en</strong>dre <strong>le</strong>s années 70-80, <strong>pour</strong> que<br />
progressivem<strong>en</strong>t, suite aux avancées des théories<br />
orthopédagogiques notamm<strong>en</strong>t, un autre regard<br />
se pose sur <strong>la</strong> personne handicapée. La personne<br />
avec un handicap intel<strong>le</strong>ctuel est « une personne<br />
ordinaire mais avec des besoins particuliers à<br />
côté des besoins habituels » 3 . Le handicap est<br />
considéré comme une conséqu<strong>en</strong>ce possib<strong>le</strong>, <strong>en</strong><br />
fonction des normes et va<strong>le</strong>urs <strong>en</strong> cours de <strong>la</strong> vie<br />
socia<strong>le</strong>, de limitations dans <strong>le</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t<br />
personnel. Il est à compr<strong>en</strong>dre de manière<br />
re<strong>la</strong>tionnel<strong>le</strong>, interre<strong>la</strong>tionnel<strong>le</strong>, dans un contexte<br />
social. Les conditions et modè<strong>le</strong>s de vies doiv<strong>en</strong>t<br />
donc être <strong>le</strong>s plus ordinaires possib<strong>le</strong>s afin de<br />
trouver une p<strong>la</strong>ce de citoy<strong>en</strong> à part <strong>en</strong>tière dans<br />
cette société, malgré <strong>le</strong>s limitations personnel<strong>le</strong>s<br />
et <strong>le</strong>s problèmes organiques. C’est ce que l’on<br />
nomme « l’intégration ». Trouver dans <strong>la</strong> société,<br />
<strong>la</strong> solution d’un problème de société. L’acc<strong>en</strong>t est<br />
mis sur l’autodétermination, l’épanouissem<strong>en</strong>t<br />
personnel et l’inclusion comme élém<strong>en</strong>ts<br />
ess<strong>en</strong>tiels.<br />
Paradoxa<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t, simultaném<strong>en</strong>t à ce mouvem<strong>en</strong>t<br />
optimiste d’inclusion, une autre t<strong>en</strong>dance apparaît,<br />
sous <strong>la</strong> forme de <strong>la</strong> notion de « doub<strong>le</strong><br />
diagnostic », comme « umheimlich », étrange,<br />
insécurisant, voire traumatique (?), qui provoque<br />
<strong>la</strong> confusion aussi bi<strong>en</strong> théorique que pratique…<br />
Et cette notion relève du diagnostic : il s’avère<br />
que <strong>la</strong> personne avec une limitation intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong><br />
a <strong>en</strong> même temps une vulnérabilité accrue <strong>en</strong><br />
<strong>santé</strong> m<strong>en</strong>ta<strong>le</strong> !<br />
L’intégration du handicap <strong>en</strong>traîne une nouvel<strong>le</strong><br />
exclusion, décalée. Désormais, <strong>la</strong> personne<br />
handicapée est certes « intégrée », <strong>en</strong>globée,<br />
indiffér<strong>en</strong>ciée. Mais, de ce fait, <strong>le</strong>s problématiques<br />
spécifiques, parfois très comp<strong>le</strong>xes, ne sont plus<br />
considérées. Les personnes « doub<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t<br />
diagnostiquées » n’ont plus de p<strong>la</strong>ce. Il semb<strong>le</strong><br />
que d’un point de vue théorique du moins, <strong>le</strong><br />
changem<strong>en</strong>t du modè<strong>le</strong> médical au modè<strong>le</strong><br />
citoy<strong>en</strong>, ne fait que répéter une image de l’homme<br />
qui repose sur une vision de <strong>la</strong> norme <strong>en</strong>t<strong>en</strong>due<br />
comme « ce qui est possib<strong>le</strong> ou non », « ce qui<br />
est permis ou non ». Cette institutionnalisation<br />
de <strong>la</strong> vie humaine résiste. La notion de doub<strong>le</strong><br />
diagnostic répond à <strong>la</strong> logique de ces discours ;<br />
il dénie <strong>la</strong> transformation et <strong>la</strong> réduction 4 qu’il<br />
opère du sujet afin de se donner accès à cette<br />
« effectivité exist<strong>en</strong>tiel<strong>le</strong> » et d’être opérationnel.<br />
Mais <strong>la</strong> personne avec un handicap n’est pas un<br />
sujet volontaire, autonome, transpar<strong>en</strong>t et maître<br />
de lui-même, pas plus que nous <strong>le</strong> sommes. Pour<br />
<strong>le</strong> dire avec Cicéron : « ri<strong>en</strong> d’humain ne m’est<br />
<strong>Conflu<strong>en</strong>ce</strong>s N°<strong>24</strong> Juin 2010<br />
DOSSIER<br />
45