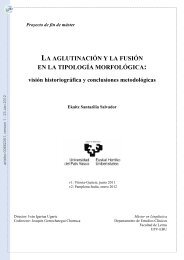Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
artxibo-00610768, version 1 - 24 Jul 2011<br />
Université Paris IV<br />
2009-2011<br />
Sous la direction de Françoise Guérin<br />
Gaël Frank, M1 Linguistique<br />
<strong>Phénomènes</strong> d’actance<br />
<strong>dans</strong> <strong>des</strong> <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong><br />
0 Introduction<br />
0.1 Objet de cette étude<br />
Le point de départ de cette étude consiste à appliquer aux <strong>langues</strong> <strong>des</strong> trois familles<br />
<strong>caucasiques</strong> la typologie mise au jour par Dixon (1994). Dixon distingue plusieurs<br />
types de phénomènes <strong>dans</strong> les <strong>langues</strong> ergatives, mais il est assez succinct<br />
sur les <strong>langues</strong> du Caucase. Il est intéressant d’aller chercher chez les auteurs que<br />
Dixon cite et chez d’autres, <strong>des</strong> compléments d’information.<br />
Dans son ouvrage sur l’ergativité, Dixon évoque les phénomènes de « split ergativity<br />
». Déjà, quelle traduction adopter en français? Les traductions les plus répandues<br />
parlent de fracture d’actance ou d’ergativité scindée. Nous emploierons indifféremment<br />
ces deux formes. À quoi cela correspond-il en tout cas? S’il y a bien un<br />
point commun à toutes les <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, reconnu comme un de leurs attributs<br />
fondamentaux, c’est l’ergativité. Nous illustrerons cette affirmation.<br />
Et la rupture, la fracture, la scission? Les « structures ergatives » présentes <strong>dans</strong><br />
ces <strong>langues</strong> sont combinées à <strong>des</strong> structures « qui ne le sont pas ». L’objet de ce<br />
travail est justement d’étudier ces structures non-ergatives. Les auteurs ne sont<br />
pas d’accord, c’est même l’objet de controverses sérieuses entre spécialistes. Ces<br />
structures sont-elles accusatives? duales (= mixtes)?<br />
Nous nous fixons comme tâche de décrire en quoi les <strong>langues</strong> du Caucase présentent<br />
<strong>des</strong> structures ergatives, et en quoi elles peuvent présenter <strong>des</strong> structures<br />
non-ergatives: soit accusatives, soit composites. La question au départ de ce travail<br />
est en effet de savoir si les <strong>langues</strong> du Caucase ne seraient pas en train d’évoluer<br />
vers un schéma plus accusatif. Si l’on observe le marquage casuel <strong>des</strong> <strong>langues</strong> qui<br />
en présentent un, on constatera de l’ergativité. Mais si l’on regarde l’ordre <strong>des</strong> éléments<br />
et la structure <strong>des</strong> propositions, et si l’on prend en compte <strong>des</strong> facteurs<br />
pragmatiques, l’observation sera différente.<br />
On commencera par présenter, au moyen de cartes et d’explications générales, les<br />
<strong>langues</strong> du Caucase, parlées entre la mer Noire et la mer Caspienne.<br />
Puis on étudiera les structures d’actance <strong>dans</strong> les <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, c’est-à-dire<br />
la question de savoir comment se manifestent les interactions entre le ou les actants<br />
et le verbe. Cela permettra d’étudier les phénomènes majeurs, canoniques,<br />
<strong>dans</strong> les <strong>langues</strong> considérées. Ces phénomènes sont de trois types. Tout d’abord,<br />
les structures avec le cas spécifique « ergatif ». Dans un second temps, les structures<br />
avec un cas autre que l’ergatif (soit qu’il s’agisse de structures ergatives à un<br />
autre cas, soit que les <strong>langues</strong> en question n’aient pas de cas ergatif spécifique).<br />
Dans un troisième temps, on étudiera les structures inverses, où l’actant agent ou<br />
expérient, est marqué au datif.<br />
Ceci étant posé, on pourra étudier <strong>des</strong> phénomènes qui s’écartent <strong>des</strong> structures<br />
typiques. On s’intéressera au « double absolutif », cette construction où, pour<br />
mettre l’accent sur l’agent, on ne le marque pas, mais où c’est le verbe qui prend<br />
un indice de coréférence différent. On parlera de l’ « antipassif », diathèse récessive<br />
où, en miroir de ce qui se passe <strong>dans</strong> les <strong>langues</strong> accusatives, ce n’est pas<br />
l’agent, mais le patient qui est mis à l’arrière-plan. Ceci permettra de parler <strong>des</strong><br />
verbes « labiles », qui apparaissent <strong>dans</strong> deux structures différentes: en structure<br />
G. Frank, Actance en <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, 2 / 90.