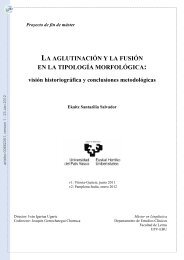Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
artxibo-00610768, version 1 - 24 Jul 2011<br />
structures selon la série de TAM à laquelle on conjugue le verbe.<br />
En CNE, l’avar ne connaît pas de cas spécifiquement ergatif. C’est l’instrumental<br />
qui en tient lieu. Tchekhoff (1979: 70) précise que ce qu’on appelle « sujet » en<br />
grammaire traditionnelle est une notion qui n’a pas de réalité en avar. Il y a en effet<br />
plusieurs cas possibles pour marquer les rôles spécifiques d’agent [+animé,<br />
+contrôle, +volonté], d’auteur [+animé, –contrôle, –volonté] et d’expérient [+animé,<br />
–contrôle, +volonté]: le superessif (28), (36); l’instrumental (26), (32); le datif<br />
(27), (109).<br />
En avar, (26) est une phrase d’action, à construction bi-actancielle canonique; (27)<br />
et (28) ont d’autres constructions (Charachidzé 1981: 154 et 160). Nous considérerons<br />
ici ces structures comme canoniques également, <strong>dans</strong> la mesure où elles sont<br />
régulières et productives.<br />
(26) Verbes d’action<br />
A<br />
di-cca<br />
P1-INSTR<br />
P<br />
l‘uri<br />
rocher(CL.NT):ABS<br />
p<br />
b<br />
CL.NT<br />
« Je soulevai le rocher. »<br />
(27) Verba sentiendi<br />
EXP<br />
di-ye<br />
P1-DAT<br />
STIM<br />
yas<br />
fille(CL.FEM):ABS<br />
stim<br />
y<br />
CL.FEM<br />
« J’aime la jeune fille. »<br />
(28) Verba percepiendi<br />
EXP<br />
di-da<br />
P1-SUP<br />
co un<br />
STIM<br />
č‘e g érl’i<br />
silhouette(CL.NT)<br />
- orx -ana<br />
soulever AOR<br />
- ol‘ -ula<br />
aimer PRS<br />
stim<br />
b<br />
CL.NT<br />
- íħ -ana<br />
voir AOR<br />
(Avar)<br />
(Avar)<br />
(Avar)<br />
« Je vis une silhouette. »<br />
Chacun de ces trois énoncé comprend un terme à l’absolutif, qui régit l’accord du<br />
verbe et est donc traité comme le « patient prototypique », mais le cas de l’autre<br />
terme varie selon la sémantique du verbe employé. En conclusion, Tchekhoff écrit:<br />
« Nous avons donc vu <strong>des</strong> deuxièmes déterminants à <strong>des</strong> cas divers: instrumental,<br />
superessif, datif, mais toujours le cas du deuxième participant<br />
est entraîné automatiquement par le verbe. Il n’y a donc pas choix,<br />
pas d’opposition pertinente » (1979: 73).<br />
2.1 Accord avec le patient: exemple de l’avar (CNE)<br />
Certaines <strong>langues</strong> coréférencient <strong>des</strong> actants <strong>dans</strong> la forme verbale. C’est ce qu’on<br />
appelle l’ « accord » du verbe avec les participants. En français (à l’écrit) ou en latin,<br />
on accorde le verbe avec l’agent, en avar avec le patient. À chaque fois, un seul<br />
actant est coréférencé <strong>dans</strong> la forme verbale.<br />
Les mécanismes de coréférence sont différents selon les <strong>langues</strong>.<br />
Un premier système est l’ accord en « classe nominale ». Certaines <strong>langues</strong>, notamment<br />
CNE, connaissent une classification <strong>des</strong> noms selon différentes classes,<br />
qui correspondent au genre <strong>des</strong> <strong>langues</strong> indo-européennes ou de plus près aux<br />
classificateurs <strong>des</strong> <strong>langues</strong> africaines. Le nominal porte ou non lui-même un indice<br />
de classe. Dans les <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, il n’en porte pas (ce qui différencie ces<br />
<strong>langues</strong> <strong>des</strong> <strong>langues</strong> africaines). C’est le verbe (à condition qu’il soit à initiale vocalique)<br />
qui porte les indices de coréférence, ainsi que parfois plusieurs autres éléments,<br />
ainsi en avar:<br />
Le nom « či » appartient à la classe I, celle <strong>des</strong> masculins. En conséquence, tous<br />
les autres éléments de la chaîne (adjectifs, participes, formes verbales) s’accordent<br />
avec lui, comme <strong>dans</strong> l’exemple (29).<br />
(29) a-w<br />
ce<br />
hit`ín.a-w<br />
petit<br />
či<br />
homme<br />
w-áqara.w<br />
monté<br />
rosnó-w-e<br />
en.barque<br />
w-ússana<br />
retourna<br />
roq`ó-w-e<br />
à.la.maison<br />
(Avar)<br />
« Ce petit homme monté en barque retourna à la maison. » (Charachidzé<br />
G. Frank, Actance en <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, 24 / 90.