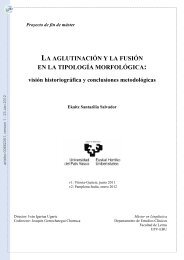Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
artxibo-00610768, version 1 - 24 Jul 2011<br />
0.3.2 Définition de l’actance<br />
Citons Lazard:<br />
« Les actants sont les termes nominaux qui entretiennent avec le verbe<br />
<strong>des</strong> relations grammaticales particulières: par exemple ils peuvent régir<br />
l’accord du verbe, être marqués par <strong>des</strong> indices spécifiques, occuper<br />
une place définie, se prêter à certaines transformations, etc. Ils se distinguent<br />
par là <strong>des</strong> autres termes nominaux (les circonstants) » (Lazard<br />
1985).<br />
Dans un énoncé (le plus souvent verbal), on trouve un prédicat et <strong>des</strong> actants qui<br />
gravitent autour de lui. En énoncé monovalent, on a un actant unique, S. Cet actant<br />
peut être auteur, il peut avoir ou non le contrôle du procès exprimé par le<br />
verbe. On le symbolisera en tout cas par « S ». En énoncé bivalent, prototypiquement<br />
il s’agit d’une action effectuée par un « agent » (A) sur un « patient » (P).<br />
Toutefois, certaines <strong>langues</strong> n’ont pas une catégorie « S » unifiée. Des verbes ont<br />
un actant unique S qui se comporte comme le patient <strong>des</strong> verbes biactanciels. On<br />
symbolisera ceci par la lettre « p » en indice au symbole S: « Sp ». On opposera<br />
ceci à la structure monoactancielle où S aura le même comportement que l’agent.<br />
Cette structure sera symbolisée « Sa ».<br />
Des structures sémantiquement différentes peuvent se calquer sur ces structures<br />
prototypiques. Ainsi, pour les verbes de sentiment ou de perception, on ne parlera<br />
pas d’agent et de patient, mais d’expérient (EXP) et de stimulus (STIM). Cette distinction<br />
est très opérante pour distinguer <strong>des</strong> structures différentes.<br />
1 Présentation <strong>des</strong> <strong>langues</strong><br />
Les <strong>langues</strong> qui vont nous occuper <strong>dans</strong> le cadre de ce travail sont surtout le géorgien<br />
(de la famille caucasique du sud, qui comprend aussi le mingrélien, le svane,<br />
le laze) et certaines <strong>langues</strong> <strong>des</strong> deux familles du nord que sont le caucasique du<br />
nord-est (nakh, lezghien, lak, tsez, avar...) et caucasique du nord-ouest (abkhaze,<br />
oubykh, tcherkesse...).<br />
On parle d’une, ou plutôt de trois familles de <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong> 1 :<br />
• <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong> du Nord-Est ou <strong>langues</strong> nakho-daghestaniennes.<br />
• <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong> du Nord-Ouest ou <strong>langues</strong> abkhazo-adygiennes<br />
• <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong> du Sud ou <strong>langues</strong> kartvéliennes<br />
1.1 Cartes<br />
Ces <strong>langues</strong> sont parlées entre autres en Géorgie, en Azerbaïdjan, au Daghestan,<br />
en Fédération de Russie, entre la mer Noire et la mer Caspienne, ainsi que le<br />
montre la carte suivante, extraite de la monographie de Charachidzé sur l’Avar<br />
(1981: 6).<br />
1 Des recherches existent qui cherchent à prouver l’existence d’une « super-famille », mais<br />
ce sujet controversé ne sera pas traité ici.<br />
G. Frank, Actance en <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, 4 / 90.