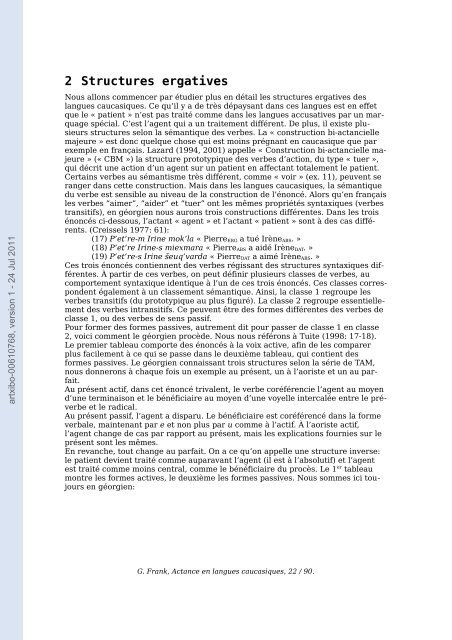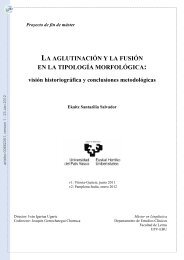Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
artxibo-00610768, version 1 - 24 Jul 2011<br />
2 Structures ergatives<br />
Nous allons commencer par étudier plus en détail les structures ergatives <strong>des</strong><br />
<strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>. Ce qu’il y a de très dépaysant <strong>dans</strong> ces <strong>langues</strong> est en effet<br />
que le « patient » n’est pas traité comme <strong>dans</strong> les <strong>langues</strong> accusatives par un marquage<br />
spécial. C’est l’agent qui a un traitement différent. De plus, il existe plusieurs<br />
structures selon la sémantique <strong>des</strong> verbes. La « construction bi-actancielle<br />
majeure » est donc quelque chose qui est moins prégnant en caucasique que par<br />
exemple en français. Lazard (1994, 2001) appelle « Construction bi-actancielle majeure<br />
» (« CBM ») la structure prototypique <strong>des</strong> verbes d’action, du type « tuer »,<br />
qui décrit une action d’un agent sur un patient en affectant totalement le patient.<br />
Certains verbes au sémantisme très différent, comme « voir » (ex. 11), peuvent se<br />
ranger <strong>dans</strong> cette construction. Mais <strong>dans</strong> les <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, la sémantique<br />
du verbe est sensible au niveau de la construction de l’énoncé. Alors qu’en français<br />
les verbes “aimer”, “aider” et “tuer” ont les mêmes propriétés syntaxiques (verbes<br />
transitifs), en géorgien nous aurons trois constructions différentes. Dans les trois<br />
énoncés ci-<strong>des</strong>sous, l’actant « agent » et l’actant « patient » sont à <strong>des</strong> cas différents.<br />
(Creissels 1977: 61):<br />
(17) P’et’re-m Irine mok’la « PierreERG a tué IrèneABS. »<br />
(18) P’et’re Irine-s miexmara « PierreABS a aidé IrèneDAT. »<br />
(19) P’et’re-s Irine seuq’varda « PierreDAT a aimé IrèneABS. »<br />
Ces trois énoncés contiennent <strong>des</strong> verbes régissant <strong>des</strong> structures syntaxiques différentes.<br />
À partir de ces verbes, on peut définir plusieurs classes de verbes, au<br />
comportement syntaxique identique à l’un de ces trois énoncés. Ces classes correspondent<br />
également à un classement sémantique. Ainsi, la classe 1 regroupe les<br />
verbes transitifs (du prototypique au plus figuré). La classe 2 regroupe essentiellement<br />
<strong>des</strong> verbes intransitifs. Ce peuvent être <strong>des</strong> formes différentes <strong>des</strong> verbes de<br />
classe 1, ou <strong>des</strong> verbes de sens passif.<br />
Pour former <strong>des</strong> formes passives, autrement dit pour passer de classe 1 en classe<br />
2, voici comment le géorgien procède. Nous nous référons à Tuite (1998: 17-18).<br />
Le premier tableau comporte <strong>des</strong> énoncés à la voix active, afin de les comparer<br />
plus facilement à ce qui se passe <strong>dans</strong> le deuxième tableau, qui contient <strong>des</strong><br />
formes passives. Le géorgien connaissant trois structures selon la série de TAM,<br />
nous donnerons à chaque fois un exemple au présent, un à l’aoriste et un au parfait.<br />
Au présent actif, <strong>dans</strong> cet énoncé trivalent, le verbe coréférencie l’agent au moyen<br />
d’une terminaison et le bénéficiaire au moyen d’une voyelle intercalée entre le préverbe<br />
et le radical.<br />
Au présent passif, l’agent a disparu. Le bénéficiaire est coréférencé <strong>dans</strong> la forme<br />
verbale, maintenant par e et non plus par u comme à l’actif. À l’aoriste actif,<br />
l’agent change de cas par rapport au présent, mais les explications fournies sur le<br />
présent sont les mêmes.<br />
En revanche, tout change au parfait. On a ce qu’on appelle une structure inverse:<br />
le patient devient traité comme auparavant l’agent (il est à l’absolutif) et l’agent<br />
est traité comme moins central, comme le bénéficiaire du procès. Le 1 er tableau<br />
montre les formes actives, le deuxième les formes passives. Nous sommes ici toujours<br />
en géorgien:<br />
G. Frank, Actance en <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, 22 / 90.