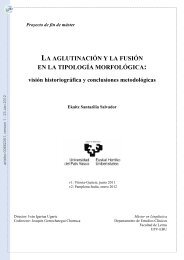Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
artxibo-00610768, version 1 - 24 Jul 2011<br />
(70) (a) g-i-sts’avl-i-a (parfait) « tu l’as appris (paraît-il) » 21<br />
(b) i-sts’avl-e (aoriste) « tu l’as appris (manifestement) »<br />
Le patient ne peut être que de 3e personne. Si on veut mettre un patient de 1e ou 2e personne, il faut employer une périphrase avec un mot comme « ma tête, ta tête »,<br />
ce qui le fait passer à la 3e personne de toute façon (Aronson 1990: 267).<br />
Aux tiroirs du parfait, on a ce que les grammairiens géorgiens appellent une<br />
construction « inverse ». En effet, il y a inversion point par point de la structure<br />
du présent. L’Agent sémantique est maintenant au datif, coréférencé par un indice<br />
de série III. Le Patient sémantique est au cas zéro, coréférencé par un indice de série<br />
I. Les ouvrages de linguistique générale rapprochent cette structure de celle de<br />
l’islandais, où l’on dit « À l’homme la femme est tuée » pour signifier « L’homme a<br />
tué la femme ». Le phénomène caractéristique de la série III est l’inversion. On décrit<br />
une action passée sans qu’on ne l’ait vue se dérouler. On constate une évidence,<br />
le résultat est là, d’où le nom d’évidentiel. Étymologiquement, on peut y<br />
voir une possession du participant, comme en français où l’on exprime cette notion<br />
avec le verbe « avoir », qui sert aussi à indiquer la possession. Dans « J’ai un<br />
livre », on percoit la possession, ce qui est moins évident <strong>dans</strong> « J’ai écrit une<br />
lettre ». En revanche, quand l’action est décrite au présent, envisagée sous l’angle<br />
de son déroulement actuel, l’agent est à l’absolutif, ce qui est une façon neutre de<br />
le signaler syntaxiquement. De même, lorsqu’on décrit l’action à l’aoriste, l’agent<br />
est marqué au cas ergatif, ce qui laisse penser à un marquage plus fort de<br />
l’agent22 . (Harris 1981).<br />
Lazard ajoute que l’inversion n’est pas totale, car pour le tiroir du présent l’indice<br />
appartient à la série II alors que pour le tiroir du parfait il s’agit de la série III (Lazard<br />
2001: 249, n. 1).<br />
(71) a.<br />
A<br />
P<br />
aIII pI (Géorgien) classe 1, (III)<br />
k’ac - s kal - i mo-∅<br />
- u -k’lav - s<br />
homme DAT femme ABS PVB lui PFX tuer elle<br />
« L’homme a, paraît-il, tué la femme. » (« À l’homme la femme est<br />
tuée. »)<br />
b.<br />
S<br />
sI (Géorgien) classe 2, (III)<br />
k’ac - i mo-<br />
m -k’vd -ar - a<br />
homme ABS PVB PFX mourir TH il(PF.3S)<br />
« L’homme, paraît-il, est mort. » 23<br />
La structure du parfait est typiquement ergative. L’actant P de la phrase biactancielle<br />
est à l’absolutif, de même que l’actant unique S de la phrase monoactancielle.<br />
La structure est inversée par rapport au présent (68a et b). Donc, au niveau<br />
<strong>des</strong> nominaux, P = S .<br />
De même en ce qui concerne l’accord verbal. L’actant A de la phrase (71a) est corérérencé<br />
par un indice, symbolisé a, tiré de la IIIe série, celle du bénéficiaire. L’actant<br />
P quant à lui est corérérencé par un indice p tiré de la Ie série. L’actant S de la<br />
phrase (71b) est lui aussi coréférencé par un indice de Ie série. Il y a donc ici<br />
congruence entre les indices actanciels et l’accord casuel, p = s .<br />
L’ordre <strong>des</strong> morphèmes <strong>dans</strong> la forme verbale transitive est donc A-V-P, à l’inverse<br />
du présent et de l’aoriste.<br />
Rôle Cas <strong>des</strong> nominaux Indices de coréférence<br />
Agent datif série III<br />
Patient absolutif série I<br />
En conclusion, notons que le géorgien a pu être défini (Lazard 1994, 2001) comme<br />
21 On remarque le g initial, indice de P2 en fonction bénéficiaire, qui est absent de<br />
l’exemple suivant.<br />
22 En effet, le passé est le temps par excellence de la certitude a priori de « qui a fait<br />
quoi »!<br />
23 On peut reconnaître une voyelle de version <strong>dans</strong> le « préfixe » u de la phrase biactancielle,<br />
mais le m de la phrase uniactancielle reste obscur.<br />
G. Frank, Actance en <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, 36 / 90.