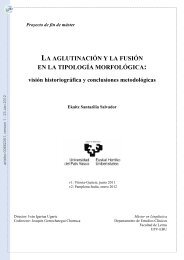Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
artxibo-00610768, version 1 - 24 Jul 2011<br />
- observer le cas de l’agent ou assimilé (A) et du patient ou assimilé (P), ainsi que<br />
le cas de l’actant unique d’un verbe intransitif (S),<br />
- regarder l’accord <strong>des</strong> participants avec le verbe,<br />
- comparer le même énoncé à plusieurs temps verbaux.<br />
Prenons <strong>des</strong> exemples cités par Lazard (2001: 248), qui les emprunte lui-même à<br />
Hewitt (1987a: 322).<br />
3.1.1 Au présent<br />
(68) a.<br />
A<br />
k’ac<br />
homme<br />
- i<br />
ABS<br />
P<br />
kal<br />
femme<br />
- s<br />
DAT<br />
pII ∅<br />
la<br />
aI (Géorgien) classe 1, (I)<br />
-k’lav -s<br />
tuer il<br />
« L’homme tue la femme. »<br />
b.<br />
S<br />
sI (Géorgien) classe 2, (I)<br />
k’ac - i k’vdeb-a<br />
homme ABS mourir il<br />
« L’homme meurt. »<br />
Au présent, la structure est accusative, selon la formule A = S. Regardons<br />
d’abord les cas <strong>des</strong> actants. L’agent (symbolisé A) de la phrase (68a), biactancielle,<br />
est à l’absolutif (marque -i) et le verbe s’accorde avec lui. De même, l’actant<br />
unique (symbolisé S) de la phrase (68b), monoactancielle, est à l’absolutif et le<br />
verbe s’accorde avec lui.<br />
La phrase biactancielle comporte un patient (symbolisé P), qui en géorgien est au<br />
datif.<br />
Voyons comment se comporte la coréférence, c’est-à-dire la manière dont les<br />
actants s’accordent <strong>dans</strong> le verbe. En géorgien, jusqu’à deux actants peuvent être<br />
coréférencés <strong>dans</strong> le verbe ditransitif, schématiquement l’agent A et le patient P.<br />
Il existe trois jeux d’indices actanciels, c’est-à-dire de marques qui s’incorporent à<br />
la forme verbale19 : la série I représente l’agent, la série II le patient et la série III<br />
le bénéficiaire (humain). À la 3e personne, les morphèmes de chaque série de<br />
marques sont les suivants. Le tiret « — » représente le radical du nom et les variantes<br />
sont soit phonologiques soit dépendantes du temps verbal.<br />
série I série II série III<br />
3e personne ∅ —s/a/o/os/as/es<br />
— h/s/ ∅— ∅<br />
En (68a), l’actant A est coréférencé <strong>dans</strong> le verbe par l’indice -s, qui appartient à la<br />
série I, ce qui est la même chose que <strong>dans</strong> (68b) pour l’actant S.<br />
En (68a), l’actant P n’est pas représenté <strong>dans</strong> la forme verbale. En effet, le patient<br />
n’est pas représenté <strong>dans</strong> le verbe.<br />
L’ordre <strong>des</strong> morphèmes <strong>dans</strong> la forme verbale transitive est donc: P-V-A.<br />
Le tableau suivant résume ce que nous venons de dire:<br />
Rôle Cas <strong>des</strong> nominaux Indices de coréférence<br />
Agent absolutif série I<br />
Patient datif série II<br />
3.1.2 À l’aoriste<br />
Voyons maintenant ce qui se passe à d’autres séries de TAM 20 , et tout d’abord l’aoriste<br />
(le passé défini).<br />
19 On connaît ce phénomène en français, ex. « Je le lui dirai. » (« le » et « lui » sont incorporés<br />
<strong>dans</strong> la « forme verbale ».<br />
20 Le nom en grammaire géorgienne est « screeves », qu’on peut rendre en français par<br />
« tiroirs verbaux ». On ne peut employer le terme « temps » car celui-ci est trop réducteur.<br />
Les « screeves » peuvent avoir une valeur temporelle, mais aussi aspectuelle et modale.<br />
On parlera donc en français de « séries de TAM ».<br />
G. Frank, Actance en <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, 34 / 90.