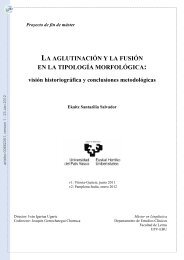Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Phénomènes d'actance dans des langues caucasiques.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
artxibo-00610768, version 1 - 24 Jul 2011<br />
sente alors deux participants au datif, le patient et le bénéficiaire sont au même<br />
cas. Seul le bénéficiaire est coréférencé <strong>dans</strong> le verbe. Le patient vérifie ce qu’on<br />
peut appeler une relation privilégiée au prédicat, il y a une sorte de coalescence. Il<br />
n’est pas référencé <strong>dans</strong> le verbe mais est toujours situé à côté de lui. C’est cette<br />
proximité qui permet de postuler un lien étroit entre les deux. Le patient fait en effet<br />
partie du bloc rhématique avec le verbe (Lazard 1994).<br />
Lorsqu’il y a un bénéficiaire et que le verbe est ditransitif ou employé ditransitivement,<br />
le bénéficiaire est coréférencé <strong>dans</strong> la forme verbale, qui contient donc deux<br />
affixes personnels. Dans l’énoncé biactanciel (54), le patient n’est pas coréférencé<br />
<strong>dans</strong> le verbe, il y a un seul indice de coréférence. En énoncé triactanciel: (55) (où<br />
le verbe est le même) et (56) où il s’agit aussi d’un verbe de don, le bénéficiaire est<br />
coréférencé <strong>dans</strong> le verbe.<br />
(55)<br />
A B<br />
P<br />
(56)<br />
šota<br />
NP.ABS<br />
leila-s<br />
NP-DAT<br />
c’eril-s<br />
lettre-DAT<br />
b<br />
s<br />
S3 III<br />
-c’er<br />
écrire<br />
a<br />
- s<br />
PRS.S3I (Géorgien)<br />
« Chota écrit une lettre à Leila. » (Creissels 2006: 312)<br />
A<br />
ketino<br />
NP.ABS<br />
B<br />
ek’a-m<br />
NP-DAT<br />
P<br />
xalitša-s<br />
tapis-DAT<br />
b<br />
s<br />
S3 III<br />
-čukni<br />
offrir<br />
- s<br />
a (Géorgien)<br />
« Ketino offre un tapis à Eka. » (Joppen-Hellwig)<br />
Creissels (2006: 296) reconnaît à l’actant au datif un rôle nucléaire pour les verbes<br />
ditransitifs. C’est logique, puisque ces verbes impliquent trois participants. 17 Autrement<br />
dit, le participant au datif est bien un actant et non pas un simple oblique<br />
qui serait un circonstant périphérique. L’argument en faveur de cette thèse est que<br />
cet actant est coréférencé <strong>dans</strong> le verbe même à la troisième personne. En géorgien,<br />
le patient de 3 e personne n’est pas coréférencé <strong>dans</strong> le verbe, alors que le bénéficiaire<br />
l’est. Le fait que P ne soit pas coréférencé <strong>dans</strong> le verbe est le signe qu’il<br />
est plus proche du verbe et qu’il fait corps avec lui. C’est ce que Lazard appelle<br />
« coalescence ». Dans une perspective de visée communicative, si on s’intéresse au<br />
flux de l’attention (« attention flow »), A est nettement disjoint du bloc VP. On<br />
considèrera (avec Lazard et Bossong) comme accusative (sur le plan de la visée)<br />
une structure où A et S seraient tous deux en position initiale et thématique d’un<br />
énoncé et où le rhème serait constitué soit par un bloc VP soit uniquement par un<br />
prédicat.<br />
Les auteurs distinguent trois jeux d’affixes verbaux pour coréférencer les actants<br />
en géorgien: la liste (ou série) I, qui coréférencie l’agent; la liste (ou série) II, qui<br />
coréférencie le patient, et la liste (ou série) III, qui coréférencie le bénéficiaire. Ces<br />
trois rôles sont donc centraux, nucléaires. Prototypiquement, il s’agit <strong>des</strong> verbes<br />
de don, avec objet transféré d’un premier protagoniste à un deuxième.<br />
À la non-personne, les verbes ne coréférencient que le bénéficiaire. Aux deux premières<br />
personnes, les morphèmes de séries II et III sont identiques, mais seul le<br />
bénéficiaire est coréférencé <strong>dans</strong> la forme verbale. En effet, si le patient est de 1 e<br />
ou de 2 e personne, il apparaît <strong>dans</strong> l’énoncé par une périphrase « ma tête, ta<br />
tête », ce qui le fait basculer à la 3 e personne. Seul le bénéficiaire est donc coréférencé,<br />
et le patient uniquement quand il n’y a pas de bénéficiaire.<br />
Ceci est donc un argument concernant le caractère « oblique » <strong>des</strong> actants non-agents<br />
du géorgien. Le point commun aux deux séries II et III d’indices de coréférence<br />
est donc de renvoyer à un actant « non-agent » (mais « nucléaire »). L’ « objet<br />
» et le « circonstant » ne se laissent pas toujours distinguer. On connaît ce<br />
genre de structures <strong>dans</strong> d’autres <strong>langues</strong>, comme l’anglais, qui font la différence<br />
entre « read a book » et « read in a book », le procès parvenant à un résultat<br />
moindre <strong>dans</strong> le 2 e exemple que <strong>dans</strong> le 1 er .<br />
Mais en envisageant la série de TAM du parfait, nous verrons (§ 3.1.3) que ce qui<br />
pouvait sembler un actant était relégué à une position périphérique. Ce qui était<br />
17 Mais <strong>dans</strong> d’autres <strong>langues</strong> (Creissels cite le russe et le hongrois), le participant au datif<br />
n’a de rôle particulier que sémantique, et pas syntaxique.<br />
G. Frank, Actance en <strong>langues</strong> <strong>caucasiques</strong>, 30 / 90.<br />
S3I