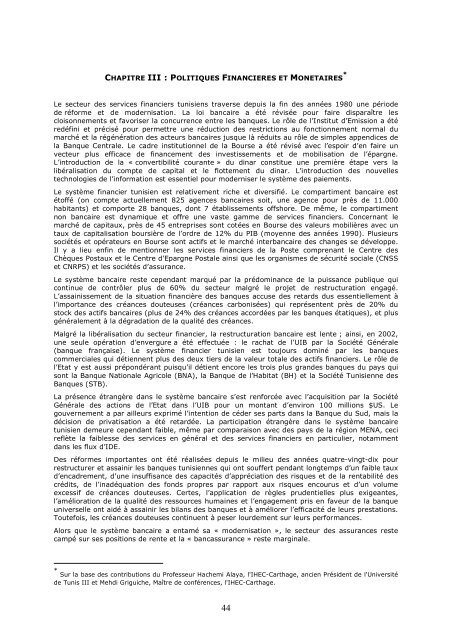PROFIL PAYS TUNISIE FEMISE
PROFIL PAYS TUNISIE FEMISE
PROFIL PAYS TUNISIE FEMISE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CHAPITRE III : POLITIQUES FINANCIERES ET MONETAIRES *<br />
Le secteur des services financiers tunisiens traverse depuis la fin des années 1980 une période<br />
de réforme et de modernisation. La loi bancaire a été révisée pour faire disparaître les<br />
cloisonnements et favoriser la concurrence entre les banques. Le rôle de l’Institut d’Emission a été<br />
redéfini et précisé pour permettre une réduction des restrictions au fonctionnement normal du<br />
marché et la régénération des acteurs bancaires jusque là réduits au rôle de simples appendices de<br />
la Banque Centrale. Le cadre institutionnel de la Bourse a été révisé avec l’espoir d’en faire un<br />
vecteur plus efficace de financement des investissements et de mobilisation de l’épargne.<br />
L’introduction de la « convertibilité courante » du dinar constitue une première étape vers la<br />
libéralisation du compte de capital et le flottement du dinar. L’introduction des nouvelles<br />
technologies de l’information est essentiel pour moderniser le système des paiements.<br />
Le système financier tunisien est relativement riche et diversifié. Le compartiment bancaire est<br />
étoffé (on compte actuellement 825 agences bancaires soit, une agence pour près de 11.000<br />
habitants) et comporte 28 banques, dont 7 établissements offshore. De même, le compartiment<br />
non bancaire est dynamique et offre une vaste gamme de services financiers. Concernant le<br />
marché de capitaux, près de 45 entreprises sont cotées en Bourse des valeurs mobilières avec un<br />
taux de capitalisation boursière de l’ordre de 12% du PIB (moyenne des années 1990). Plusieurs<br />
sociétés et opérateurs en Bourse sont actifs et le marché interbancaire des changes se développe.<br />
Il y a lieu enfin de mentionner les services financiers de la Poste comprenant le Centre des<br />
Chèques Postaux et le Centre d’Epargne Postale ainsi que les organismes de sécurité sociale (CNSS<br />
et CNRPS) et les sociétés d’assurance.<br />
Le système bancaire reste cependant marqué par la prédominance de la puissance publique qui<br />
continue de contrôler plus de 60% du secteur malgré le projet de restructuration engagé.<br />
L’assainissement de la situation financière des banques accuse des retards dus essentiellement à<br />
l’importance des créances douteuses (créances carbonisées) qui représentent près de 20% du<br />
stock des actifs bancaires (plus de 24% des créances accordées par les banques étatiques), et plus<br />
généralement à la dégradation de la qualité des créances.<br />
Malgré la libéralisation du secteur financier, la restructuration bancaire est lente ; ainsi, en 2002,<br />
une seule opération d’envergure a été effectuée : le rachat de l’UIB par la Société Générale<br />
(banque française). Le système financier tunisien est toujours dominé par les banques<br />
commerciales qui détiennent plus des deux tiers de la valeur totale des actifs financiers. Le rôle de<br />
l’Etat y est aussi prépondérant puisqu’il détient encore les trois plus grandes banques du pays qui<br />
sont la Banque Nationale Agricole (BNA), la Banque de l’Habitat (BH) et la Société Tunisienne des<br />
Banques (STB).<br />
La présence étrangère dans le système bancaire s’est renforcée avec l’acquisition par la Société<br />
Générale des actions de l’Etat dans l’UIB pour un montant d’environ 100 millions $US. Le<br />
gouvernement a par ailleurs exprimé l’intention de céder ses parts dans la Banque du Sud, mais la<br />
décision de privatisation a été retardée. La participation étrangère dans le système bancaire<br />
tunisien demeure cependant faible, même par comparaison avec des pays de la région MENA, ceci<br />
reflète la faiblesse des services en général et des services financiers en particulier, notamment<br />
dans les flux d’IDE.<br />
Des réformes importantes ont été réalisées depuis le milieu des années quatre-vingt-dix pour<br />
restructurer et assainir les banques tunisiennes qui ont souffert pendant longtemps d’un faible taux<br />
d’encadrement, d’une insuffisance des capacités d’appréciation des risques et de la rentabilité des<br />
crédits, de l’inadéquation des fonds propres par rapport aux risques encourus et d’un volume<br />
excessif de créances douteuses. Certes, l’application de règles prudentielles plus exigeantes,<br />
l’amélioration de la qualité des ressources humaines et l’engagement pris en faveur de la banque<br />
universelle ont aidé à assainir les bilans des banques et à améliorer l’efficacité de leurs prestations.<br />
Toutefois, les créances douteuses continuent à peser lourdement sur leurs performances.<br />
Alors que le système bancaire a entamé sa « modernisation », le secteur des assurances reste<br />
campé sur ses positions de rente et la « bancassurance » reste marginale.<br />
*<br />
Sur la base des contributions du Professeur Hachemi Alaya, l'IHEC-Carthage, ancien Président de l'Université<br />
de Tunis III et Mehdi Griguiche, Maître de conférences, l'IHEC-Carthage.<br />
44