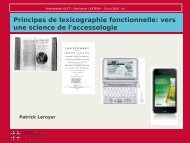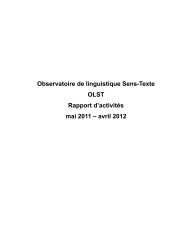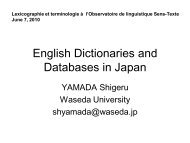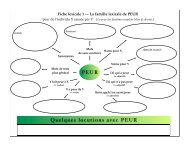- Page 1: UNIVERSITE PARIS 7 - DENIS DIDEROT
- Page 5 and 6: Table des matières TABLEAU DE L’
- Page 7: 3.1.1. La règle d’initialisation
- Page 10 and 11: Abréviations ACC : accusatif ADJ :
- Page 13 and 14: Introduction 1. Problématique de l
- Page 15 and 16: mots dans la phrase française dans
- Page 17 and 18: Partie I : Repères Théoriques Ava
- Page 19 and 20: de génération c’est l’ordinat
- Page 21 and 22: 2. La micro-planification (ou la pl
- Page 23 and 24: produits dans plusieurs langues à
- Page 25 and 26: développée dans différents coins
- Page 27 and 28: 2.2. L’architecture d’un modèl
- Page 29 and 30: Comme un système de génération a
- Page 31 and 32: • Une structure syntaxique-commun
- Page 33 and 34: syntagmatique (PSG dorénavant, de
- Page 35 and 36: S GN GV Jean V GN embrasse Marie Fi
- Page 37 and 38: ne présuppose pas l’unicité du
- Page 39 and 40: syntaxiques, beaucoup de confusions
- Page 41 and 42: 3.2.4. Les propriétés linguistiqu
- Page 43 and 44: Troisièmement, un mot X est le con
- Page 45 and 46: éfléchi aux PDD. Il distingua les
- Page 47: Du point de vue distributionnel, un
- Page 51 and 52: 3.4. Les significations grammatical
- Page 53 and 54: nucléus mais (…) intranucléaire
- Page 55 and 56: 3. les dialectes proche-orientaux :
- Page 57 and 58: emplaçant une construction passive
- Page 59 and 60: 1. La précédence linéaire : l’
- Page 61 and 62: juste titre, il n’existe pas, com
- Page 63 and 64: Selon cette définition, l’arabe
- Page 65 and 66: (5) ʔakaluu {humu} vs ʔakalnna {h
- Page 67 and 68: déverbaux tel le nom d’agent, le
- Page 69 and 70: Nous allons présenter ici une clas
- Page 71 and 72: I. Les quatres classes majeures 1.
- Page 73 and 74: 1) Les pronoms (les pointeurs conte
- Page 75 and 76: (17) a. ʤaaʔa al+sitat+u riʤaal+
- Page 77 and 78: traditionnelle dans la catégorie n
- Page 79 and 80: 2) Les translatifs de nom en constr
- Page 81 and 82: Résumons. Dans cette section, nous
- Page 83 and 84: le domaine de l’analyse automatiq
- Page 85 and 86: même PDD, mais une telle classific
- Page 87 and 88: Dans ces deux exemples, le constitu
- Page 89 and 90: Récapitulons. Dans cette section,
- Page 91 and 92: ésomptif, comme on l’a souligné
- Page 93 and 94: cela nous semble inadéquat de camo
- Page 95 and 96: ʔataa (V)ind,passé sujet coObl hu
- Page 97 and 98: (60) a. ?maa janbaġii li#al+raʤul
- Page 99 and 100:
prépositionnel, le tout exprimant
- Page 101 and 102:
une forme verbale comme dans l’ex
- Page 103 and 104:
Selon notre point de vue, l’énon
- Page 105 and 106:
Notons que certains verbes ont une
- Page 107 and 108:
alzamaan wa#zuruuf almakaan روف
- Page 109 and 110:
marra (V)passif,ind,passé χaafa (
- Page 111 and 112:
2) Mode-temps et aspect Mode est un
- Page 113 and 114:
Les grammèmes du verbe nombre mode
- Page 115 and 116:
مه مه ) وا ( partis.’ ‘Eu
- Page 117 and 118:
(V)PRESENT ) الأولا ُد
- Page 119 and 120:
(V)PRESENT (COMP) (V)SUBJ (N)+NOM+I
- Page 121 and 122:
est arrivé Karim à Zayd avec#un l
- Page 123 and 124:
était le fait d’offrir Zayd Nani
- Page 125 and 126:
d. ʔuridu {ʔanaa}-coDir→ ʔakl+
- Page 127 and 128:
ai marié#lui {je} Hind | de#Hind )
- Page 129 and 130:
B) Autre solution Il serait possibl
- Page 131 and 132:
(121) a. manaʕa zajd+u+n kariim+a+
- Page 133 and 134:
B) Linéarisation l’agent-prépos
- Page 135 and 136:
(V)PRESENT (N,masc)SG+NOM+INDEF (AD
- Page 137 and 138:
au présent de l’indicatif. La pr
- Page 139 and 140:
kaana (V)ind,passé sujet attribut
- Page 141 and 142:
a cru Zayd Nanis debout (حسب
- Page 143 and 144:
a joui Zayd esprit lit. Zayd a joui
- Page 145 and 146:
akala (V)impératif sujet adjonc ad
- Page 147 and 148:
La grammaire normative arabe note a
- Page 149 and 150:
(154) a. i∫taraa zajd+u+n sitiina
- Page 151 and 152:
était Zayd homme le plus vertueux
- Page 153 and 154:
L’ordre dans la proposition de mo
- Page 155 and 156:
Le processus d’apposition est par
- Page 157 and 158:
e. ʤaaʔa al+fariiq+u-appos→ ʕa
- Page 159 and 160:
(174) a. *taaba-sujet→ quluub+u#h
- Page 161 and 162:
. sarrata#nii tarʤamat+u -compN→
- Page 163 and 164:
tarʤama (Nmasdar ) CompN coDir coO
- Page 165 and 166:
− Il ne suit pas le cas de son go
- Page 167 and 168:
3 ème cas : Ø kaana al+kilaab+u [
- Page 169 and 170:
(198) Ø kaana zajd+u+n ʔawdah+u (
- Page 171 and 172:
(204) a. ʔin-Conj_Sub→ tuðaaqir
- Page 173 and 174:
. ʔa#tuðaakiru {ʔanta} ʔam tal
- Page 175 and 176:
akala (V)ind,présent sujet coord w
- Page 177 and 178:
saara (V)ind,passé sujet circ-acco
- Page 179 and 180:
circ-accomp (226) a. sallamtu {ʔan
- Page 181 and 182:
asyndétique. Ce procédé permet d
- Page 183 and 184:
aussi proposé une analyse original
- Page 185 and 186:
1) turikat naaniis+u+n wahiidat+a+n
- Page 187 and 188:
(234) a. kaanat maʕrakat+u hitiin+
- Page 189 and 190:
pronom coréférant avec le ʔ ism,
- Page 191 and 192:
يلعبون ( jouent lit. les enfa
- Page 193 and 194:
A notre avis, les phrases suivantes
- Page 195 and 196:
(246) kaana {huwa} janzuru {huwa}
- Page 197 and 198:
1- La première serait à dire que
- Page 199 and 200:
6. *jalʕabu al+ʔatfaal+u kaana (V
- Page 201 and 202:
SSyntS arabe SSyntS française kaan
- Page 203 and 204:
kaana sujet jonct-verbale (N) sujet
- Page 205 and 206:
du verbe arabe, et la sous-section
- Page 207 and 208:
comme, par exemple, la forme ʤaraa
- Page 209 and 210:
En effet, l’aspect et le temps ve
- Page 211 and 212:
(254) ġaddaa kamaalun basara#hu (
- Page 213 and 214:
(258) ʔin 202 ġaabat al∫amsu za
- Page 215 and 216:
(262) a. iðaa iʤtahaddta {ʔanta}
- Page 217 and 218:
(265) alʔasadu jaʔkulu {huwa} all
- Page 219 and 220:
Postériorité Le présent simple e
- Page 221 and 222:
time reference meaning of the verb
- Page 223 and 224:
(الأولادُ أآلو
- Page 225 and 226:
qad ʔakaluu T R T E Le verbe kaana
- Page 227 and 228:
3. La relation attributive et les v
- Page 229 and 230:
4- Les verbes possédant uniquement
- Page 231 and 232:
ʔamsaa (V)ind,passé ʔamsaa (V)in
- Page 233 and 234:
D’après leur sens, les verbes ph
- Page 235 and 236:
(قام الأولادُ ي
- Page 237 and 238:
5- V 2 est au présent de l’indic
- Page 239 and 240:
kaada (V)ind,passé kaada (V)ind,pa
- Page 241 and 242:
verbes, ‘voir et ses soeurs’).
- Page 243 and 244:
(306) taraktu {ʔanaa} al+fasl+a na
- Page 245 and 246:
(V 1 ) coDir-prop2 (V 2 ) prolepse
- Page 247 and 248:
distinctes, comme la RelSyntS coDir
- Page 249 and 250:
La relation coDir-prop2 permet d’
- Page 251 and 252:
(320) zaʕama zajd+u+n ʔan lan jah
- Page 253 and 254:
d. [altuffahatu] coDir ʔakala#haa
- Page 255 and 256:
. hasiba zajdun [alʔawlaada] coDir
- Page 257 and 258:
(333) a. sajartu {ʔanaa} al+χa∫
- Page 259 and 260:
Nous aurions pu présenter ce group
- Page 261 and 262:
complémenteur. Or, ces éléments
- Page 263 and 264:
(V) sujet coprédicat coDir (PRO) (
- Page 265 and 266:
(345) a. ʔinna | kaʔanna | laʕal
- Page 267 and 268:
de qualité abstraite avec la prép
- Page 269 and 270:
(350) *al+ʔawlaad+u (kaana#hum | k
- Page 271 and 272:
1- Une observation d’ordre géné
- Page 273 and 274:
Dans la construction française, le
- Page 275 and 276:
. [qaala kariimun] P1 [ʔinna | la
- Page 277 and 278:
. ʔin ʔadrii {ʔanaa} laʕalla#hu
- Page 279 and 280:
avec généralement un lien de cor
- Page 281 and 282:
Partie IV : Le module du calcul de
- Page 283 and 284:
une phrase et énumèrent les types
- Page 285 and 286:
Pour l’arbre de dépendance topol
- Page 287 and 288:
• Une règle de correspondance ma
- Page 289 and 290:
soit nominal ou pronominal, sauf si
- Page 291 and 292:
La seconde analyse est basée sur l
- Page 293 and 294:
(ننام) na+naamu (أن
- Page 295 and 296:
SF domP chI chR chF Constituant 1:
- Page 297 and 298:
fa (‘et’) (CONJ-COORD) conj-coo
- Page 299 and 300:
qu’il existe d’autres champs du
- Page 301 and 302:
3.2.1. L’ajout de traits communic
- Page 303 and 304:
domP domV noyV ʔinna walad chI chP
- Page 305 and 306:
Thème ʔakala (V)actif,ind,passé
- Page 307 and 308:
(V) sujet (N) domV (V) chV (N) chM
- Page 309 and 310:
et RC3 indiquent le placement des a
- Page 311 and 312:
3.2.2.2.1.1 Placement de la composa
- Page 313 and 314:
Le verbe de la principale ouvre suc
- Page 315 and 316:
une proposition sujet ou un masdar
- Page 317 and 318:
RC = (V, Conj_Sub, coDir, chPF) dom
- Page 319 and 320:
Par contre, si le complément d’o
- Page 321 and 322:
taaba (‘a joui’) (V)ind, passé
- Page 323 and 324:
domV kaana chV chM chP (N) sujet jo
- Page 325 and 326:
Nous avons vu dans la partie préc
- Page 327 and 328:
. turikat naaniis+u+n wahiidat+a+n
- Page 329 and 330:
Cette règle de correspondance perm
- Page 331 and 332:
al+tuffaah+u jaʔkulu#hu al+ʔawlaa
- Page 333 and 334:
prolepse (413) al+ustaað+u kaana a
- Page 335 and 336:
domP altuffaahu chI domV chPI chP n
- Page 337 and 338:
(418) al+ʔawlaad+u al+tuffaah+u ja
- Page 339 and 340:
prolepse alwardatu-prolepse→saaqu
- Page 341 and 342:
(422) a. [ʔinna al+ʔawlaad+a] [ka
- Page 343 and 344:
ʔinna (V)ind, passé ʔakala (‘a
- Page 345 and 346:
certains éléments n’ont pas de
- Page 347 and 348:
ésoudre les dissimilitudes interla
- Page 349 and 350:
Dans la phrase arabe, le verbe iʤt
- Page 351 and 352:
(434) kaana al+ʔawlaad+u qad ʔaka
- Page 353 and 354:
(439) [sajuqaal [ʔanna zajd+a+n sa
- Page 355 and 356:
qui peut être traduit par « on a
- Page 357 and 358:
2.3.3. Les divergences concernant l
- Page 359 and 360:
2.4. Les divergences relatives à l
- Page 361 and 362:
(N) DEF SSyntS arabe (N) INDEF SSyn
- Page 363 and 364:
Pour concilier les SSyntP, il serai
- Page 365 and 366:
SSyntS arabe (V1) SSyntS française
- Page 367 and 368:
(455) [juriidu al+ʔawlaad+u [ʔan
- Page 369 and 370:
(459) [juridu zajd+u+n [ʔan jakuun
- Page 371 and 372:
(يريد الأولادُ
- Page 373 and 374:
L’équivalent complétif Dans l
- Page 375 and 376:
(PREP) SSyntP arabe ATTR kaana Mode
- Page 377 and 378:
kaana fini SSyntS arabe SSyntS fran
- Page 379 and 380:
SSyntP arabe kaana SSyntP français
- Page 381 and 382:
SSyntP arabe kaana SSyntP français
- Page 383 and 384:
est dérivé du verbe ʤarra signif
- Page 385 and 386:
une seule unité lexicale profonde.
- Page 387 and 388:
(476) a. janðuru {huwa} ilaa nafs+
- Page 389 and 390:
3.2.4.2 La construction de coordina
- Page 391 and 392:
Notons l’absence de lien anaphori
- Page 393 and 394:
modifiant le nom alʔawlaada a pour
- Page 395 and 396:
SSyntS arabe (V1) jussif | ind SSyn
- Page 397 and 398:
SSyntP arabe (V1) SSyntP française
- Page 399 and 400:
La correspondance montre la dispari
- Page 401 and 402:
La règle de correspondance s’app
- Page 403 and 404:
moins marquée en arabe qu’en fra
- Page 405 and 406:
lit. : je me suis adressé à lui e
- Page 407 and 408:
SSyntS arabe (V1) SSyntS française
- Page 409 and 410:
3.3.4. Les équivalents du constitu
- Page 411 and 412:
Conclusion Au départ, notre object
- Page 413 and 414:
La présente étude a soulevé la q
- Page 415 and 416:
NoyN chCoord chINT chPé1 chL1 chC
- Page 417 and 418:
(V) NoyV adverbiale (ADV interr ) c
- Page 419 and 420:
. laa wa#lam wa#lan janaam {humu}
- Page 421 and 422:
se place dans le champ clitique chC
- Page 423 and 424:
(5) Ø kaana ʕalaj#a dajn+u+n ⇒
- Page 425 and 426:
(7) a. Ø kaana fii al+daar+i saahi
- Page 427 and 428:
Glossaire 306 Arabe Français ∫ib
- Page 429 and 430:
taqdiim alχabar ت قديم الخ
- Page 431 and 432:
[14] BADAWI, El Said ; CARTER, Mich
- Page 433 and 434:
[43] CORI, M ; MARANDIN, J.-M (1993
- Page 435 and 436:
[68] FEHRI, Abdelkader Fassi (1993)
- Page 437 and 438:
[95] KAHANE, Sylvain; NASR Alexis;
- Page 439 and 440:
[123] NEYRENEUF M. et AL-HAKKAK G.
- Page 441 and 442:
[148] SMRŽ, Otakar (en préparatio
- Page 443 and 444:
FIGURE 48 : SSYNTS DE LA CONSTRUCTI
- Page 445 and 446:
FIGURE 135 : SSYNTS D’UNE CONSTRU
- Page 447 and 448:
FIGURE 223 : APPLICATION DES RÈGLE
- Page 449 and 450:
ʔan (que ,(أنْ v, 2, 12,
- Page 451 and 452:
158, 159, 166, 169, 171, 174, 181,