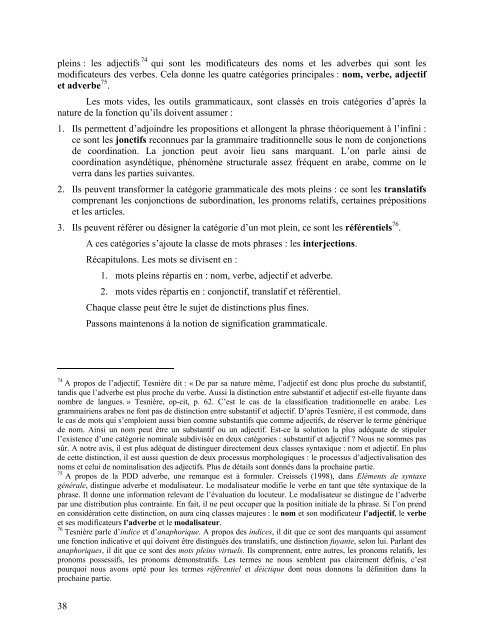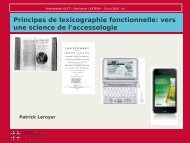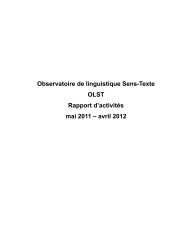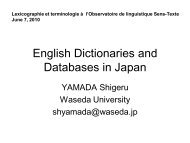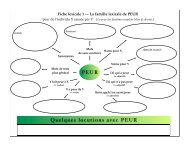une etude contrastive de l'arabe et du français dans une perspective ...
une etude contrastive de l'arabe et du français dans une perspective ...
une etude contrastive de l'arabe et du français dans une perspective ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
pleins : les adjectifs 74 qui sont les modificateurs <strong>de</strong>s noms <strong>et</strong> les adverbes qui sont les<br />
modificateurs <strong>de</strong>s verbes. Cela donne les quatre catégories principales : nom, verbe, adjectif<br />
<strong>et</strong> adverbe 75 .<br />
Les mots vi<strong>de</strong>s, les outils grammaticaux, sont classés en trois catégories d’après la<br />
nature <strong>de</strong> la fonction qu’ils doivent assumer :<br />
1. Ils perm<strong>et</strong>tent d’adjoindre les propositions <strong>et</strong> allongent la phrase théoriquement à l’infini :<br />
ce sont les jonctifs reconnues par la grammaire traditionnelle sous le nom <strong>de</strong> conjonctions<br />
<strong>de</strong> coordination. La jonction peut avoir lieu sans marquant. L’on parle ainsi <strong>de</strong><br />
coordination asyndétique, phénomène structurale assez fréquent en arabe, comme on le<br />
verra <strong>dans</strong> les parties suivantes.<br />
2. Ils peuvent transformer la catégorie grammaticale <strong>de</strong>s mots pleins : ce sont les translatifs<br />
comprenant les conjonctions <strong>de</strong> subordination, les pronoms relatifs, certaines prépositions<br />
<strong>et</strong> les articles.<br />
3. Ils peuvent référer ou désigner la catégorie d’un mot plein, ce sont les référentiels 76 .<br />
A ces catégories s’ajoute la classe <strong>de</strong> mots phrases : les interjections.<br />
Récapitulons. Les mots se divisent en :<br />
1. mots pleins répartis en : nom, verbe, adjectif <strong>et</strong> adverbe.<br />
2. mots vi<strong>de</strong>s répartis en : conjonctif, translatif <strong>et</strong> référentiel.<br />
Chaque classe peut être le suj<strong>et</strong> <strong>de</strong> distinctions plus fines.<br />
Passons maintenons à la notion <strong>de</strong> signification grammaticale.<br />
74 A propos <strong>de</strong> l’adjectif, Tesnière dit : « De par sa nature même, l’adjectif est donc plus proche <strong>du</strong> substantif,<br />
tandis que l’adverbe est plus proche <strong>du</strong> verbe. Aussi la distinction entre substantif <strong>et</strong> adjectif est-elle fuyante <strong>dans</strong><br />
nombre <strong>de</strong> langues. » Tesnière, op-cit, p. 62. C’est le cas <strong>de</strong> la classification traditionnelle en arabe. Les<br />
grammairiens arabes ne font pas <strong>de</strong> distinction entre substantif <strong>et</strong> adjectif. D’après Tesnière, il est commo<strong>de</strong>, <strong>dans</strong><br />
le cas <strong>de</strong> mots qui s’emploient aussi bien comme substantifs que comme adjectifs, <strong>de</strong> réserver le terme générique<br />
<strong>de</strong> nom. Ainsi un nom peut être un substantif ou un adjectif. Est-ce la solution la plus adéquate <strong>de</strong> stipuler<br />
l’existence d’<strong>une</strong> catégorie nominale subdivisée en <strong>de</strong>ux catégories : substantif <strong>et</strong> adjectif ? Nous ne sommes pas<br />
sûr. A notre avis, il est plus adéquat <strong>de</strong> distinguer directement <strong>de</strong>ux classes syntaxique : nom <strong>et</strong> adjectif. En plus<br />
<strong>de</strong> c<strong>et</strong>te distinction, il est aussi question <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux processus morphologiques : le processus d’adjectivalisation <strong>de</strong>s<br />
noms <strong>et</strong> celui <strong>de</strong> nominalisation <strong>de</strong>s adjectifs. Plus <strong>de</strong> détails sont donnés <strong>dans</strong> la prochaine partie.<br />
75 A propos <strong>de</strong> la PDD adverbe, <strong>une</strong> remarque est à formuler. Creissels (1998), <strong>dans</strong> Eléments <strong>de</strong> syntaxe<br />
générale, distingue adverbe <strong>et</strong> modalisateur. Le modalisateur modifie le verbe en tant que tête syntaxique <strong>de</strong> la<br />
phrase. Il donne <strong>une</strong> information relevant <strong>de</strong> l’évaluation <strong>du</strong> locuteur. Le modalisateur se distingue <strong>de</strong> l’adverbe<br />
par <strong>une</strong> distribution plus contrainte. En fait, il ne peut occuper que la position initiale <strong>de</strong> la phrase. Si l’on prend<br />
en considération c<strong>et</strong>te distinction, on aura cinq classes majeures : le nom <strong>et</strong> son modificateur l’adjectif, le verbe<br />
<strong>et</strong> ses modificateurs l’adverbe <strong>et</strong> le modalisateur.<br />
76 Tesnière parle d’indice <strong>et</strong> d’anaphorique. A propos <strong>de</strong>s indices, il dit que ce sont <strong>de</strong>s marquants qui assument<br />
<strong>une</strong> fonction indicative <strong>et</strong> qui doivent être distingués <strong>de</strong>s translatifs, <strong>une</strong> distinction fuyante, selon lui. Parlant <strong>de</strong>s<br />
anaphoriques, il dit que ce sont <strong>de</strong>s mots pleins virtuels. Ils comprennent, entre autres, les pronoms relatifs, les<br />
pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs. Les termes ne nous semblent pas clairement définis, c’est<br />
pourquoi nous avons opté pour les termes référentiel <strong>et</strong> déictique dont nous donnons la définition <strong>dans</strong> la<br />
prochaine partie.<br />
38