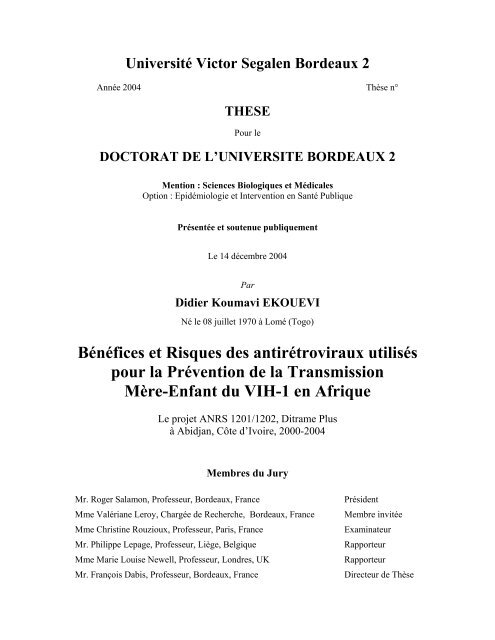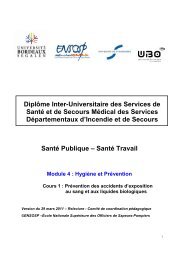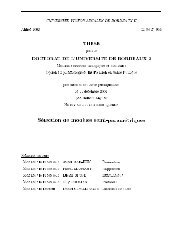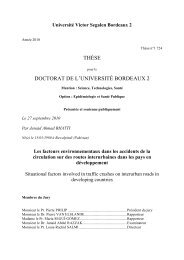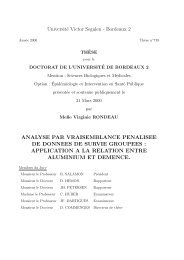Télécharger le texte intégral - ISPED-Enseignement à distance
Télécharger le texte intégral - ISPED-Enseignement à distance
Télécharger le texte intégral - ISPED-Enseignement à distance
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Université Victor Sega<strong>le</strong>n Bordeaux 2<br />
Année 2004 Thèse n°<br />
THESE<br />
Pour <strong>le</strong><br />
DOCTORAT DE L’UNIVERSITE BORDEAUX 2<br />
Mention : Sciences Biologiques et Médica<strong>le</strong>s<br />
Option : Epidémiologie et Intervention en Santé Publique<br />
Présentée et soutenue publiquement<br />
Le 14 décembre 2004<br />
Par<br />
Didier Koumavi EKOUEVI<br />
Né <strong>le</strong> 08 juil<strong>le</strong>t 1970 <strong>à</strong> Lomé (Togo)<br />
Bénéfices et Risques des antirétroviraux utilisés<br />
pour la Prévention de la Transmission<br />
Mère-Enfant du VIH-1 en Afrique<br />
Le projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus<br />
<strong>à</strong> Abidjan, Côte d’Ivoire, 2000-2004<br />
Membres du Jury<br />
Mr. Roger Salamon, Professeur, Bordeaux, France<br />
Mme Valériane Leroy, Chargée de Recherche, Bordeaux, France<br />
Mme Christine Rouzioux, Professeur, Paris, France<br />
Mr. Philippe Lepage, Professeur, Liège, Belgique<br />
Mme Marie Louise Newell, Professeur, Londres, UK<br />
Mr. François Dabis, Professeur, Bordeaux, France<br />
Président<br />
Membre invitée<br />
Examinateur<br />
Rapporteur<br />
Rapporteur<br />
Directeur de Thèse
2<br />
REMERCIEMENTS<br />
A Monsieur <strong>le</strong> Professeur Roger Salamon<br />
Professeur des Universités en Santé Publique (Université Victor Sega<strong>le</strong>n de Bordeaux 2, France)<br />
Chef du Service d’Information Médica<strong>le</strong> au CHR de Bordeaux<br />
Directeur de l’Unité INSERM 593<br />
Directeur de l’Institut de Santé Publique d’Epidémiologie et de Développement (<strong>ISPED</strong>)<br />
Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance. J’ai eu la chance de bénéficier de vos<br />
conseils et de votre soutien depuis mon arrivée <strong>à</strong> Bordeaux en 1997 en tant qu’interne en Santé<br />
Publique dans votre département. J’ai beaucoup appris pendant toutes ces années passées <strong>à</strong> l’<strong>ISPED</strong>.<br />
Je vous remercie de l’honneur que vous me faites en acceptant de présider ce jury de thèse.<br />
Soyez assuré de ma gratitude et de mon profond respect.<br />
A Madame <strong>le</strong> Docteur Valériane Leroy<br />
Chargée de Recherche <strong>à</strong> l’Unité INSERM 593<br />
Habilitation <strong>à</strong> Diriger <strong>le</strong>s Recherches (Université Victor Sega<strong>le</strong>n, Bordeaux 2, France)<br />
Docteur en Médecine, option Santé Publique<br />
Je me souviens encore de ton mail du 20 décembre 2000 me proposant d’intégrer l’équipe<br />
Ditrame Plus. Merci pour cette confiance. Ton soutien pendant ces quatre années passées ensemb<strong>le</strong><br />
m’a permis de renforcer mes connaissances en épidémiologie et en recherche clinique.<br />
Merci d’avoir accepté de juger ce travail.<br />
A Madame <strong>le</strong> Professeur Christine Rouzioux<br />
Professeur des Universités en Virologie (Université René Descartes, Paris, France)<br />
Docteur en Pharmacie<br />
Laboratoire de Virologie, EA 3620, C.H.U. Necker, Enfants Malades,<br />
Merci d’avoir accepté de participer <strong>à</strong> ce jury de thèse. J’ai eu l’occasion de travail<strong>le</strong>r avec<br />
vous <strong>à</strong> Abidjan et <strong>à</strong> Paris. Votre simplicité et votre amabilité, sont autant de qualités qui vous<br />
honorent. J’espère que nous continuerons cette fructueuse collaboration avec votre équipe. Veuil<strong>le</strong>z<br />
trouver ici <strong>le</strong> témoignage de mon entière reconnaissance et de mon profond respect.
3<br />
A Monsieur <strong>le</strong> Professeur Philippe Lepage<br />
Professeur des Universités en Pédiatrie (Université de Liège, Belgique)<br />
Président du Département Universitaire de Pédiatrie de Liège<br />
Chef du service de Pédiatrie au Centre Hospitalier Régiona<strong>le</strong> de la Citadel<strong>le</strong><br />
Merci pour l’honneur que vous nous faites en acceptant d’être <strong>le</strong> rapporteur de ce travail.<br />
Merci pour votre disponibilité et votre courtoisie. Votre regard critique sur ce travail nous permettra<br />
sans doute de l’améliorer. Veuil<strong>le</strong>z trouver ici l’expression de notre reconnaissance.<br />
A Madame <strong>le</strong> Professeur Marie-Louise Newell<br />
Professor in Paediatric Epidemiology (University Col<strong>le</strong>ge London, UK)<br />
Centre for Paediatric Epidemiology and Biostatistics<br />
Merci pour votre disponibilité. Nous espérons que vous apporterez sans retenue tout votre<br />
regard critique sur ce travail afin de l’améliorer. Votre présence dans ce jury est un honneur pour<br />
nous. Soyez assurée de notre gratitude.<br />
A Monsieur <strong>le</strong> Professeur François Dabis<br />
Professeur des Universités en Santé Publique (Université Victor Sega<strong>le</strong>n, Bordeaux 2, France)<br />
Praticien Hospitalier<br />
Chef de l’équipe VIH <strong>à</strong> l’unité INSERM 593<br />
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez faite en me confiant ce travail. Vous m’avez<br />
beaucoup appris sur <strong>le</strong> plan professionnel par votre disponibilité et votre rigueur. Je reste<br />
impressionné par votre goût pour <strong>le</strong> travail bien fait. J’espère vivement que nous allons poursuivre<br />
cette collaboration. Que ce travail soit <strong>le</strong> modeste témoignage de mon estime et de ma profonde<br />
reconnaissance.
4<br />
A Mon père Joseph et <strong>à</strong> ma mère Patricia, toute mon affection et ma reconnaissance. Vous m’avez<br />
toujours soutenu avec générosité et tendresse.<br />
A mes frères Guy, Christian et <strong>à</strong> ma sœur Josita, merci pour vos encouragements. La fraternité est<br />
une richesse inépuisab<strong>le</strong>. Trouvez ici l’expression de ma profonde affection.<br />
A ma chérie Patricia, merci pour ta compréhension, ta patience et tes conseils de tous <strong>le</strong>s jours.<br />
A ma grand-mère Odilia Paraïso, tendresse filia<strong>le</strong><br />
A Arthur et Marie-Jo Creppy, merci pour votre disponibilité et votre accueil chaque fois que je suis<br />
de passage <strong>à</strong> Bordeaux<br />
A Vana Mena, merci pour tous <strong>le</strong>s services rendus chaque fois que je passe <strong>à</strong> Bordeaux<br />
A mes amis : Hervé et Djoudjou Mensah, Karl Doe, Joseph Tégbé, Judith Fiagan, Yolande Aithnard,<br />
Valère Honyigloh, Nathalie Kagni-Freitas, Ilagou Ayeva, Lazare Noulékou, Clarence Atayi, A<strong>le</strong>xis et<br />
Christel<strong>le</strong> Nguessan, Arnaud Monney, A<strong>le</strong>xandre Creppy, Merci pour votre soutien<br />
A Moustapha Thiam « <strong>le</strong> manager », en souvenir de toutes <strong>le</strong>s soirées de délire passées chez toi <strong>à</strong><br />
Abidjan et <strong>à</strong> toutes ces centaines de personnes que j’ai pu croiser un soir : Jo, Aminata, Cissé, etc<br />
A Detty Fiagan, merci pour tes conseils et tes encouragements<br />
A tous <strong>le</strong>s amis que je n’ai pas cités, affectueuse considération<br />
Aux famil<strong>le</strong>s : EKOUEVI, AMAVI, SODATONOU, PARAISO, FASSINOU, BOURAIMA, GBIKPI,<br />
AKUE-GEDU, HOUNGUES, toute ma sympathie, mon amitié et mon attachement.<br />
A toutes <strong>le</strong>s personnes qui ont contribué <strong>à</strong> ma formation et particulièrement<br />
A mes enseignants <strong>à</strong> Lomé et plus particulièrement aux Professeurs : Prince David, James, Mijiyawa,<br />
Gbadoe, Napo-Koura, Pitché, Vovor et Hodonou. Merci pour vos conseils<br />
A Madame <strong>le</strong> professeur Geneviève Chêne, Je vous dois beaucoup sur <strong>le</strong> plan de ma formation.<br />
Merci de m’avoir fait confiance dès <strong>le</strong>s premiers jours. Je n’oublierai jamais <strong>le</strong>s six mois passés dans<br />
votre service.<br />
A Madame <strong>le</strong> Dr Lydia Foucan, Merci, j’ai failli revenir en Guadeloupe après une année<br />
merveil<strong>le</strong>use passée sous <strong>le</strong>s tropiques. Toute ma reconnaissance et ma considération<br />
A toutes <strong>le</strong>s personnes qui ont contribué <strong>à</strong> la réalisation de ce travail<br />
A Renaud Becquet, Merci pour ton amica<strong>le</strong> promptitude <strong>à</strong> résoudre mes différents problèmes. Je te<br />
dis merci pour tous <strong>le</strong>s services rendus<br />
A Charlotte Sakarovich, Dominique Touchard et <strong>à</strong> Laurence Dequae-Merchadou, merci pour votre<br />
contribution <strong>à</strong> ce travail et pour tout ce qui concerne <strong>le</strong>s bases de données du projet Ditrame Plus
5<br />
A Evelyne Mouil<strong>le</strong>t, merci pour votre aide. Vous avez toujours répondu très rapidement <strong>à</strong> mes<br />
demandes depuis Abidjan. Ceci m’a beaucoup aidé dans la réalisation de ce travail.<br />
A toute l’équipe du « PMTCT Intelligence Bordeaux Working group », Ce travail fastidieux mais<br />
très formateur m’a beaucoup aidé dans la rédaction de cette thèse.<br />
Au Dr Ida Viho, Merci pour ton amitié et ton soutien. Grâce <strong>à</strong> toi, j’ai pu m’intégrer faci<strong>le</strong>ment <strong>à</strong><br />
l’équipe Ditrame Plus <strong>à</strong> Abidjan. Je t’en suis infiniment reconnaissant.<br />
Au Dr Laurence Bequet, Merci pour ta compréhension, tu m’as souvent soulagé des réunions<br />
d’équipe pour me permettre de finir ce travail. Toute ma reconnaissance.<br />
Au Dr Besigin Tonwe-Gold, nous t’avons surnommée « Miss Plus » pour ton dynamisme. Merci pour<br />
ta contribution <strong>à</strong> ce travail et tes conseils.<br />
A toute l’équipe de Ditrame Plus, toute ma reconnaissance et toute mon affection. Sans vous, ce<br />
travail n’aurait pas vu <strong>le</strong> jour. Merci.<br />
A Annabel Desgrées du lou, Hermann Brou, Hélène Agbo, Benjamin Zanou, Merci pour vos<br />
encouragements.<br />
Au Professeur N’DRI-Yoman, Merci pour votre disponibilité et vos conseils. Vous avez toujours<br />
répondu présente pour nous aider dans <strong>le</strong>s moments diffici<strong>le</strong>s. Toute notre reconnaissance.<br />
Au Professeurs Wellfens-EKra et Timité-Konan qui discrètement mais avec beaucoup d’efficacité<br />
nous ont toujours soutenu <strong>à</strong> Abidjan. Merci pour votre sens des responsabilités et votre disponibilité.<br />
Au service administratif du programme PACCI et <strong>à</strong> toute l’équipe du CeDReS <strong>à</strong> Abidjan<br />
A François Rouet, c’est un véritab<strong>le</strong> plaisir de travail<strong>le</strong>r avec toi, merci pour ta contribution<br />
A Marie-Laure Chaix, pour ta contribution et ton aide dans la rédaction de cette thèse<br />
A Bertin Kouadio, toute mon amitié<br />
A tous <strong>le</strong>s chefs de projet du Programme Pacci et Aconda (Drs Christine Danel, Cathérine Sey<strong>le</strong>r,<br />
Charlotte Huet et Siaka Touré) et au Directeur du programme PACCI (Mr Philippe Lepère), toute<br />
ma considération.<br />
Au Dr Anthony Tanoh, du Ministère de la Santé et de la Population (Côte d’Ivoire), pour tous <strong>le</strong>s<br />
services rendus et ta disponibilité.<br />
A l’équipe de L’<strong>ISPED</strong> <strong>à</strong> Bordeaux<br />
A tout <strong>le</strong> personnel de l’<strong>ISPED</strong> et particulièrement <strong>à</strong> Marie-Pierre Martin, Sylvie Lawson-Ayayi,<br />
Bellancil<strong>le</strong> Uwamaliya, Made<strong>le</strong>ine Decoin, Xavier Anglaret, Celine Moty, Alphonse Kponzehouen,<br />
Rodolphe Thiebaut, Mouffid Hajjar, Véronique Gil<strong>le</strong>ron, Merci.<br />
Aux internes en Santé Publique de Bordeaux et spécia<strong>le</strong>ment la promotion 1997-1998, mes meil<strong>le</strong>urs<br />
souvenirs<br />
A cette super promotion du DEA de Santé Publique de Bordeaux de l’année, 2000-2001, mes<br />
meil<strong>le</strong>urs souvenirs
6<br />
Et enfin qu’il me soit permis de dédier cette thèse …………………<br />
A tous <strong>le</strong>s hommes et femmes de bonne volonté<br />
qui mettent <strong>le</strong>ur temps et <strong>le</strong>urs compétences<br />
au service des personnes vivant avec <strong>le</strong> VIH<br />
"Le sida n'est pas une affaire de statistiques<br />
mais de souffrance individuel<strong>le</strong>"<br />
Nelson Mandela, Prix Nobel de la paix<br />
16 Juil<strong>le</strong>t 2004, Bangkok, Thaïlande.
7<br />
Ce travail a été rendu possib<strong>le</strong> grâce au soutien financier de Sidaction<br />
Merci <strong>à</strong> toute l’équipe et particulièrement <strong>à</strong> Madame Paola De Carli<br />
Entre avril 2002 et décembre 2004, j’ai bénéficié d’une bourse de recherche Sidaction<br />
.
8<br />
Tab<strong>le</strong> des matières<br />
Introduction 20<br />
1. La transmission du VIH de la mère <strong>à</strong> son enfant en Afrique et sa prévention. Etat<br />
des connaissances en 2004………………………………………………………………. 23<br />
1.1. Con<strong>texte</strong> général……………………………………………………………………………… 24<br />
1.2. Moment de la transmission mère-enfant du VIH…………………………………………….. 25<br />
1.3. Facteurs associés <strong>à</strong> la transmission de l'infection <strong>à</strong> VIH de la mère <strong>à</strong> l’enfant………………. 28<br />
1.4. Antirétroviraux utilisés dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH………… 34<br />
1.5. Efficacité des antirétroviraux dans la PTME………………………………………………… 38<br />
1.6. Tolérance des antirétroviraux dans la PTME………………………………………………… 44<br />
1.7. Résistance vira<strong>le</strong> aux médicaments utilisés dans la PTME………………………………….. 47<br />
1.8. Autres interventions pour réduire la TME…………………………………………………… 49<br />
1.9. Questions de recherche <strong>à</strong> envisager en Afrique……………………………………………… 51<br />
2. Mise en place du projet ANRS 1201 Ditrame Plus……………………………………. 53<br />
2.1. Situation épidémiologique du VIH/SIDA en Côte d’Ivoire…………….................................. 54<br />
2.2. Organisation du projet Ditrame Plus…………………………………………………………. 55<br />
2.3. Con<strong>texte</strong> de la mise en place du Projet Ditrame Plus : <strong>le</strong>s études de base…………………… 60<br />
2.4. L’obtention du consentement des femmes enceintes infectées par <strong>le</strong> VIH et la participation<br />
au projet Ditrame Plus………………………………………………………………………... 63<br />
3. Acceptabilité du dépistage VIH et des interventions de PTME………………………. 68<br />
3.1. Dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH chez la femme enceinte en Afrique…………………………. 69<br />
3.2. Acceptabilité du dépistage et des interventions peripartum de PTME………………………. 87<br />
4. Protoco<strong>le</strong> de l’étude ANRS 1201 : efficacité des interventions peripartum…………. 98<br />
4.1. Justification…………………………………………………………………………………… 99<br />
4.2. Objectifs de l’étude…………………………………………………………………………… 101<br />
4.3. Méthodes……………………………………………………………………………………… 101<br />
4.4. Population d’étude……………………………………………………………………………. 102<br />
4.5. Les interventions thérapeutiques……………………………………………………………... 104
9<br />
4.6. Dérou<strong>le</strong>ment de l’étude……………………………………………………………………… 105<br />
4.7. Critères de jugement………………………………………………………………………… 110<br />
4.8. Nombre de sujets nécessaire………………………………………………………………… 110<br />
4.9. Analyse des données………………………………………………………………………… 111<br />
4.10. Evénements indésirab<strong>le</strong>s……………………………………………………………………. 112<br />
4.11. Organisation pratique du projet……………………………………………………………... 113<br />
4.12. Aspects éthiques et rég<strong>le</strong>mentaires………………………………………………………….. 116<br />
4.13. Ca<strong>le</strong>ndrier de la recherche…………………………………………………………………... 117<br />
4.14. Circuit des médicaments…………………………………………………………………….. 117<br />
4.15. Fin de l’étude………………………………………………………………………………... 118<br />
4.16. Suivi des enfants infectés……………………………………………………………………. 118<br />
4.17. Principaux résultats : Efficacité des interventions…………………………………………... 119<br />
4.18. Discussion…………………………………………………………………………………… 120<br />
5. Effets secondaires des antirétroviraux utlisés pour la PTME en Afrique……………. 122<br />
5.1. Mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine……………………………………………………… 123<br />
5.2. Hyperlactatémies chez des enfants exposés aux antirétroviraux pendant la grossesse Etude<br />
ANRS 1209 Ditrame Plus Safe………………………………………………………………. 137<br />
6. Discussion…………………………………………………………………………………. 154<br />
6.1. Les spécificités africaines de la PTME……………………………………………………….. 155<br />
6.2. L’acceptabilité du dépistage et des interventions peripartum………………………………… 156<br />
6.3. Peut-on éliminer la transmission peripartum avec des régimes courts ................................... 160<br />
6.4. La prévention de la transmission postpartum après une intervention peripartum……………. 163<br />
6.5. Perspectives de santé publique………………………………………………………………... 164<br />
Conclusion…………………………………………………………………………………….. 168<br />
Références…………………………………………………………………………………….. 171
10<br />
Liste des tab<strong>le</strong>aux<br />
Tab<strong>le</strong>au 1<br />
Tab<strong>le</strong>au 2<br />
Tab<strong>le</strong>au 3<br />
Tab<strong>le</strong>au 4<br />
Tab<strong>le</strong>au 5a<br />
Tab<strong>le</strong>au 5b<br />
Risque absolu et proportion de la transmission du VIH-1 de la mère <strong>à</strong> son enfant en<br />
fonction du moment (Adapté de De Cock, JAMA 2000)……………………………... 25<br />
Estimation du moment d’acquisition de l'infection <strong>à</strong> VIH-1 de la mère <strong>à</strong> son enfant<br />
en fonction des résultats des tests virologiques……………………………………….. 27<br />
Facteurs associés <strong>à</strong> la transmission in utero et peripartum du VIH-1 de la mère <strong>à</strong> son<br />
enfant………………………………………………………………………………….. 31<br />
Facteurs associés <strong>à</strong> la transmission du VIH-1 de la mère <strong>à</strong> son enfant par l'allaitement<br />
maternel (Source Groupe de Ghent, Février 2003)…………………………………… 33<br />
Description des essais thérapeutiques de première génération pour la prévention de la<br />
transmission de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 en Afrique………………………………………. 35<br />
Description des essais thérapeutiques évaluant des régimes d’antirétroviraux pour la<br />
prévention de la transmission de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 en Afrique…………………….. 36<br />
Tab<strong>le</strong>au 6 Description des essais thérapeutiques réalisés en Thaïlande pour l’étude de la TME. 37<br />
Tab<strong>le</strong>au 7 Efficacité <strong>à</strong> long terme (M 18) des antirétroviraux utilisés pour la PTME en Afrique.. 43<br />
Tab<strong>le</strong>au 8<br />
Tab<strong>le</strong>au 9<br />
Tab<strong>le</strong>au 10<br />
Tab<strong>le</strong>au 11<br />
Tab<strong>le</strong>au 12<br />
Tab<strong>le</strong>au 13<br />
Tab<strong>le</strong>au 14<br />
Malformations congénita<strong>le</strong>s et mortinatalité décrites dans <strong>le</strong>s essais thérapeutiques<br />
sur la PTME en Afrique……………………………………………………………….. 46<br />
Description des sites du projet Ditrame Plus et ca<strong>le</strong>ndrier d’ouverture des centres de<br />
dépistage et de suivi…………………………………………………………………… 57<br />
Procédure d’obtention du consentement éclairé et niveau de compréhension de la<br />
notice d’information chez <strong>le</strong>s femmes infectées par <strong>le</strong> VIH-1 et participant au projet<br />
ANRS 1201/1202, Ditrame Plus <strong>à</strong> Abidjan, Côte d’Ivoire (2001)……………………. 66<br />
Proposition de l’Organisation Mondia<strong>le</strong> de la Santé pour améliorer l’obtention du<br />
consentement du patient pour participer <strong>à</strong> un essai thérapeutique dans <strong>le</strong>s pays en<br />
voie de développement (Extrait des conclusions de la réunion du département du<br />
VIH/SIDA de l’OMS, Genève, Juin 2003)……………………………………………. 67<br />
Présentation des différents tests sérologiques rapides disponib<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong> diagnostic<br />
de l’infection <strong>à</strong> VIH en Afrique……………………………………………………… 72<br />
Sensibilité et spécificité des tests rapides utilisés dans <strong>le</strong>s pays en voie de<br />
développement pour <strong>le</strong> diagnostic de l’infection <strong>à</strong> VIH………………………………. 73<br />
Résultats du contrô<strong>le</strong> qualité du diagnostic de l’infection <strong>à</strong> VIH par des tests rapides<br />
au sein du projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus……………………………………. 80
11<br />
Tab<strong>le</strong>au 15 Identification du type de VIH par la réalisation d’autres tests biologiques chez <strong>le</strong>s 71<br />
patients identifiés VIH-1 et 2 par <strong>le</strong> test Génie II ® . Projet ANRS 1201/1202, Ditrame<br />
Plus, Abidjan…………………………………………………………………………... 82<br />
Tab<strong>le</strong>au 16<br />
Tab<strong>le</strong>au 17<br />
Tab<strong>le</strong>au 18<br />
Tab<strong>le</strong>au 19<br />
Tab<strong>le</strong>au 20<br />
Tab<strong>le</strong>au 21<br />
Tab<strong>le</strong>au 22<br />
Tab<strong>le</strong>au 23<br />
Tab<strong>le</strong>au 24<br />
Tab<strong>le</strong>au 25<br />
Coefficient Kappa evaluant la concordance de trois tests pour la discrimination du<br />
type de VIH. Analyse réalisée chez 71 femmes enceintes identifiées VIH-1 et VIH-2<br />
sur site par <strong>le</strong> test Génie II ® . Projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus, Abidjan……….. 83<br />
Résultats sérologiques et virologiques chez 35 femmes incluses et diagnostiquées<br />
comme ayant une coinfection VIH-1 et 2 par <strong>le</strong> test Génie II ® sur site. Projet ANRS<br />
1201/1202, Ditrame Plus, Abidjan, 2000-2001………………………………………. 84<br />
Profil socio-démographique des femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 n’ayant<br />
pas connaissance de <strong>le</strong>ur statut VIH et qui n’ont pas reçu une intervention PTME <strong>à</strong><br />
Abidjan, Côte d’Ivoire, 2000-2002…………………………………………………... 91<br />
Nombre absolu et pourcentage des lymphocytes T4 (CD4+) chez <strong>le</strong>s femmes<br />
enceintes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 dans cinq centres de santé <strong>à</strong> Abidjan, Côte<br />
d’ Ivoire. Projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus, Avril - Juin 2002………………….. 94<br />
Interventions thérapeutiques proposées au sein du projet ANRS 1201/1202, Ditrame<br />
Plus……………………………………………………………………………………. 104<br />
Rythme de suivi des femmes incluses dans <strong>le</strong> projet ANRS 1201/1202 : de l'inclusion<br />
au diagnostic de l'infection <strong>à</strong> VIH……………………………………………………. 108<br />
Rythme de suivi des enfants au sein du projet ANRS 1201/1202 : de la naissanceau<br />
diagnostic de l'infection pédiatrique <strong>à</strong> VIH <strong>à</strong> S6……………………………………… 108<br />
Analyse intermédiaire, Estimation du taux de transmission <strong>à</strong> S4-S6, Projet ANRS<br />
1201/1202, Ditrame Plus, Abidjan, février 2002……………………………………… 112<br />
Liste des questionnaires utilisés pour <strong>le</strong> recueil des données chez <strong>le</strong>s femmes au sein<br />
du projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus, Abidjan………………………………….. 114<br />
Liste des questionnaires utilisés pour <strong>le</strong> recueil des données chez <strong>le</strong>s enfants au sein<br />
du projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus, Abidjan………………………………….. 114<br />
Tab<strong>le</strong>au 26 Ca<strong>le</strong>ndrier d’exécution du projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus…………………... 117<br />
Tab<strong>le</strong>au 27<br />
Tab<strong>le</strong>au 28<br />
Fréquence des mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine estimée <strong>à</strong> S4 postpartum chez<br />
la mère et <strong>le</strong>s enfants infectés. Etude ANRS 1263, Ditrame Plus Viro……………….. 126<br />
Différents types de mutations <strong>à</strong> la Névirapine identifiés dans <strong>le</strong> projet ANRS<br />
1201/1202, Ditrame Plus. Etude ANRS 1263, Ditrame Plus Viro……………………. 129<br />
Tab<strong>le</strong>au 29<br />
Tab<strong>le</strong>au 30<br />
Présence des mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine dans <strong>le</strong> plasma et dans <strong>le</strong>s<br />
cellu<strong>le</strong>s <strong>à</strong> S4. Etude ANRS 1263, Ditrame Plus Viro.<br />
Facteurs associés <strong>à</strong> la présence de mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP dans <strong>le</strong> plasma<br />
maternel <strong>à</strong> S4. Analyse univariée et multivariée. Etude ANRS 1263, Ditrame Plus<br />
Viro.<br />
132<br />
133
12<br />
Tab<strong>le</strong>au 31<br />
Relation entre la présence des mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine chez la mère<br />
et chez l’enfant. Etude ANRS 1263, Ditrame Plus Viro……………………………... 133<br />
Tab<strong>le</strong>au 32 Mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP présentes chez l’enfant et chez la mère <strong>à</strong> S4.<br />
Etude ANRS 1263, Ditrame Plus Viro…………………………………………………….. 134<br />
Tab<strong>le</strong>au 33 Interventions thérapeutiques dans l’étude ANRS 1209, Ditrame Plus Safe, Abidjan.. 140<br />
Tab<strong>le</strong>au 34<br />
Tab<strong>le</strong>au 35<br />
Tab<strong>le</strong>au 36<br />
Tab<strong>le</strong>au 37<br />
Tab<strong>le</strong>au 38<br />
Tab<strong>le</strong>au 39<br />
Répartition en classes des va<strong>le</strong>urs de lactates obtenues sur du sang déprotéinéisé.<br />
Projet ANRS 1209, Ditrame Plus Safe………………………………………………. 144<br />
Comparaison des va<strong>le</strong>urs de lactates obtenues sur du sang déprotéinéisé et sur du<br />
plasma. Etude ANRS 1209, Ditrame Plus Safe……………………………………… 144<br />
Différence absolue et différence relative entre la lactatémie plasmatique et la<br />
lactatémie réalisée sur du sang déprotéinéisé. Etude ANRS 1209, Ditrame Plus<br />
Safe…………………………………………………………………………………… 145<br />
Facteurs mesurés chez l’enfant associés <strong>à</strong> une hyperlactatémie pédiatrique. Etude<br />
ANRS 1209, Ditrame Plus Safe……………………………………………………… 147<br />
Facteurs maternels associés <strong>à</strong> une hyperlactatémie. Etude ANRS 1209, Ditrame<br />
Plus Safe……………………………………………………………………………… 148<br />
Coût unitaire en dollars et estimation des interventions de PTME (adapté de Cresse<br />
A et al Lancet 2002)………………………………………………………………….. 164
13<br />
Liste des figures<br />
Figure 1<br />
Figure 2<br />
Figure 3<br />
Figure 4<br />
Figure 5<br />
Figure 6<br />
Figure 7<br />
Figure 8<br />
Taux de transmission de l'infection <strong>à</strong> VIH de la mère <strong>à</strong> son enfant <strong>à</strong> S4-S8 avec <strong>le</strong>s<br />
différents régimes d’antirétroviraux évalués dans <strong>le</strong>s essais de PTME en Afrique…….. 40<br />
Algorithme de dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH pour <strong>le</strong>s femmes enceintes proposé dans<br />
<strong>le</strong> projet Ditrame Plus…………………………………………………………………... 76<br />
Résultats du dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 avec l’utilisation des tests rapides dans<br />
<strong>le</strong> projet Ditrame Plus de mai 2000 <strong>à</strong> février 2002……………………………………... 81<br />
Etapes de la proposition du test VIH <strong>à</strong> l’administration de la prophylaxie<br />
antirétrovira<strong>le</strong> pour la prévention de la transmission du VIH de la mère <strong>à</strong> l'enfant.<br />
Expérience du projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus <strong>à</strong> Abidjan, Côte d’Ivoire, Mai<br />
2000-Octobre 2002……………………………………………………………………... 89<br />
Taux de transmission S4-S6 des différents régimes thérapeutiques étudiés au sein du<br />
projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus (2001-2003) et de la cohorte historique chez <strong>le</strong>s<br />
femmes traitées par une monothérapie de zidovudine (1995-2000), Abidjan, Côte<br />
d’Ivoire………………………………………………………………………………….. 119<br />
Taux de transmission de l'infection <strong>à</strong> VIH de la mère <strong>à</strong> son enfant <strong>à</strong> S4-S8 avec <strong>le</strong>s<br />
différents régimes d’antirétroviraux évalués dans <strong>le</strong>s essais de PTME en Afrique<br />
incluant <strong>le</strong>s études du projet Ditrame Plus……………………………………………… 121<br />
Sé<strong>le</strong>ction de la population étudiée pour l'étude des mutations de résistance <strong>à</strong> la<br />
Névirapine en fonction du statut de transmettrices et non transmettrices et selon <strong>le</strong>s<br />
quarti<strong>le</strong>s de charge vira<strong>le</strong>……………………………………………………………….. 130<br />
Médiane de concentration de Névirapine plasmatique chez <strong>le</strong>s femmes selon la<br />
présence ou non d’une mutation de résistance <strong>à</strong> la Névirapine………………………… 131<br />
Figure 9<br />
Va<strong>le</strong>urs médianes et étendue interquarti<strong>le</strong> des lactates plasmatiques en fonction des<br />
trois types de régime antirétroviral. Etude ANRS 1209 Ditrame Plus Safe…………….<br />
143<br />
Figure 10<br />
Figure 11<br />
Figure 12<br />
Préva<strong>le</strong>nce des hyperlactatémies chez des enfants exposés aux antirétroviraux pendant<br />
la grossesse en fonction des groupes de traitement. Etude ANRS 1209 Ditrame Plus<br />
Safe……………………………………………………………………………………… 146<br />
Evolution biologique des hyperlactatémies observées chez <strong>le</strong>s 31 enfants exposés aux<br />
inhibiteurs nucléosidiques. Etude ANRS 1209 Ditrame Plus Safe……………………... 149<br />
Approche « Opt in » et approche « Opt out » pour <strong>le</strong> dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH.<br />
Cadre conceptuel………………………………………………………………………... 157
14<br />
Liste des cartes<br />
Carte 1 Carte de la République de Côte d’Ivoire……………………………………………….. 56<br />
Carte 2<br />
Carte de la vil<strong>le</strong> d’Abidjan montrant <strong>le</strong>s sites de dépistage et de suivi du projet ANRS<br />
1201/1202 Ditrame Plus………………………………………………………………... 58<br />
Liste des photos<br />
Photo 1 Centre de suivi et de dépistage d’Avocatier <strong>à</strong> Abobo (vue de face)……………………… 58<br />
Photo 2<br />
Dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH. Résultat d’un test VIH positif et négatif par <strong>le</strong> test<br />
Determine® obtenus sur <strong>le</strong> site de Niangon-Sud, Abidjan, Côte d’Ivoire………………... 77<br />
Liste des annexes<br />
Annexe 1 Publication scientifique (Viho I, et al, Gynécologie-Obstétrique & Fertilité, 2004).<br />
Comportements de santé des femmes consultant en protection maternel<strong>le</strong> et infanti<strong>le</strong><br />
dans <strong>le</strong>s formations sanitaires d'Abidjan, Côte d’Ivoire.<br />
Annexe 2 Questionnaire utilisé pour l’étude sur <strong>le</strong> « Consentement ».<br />
Annexe 3<br />
Annexe 4<br />
Annexe 5<br />
Annexe 6<br />
Algorithme N°2 proposé pour <strong>le</strong> dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH chez la femme enceinte,<br />
Projet Ditrame Plus, Abidjan, Côte d’Ivoire.<br />
Fiche de consentement et notice d’information et utilisé dans <strong>le</strong> Projet Ditrame Plus.<br />
Abidjan, Côte d’Ivoire.<br />
Questionnaires utilisés pour <strong>le</strong> recueil des données au sein du projet Ditrame Plus,<br />
Abidjan, Côte d’Ivoire.<br />
Liste des membres du comité de pilotage et du conseil scientifique du projet Ditrame<br />
Plus, Abidjan, Côte d’Ivoire.
15<br />
Liste des abréviations<br />
3TC<br />
Lamivudine<br />
ARV<br />
Antirétroviral<br />
ARVs<br />
Antirétroviraux<br />
AZT (ZDV)<br />
Zidovudine<br />
CHU<br />
Centre Hospitalier Universitaire<br />
DITRAME<br />
Diminution de la Transmission Mère Enfant du VIH/SIDA<br />
FSTI<br />
Fonds de Solidarité Thérapeutique Internationa<strong>le</strong><br />
FSUcom<br />
Formation Sanitaire Urbaine <strong>à</strong> base communautaire<br />
IEC<br />
Information – Education – Communication<br />
IC95% Interval<strong>le</strong> de confiance <strong>à</strong> 95%<br />
IN<br />
Inhibiteur nucléosidique de la (transcriptase inverse)<br />
INN<br />
Inhibiteur non nucléosidique de la (transcriptase inverse)<br />
IO<br />
Infection Opportuniste<br />
IP<br />
Inhibiteur de protéase<br />
IST<br />
Infections sexuel<strong>le</strong>ment transmissib<strong>le</strong>s [anciennement MST]<br />
MLS<br />
Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé de la lutte contre <strong>le</strong> VIH/SIDA<br />
MSP<br />
Ministère de la Santé Publique<br />
NVP<br />
Névirapine<br />
OMS<br />
Organisation Mondia<strong>le</strong> de la Santé<br />
ONG<br />
Organisation Non Gouvernementa<strong>le</strong><br />
ONUSIDA<br />
Programme commun de Nations Unies sur <strong>le</strong> VIH/SIDA<br />
OR<br />
Odds Ratio (ORa : Odds Ratio ajusté)<br />
PF<br />
Planification Familia<strong>le</strong><br />
PMI<br />
Protection Maternel<strong>le</strong> et Infanti<strong>le</strong><br />
PTME<br />
Prévention de la Transmission Mère-enfant du VIH<br />
PVVIH<br />
Personnes vivant avec <strong>le</strong> VIH/SIDA<br />
PCR<br />
Polymerase Chain Reaction<br />
RR<br />
Risque Relatif (RRa : Risque Relatif ajusté)<br />
SIDA<br />
Syndrome Immunodéficitaire Acquis<br />
TME<br />
Transmission mère enfant du VIH<br />
UNICEF<br />
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance<br />
USAC<br />
Unité de Soins Ambulatoires et de Conseil<br />
VIH<br />
Virus de l’immunodéficience humaine<br />
ZDV<br />
Zidovudine
16<br />
RESUME<br />
L’objectif du projet Ditrame Plus qui se dérou<strong>le</strong> <strong>à</strong> Abidjan, Côte d’Ivoire, est d’évaluer un paquet d’interventions<br />
peripartum et postpartum dirigées vers l’infection <strong>à</strong> VIH de la mère et de l’enfant en Afrique. Ainsi un ensemb<strong>le</strong><br />
d’interventions coordonnées est proposé depuis mai 2000, comprenant <strong>le</strong> dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH chez la<br />
femme enceinte avec des tests rapides, la prévention de la TME par des combinaisons d’antirétroviraux ainsi que<br />
des interventions nutritionnel<strong>le</strong>s (une alimentation artificiel<strong>le</strong> dès la naissance ou un allaitement avec un sevrage<br />
précoce <strong>à</strong> 3 mois). Les bénéfices aussi bien que <strong>le</strong>s risques liés <strong>à</strong> l’utilisation des antirétroviraux ont été étudiés.<br />
L’étude des risques a porté sur la recherche des mutations de résistance <strong>à</strong> la monodose de Névirapine (NVPmd)<br />
chez <strong>le</strong>s mères et <strong>le</strong>s enfants infectés et l’étude sur la toxicité mitochondria<strong>le</strong> induite par la Zidovudine (ZDV)<br />
chez <strong>le</strong>s enfants par la mesure des lactates plasmatiques pendant <strong>le</strong>s trois premiers mois de vie parmi <strong>le</strong>s enfants<br />
exposés aux différentes régimes d’antirétroviraux pendant la grossesse.<br />
Avec l’utilisation des tests rapides pour <strong>le</strong> dépistage prénatal, on note 90% d’acceptation du test ; la préva<strong>le</strong>nce<br />
du VIH-1 était estimée <strong>à</strong> 11,0% chez <strong>le</strong>s femmes enceintes en 2002. Cependant, seu<strong>le</strong>ment 25% des femmes<br />
dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 (VIH+) ont reçu une prophylaxie antirétrovira<strong>le</strong> pour la PTME. Deux facteurs<br />
étaient associés <strong>à</strong> la faib<strong>le</strong> acceptabilité des interventions de PTME : un faib<strong>le</strong> niveau d’éducation scolaire et <strong>le</strong><br />
fait de vivre avec son partenaire (Ekouévi, AIDS 2004). L’acceptabilité des interventions antirétrovira<strong>le</strong>s de<br />
PTME n’est pas liée au statut immunitaire de la femme apprécié par la mesure des CD4 maternel au dépistage<br />
prénatal (Ekouévi, JAIDS 2004).<br />
Dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus 1201, de mars 2001 <strong>à</strong> juil<strong>le</strong>t 2003, 793 femmes infectées par <strong>le</strong> VIH ont été incluses<br />
dans l’étude des interventions peripartum pour prévenir la TME : 420 avaient reçu une prophylaxie par ZDV<br />
débutée <strong>à</strong> la 36 ème semaine d’aménorrhée (SA) + NVPmd et 373 avaient reçu une prophylaxie par ZDV+3TC<br />
débutée <strong>à</strong> la 32 ème SA + NVPmd. Le taux de transmission <strong>à</strong> S6 de vie était de 6,5% (Interval<strong>le</strong> de confiance <strong>à</strong><br />
95% (IC95% [3,9-9,1%]) avec la ZDV+NVPmd et de 4,7% (IC95% [2,4-7,0%]). Aucune différence significative<br />
n’a été trouvée entre <strong>le</strong>s deux régimes thérapeutiques étudiés. En utilisant comme groupe de référence, la cohorte<br />
historique de femmes VIH+ issues de la même population et ayant reçu une monothérapie de ZDV débutée <strong>à</strong> la<br />
36-38 ème SA pour la PTME entre 1995 et 2000 (DITRAME ANRS 049) on observe une réduction de la TME de<br />
72% (IC95% [52-88%], p=0,002) (Dabis, AIDS 2005 in Press).<br />
Dans l’étude ANRS 1263 (composante virologique de l’étude Ditrame Plus), parmi <strong>le</strong>s 63 femmes VIH+ ayant<br />
reçu la combinaison ZDV+ NVPmd et incluses dans cette étude, 21 femmes VIH+ ont présenté des mutations de<br />
résistance <strong>à</strong> la NVP (33%) et 6/26 enfants (23%) inclus avaient éga<strong>le</strong>ment des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP<br />
<strong>à</strong> S4 de vie. La charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> de la préinclusion et la concentration plasmatique de NVP <strong>à</strong> J2 étaient<br />
associées aux mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP (Chaix, CROI 2004, San Francisco, USA).<br />
Dans l’étude ANRS 1209 (composante de la surveillance de la toxicité aux antirétroviraux chez <strong>le</strong>s enfants de<br />
l’étude Ditrame Plus), nous avons fait l’hypothèse que la mesure systématique des lactates plasmatiques chez <strong>le</strong>s<br />
enfants au cours des trois premiers mois de vie pouvait permettre d’identifier précocement un dysfonctionnement<br />
mitochondrial surtout en en cas d’exposition peripartum <strong>à</strong> la ZDV. Les résultats préliminaires de cette étude<br />
montrent qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative entre la préva<strong>le</strong>nce des hyperlactatémies chez<br />
des enfants exposés <strong>à</strong> trois régimes thérapeutiques différents (p=0,17). Cette préva<strong>le</strong>nce était estimée <strong>à</strong> 11% avec<br />
la ZDV+NVPmd, <strong>à</strong> 17% avec la ZDV+3TC+NVPmd et <strong>à</strong> 18% avec la NVPmd (<strong>le</strong>s inclusions sont en cours
17<br />
dans ce dernier groupe). Les premières observations nous amènent donc <strong>à</strong> penser que <strong>le</strong>s hyperlactatémies sont<br />
artéfactuel<strong>le</strong>s plutôt qu’en faveur d’un dysfonctionnement mitochondrial. Nous estimons donc que la mesure des<br />
lactates n’est pas un bon moyen d’identification de la toxicité mitochondria<strong>le</strong> en Afrique (Ekouévi, IAS 2003,<br />
Paris, France).<br />
En conclusion, nous avons pu montrer qu’avec des combinaisons thérapeutiques de ZDV+NVPmd et de<br />
ZDV+3TC+NVPmd on obtient une réduction importante de la TME comparativement <strong>à</strong> la monothérapie de<br />
ZDV. Les effets secondaires observés notamment la fréquence é<strong>le</strong>vée des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP doit<br />
être prise en compte dans <strong>le</strong>s recommandations <strong>à</strong> formu<strong>le</strong>r pour des propositions de prophylaxie antirétrovira<strong>le</strong><br />
pour la PTME. Des études doivent être rapidement planifiées pour identifier des alternatives <strong>à</strong> la monodose de<br />
NVP. Nous estimons cependant que la meil<strong>le</strong>ure stratégie pour la PTME est la multithérapie qui doit être<br />
privilégiée en prophylaxie de PTME pour <strong>le</strong>s femmes qui en ont besoin pour el<strong>le</strong>s-mêmes. Cel<strong>le</strong>-ci doit être<br />
débutée <strong>le</strong> plus rapidement possib<strong>le</strong> pendant la grossesse. La mobilisation communautaire et la lutte contre la<br />
stigmatisation sont nécessaires pour accroître de façon significative l’acceptabilité des interventions de PTME.<br />
Enfin, la prévention et <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> du risque de transmission postnata<strong>le</strong> pourraient être un complément pour<br />
rendre plus efficace <strong>le</strong>s interventions peripartum tel<strong>le</strong>s que nous l’avons recommandé.<br />
Mots clés : Transmission mère-enfant, VIH, Antirétroviraux, Afrique subsaharienne, Résistance, Lactate,<br />
Acceptabilité, Enfants. ANRS.
18<br />
Benefits and Risks of the antiretroviral drugs for the Prevention of Mother-To-Child Transmission of<br />
HIV-1 in Africa. The ANRS 1201/1202 Ditrame Plus project in Abidjan, Côte d’Ivoire<br />
SUMMARY<br />
The aim of the ANRS Ditrame Plus project in Abidjan, Côte d’Ivoire was to evaluate a package of peripartum<br />
and postpartum interventions targeted at African HIV-infected women and children for PMTCT and to enhance<br />
child survival in the HIV context. This package of interventions proposed since May 2000 includes HIV test<br />
counseling services among pregnant women with rapid HIV testing, a PMTCT intervention with ARVs as well<br />
as a nutritional component (artificial feeding from birth or early cessation of breastfeeding from three months of<br />
age).<br />
The effectiveness or field efficacy as well as the to<strong>le</strong>rance of the ARVs was studied. It included the identification<br />
of nevirapine (NVP) resistance of HIV in mothers and HIV-infected infants that had been exposed to NVP sing<strong>le</strong><br />
dose (NVPsd) and the study of mitochondrial toxicity induced by zidovudine (ZDV) with lactate measurements<br />
performed during the first 3 months of life among infants exposed to this drug in their PMTCT regimen.<br />
The acceptance of prenatal counseling with rapid HIV test was 90% and the HIV-1 preva<strong>le</strong>nce was 11% in 2002.<br />
However, only 25% of the HIV-infected pregnant women identified started the PMTCT programme. Two factors<br />
were associated with a poor uptake of the PMTCT package: a low <strong>le</strong>vel of school education and living with her<br />
partner (Ekouévi, AIDS 2004). The overall uptake of the package of interventions was independent of the<br />
immune status appreciated by the measurement of CD4+ count at prenatal counselling (Ekouévi, JAIDS 2004).<br />
In the ANRS Ditrame Plus study, from March 2001 to July 2003, 793 HIV-infected pregnant women were<br />
included: 420 received a short course of ZDV starting at 36 weeks of gestation + NVPsd for PMTCT and 373<br />
received a short-course of ZDV+ lamivudine (3TC) starting at 32 weeks + NVPsd. The MTCT rate at six week<br />
of life was 6.5% (95% confidence interval [CI] 3.9-9.1%) with ZDV+NVPsd and 4.7% (95% CI [2.4-7.0%])<br />
with ZDV+3TC+NVPsd. No significant difference was found between these two ARV regimens. Using as a<br />
reference group an historical cohort (ANRS 049) where women received a short-course ZDV regimen starting at<br />
36-38 weeks in 1995-2000 in the same population, the MTCT reduction was 72% (95% CI [52-88%], p=0.002),<br />
when comparing ZDV+NVPsd to ZDV alone after having adjusted on maternal CD4+ count, clinical stage and<br />
breastfeeding (Dabis, AIDS 2005 in Press).<br />
In the ANRS 1263 Ditrame Plus study (virological component of the ANRS Ditrame Plus project), among 63<br />
HIV-infected women, the NVP mutation resistance was detectab<strong>le</strong> in 21 women (33%) at four week postpartum<br />
and in 6/26 (23%) of HIV-infected infants at four weeks. Maternal plasma HIV-1 RNA viral load at baseline (32<br />
weeks of amenorrhea) and a high <strong>le</strong>vel of NVP concentration were associated with NVP resistance mutation<br />
(Chaix, CROI 2004, San Francisco, USA).<br />
In the ARNS 1209 study (toxicity component of the ANRS Ditrame Plus project), we hypothesized that the<br />
screening of hyperlactatemia in neonates exposed to ARVs could help to identify early a possib<strong>le</strong> mitochondrial<br />
toxicity. There was no statistical difference between the 0-3 month preva<strong>le</strong>nce of hyperlactatemia in infants<br />
exposed to three different ARV regimens (p=0.17): the preva<strong>le</strong>nce of hyperlactatemia was 11% with the<br />
ZDV+NVPsd regimen, 17% with ZDV+3TC+NVPsd and 18% in the control group exposed to NVPsd only<br />
(enrolment in this latter group is still ongoing). Thus, our preliminary findings do not confirm our study
19<br />
hypothesis but rather suggest that asymptomatic hyperlactatemia could be an artefact of blood col<strong>le</strong>ction in this<br />
neonatal context and is not a reliab<strong>le</strong> marker for the identification of mitochondrial toxicity under our field<br />
conditions (Ekouévi, IAS 2003, Paris, France).<br />
In conclusion; The ANRS Ditrame Plus project has shown the field efficacy of two news ARV regimens as<br />
compared to ZDV alone. However the high frequency of NVP mutation must be taken into account in the<br />
proposition of new recommendations of ARV use for PMTCT. Several investigations are required to identify<br />
quickly alternatives to NVPsd containing PMTCT regimens. We suggest also that the best option to prevent<br />
MTCT is to initiate HAART as soon as possib<strong>le</strong> during pregnancy for HIV-infected pregnant women with<br />
indication for ARV treatment. The community mobilization and the strugg<strong>le</strong> against stigmatization are vital to<br />
increase uptake of the PMTCT intervention in Africa. Finally, the prevention and control of the risk of postnatal<br />
transmission should comp<strong>le</strong>ment the very effective peripartum interventions that can now be recommended.<br />
Keys words: Mother-to-child transmission, HIV, Antiretroviral prophylaxis, Africa, Resistance,<br />
Nevirapine, Lactate, Uptake, Infant, ANRS
20<br />
Introduction<br />
La pandémie de l’infection <strong>à</strong> VIH/SIDA constitue bien un problème de Santé Publique majeur et<br />
durab<strong>le</strong> en Afrique subsaharienne. L’épidémie est solidement implantée sur ce continent, sans aucun<br />
signe de fléchissement. Les dernières estimations de l’ONUSIDA en juil<strong>le</strong>t 2004 montrent que <strong>le</strong><br />
continent africain est de loin <strong>le</strong> continent <strong>le</strong> plus touché par cette maladie (1). Ainsi, on estime en<br />
2004, <strong>à</strong> 25 millions <strong>le</strong> nombre de sujets infectés par <strong>le</strong> VIH vivant en Afrique subsaharienne (1).<br />
Les femmes représentent maintenant près de 50% des personnes infectées dans <strong>le</strong> monde (contre 41%<br />
en 1997). Mais contrairement aux autres régions du monde, <strong>le</strong>s femmes en Afrique subsaharienne sont<br />
plus infectées que <strong>le</strong>s hommes. El<strong>le</strong>s représentent ainsi 58% des personnes infectées par <strong>le</strong> VIH (1).<br />
Les jeunes de 15 <strong>à</strong> 24 ans représentent pour plus de la moitié des cas de ces nouvel<strong>le</strong>s infections au<br />
VIH dans <strong>le</strong> monde. Sur <strong>le</strong>s dix millions de jeunes infectés dans <strong>le</strong> monde, 6,2 millions vivent en<br />
Afrique subsaharienne et 75% d'entre eux sont des jeunes femmes en âge de procréer. Ce phénomène<br />
peut s’expliquer en partie par la précocité des rapports sexuels <strong>le</strong> plus souvent avec des partenaires<br />
masculins plus âgés. De plus, sur <strong>le</strong> plan biologique, la transmission du VIH s’opère plus faci<strong>le</strong>ment<br />
de l’homme <strong>à</strong> la femme que l’inverse (2). Tous ces éléments ont pour corollaire, un nombre important<br />
d’enfants qui s’infectent par <strong>le</strong> biais de <strong>le</strong>ur mère pendant la grossesse, l’accouchement et en<br />
postpartum par l’allaitement puisque <strong>le</strong> VIH est éga<strong>le</strong>ment transmissib<strong>le</strong> de la mère <strong>à</strong> l’enfant.<br />
La transmission de l’infection <strong>à</strong> VIH de la mère <strong>à</strong> l’enfant (TME) constitue ainsi la deuxième cause de<br />
contamination par <strong>le</strong> VIH après la transmission hétérosexuel<strong>le</strong> avec 2200 nouveaux cas d’infection<br />
pédiatrique chaque jour, dont 90% au moins sont <strong>le</strong> fait de la TME (1, 3). En 2003, environ 700000<br />
nouveaux cas d’infection pédiatrique sont survenus en Afrique subsaharienne (1, 3).<br />
Depuis 1990, de nombreuses études ont montré la preuve de l’efficacité des antirétroviraux (ARVs)<br />
dans la prévention de la TME (PTME) en réduisant de 2/3 cette transmission dans <strong>le</strong>s pays<br />
industrialisés (4, 5), mais aussi avec des régimes beaucoup plus courts et beaucoup plus simplifiés<br />
dans <strong>le</strong>s pays du sud. Ainsi, ces études ont montré en Afrique ou en Thaïlande, l’efficacité de la<br />
monothérapie courte par Zidovudine (ZDV), (6-8) de la Névirapine en monodose (NVP) (9, 10) et du<br />
Combivir ® (ZDV+lamivudine ou 3TC) administré en peripartum (10, 11).<br />
Les schémas thérapeutiques proposés après la conclusion de ces essais thérapeutiques, ont été assez<br />
rapidement utilisés dans <strong>le</strong>s programmes sur <strong>le</strong> terrain. Cependant, la mise en place des programmes<br />
opérationnels <strong>à</strong> large échel<strong>le</strong> s’effectue très <strong>le</strong>ntement dans bon nombre de pays en Afrique<br />
subsaharienne parce que <strong>le</strong> VIH/SIDA reste encore un sujet souvent tabou, une maladie très
21<br />
stigmatisée. De plus, il faut souligner une absence marquée de volonté politique pour faire face<br />
activement <strong>à</strong> cette pandémie.<br />
Dans ce con<strong>texte</strong>, en 2001, une Assemblée Généra<strong>le</strong> spécia<strong>le</strong> des Nations Unies s’est tenue sur <strong>le</strong> VIH,<br />
la première sur un sujet de santé dans l’histoire de l’ONU, et a lancé un appel clair en faveur de la lutte<br />
contre <strong>le</strong> VIH/SIDAen fixant ainsi pour objectif concret de réduire de 20%, la proportion d’enfants<br />
infectés en 2005 et de 50% en 2010 (12).<br />
Pour répondre <strong>à</strong> ce nouveau défi, et notamment pour rechercher des combinaisons thérapeutiques plus<br />
efficaces et des solutions plus appropriées, un nouveau programme d’étude a été mis en place <strong>à</strong><br />
Abidjan en Côte d’Ivoire qui est <strong>le</strong> pays où la préva<strong>le</strong>nce de l’infection <strong>à</strong> VIH est la plus é<strong>le</strong>vée en<br />
Afrique de l’Ouest et estimée entre 14% et 15% entre 1994 et 1998 (13-15).<br />
Ce projet avait pour but d’étudier un paquet d’interventions dirigées vers l’infection <strong>à</strong> VIH de la mère<br />
et de l’enfant en Afrique regroupant des interventions spécifiques en peripartum et postpartum pour<br />
des soins maternels et infanti<strong>le</strong>s. Quatre études ont ainsi été financées par l’Agence Nationa<strong>le</strong> de la<br />
Recherches sur <strong>le</strong> SIDA (ANRS). Il s’agit des projets ANRS 1201 (DITRAME-PLUS 1), ANRS 1202<br />
(DITRAME-PLUS 2), ANRS 1209 (DITRAME PLUS SAFE) et ANRS 1263 (DITRAME-PLUS<br />
VIRO) qui nous ont permis de répondre <strong>à</strong> plusieurs questions spécifiques sur la PTME depuis <strong>le</strong><br />
dépistage prénatal jusqu’aux interventions peripartum et postpartum en terminant par des études de<br />
tolérance et de résistance aux antirétroviraux.<br />
Ces études servent de base <strong>à</strong> la rédaction de cette thèse qui se décompose en six chapitres.<br />
Le chapitre 1 rappel<strong>le</strong> l’état des connaissances sur la transmission du VIH de la mère <strong>à</strong> l’enfant et sa<br />
prévention, et ceci depuis 1994 avec la première étude ACTG 076/ANRS 024 montrant l’efficacité<br />
d’un régime long de ZDV dans la PTME (4). Nous présentons tout d’abord une revue de la littérature<br />
scientifique sur la TME et sa prévention. Les différents essais thérapeutiques réalisés en Afrique et en<br />
Thaïlande jusqu’en 2004 et une synthèse sur <strong>le</strong>s données de résistances aux antirétroviraux utilisés<br />
pendant la grossesse sont exposés dans ce chapitre.<br />
Dans <strong>le</strong> chapitre 2 nous faisons un bref exposé sur <strong>le</strong> projet Ditrame Plus, en précisant <strong>le</strong>s conditions<br />
de sa mise en place avec la réalisation de deux études de base, puis une réf<strong>le</strong>xion sur l’obtention du<br />
consentement chez <strong>le</strong>s femmes enceintes participant au projet Ditrame Plus. Une étude spécifique a en<br />
effet été réalisée au sein de ce projet sur <strong>le</strong> consentement et sera décrite et positionnée dans <strong>le</strong> débat<br />
plus large sur <strong>le</strong> consentement des personnes participant <strong>à</strong> la recherche et sur l’éthique de la recherche<br />
médica<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s pays en développement.
22<br />
Le chapitre 3 présente <strong>le</strong>s résultats obtenus en terme d’acceptabilité du dépistage et des interventions<br />
médicamenteuses proposées dans <strong>le</strong> cadre du projet Ditrame Plus. Premièrement, nous présentons <strong>le</strong>s<br />
observations sur <strong>le</strong> dépistage prénatal de l’infection <strong>à</strong> VIH, réalisé avec des tests rapides. Après un<br />
rappel sur l’utilisation de ces tests, <strong>le</strong>ur performance incluant <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de qualité réalisé sur <strong>le</strong>s sites<br />
est décrite. Puis deux études spécifiques réalisées pour étudier l’acceptabilité des interventions de<br />
PTME seront rapportées.<br />
Le chapitre 4 présente une synthèse des bénéfices obtenus avec deux interventions ARV, la première<br />
est la combinaison d’un régime court de ZDV et d’une monodose de NVP en intrapartum<br />
(ZDV+NVPmd) et la deuxième est une combinaison d’un régime légèrement plus long de ZDV et<br />
3TC et d’une monodose de NVP en intrapartum (ZDV+3TC+NVPmd). Nous présentons ainsi dans ce<br />
chapitre, un exposé détaillé du protoco<strong>le</strong> de l’étude ANRS 1201, puis son dérou<strong>le</strong>ment et <strong>le</strong>s<br />
principaux résultats obtenus.<br />
Le chapitre 5 présente un aperçu des risques liés aux ARVs utilisés pour la PTME. Nous avons<br />
participé <strong>à</strong> une étude portant sur <strong>le</strong>s mutations de résistance aux ARVs notamment <strong>à</strong> la néviparine<br />
(NVP) chez <strong>le</strong>s mères et chez <strong>le</strong>s enfants infectés de notre série. Une étude spécifique chez <strong>le</strong>s enfants<br />
exposés aux inhibiteurs nucléosidiques (IN) tels que la ZDV et <strong>le</strong> 3TC avec <strong>le</strong> dosage des lactates<br />
sériques a été éga<strong>le</strong>ment réalisée afin de dépister <strong>le</strong> plus précocement possib<strong>le</strong> une éventuel<strong>le</strong> toxicité<br />
mitochondria<strong>le</strong> et d’estimer sa fréquence.<br />
Enfin, <strong>le</strong> chapitre 6 présente une discussion généra<strong>le</strong> sur <strong>le</strong>s spécificités de la PTME en Afrique, <strong>le</strong>s<br />
stratégies pouvant permettre une meil<strong>le</strong>ure acceptabilité des interventions de PTME. Une deuxième<br />
partie de la discussion porte sur <strong>le</strong>s régimes d’ARVs utilisés pour la réduction de la TME ainsi que sur<br />
<strong>le</strong> débat sur <strong>le</strong> choix entre l’utilisation d’une monothérapie et de combinaisons thérapeutiques. Avec<br />
<strong>le</strong>s données de résistances actuel<strong>le</strong>ment disponib<strong>le</strong>s dont cel<strong>le</strong>s rapportées dans cette thèse, il importe<br />
de discuter aussi de la réponse viro-immunologique aux traitements de l’adulte et notamment chez des<br />
femmes ayant reçu des inhibiteurs non nucléosidiques (INN) pendant <strong>le</strong>ur grossesse. Dans ce même<br />
chapitre, nous discutons éga<strong>le</strong>ment brièvement du risque de transmission postnata<strong>le</strong> après <strong>le</strong>s<br />
interventions de PTME peripartum. Enfin <strong>le</strong>s perspectives de santé publique ont été abordées dans <strong>le</strong><br />
chapitre 6 de cette thèse en présentant d’autres approches pour réduire de façon significative, <strong>le</strong><br />
nombre de nouveaux cas d’infection pédiatrique.<br />
Nous terminons par une conclusion généra<strong>le</strong> en discutant <strong>le</strong>s possibilités d’intégration des<br />
interventions de PTME issues des projets de recherche tels que <strong>le</strong> nôtre dans <strong>le</strong>s programmes existants<br />
de santé de la mère et de l’enfant dans <strong>le</strong>s pays <strong>à</strong> ressources limitées.<br />
.
23<br />
Chapitre 1<br />
La transmission du VIH-1 de la mère <strong>à</strong> son enfant en<br />
Afrique et sa prévention<br />
Etat des connaissances en 2004<br />
" Soyons clairs. Le SIDA est bien plus qu’une crise sanitaire :<br />
c’est la menace la plus grave qui n’ait jamais pesé sur <strong>le</strong> développement "<br />
Kofi Annan (Secrétaire Général des Nations Unies)<br />
Juil<strong>le</strong>t 2004, Bangkok, Thaïlande.
24<br />
1.1. Con<strong>texte</strong> général<br />
L'Afrique subaharienne est la région la plus touchée au monde par l'épidémie d'infection par <strong>le</strong> VIH.<br />
En 2003, <strong>le</strong> nombre de personnes vivant avec <strong>le</strong> VIH a été estimé <strong>à</strong> 25 millions dont 3 millions ayant<br />
contracté l'infection au cours de la dernière année écoulée (1). La préva<strong>le</strong>nce de l'infection <strong>à</strong> VIH-1 est<br />
très variab<strong>le</strong> dans cette région du monde et comprise entre 1% et 40% (1). On estime <strong>à</strong> 1,9 millions, <strong>le</strong><br />
nombre d'enfants de moins de 15 ans vivant avec cette infection sur <strong>le</strong> continent africain (1).<br />
La PTME reste une urgence de santé publique, avec 630 000 nouveaux cas d'infection pédiatrique<br />
observés en 2003 dans <strong>le</strong> monde (1). Plus de 90% de ces infections surviennent en Afrique<br />
subsaharienne (3). La TME constitue ainsi <strong>le</strong> mode d'acquisition quasi-exclusif de cette infection chez<br />
<strong>le</strong>s enfants (1, 3).<br />
La TME est plus que jamais une priorité de l'Organisation Mondia<strong>le</strong> de la Santé (OMS) et de<br />
l'Organisation des Nations Unies (ONU) et un des objectifs déclarés par l'ONU, lors de son assemblée<br />
généra<strong>le</strong> spécia<strong>le</strong> tenue en juin 2001, est de réduire la proportion d’enfants infectés de 20% en 2005 et<br />
de 50% en 2010 (12).<br />
Les résultats du premier essai thérapeutique publié en 1994 et conduit chez <strong>le</strong>s femmes enceintes<br />
infectées par <strong>le</strong> VIH-1 en France et aux Etats-Unis ont montré que la TME survenant dans un cas sur<br />
quatre en l'absence d'intervention peut être réduite de deux tiers dans ce con<strong>texte</strong>, par la prise d'une<br />
monothérapie antirétrovira<strong>le</strong> de ZDV par voie ora<strong>le</strong> pendant la grossesse et par voie intraveineuse<br />
pendant l'accouchement (4).<br />
Dans <strong>le</strong>s pays en voie de développement, et depuis 1999, il a éga<strong>le</strong>ment été démontré l'efficacité de la<br />
monothérapie antirétrovira<strong>le</strong> de ZDV dans <strong>le</strong>s populations pratiquant en majorité l'allaitement (6, 7,<br />
16). Ces premiers essais thérapeutiques de réduction de la TME avec des régimes simplifiés ont été<br />
des essais « classiques » avec la constitution de groupe de comparaison recevant un placebo (6, 7) ou<br />
des pseudo placebo (monodose de ZDV) comme dans l'essai HIVNET 012 (9).<br />
Cependant, <strong>le</strong> risque de transmission reste é<strong>le</strong>vé avec l’utilisation d’une monothérapie courte, en<br />
particulier chez <strong>le</strong>s femmes fortement immunodéprimées (8). On sait aussi que l'efficacité <strong>à</strong> long terme<br />
de la combinaison de ZDV+3TC, c’est-<strong>à</strong>-dire <strong>à</strong> 18 mois reste limitée (11).<br />
Ainsi, depuis 2002, avec <strong>le</strong>s résultats d’autres essais thérapeutiques réalisés en France et aux Etats-<br />
Unis ayant utilisé des combinaisons d’ARVs avec une efficacité tout <strong>à</strong> fait remarquab<strong>le</strong> dans la PTME<br />
(5, 17) de nouveaux essais ou cohortes thérapeutiques ont été mis en place en parallè<strong>le</strong> en Afrique
25<br />
subsaharienne pour tester l'efficacité des combinaisons d'ARVs plus simp<strong>le</strong> <strong>à</strong> manipu<strong>le</strong>r et de courte<br />
durée dans la PTME. Une des particularités de cette deuxième génération d’études est l'absence<br />
éventuel<strong>le</strong> de groupe de comparaison recevant un placebo remplacé par des groupes de contrô<strong>le</strong> issus<br />
des cohortes historiques ayant reçu un traitement antirétroviral de première génération, <strong>le</strong> plus souvent<br />
une monothérapie de ZDV. Ces essais peuvent donc être considérés aujourd'hui comme <strong>le</strong>s études de<br />
deuxième génération de la PTME en Afrique (18).<br />
Dans cette revue de la littérature, nous présentons après un bref rappel de l’histoire naturel<strong>le</strong> de la<br />
TME, <strong>le</strong>s avancées thérapeutiques réalisées dans <strong>le</strong> domaine de la PTME en Afrique, dix ans après la<br />
publication du tout premier essai et aussi <strong>le</strong>s données sur la résistance vira<strong>le</strong> <strong>à</strong> ces ARVs.<br />
1.2 . Moment de la transmission mère-enfant du VIH<br />
Le virus VIH de type 1 (VIH-1) se transmet pendant la grossesse (in utero), pendant l’accouchement<br />
(intrapartum) ou après la naissance (postnata<strong>le</strong>) par l’allaitement (19). Nous par<strong>le</strong>rons essentiel<strong>le</strong>ment<br />
de la transmission du VIH-1 car <strong>le</strong> VIH de type 2 a un très faib<strong>le</strong> potentiel de TME (20, 21). Le risque<br />
de TME du VIH-1 dans <strong>le</strong>s populations pratiquant en majorité l'allaitement est estimé entre 25% et<br />
48% (22).<br />
Le tab<strong>le</strong>au 1 présente <strong>le</strong>s proportions et <strong>le</strong>s risques absolus d’acquisition de l'infection <strong>à</strong> VIH de la<br />
mère <strong>à</strong> l'enfant selon la période et en fonction de la pratique ou non d'allaitement.<br />
Tab<strong>le</strong>au 1. Risque absolu et proportion de la transmission du VIH-1 de la mère <strong>à</strong> son enfant en<br />
fonction du moment (Adapté de De Cock, JAMA 2000) (22).<br />
Moment de la transmission<br />
Pas d'allaitement<br />
Allaitement maternel<br />
Risque Absolu Proportion Risque Absolu Proportion<br />
In Utero 5-10% 33% 5-10% 20%<br />
Intrapartum 10-20% 67% 10-20% 40%<br />
Postpartum - - 10-15% 40%<br />
Total 15-30% 100% 25-45% 100%
26<br />
• La transmission in utero (pendant la grossesse)<br />
El<strong>le</strong> représente 25 <strong>à</strong> 40% des cas d'infection pédiatrique en l'absence d'allaitement et un cinquième des<br />
cas au moins en proportion dans <strong>le</strong>s populations allaitées. Cette transmission peut être précoce (début<br />
de grossesse) dans 2 <strong>à</strong> 5% des cas, mais el<strong>le</strong> est <strong>le</strong> plus souvent tardive et survient plutôt en fin de<br />
grossesse. La transmission in utero du VIH-1 se fait probab<strong>le</strong>ment par voie transplacentaire ou par<br />
ingestion de liquide amniotique infecté (23-25).<br />
• La transmission peripartum (pendant l’accouchement)<br />
El<strong>le</strong> représente 60 <strong>à</strong> 75% des cas d'infection pédiatrique chez <strong>le</strong>s enfants infectés en l'absence<br />
d'allaitement et probab<strong>le</strong>ment deux cas sur cinq dans <strong>le</strong>s populations allaités. Plusieurs hypothèses<br />
peuvent expliquer cette transmission au moment de l’accouchement ; soit une infection après la<br />
rupture des membranes ou une infection par contact direct du nouveau-né avec <strong>le</strong> sang maternel ou <strong>le</strong>s<br />
sécrétions cervico-vagina<strong>le</strong>s ou encore une infection par microtransfusion du sang maternel vers <strong>le</strong><br />
sang fœtal pendant <strong>le</strong>s contractions utérines (26). La transmission peut aussi se faire par voie ora<strong>le</strong> par<br />
ingestion de particu<strong>le</strong>s vira<strong>le</strong>s par <strong>le</strong> nouveau-né au moment de l’accouchement (27).<br />
• La transmission postpartum par l’allaitement<br />
El<strong>le</strong> représente près de la moitié du total de la TME (28). Ce mode d’acquisition de l’infection<br />
commence dès <strong>le</strong> début de l’allaitement. Plus l’allaitement est prolongé, plus <strong>le</strong> risque de transmission<br />
du VIH de la mère <strong>à</strong> l’enfant est é<strong>le</strong>vé. Une étude réalisée au Malawi a évalué <strong>à</strong> 1% <strong>le</strong> risque<br />
additionnel par mois pendant <strong>le</strong>s six premiers mois d’allaitement, suivi d’un risque inférieur ou égal <strong>à</strong><br />
0,5% aux stades plus tardifs de la lactation (29). Le risque absolu de transmission due <strong>à</strong> l’allaitement<br />
maternel est estimé <strong>à</strong> 16,2% <strong>à</strong> partir d’une étude randomisée réalisée <strong>à</strong> Nairobi au Kenya et <strong>le</strong> risque<br />
attribuab<strong>le</strong> <strong>à</strong> 44% (30).<br />
Dans une récente méta-analyse réalisée incluant neuf essais thérapeutiques d’intervention peripartum<br />
en Afrique et disposant de données de suivi <strong>à</strong> long terme avec 4085 enfants allaités inclus, <strong>le</strong> risque<br />
cumulé de transmission postnata<strong>le</strong> était estimé <strong>à</strong> 8,9%, IC95% [8,2-10,7%] pour 100 enfants-année.<br />
Cette étude montrait éga<strong>le</strong>ment que la transmission postnata<strong>le</strong> représentait 42% des cas de TME. (31).<br />
La probabilité de transmission estimée <strong>à</strong> 18 mois était de 9,3%, avec de fortes différences selon l’état<br />
immunitaire maternel (31).<br />
La transmission du VIH-1 par l'allaitement est manifestement facilitée si la mère acquiert l'infection<br />
alors qu'el<strong>le</strong> allaite. Cette transmission, en cas de primo-infection, a été mise en évidence pour la<br />
première fois dans une étude de cohorte menée <strong>à</strong> Kigali au Rwanda entre 1988 et 1991 (32). La charge<br />
vira<strong>le</strong> circulante dans <strong>le</strong>s six semaines suivant l'infection est 10 <strong>à</strong> 200 fois supérieure <strong>à</strong> cel<strong>le</strong> mesurée<br />
quand l'infection est passée <strong>à</strong> la chronicité expliquant ainsi une transmission é<strong>le</strong>vée en cas d'infection<br />
primaire (32).
27<br />
La transmission par l’allaitement chez des mères en phase chronique d'infection a été plus diffici<strong>le</strong> <strong>à</strong><br />
démontrer <strong>à</strong> cause des difficultés méthodologiques <strong>à</strong> diagnostiquer une infection <strong>à</strong> VIH précoce chez<br />
<strong>le</strong> nouveau-né et <strong>le</strong> jeune enfant <strong>à</strong> cause de la présence des anticorps maternels dans <strong>le</strong> sang du fœtus<br />
(33). C’est avec la mise au point de la technique de la Polymerase Chain Reaction (PCR) suppléant la<br />
culture vira<strong>le</strong>, trop comp<strong>le</strong>xe <strong>à</strong> mettre en œuvre <strong>à</strong> large échel<strong>le</strong>, qu’on a pu caractériser <strong>le</strong>s enfants<br />
infectés précocement et ceux qui étaient encore <strong>à</strong> risque d’acquisition d’une infection postnata<strong>le</strong> (34-<br />
39).<br />
Le tab<strong>le</strong>au 2 synthétise la manière d’estimer <strong>le</strong> moment de la TME <strong>à</strong> l’aide des tests de mise en<br />
évidence directe du virus par la culture de la charge vira<strong>le</strong> ou plus fréquemment par la technique de<br />
PCR (40-42).<br />
Tab<strong>le</strong>au 2. Estimation du moment d’acquisition de l'infection <strong>à</strong> VIH-1 de la mère <strong>à</strong> son enfant en<br />
fonction des résultats des tests virologiques (culture vira<strong>le</strong> ou PCR ADN ou ARN).<br />
< J5 J5 – J45 >=J45<br />
In utero + + +<br />
Intrapartum - + +<br />
Postpartum - - +<br />
Le virus VIH de type 2 (VIH-2) a un très faib<strong>le</strong> potentiel de TME (20) et ne nécessite pas de mesures<br />
prophylactiques spécifiques sauf en cas d’infection dua<strong>le</strong> VIH-1+2, une situation assez fréquente en<br />
Afrique de l’Ouest. Il existe peu de données sur la transmission de ce type de virus de la mère <strong>à</strong><br />
l’enfant. Une étude récente de la cohorte pédiatrique française a estimé que <strong>le</strong> diagnostic est<br />
actuel<strong>le</strong>ment possib<strong>le</strong> par la technique de PCR en temps réel. Ainsi, <strong>le</strong> taux cumulé de TME est estimé<br />
<strong>à</strong> 0,5% (1/204, IC95% [0-1,5%]) (21).
1.3. Les facteurs associés <strong>à</strong> la transmission de l'infection <strong>à</strong> VIH de la mère<br />
<strong>à</strong> l’enfant<br />
28<br />
Les facteurs pouvant expliquer la survenue d'une TME sont multip<strong>le</strong>s et dépendent du type et du<br />
moment de la transmission. Mais la charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> est <strong>le</strong> facteur <strong>le</strong> plus constamment<br />
retrouvé indépendamment de tout autre facteur.<br />
1.3.1 Facteurs maternels<br />
1.3.1.1. Caractéristiques démographiques et comportements <strong>à</strong> risque<br />
La race, l'ethnie et la parité ne sont pas des facteurs associés <strong>à</strong> la TME (43-45).<br />
L'utilisation de drogues illicites (44, 45) et <strong>le</strong> tabagisme durant la grossesse sont associés <strong>à</strong> un<br />
accroissement du risque de TME. Certaines drogues comme la cocaïne et l'héroïne augmentent la<br />
réplication vira<strong>le</strong> in vitro (44). L'usage des drogues pourrait accentuer la TME par la diminution des<br />
défenses immunes maternel<strong>le</strong>s.<br />
Les comportements sexuels <strong>à</strong> risque au cours de la grossesse sont associés <strong>à</strong> un risque accru de TME<br />
(46-48).<br />
L'état de santé maternel<strong>le</strong> est un important facteur de risque de TME, qu'il soit mesuré cliniquement<br />
(classification OMS ou CDC) ou par des marqueurs immuno-virologiques (numération des CD4,<br />
pourcentage des CD4 et charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>) (8, 11).<br />
1.3.1.2 Facteurs virologiques et immunologiques<br />
• La charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong><br />
La charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>, mesurée par <strong>le</strong> nombre de copies d'ARN viral dans <strong>le</strong> plasma et <strong>le</strong> sérum<br />
est <strong>le</strong> facteur <strong>le</strong> plus déterminant de la transmission materno-fœta<strong>le</strong>. Plus la charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong><br />
est é<strong>le</strong>vée, plus <strong>le</strong> risque de TME est é<strong>le</strong>vé sans qu’il soit possib<strong>le</strong> d’identifier un seuil (49-51).<br />
Cependant, la charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> <strong>à</strong> el<strong>le</strong> seu<strong>le</strong> n'explique pas l'ensemb<strong>le</strong> du risque de TME. En<br />
effet, des mères avec des niveaux de charge vira<strong>le</strong> très é<strong>le</strong>vés ne transmettent pas <strong>le</strong> virus <strong>à</strong> <strong>le</strong>ur enfant.<br />
Ainsi, il n'y a pas de seuil de charge vira<strong>le</strong> plasmatique maternel<strong>le</strong> clairement défini <strong>à</strong> partir duquel <strong>le</strong><br />
risque de transmission est certain.
29<br />
La charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> mesurée <strong>à</strong> l'inclusion, avant <strong>le</strong> début du traitement antirétroviral a été<br />
<strong>le</strong> plus souvent retrouvée associée <strong>à</strong> la TME chez <strong>le</strong>s femmes incluses dans l’essai HIVNET 012<br />
avec un risque relatif (RR) de deux (IC95% [1,6-2,7]) pour toute augmentation d'un log de charge<br />
vira<strong>le</strong> (9).<br />
Dans l'essai SAINT, l'odds ratio était estimé <strong>à</strong> trois environ (IC95% [1,8-4,8]) pour toute<br />
augmentation d'un log de CV <strong>à</strong> l’inclusion pour la TME in utero et <strong>à</strong> trois éga<strong>le</strong>ment (IC95% [1,4-<br />
6,4]) pour toute augmentation d'un log de CV pour la TME intrapartum <strong>à</strong> S4 (10).<br />
Dans l'essai NVAZ, <strong>le</strong> RR de TME a été estimé <strong>à</strong> 3,2 (IC95% [2,1-4,6]) pour toute augmentation<br />
d'un log de charge vira<strong>le</strong> (49).<br />
• Les lymphocytes CD4+ maternels (CD4)<br />
L’état immunologique de la mère déterminé par la quantification des CD4 est éga<strong>le</strong>ment un<br />
facteur très fortement associé <strong>à</strong> la TME. Dans l’essai PETRA, <strong>le</strong>s CD4 é<strong>le</strong>vés étaient associés <strong>à</strong> un<br />
faib<strong>le</strong> risque de transmission materno-foeta<strong>le</strong> (OR=0,9 ; IC95% [0,8-0,9]) pour chaque<br />
augmentation de 100 CD4. (11).<br />
Dans presque tous <strong>le</strong>s essais, <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> des CD4 maternels sur la TME a pu être étudié, sauf pour<br />
l'étude KZT réalisée <strong>à</strong> Abidjan, Côte d'Ivoire. Toutes ces études ont montré une relation entre <strong>le</strong>s<br />
CD4 et la TME. Dans <strong>le</strong>s essais DITRAME et HIVNET 012, on note pour toute diminution de 100<br />
cellu<strong>le</strong>s de CD4, un OR estimé <strong>à</strong> 1,2 (IC95% [1,1-1,3]) et <strong>à</strong> 1,3 (IC95% [1,2-1,4]) respectivement<br />
(6, 9).<br />
Aussi Leroy et al montraient que <strong>le</strong> risque cumulé de TME <strong>à</strong> 24 mois chez <strong>le</strong>s enfants nés de mère<br />
ayant reçu de la ZDV pour la PTME était de 0,40 chez <strong>le</strong>s mères ayant des CD4=500/mm3.<br />
Dans l’essai SAINT, <strong>le</strong> niveau des CD4 était éga<strong>le</strong>ment associé au risque de TME avec un OR de<br />
0,6 (IC95% [0,4-0,9]) pour toute augmentation de 100 cellu<strong>le</strong>s de CD4 (11).<br />
.
30<br />
1.3.2 Facteurs liés au fœtus<br />
• Poids de naissance et prématurité<br />
Un petit poids de naissance défini comme un enfant né vivant pesant moins de 2500g (43, 52) et la<br />
prématurité définie comme tout accouchement avant la 37 ème semaine d’aménorrhée (52) sont des<br />
facteurs associés <strong>à</strong> une augmentation du risque de TME.<br />
• Gémellité<br />
La gémellité est aussi un facteur de risque de TME d’après <strong>le</strong>s premières études observationnel<strong>le</strong>s.<br />
Ainsi, <strong>le</strong> premier jumeau aurait un risque deux fois plus é<strong>le</strong>vé d’être infecté que <strong>le</strong> second jumeau<br />
et ceci, que l'accouchement se fasse par voie vagina<strong>le</strong> ou par césarienne (53). Une étude récente<br />
réalisée chez 315 paires de jumeaux au Malawi montrait cependant que <strong>le</strong> risque de transmission<br />
in utero est similaire chez <strong>le</strong> premier et <strong>le</strong> deuxième jumeau avec un taux de TME estimée <strong>à</strong> 6,3%<br />
pour <strong>le</strong> premier jumeau et 6,0% pour <strong>le</strong> second jumeau. Il en était de même pour la transmission<br />
peripartum (15,9% pour <strong>le</strong> premier jumeau et 18,7% pour <strong>le</strong> deuxième jumeau) (54). Aucun effet<br />
n'a été retrouvé non plus pour la transmission postnata<strong>le</strong>. Pour Biggar et al, ces résultats récents<br />
contrastent par rapport aux premières publications et montrent ainsi que l'ordre de naissance n'est<br />
pas un facteur déterminant associé <strong>à</strong> la TME chez <strong>le</strong>s jumeaux (54).<br />
1.3.3 Facteurs obstétricaux<br />
• Rupture prématurée des membranes<br />
Dans l'essai DITRAME, la rupture prématurée des membranes supérieure <strong>à</strong> quatre heures était<br />
associée <strong>à</strong> la TME avec un RR de 1,9 (IC95% [1,2-3,2]) (6). On note dans l'étude de TAHA une<br />
tendance <strong>à</strong> la signification avec un OR estimé <strong>à</strong> 1,9 (IC95% [0,9-3.9], p=0,07) (49). L’essai<br />
SAINT n'a retrouvé aucune association entre la rupture prématurée des membranes et la TME<br />
(10).<br />
• Césarienne<br />
Presque toutes <strong>le</strong>s études réalisées en Afrique n'ont pas trouvé d'association entre la césarienne et<br />
la TME (6, 9, 10), sauf l'essai PETRA où 33% des femmes avaient une indication de césarienne.<br />
Cette étude montrait que la césarienne était un facteur de réduction de la TME avec un OR de 0,6<br />
(IC95% [0,4-0,9]) (11). Dans cette étude cependant, entre 68 et 76% des césariennes étaient des<br />
césariennes d'urgence.
31<br />
L'effet protecteur de la césarienne avant <strong>le</strong> début du travail a été montré dans plusieurs études. Une<br />
méta-analyse de 15 études prospectives réalisées en Europe et en Amérique du Nord a montré que<br />
la césarienne réduisait de 50% <strong>le</strong> risque de TME comparativement aux autres modalités<br />
d’accouchement (OR=0,4 ; IC95% [0,3-0,6]) (55). Ces résultats ont été confirmés par <strong>le</strong>s données<br />
d’un essai randomisé. Le taux de transmission était ainsi de 1,8% (3/170/ chez <strong>le</strong>s femmes qui ont<br />
eu une césarienne et de 10,5% (21/200) chez <strong>le</strong>s femmes qui ont accouché par voie basse<br />
(p
32<br />
1.3.4 Facteurs liés <strong>à</strong> la transmission postpartum<br />
• Modalités d’alimentation<br />
Il est vraisemblab<strong>le</strong> que des pratiques différentes d'allaitement soient associées <strong>à</strong> des risques<br />
différents de transmission. Coustoudis et al ont montré que <strong>le</strong> taux de transmission du VIH-1 de la<br />
mère <strong>à</strong> son enfant est inférieur chez des enfants allaités exclusivement au sein (19,4%)<br />
comparativement aux enfants sous allaitement mixte (26,1%) (59). Cette différence peut<br />
s'expliquer sur <strong>le</strong> plan biologique puisque l'allaitement exclusif au sein semb<strong>le</strong> apporter une<br />
protection maxima<strong>le</strong> des muqueuses de l'enfant par <strong>le</strong>s anticorps maternels contenus dans <strong>le</strong> lait.<br />
Cette protection pourrait donc être érodée par l'introduction d’aliments autres que <strong>le</strong> lait maternel<br />
(59).<br />
• Charge vira<strong>le</strong><br />
Une charge vira<strong>le</strong> décelab<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> lait maternel et dans <strong>le</strong> plasma est un facteur très corrélé <strong>à</strong> la<br />
transmission postpartum par <strong>le</strong> lait maternel. On sait aussi que la charge vira<strong>le</strong> plasmatique<br />
maternel<strong>le</strong> est très corrélée <strong>à</strong> la charge vira<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> lait (60). Dans l'analyse poolée de deux<br />
essais réalisés en Afrique de l'Ouest, la charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> était associée <strong>à</strong> la TME par <strong>le</strong> lait<br />
maternel avec un RR en analyse multivariée de 2,6 (IC95% [1,8-4,0] pour toute augmentation d'un<br />
log de charge vira<strong>le</strong> (61).<br />
• CD4 maternels<br />
L’état de la mère mesuré par <strong>le</strong>s CD4 joue un rô<strong>le</strong> prépondérant dans la transmission par <strong>le</strong> lait<br />
maternel (31, 61). Le risque de transmission postnata<strong>le</strong> en Afrique de l’Ouest, en analyse<br />
multivariée est en moyenne trois fois plus é<strong>le</strong>vé chez <strong>le</strong>s femmes ayant des CD4=500/mm 3 (61). Une métaanalyse<br />
réalisée en Afrique a aussi montré que <strong>le</strong> risque de transmission postnata<strong>le</strong> était<br />
significativement plus é<strong>le</strong>vé chez <strong>le</strong>s enfants nés de mères infectées par <strong>le</strong> VIH et ayant des CD4<br />
très bas (31).<br />
• Mastites subcliniques et cliniques<br />
Les femmes qui avaient des mastites cliniques et subcliniques détectées biologiquement par <strong>le</strong><br />
dosage du sodium dans <strong>le</strong> lait maternel avaient une charge vira<strong>le</strong> augmentée dans <strong>le</strong> lait et<br />
transmettaient davantage <strong>le</strong> VIH-1 <strong>à</strong> <strong>le</strong>ur enfant (51, 60, 62), de même que cel<strong>le</strong>s qui présentaient<br />
des lésions du mamelon (51) ou un abcès mammaire (62).
33<br />
• Sexe de l’enfant<br />
Une récente méta-analyse a montré que <strong>le</strong> sexe de l’enfant était associé <strong>à</strong> la transmission<br />
postnata<strong>le</strong> par <strong>le</strong> lait maternel. Les garçons sont plus susceptib<strong>le</strong>s d’être infectés que <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s.<br />
L’odds ratio chez <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s était estimé <strong>à</strong> 0,7, (IC95% [0,5-0,9]). (31).<br />
• Déficit en vitamine A<br />
La présence de cellu<strong>le</strong>s infectées par <strong>le</strong> VIH-1 dans <strong>le</strong> lait était associée selon une relation de type<br />
dose/réponse <strong>à</strong> une déficience maternel<strong>le</strong> en vitamine A (63). Les mêmes observations ont été<br />
rapportées dans une étude au Malawi. Cette dernière étude associait <strong>le</strong> risque de TME <strong>à</strong> cette<br />
même déficience maternel<strong>le</strong> en vitamine A (64). Les effets de la vitamine A sur la réponse<br />
immunitaire et la protection de l'intégrité des surfaces muqueuses pourraient expliquer cette<br />
association lorsqu’un déficit est installé.<br />
Très récemment, une autre étude réalisée par l'équipe de Fawzi et al, en Tanzanie montrait qu'une<br />
supplémentation en vitamine A entraînait cependant une augmentation de la TME par l'allaitement<br />
avec un RR de 1,4 (IC95% [1,1-1,8], p = 0,009) (65).<br />
Le tab<strong>le</strong>au 4 récapitu<strong>le</strong> la liste des facteurs qui jouent un rô<strong>le</strong> déterminant dans la TME postnata<strong>le</strong><br />
Tab<strong>le</strong>au 4. Facteurs associés <strong>à</strong> la transmission du VIH-1 de la mère <strong>à</strong> son enfant par<br />
l'allaitement (Source groupe de Ghent, Février 2003 (66)).<br />
Mère<br />
• Charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> é<strong>le</strong>vée dans <strong>le</strong> lait<br />
• Charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> é<strong>le</strong>vée dans <strong>le</strong> plasma<br />
• Stade clinique et/ou immunologique avancé de la maladie VIH (Nombre bas de CD4)<br />
• Pathologie mammaire (Mastite clinique et sub-clinique, abcès, crevasses mamelonnaires)<br />
• Facteurs immuns locaux présents dans <strong>le</strong> lait maternel<br />
Enfant<br />
• Charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> é<strong>le</strong>vée dans <strong>le</strong> lait<br />
• Modalité d’alimentation (alimentation mixte)<br />
• Maladie de l’enfant entraînant une faib<strong>le</strong> succion du lait et une stase du lait maternel
34<br />
1.4. Antirétroviraux utilisés dans la PTME<br />
Les ARVs utilisés pour la PTME sont très limités en nombre dans <strong>le</strong>s pays <strong>à</strong> ressources limitées. On<br />
ne dénombre que trois ARVs utilisés dans des régimes courts ou ultracourts: la zidovudine (Retrovir ® ),<br />
la Névirapine ou NVP (Viramune ® ) et la lamivudine ou 3TC (Epivir ® )<br />
Ces ARVs sont utilisés seuls en monothérapie (6-8, 10) <strong>le</strong> plus souvent en prepartum ou uniquement<br />
en intrapartum (9) ou en association comme <strong>le</strong> Combivir ® (ZDV+3TC) (10, 11).<br />
Des études pharmacocinétiques ont été réalisées chez <strong>le</strong>s femmes enceintes pour connaître l'intérêt<br />
d'utiliser <strong>le</strong>s inhibiteurs de protéase (IP) pour la prévention de la TME. On sait ainsi qu'on observe une<br />
induction du métabolisme de l'indinavir pendant la grossesse (67). Par contre, aucun effet n'a été<br />
retrouvé avec <strong>le</strong> nelfinavir, avec des résultats très variab<strong>le</strong>s d'un patient <strong>à</strong> un autre (67). Il en est de<br />
même pour <strong>le</strong> ritonavir (68). Aucune donnée n’est disponib<strong>le</strong> pour l’amprenavir, ni pour l’association<br />
lopinavir-ritonavir, ni pour l’azatanavir. On sait éga<strong>le</strong>ment que <strong>le</strong>s concentrations plasmatiques des IP<br />
peuvent fluctuer de façon importante lors du 3 ème trimestre de la grossesse justifiant la pratique du<br />
dosage des IP (68).<br />
Chez <strong>le</strong>s nouveaux-nés, <strong>le</strong>s mêmes ARVs sont utilisés <strong>à</strong> des posologies adaptées en fonction du poids<br />
de l'enfant ou de la surface corporel<strong>le</strong>. Chez <strong>le</strong> nouveau-né, il s'agit ainsi de réaliser une couverture<br />
postnata<strong>le</strong> en monodose <strong>à</strong> J2 par la NVP (9) ou un traitement d'une semaine comme dans l'essai<br />
PETRA avec de la ZDV+3TC (11). Très récemment dans l'essai SIMBA, un traitement par la NVP ou<br />
<strong>le</strong> 3TC a été utilisé pendant six mois de vie chez <strong>le</strong>s enfants pendant la période d’exposition au lait<br />
maternel pour prévenir la transmission postnata<strong>le</strong> (69).<br />
1.4.1 Les essais thérapeutiques et <strong>le</strong>s cohortes thérapeutiques en Afrique<br />
Les premiers essais thérapeutiques réalisés en Afrique ont été des essais thérapeutiques avec la<br />
constitution de groupes de comparaison recevant du placebo (6, 7, 11). Dès la publication des premiers<br />
résultats d’un essai comparab<strong>le</strong> en Thaïlande, <strong>le</strong>s groupes placebo ont été arrêtés dans tous <strong>le</strong>s essais<br />
africains en février 1998 (16). Par contre, l’essai HIVNET 012 a utilisé un pseudo placebo constitué de<br />
ZDV administré en monodose en intrapartum pour étudier l’efficacité et la tolérance de la NVP (9).<br />
Les tab<strong>le</strong>aux 5a et 5b présentent <strong>le</strong>s interventions d’ARVs utilisées au cours des essais réalisés en<br />
Afrique. Les données des essais réalisés en Thaïlande avec une alimentation artificiel<strong>le</strong> prédominante<br />
sont présentées dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 6.<br />
On distingue <strong>le</strong>s prophylaxies en monodose (ZDV ou NVP) et <strong>le</strong>s bithérapies (ZDV+3TC, ou<br />
ZDV+NVP ou ZDV+Didanosine) (11, 69, 70).
Tab<strong>le</strong>au 5a. Description des essais thérapeutiques de première génération étudiant la prévention de la TME du VIH en Afrique.<br />
35<br />
Nom de l’étude Prepartum Intrapartum Postpartum<br />
(mère)<br />
Prophylaxie<br />
néonata<strong>le</strong><br />
Groupe<br />
Placebo<br />
Essai DITRAME ANRS 049<br />
ZDV (36 ème SA)<br />
ZDV<br />
ZDV (1 semaine)<br />
Oui<br />
Côte d'Ivoire (1995 – 1998)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
600 mg per os<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
(6)<br />
Essai CDC (7)<br />
ZDV (36 ème SA)<br />
ZDV<br />
Oui<br />
Côte d'Ivoire (1996 – 1998)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
300 mg per os / 3 h<br />
Essai HIVNET 012 (9)<br />
Ouganda (1997 – 1999)<br />
NVP<br />
200mg per os<br />
- NVP : 2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J3<br />
Mère : ZDV intrapartum<br />
(600 mg + 300mg/3h +<br />
Enfant ZDV : 4 mg/kg/ x 2/j<br />
(une semaine)<br />
Essai PETRA (11)<br />
ZDV + 3TC (36 ème SA)<br />
ZDV 300 mg per os / 3 h<br />
ZDV + 3TC (1 semaine)<br />
ZDV + 3TC (1 semaine)<br />
Oui<br />
Afrique du Sud<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
3TC 150 mg per os / 12 h<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV : 4 mg/kg/ x 2/j<br />
Ouganda<br />
150 mg 3TC per os x 2<br />
150 mg 3TC per os x 2<br />
3TC : 2 mg/kg/ x 2/j<br />
Tanzanie<br />
1996 - 2000<br />
ZDV 300 mg per os / 3 h<br />
3TC 150 mg per os / 12 h<br />
ZDV + 3TC (1 semaine)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV + 3TC (1 semaine)<br />
ZDV : 4 mg/kg/ x 2/<br />
150 mg 3TC per os x 2<br />
3TC : 2 mg/kg/ x 2/j<br />
ZDV 300 mg per os / 3 h<br />
3TC 150 mg per os / 12 h<br />
Essai SAINT (10)<br />
ZDV 300 mg per os / 3 h<br />
ZDV + 3TC (1 semaine)<br />
ZDV + 3TC (1 semaine)<br />
Non<br />
Afrique du Sud (1999 – 2000)<br />
3TC 150 mg per os / 12 h<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV : 4 mg/kg/ x 2/j<br />
150 mg 3TC per os x 2<br />
3TC : 2 mg/kg/ x 2/j<br />
NVP<br />
200mg per os<br />
NVP : 200mg per os<br />
(24-48 heures)<br />
NVP<br />
2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2
Tab<strong>le</strong>au 5b. Description des essais thérapeutiques évaluant des régimes antirétroviraux pour la prévention de la transmission de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 en<br />
Afrique.<br />
36<br />
Nom de l’étude<br />
Traitement<br />
Prepartum<br />
Traitement<br />
Intrapartum<br />
Traitement<br />
Postpartum<br />
Traitement<br />
Postnatal<br />
Groupe<br />
Placebo<br />
Essai SIMBA (69)<br />
Ouganda, Rwanda (2001)<br />
ZDV + DDI (36 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV + DDI<br />
ZDV + DDI (1 semaine)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
3TC sirop : naissance jusqu’<strong>à</strong> un mois<br />
après l’arrêt de l’allaitement maternel.<br />
2mg /kg/ x 2 (J0 – J30)<br />
Non<br />
4 mg/kg/x 2 (>=J30)<br />
Essai TAHA (NVAZ-1) (49)<br />
Malawi (2000 – 2002)<br />
ZDV + DDI (36 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV + DDI<br />
ZDV + DDI (1 semaine)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
NVP sirop : Naissance jusqu’<strong>à</strong> un<br />
mois après l’arrêt de l’allaitement<br />
2mg /kg/ x 1 (J0 – J14)<br />
2 mg/kg/x 2 (>=J14)<br />
- - - ZDV sirop (1 semaine) : 4 mg/kg/ x 2<br />
NVP : 2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2<br />
- - - NVP : 2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2<br />
Non<br />
Essai TAHA (NVAZ-2) (71)<br />
Malawi (2000 – 2003)<br />
- NVP<br />
200mg per os<br />
- NVP<br />
200mg per os<br />
- ZDV sirop (1 semaine) : 4 mg/kg/ x 2<br />
NVP : 2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2<br />
- NVP : 2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2
Tab<strong>le</strong>au 6. Description des essais thérapeutiques réalisés en Thaïlande pour l’étude de la TME du VIH.<br />
37<br />
Nom et<br />
Période de l’étude<br />
Prepartum Intrapartum Postpartum (mère) Prophylaxie<br />
néonata<strong>le</strong><br />
Groupe<br />
Placebo<br />
Essai CDC (16)<br />
(1996-1997)<br />
ZDV (36 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV 300 mg per os / 3<br />
heures<br />
- Oui<br />
Essai PHPT-1(72)<br />
(1997-1999)<br />
ZDV (28 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV 300 mg per os / 3<br />
heures<br />
- ZDV sirop (6 semaines)<br />
2 mg/kg/ x 4<br />
Non<br />
ZDV (35 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV 300 mg per os / 3<br />
heures<br />
-<br />
- ZDV sirop (3 jours)<br />
2 mg/kg/ x4<br />
ZDV (35 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV : 300 mg per os / 3<br />
heures<br />
-<br />
- ZDV sirop (6 semaines)<br />
2 mg/kg/ x4<br />
Essai PHPT-2 (70)<br />
(2001 – 2003)<br />
ZDV (28 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV : 300 mg per os / 3<br />
heures<br />
NVP 200mg per os<br />
- ZDV sirop: 2 mg/kg/ x 4)<br />
(1 semaine ou 4-6 semaines si<br />
traitement maternel < 4 semaines :<br />
Non<br />
NVP : 2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2<br />
ZDV (28 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV : 300 mg per os / 3<br />
heures<br />
NVP 200mg per os<br />
- ZDV sirop : 2 mg/kg/ x 4)<br />
(1 semaine) ou 4-6 semaines si<br />
traitement maternel < 4 semaines :<br />
ZDV (28 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
ZDV : 300 mg per os / 3<br />
heures<br />
- ZDV sirop : 2 mg/kg/ x 4)<br />
(1 semaine) ou 4-6 semaines si<br />
traitement maternel < 4 semaines<br />
PHPT (Perinatal HIV Prevention Trial)
1.5 Efficacité des régimes antirétroviraux pour la PTME dans <strong>le</strong>s pays <strong>à</strong><br />
ressources limitées<br />
38<br />
1.5.1 Efficacité <strong>à</strong> court terme<br />
1.5.1.1 Transmission in utero et intrapartum<br />
L'efficacité des différents régimes d'ARVs précédemment détaillés a été évaluée <strong>à</strong> partir des essais<br />
thérapeutiques avec des groupes placebo comme groupe de référence. Les résultats en matière de taux<br />
de transmission peripartum des ARVs sont résumés sur la figure 1.<br />
Dans l'essai KZT-RETROCI <strong>à</strong> Abidjan, on note un taux de transmission de 24,9% dans <strong>le</strong> groupe<br />
placebo contre 15,7% dans <strong>le</strong> groupe recevant la ZDV (7) alors que l'essai ANRS 049 DITRAME avec<br />
une intervention postpartum d'une semaine en plus notait une TME de 21,8% dans <strong>le</strong> groupe placebo<br />
contre 15,1% dans <strong>le</strong> groupe ZDV (6). L'efficacité relative de ces interventions <strong>à</strong> base de ZDV par<br />
rapport au groupe placebo a été décrite dans ces différents essais. El<strong>le</strong> était de 50% en Thaïlande en<br />
absence d'allaitement maternel (16), de 37% <strong>à</strong> trois mois de vie dans l'essai KZT <strong>à</strong> Abidjan (7) et de<br />
38% <strong>à</strong> 6 mois dans l'essai ANRS 049 DITRAME réalisé en Côte d'Ivoire et au Burkina-Faso (6).<br />
Dans l’'essai HIVNET 012 réalisé en Ouganda, <strong>le</strong> taux de TME était estimé <strong>à</strong> 11,9% <strong>à</strong> S6-S8 dans <strong>le</strong><br />
groupe traité par la NVP monodose et <strong>à</strong> 21,3% dans <strong>le</strong> groupe ayant reçu un traitement par la ZDV en<br />
intrapartum (p=0,0027) (9).<br />
Dans l'essai PETRA qui a été réalisé en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Ouganda, et ayant utilisé<br />
une association de ZDV+3TC, une réduction substantiel<strong>le</strong> de la TME du VIH-1 a éga<strong>le</strong>ment été notée<br />
chez <strong>le</strong>s patients inclus dans <strong>le</strong> bras long débuté <strong>à</strong> la 36 ème SA, plus un traitement intrapartum et une<br />
semaine de traitement postpartum (tab<strong>le</strong>au 5a). Le risque relatif était ainsi estimé <strong>à</strong> 0,4 (IC95% [0,2-<br />
0,7]. Par contre, l'administration de cette combinaison de ZDV+3TC (bras court) en traitement<br />
intrapartum uniquement n'a montré aucune réduction significative (RR=0,9 ; IC95% [0,6-1,4] par<br />
rapport au placebo (11).<br />
La publication des données de l'essai SAINT réalisé en Afrique du Sud confirme <strong>le</strong>s résultats obtenus<br />
avec l'essai HIVNET 012 avec un taux de transmission presque similaire estimé <strong>à</strong> 12,3% <strong>à</strong> S4-S6 avec<br />
la NVP en monodose (10). Cependant, une dose additionnel<strong>le</strong> de NVP était administrée <strong>à</strong> la femme<br />
entre la 24 ème heure et la 72 ème heure dans l'essai SAINT, (10), ce qui n’était pas <strong>le</strong> cas dans l’essai<br />
HIVNET 012 (9).
39<br />
La récente publication d'un essai thérapeutique réalisé au Malawi rapporte l'efficacité de la<br />
prophylaxie post-exposition chez <strong>le</strong>s enfants dont <strong>le</strong>s mères n'ont pas été traitées en prepartum ou en<br />
intrapartum. On note ainsi une efficacité relative estimée <strong>à</strong> 36% (p=0,03) et un taux de transmission <strong>à</strong><br />
S6-S8 de 15,3% chez <strong>le</strong>s enfants traités par une combinaison de ZDV pendant une semaine et une<br />
monodose de NVP au deuxième jour de vie et de 20,9% chez <strong>le</strong>s enfants ayant reçu uniquement une<br />
monothérapie de ZDV pendant la même durée. Un autre essai de la même équipe réalisé<br />
simultanément dans la même population ne trouvait pas de différence significative <strong>à</strong> S6-S8 (p=0,36)<br />
chez <strong>le</strong>s enfants recevant une prophylaxie postnata<strong>le</strong> par ZDV pendant une semaine (14,1%) et par<br />
l’association ZDV pendant une semaine + NVP en monodose (16,3%). La différence importante par<br />
rapport <strong>à</strong> la première étude menée au Malawi était que <strong>le</strong>s mères incluses dans cette deuxième étude<br />
avaient reçu en début du travail une monodose de NVP (71).<br />
L'essai SIMBA (Stopping Infection from Mother-to-child via Breastfeeding in Africa) réalisé en<br />
Ouganda et au Rwanda avait pour objectif d'évaluer l'efficacité d'une prophylaxie chez <strong>le</strong>s enfants<br />
avec <strong>le</strong> 3TC ou la NVP dans la prévention de la transmission postnata<strong>le</strong>. Cette étude a mis en évidence<br />
une transmission postnata<strong>le</strong> résiduel<strong>le</strong> estimée <strong>à</strong> 1% <strong>à</strong> l'âge de 6 mois avec une prophylaxie postnata<strong>le</strong><br />
par <strong>le</strong> 3TC ou la NVP mais en combinaison avec un sevrage précoce <strong>à</strong> 4 mois (69).<br />
Depuis l’an 2000, de nouveaux essais ou cohortes thérapeutiques ont été mis en place avec l'utilisation<br />
de nouvel<strong>le</strong>s combinaisons d’ARVs. On observe des taux de transmission plus faib<strong>le</strong>s compris entre<br />
5% et 6% en Afrique comme nous <strong>le</strong> rapporterons dans notre thèse (18).
40<br />
Placebo (ANRS 049 + KZT)<br />
24,8<br />
Monodose ZDV (HIVNET012)<br />
ZDV enfant (NVAZ-1)<br />
21,3<br />
20,9<br />
NVPmd (mère) + ZDV+NVPmd enfant (NVAZ-2)<br />
16,3<br />
ZDV + NVPmd enfant (NVAZ-1)<br />
15,3<br />
ZDV (ANRS 049)<br />
15,1<br />
Régimes thérapeutiques<br />
ZDV + 3TC (Petra/ Bras C)<br />
ZDV (ANRS 049 + KZT)<br />
NVPmd (mère) + ZDV enfant (NVAZ-2)<br />
Monodose NVP (SAINT)<br />
12,3<br />
14,2<br />
14,7<br />
14,1<br />
ZDV (KZT)<br />
12,2<br />
Monodose NVP (HIVNET012)<br />
11,9<br />
ZDV+ 3TC (SAINT)<br />
ZDV + 3TC (Petra/ Bras B)<br />
8,9<br />
9,3<br />
ZDV + 3TC (Petra/ Bras A)<br />
5,7<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
Taux de transmission (S4-S6) en %<br />
Figure 1. Taux de transmission de l'infection <strong>à</strong> VIH de la mère <strong>à</strong> son enfant <strong>à</strong> S4-S8 avec <strong>le</strong>s différents régimes d’ARVs évalués dans <strong>le</strong>s essais de<br />
PTME en Afrique.
41<br />
1.5.2 Efficacité <strong>à</strong> long terme (18-24 mois)<br />
Le suivi <strong>à</strong> long terme des enfants allaités par <strong>le</strong>ur mère <strong>à</strong> l’âge de 12-24 mois fournit des informations<br />
sur <strong>le</strong> risque cumulé de la TME dû <strong>à</strong> l’allaitement. Le risque de transmission par l’allaitement est<br />
parfois considéré comme <strong>le</strong> mode de transmission <strong>le</strong> plus important en Afrique (22). Il résulte de ce<br />
fait que l’efficacité <strong>à</strong> long terme des régimes d’ARVs utilisé en peripartum peut être hypothéquée ou<br />
en partie compromise par <strong>le</strong>s cas de transmission postnata<strong>le</strong>.<br />
Quatre essais thérapeutiques avec des groupes placebo ont présenté <strong>le</strong>s résultats <strong>à</strong> long terme de<br />
l’efficacité des régimes d’ARVs utilisés en peripartum (tab<strong>le</strong>au 7).<br />
Tous ces essais ont montré la persistance de l’efficacité <strong>à</strong> long terme des régimes d’ARVs dans une<br />
population pratiquant en majorité l’allaitement, sauf l’essai PETRA (11). Les deux autres essais ayant<br />
utilisé de la ZDV ou de la NVP en monodose ont montré une relative efficacité estimée <strong>à</strong> 26% (8)<br />
pour la ZDV et <strong>à</strong> 41% pour la NVP (73). On note cependant que la durée de l’allaitement maternel<br />
était de 9 mois en médiane dans <strong>le</strong> groupe traité par NVP contre 14 mois dans <strong>le</strong> groupe traité par<br />
ZDV.<br />
Cette efficacité de la ZDV est très liée au taux de CD4 maternel <strong>à</strong> l’inclusion (8). Leroy et al ont<br />
estimé <strong>à</strong> 56% (IC95% [28-76%]), l’efficacité <strong>à</strong> 24 mois de la ZDV chez <strong>le</strong>s femmes ayant des<br />
CD4>=500/mm 3 contre une absence tota<strong>le</strong> d’efficacité chez <strong>le</strong>s femmes ayant des CD4=500/mm 3 .<br />
Compte tenu de l’absence d’efficacité <strong>à</strong> long terme observée dans l’étude PETRA, et aussi chez la<br />
femme ayant des CD4
42<br />
permettre aux femmes infectées de pratiquer en toute sécurité l’allaitement s’il s’avérait que ces<br />
interventions étaient efficaces (77, 78).
43<br />
Tab<strong>le</strong>au 7. Efficacité <strong>à</strong> long terme (M 18) des antirétroviraux utilisés pour la PTME en Afrique.<br />
Essai Intervention $ Allaitement Maternel<br />
(durée médiane en mois)<br />
TME <strong>à</strong> S4-S8<br />
(%)<br />
TME <strong>à</strong> M18 (%)<br />
[IC95%]<br />
Analyse Poolée Zidovudine 97,5%<br />
14, 7 22,5 [17,6-27,3]<br />
Afrique de l’Ouest *<br />
14 [7,8-18]<br />
(8) Placebo 98,8%<br />
24,8 30,2 [25,0-35,4]<br />
13 [8,5-18,2]<br />
HIVNET 012 Névirapine Monodose 99%<br />
11,9 15,7 [11,5-19,8]<br />
(73)<br />
8,8 [7,9-9,7]<br />
ZDV intrapartum 99%<br />
21,3 25,8 [20,7-30,8]<br />
9,5 [8,8-10.3]<br />
PETRA<br />
Bras long (A) 5,7 14,9 [9,4-22,8]<br />
(11)<br />
Bras intermédiaire (B) 74%<br />
8,9 18,1 [12,1-26,2]<br />
Bras court (C) 7 [2-12]<br />
14,2 20,0 [12,9-30,1]<br />
Placebo<br />
15,3 22,2 [15,9-30,2]<br />
ND : Efficacité non calculée<br />
* Risque cumulatif <strong>à</strong> 18- 24 mois (Essai KZT-RETROCi et ANRS 049)<br />
$ Confère <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 5a pour <strong>le</strong> détail relatif aux régimes d’ARVs.<br />
Efficacité <strong>à</strong> M18<br />
[IC95%]<br />
26% [2-44%]<br />
41% [16-59%]<br />
ND
44<br />
1.6 Tolérance des antirétroviraux dans la PTME<br />
La tolérance des médicaments ARVs administrés pour la PTME chez la mère et son enfant a été<br />
investiguée essentiel<strong>le</strong>ment sur la base des données hématologiques c’est-<strong>à</strong>-dire la survenue d’une<br />
anémie, d’une neutropénie <strong>à</strong> S4 postpartum chez la mère et chez l’enfant <strong>à</strong> S4-S8 de vie. El<strong>le</strong> concerne<br />
donc essentiel<strong>le</strong>ment l’exposition au IN, notamment la ZDV et <strong>le</strong> 3TC.<br />
1.6.1 Chez la mère<br />
Les anomalies biologiques sont <strong>le</strong>s principaux effets secondaires recherchés chez <strong>le</strong>s mères ayant reçu<br />
des traitements ARVs par IN en peripartum pour prévenir la TME. L'essai DITRAME ANRS 049 a<br />
rapporté 5,6% d'anémie sévère (6), et l'essai KZT, 5,9% d'anomalies biologiques de grade 3 ou 4 (7).<br />
Dans <strong>le</strong> bras long de l'essai PETRA, 9% d'anomalies biologiques de grade 3 ou 4 ont été rapportées<br />
(11). Dans tous <strong>le</strong>s cas, aucune différence n’a été observée par rapport au groupe placebo et ces<br />
anomalies étaient rapidement reversib<strong>le</strong>s. Aucune toxicité cutanée sévère n’a été détectée en rapport<br />
avec l’utilisation de la NVP en monodose (9).<br />
1.6.2 Chez <strong>le</strong>s enfants<br />
• Tolérance biologique<br />
Aucun ARV n'a été donné aux enfants en période postnata<strong>le</strong> dans la plupart des essais, sauf dans <strong>le</strong>s<br />
essais HIVNET 012, <strong>le</strong> bras long de PETRA, NVAZ-1, NVAZ-2 et SIMBA. Dans l'essai HIVNET<br />
012, on notait 4,7% (13/277) d'anémie définie par des taux d’hémoglobine entre 8,5-11,8 g/dl (9).<br />
Dans <strong>le</strong> bras long de l'essai PETRA où la ZDV et <strong>le</strong> 3TC ont été administrées pendant une semaine 5%<br />
d'anomalies biologiques de grade 3 ou 4 chez <strong>le</strong>s enfants ont été rapportées (11). Les anomalies<br />
biologiques de grade 3 et 4 <strong>à</strong> six semaines dans l'essai NVAZ-1 étaient estimées <strong>à</strong> 5,6% dans <strong>le</strong> bras<br />
NVP et <strong>à</strong> 7,8% dans <strong>le</strong> bras NVP+ ZDV (p=0, 16) (49). Dans l'essai SIMBA, aucune différence<br />
significative n'a été retrouvée en ce qui concerne la survenue d'une anomalie biologique grave (8,5%<br />
dans <strong>le</strong> bras 3TC et 8,1% dans <strong>le</strong> bras NVP) (69). Dans tous <strong>le</strong>s cas, ces anomalies biologiques étaient<br />
rapidement réversib<strong>le</strong>s.
45<br />
• Mortinatalité<br />
Tous <strong>le</strong>s essais réalisés ont rapporté des cas de mort-nés. Cette fréquence de mortinatalité varie entre<br />
0,5% et 5,1% (6, 11, 79). Aucune différence statistiquement significative n'a été observée par rapport<br />
au groupe de comparaison avec <strong>le</strong>s différents régimes d’ARVs utilisés (6, 11, 79). Cependant, il<br />
faudrait tenir compte du mode d'accouchement, pour comparer formel<strong>le</strong>ment ces résultats, avec par<br />
exemp<strong>le</strong> la pratique de la césarienne dans 33% des cas en Afrique du Sud dans <strong>le</strong>s essais PETRA et<br />
SAINT (10, 11) contre 1% <strong>à</strong> Abidjan (6, 7).<br />
• Malformations congénita<strong>le</strong>s et mortinatalité<br />
Des descriptions détaillées des cas de malformations congénita<strong>le</strong>s n'ont pas été rapportées dans la<br />
littérature. La fréquence des malformations notées chez des enfants nés de mères infectées par <strong>le</strong><br />
VIH-1 et traitées par des ARVs varie entre 1,5% et 7% (6, 11, 79). Aucune différence statistiquement<br />
significative n'a été observée entre <strong>le</strong>s différents groupes exposés aux ARVs avec <strong>le</strong> groupe de<br />
comparaison en général avec un placebo (6, 11, 79).<br />
Le tab<strong>le</strong>au 8 résume la fréquence des malformations congénita<strong>le</strong>s et cel<strong>le</strong> de la mortinatalité observées<br />
dans <strong>le</strong>s essais PTME réalisés en Afrique.
46<br />
Tab<strong>le</strong>au 8. Malformations congénita<strong>le</strong>s et mortinatalité décrites dans <strong>le</strong>s essais thérapeutiques<br />
sur la PTME en Afrique.<br />
Essais Traitement Malformations Congénita<strong>le</strong>s Mort-Né<br />
ANRS 049 (6) ZDV 5 (2,5%) 1/203 (0,4%)<br />
Côte d'Ivoire Placebo 1 (0,5%) 7/211 (3,3%)<br />
KZT (7)<br />
ZDV 2/136 (1,5%) 7/136 (5,1%)<br />
Côte d'Ivoire Placebo 6/137 (4,4%) 2/137 (1,5%)<br />
SAINT(10)<br />
ZDV + 3TC Non précisé 2/666 (0,3%)<br />
Afrique du Sud NVP mondose Non précisé 0/663 (0,0%)<br />
PETRA (11) ZDV+3TC (Bras A) 28/380 (7,3%) 2/380 (1%)<br />
Afrique du Sud ZDV +3TC (Bras B) 27/382 (7,1%) 6/382 (2%)<br />
Ouganda<br />
ZDV +3TC (Bras C) 24/377 (6,4%) 4/377 (1%)<br />
Tanzanie Placebo 28/362 (7,7%) 4/362 (1%)<br />
HIVNET 012 (9)<br />
NVP monodose Non précisé 2/312 (0,6%)<br />
Ouganda ZDV intrapartum Non précisé 1/319 (0,3%)<br />
* Voir <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 5a pour la description détaillée des régimes ARV utilisés.
47<br />
1.7 Résistance vira<strong>le</strong> aux médicaments utilisés dans la PTME<br />
Il existe encore peu de données disponib<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong>s études de résistances vira<strong>le</strong>s aux prophylaxies ARV<br />
utilisées en PTME en Afrique. La résistance aux ARVs est potentiel<strong>le</strong>ment un des obstac<strong>le</strong>s évoqués<br />
pour l’administration des ARVs dans <strong>le</strong>s programmes de PTME. Si <strong>le</strong>s mutations de résistance n’ont <strong>à</strong><br />
priori aucun effet sur <strong>le</strong> niveau de TME, el<strong>le</strong>s pourraient constituer un facteur limitant important pour<br />
<strong>le</strong>s traitements futurs de la femme et de son enfant.<br />
1.7.1 Mutations associées <strong>à</strong> la Zidovudine<br />
Une étude réalisée <strong>à</strong> Abidjan en Côte d’Ivoire n’a retrouvé aucune mutation associée <strong>à</strong> un traitement<br />
court par la ZDV en fin de grossesse. Dans cette étude seu<strong>le</strong>ment 20/140 femmes traitées par la ZDV<br />
et ayant des prélèvements disponib<strong>le</strong>s <strong>à</strong> l’accouchement ont été incluses. Les mutations de résistance<br />
de la ZDV recherchées étaient <strong>le</strong>s suivantes : M41L, D67N, K70R et K215Y/F (80). La préva<strong>le</strong>nce des<br />
mutations associées <strong>à</strong> la ZDV est général très faib<strong>le</strong>. El<strong>le</strong> était estimée <strong>à</strong> 2,6% dans l’essai ACTG<br />
076/ANRS024 après 12 semaines de traitement par la ZDV aux Etats-Unis et en France (81).<br />
1.7.2 Mutations associées <strong>à</strong> la Névirapine<br />
Dans l’essai HIVNET 012, la préva<strong>le</strong>nce des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP <strong>à</strong> S6-S8 postpartum<br />
était estimée <strong>à</strong> 19% chez <strong>le</strong>s femmes. Cette étude a été réalisée chez 111 femmes et la mutation de<br />
résistance la plus observée est la K103. En analyse univariée, <strong>le</strong>s facteurs suivants étaient associés aux<br />
mutations de résistance dans cette étude : la charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> (OR=3,9, IC95% [1,5-10,2]) pour<br />
chaque augmentation d’un log de CV et <strong>le</strong>s CD4 (OR=1,6, IC95% [1,2-2,2]) pour chaque diminution<br />
de 100 CD4 (82). Pour mémoire, dans l’essai ACTG 316 mené principa<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong>s pays<br />
industrialisés, aucun facteur (charge vira<strong>le</strong>, lymphocytes CD4, prise d’autres ARVs) n’était retrouvé<br />
associé aux mutations de NVP monodose dont la fréquence était estimée <strong>à</strong> 15% <strong>à</strong> six semaines (83).<br />
Dans l’essai HIVNET 012, chez <strong>le</strong>s enfants, la mutation <strong>à</strong> la NVP était retrouvée chez 11/46 enfants<br />
testés, soit une préva<strong>le</strong>nce de 46%. La mutation Y181C était identifiée dans 10 cas/11 (82).<br />
Toujours dans l’essai HIVNET 012, une relation entre la souche vira<strong>le</strong> et la fréquence des mutations<br />
de résistance <strong>à</strong> la NVP a été retrouvée. Ainsi, <strong>le</strong>s femmes ayant une souche vira<strong>le</strong> de sous type D<br />
avaient un risque plus é<strong>le</strong>vé de présenter une mutation de résistance <strong>à</strong> la NVP que <strong>le</strong>s femmes avec un<br />
virus de sous-type A (OR=4,9, IC95% [1,2-20,2] (84).
48<br />
Pour diminuer <strong>le</strong>s mutations liées <strong>à</strong> la NVP, Beckerman, a suggéré d’utiliser d’autres molécu<strong>le</strong>s en<br />
association avec la NVP. Ainsi, un schéma thérapeutique proposé pourrait être constitué de NVP en<br />
monodose plus 2 <strong>à</strong> 3 jours de traitement maternel de ZDV et/ou de 3TC (85).<br />
Une autre équipe en Afrique du Sud a récemment décrit une nouvel<strong>le</strong> mutation de résistance associée <strong>à</strong><br />
la NVP chez <strong>le</strong>s femmes infectées par <strong>le</strong> VIH-1 avec <strong>le</strong> sous-type B : la V106M. Cette mutation a été<br />
retrouvée six semaines après l'accouchement chez 7/141 femmes ayant reçu une monodose de NVP<br />
(86).<br />
1.7.3 Mutations associées <strong>à</strong> la lamivudine<br />
Une étude de résistance vira<strong>le</strong> a été réalisée en France pour rechercher des mutations de résistance au<br />
3TC. Ainsi, dans l’étude ANRS 075, on a noté des mutations associées au 3TC après huit semaines en<br />
moyenne de traitement par du Combivir ® en prepartum. La mutation M184V associée au 3TC a été<br />
retrouvée chez 52 (39%) des femmes chez <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong> séquençage viral a pu être réalisé (17).<br />
Les facteurs associés <strong>à</strong> la mutation M184V étaient respectivement la durée du traitement au 3TC<br />
(OR=3,1 pour chaque période supplémentaire de 30 jours de traitement), la charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> <strong>à</strong><br />
l’inclusion (OR=2,7 pour chaque augmentation d’un log de CV) et <strong>le</strong>s CD4 maternels (OR=0,7 pour<br />
chaque augmentation de 100 CD4). Par contre, <strong>le</strong> traitement antérieur par ARV, l’origine des femmes<br />
et <strong>le</strong> caractère transmetteur ou pas n’étaient pas associés aux mutations de résistance de la 3TC (17).<br />
Les études de résistances réalisées en Afrique dans l’essai PETRA ont montré que la mutation M184V<br />
associée au 3TC était éga<strong>le</strong>ment la plus fréquente. Cette mutation a été détectée chez 12% d’un sous<br />
échantillon inclus dans <strong>le</strong> bras A de l’essai. Aucun facteur de risque évident n'était associé <strong>à</strong> cette<br />
mutation. Peu de données interprétab<strong>le</strong>s chez des enfants ont été présentées dans cette étude (87).
49<br />
1.8 Autres interventions pour réduire la TME<br />
Les interventions de type désinfection vagina<strong>le</strong> par des microbicides qui inactivent <strong>le</strong> VIH in vitro et<br />
l'apport de supplémentation vitaminique (vitamine A ou multivitamine) ont éga<strong>le</strong>ment été évaluées en<br />
Afrique. A ce jour, en dehors des ARVs, toutes <strong>le</strong>s autres interventions qui ont été utilisées pour la<br />
réduction de la TME n’ont pas abouti <strong>à</strong> des résultats concluants.<br />
• Utilisation d'antiseptiques pour la désinfection vagina<strong>le</strong> au moment de l'accouchement<br />
Des essais ayant utilisé des antiseptiques pour désinfecter la flore microbienne vagina<strong>le</strong> avant et<br />
pendant l’accouchement ont été réalisés au Malawi (88) ainsi qu’en Côte d’Ivoire et au Burkina-Faso<br />
(89, 90). Ces deux études n’ont pas montré de réduction de la TME du VIH-1.<br />
Ainsi l'essai mené au Malawi qui a utilisé une solution de Chlorhexhidine <strong>à</strong> 0,25% avec un<br />
badigeonnage <strong>à</strong> chaque examen du col associé au nettoyage de l'enfant a montré que <strong>le</strong> taux de<br />
transmission était de 27% avec intervention contre 28% sans intervention (88). On note un effet sur la<br />
réduction de la TME du VIH-1 dans <strong>le</strong> sous groupe des femmes ayant une rupture prématurée des<br />
membranes de plus de quatre heures. Le taux de TME était de 25% dans <strong>le</strong> groupe traité vs 39,4%<br />
dans <strong>le</strong> groupe non traité (88).<br />
Les mêmes observations ont été rapportées après l'utilisation d'ovu<strong>le</strong> de chlorure de benzalkolnium <strong>à</strong><br />
1% dans un essai de phase II en Côte d'Ivoire et au Burkina-Faso (90). Le risque de transmission était<br />
similaire dans <strong>le</strong>s 2 groupes (23,5% dans <strong>le</strong> groupe traité contre 24,8%, dans <strong>le</strong> groupe placebo <strong>à</strong> 15<br />
mois de vie) (90). Mais l’essai ne disposait pas de la puissance nécessaire pour mettre en évidence une<br />
éventuel<strong>le</strong> différence.<br />
Une autre étude réalisée <strong>à</strong> Mombassa au Kenya ayant utilisé des concentrés de Chlorhexhidine<br />
(solution de 0,2 <strong>à</strong> 0,4%) a aussi montré l'absence d’efficacité dans la réduction de la TME avec 15,9%<br />
de TME dans <strong>le</strong> groupe avec lavage contre 17,2% dans <strong>le</strong> groupe sans lavage (p=0,67). Il n'y avait pas<br />
non plus de différence en fonction des sous-groupes en tenant compte de la durée de rupture de la<br />
poche des eaux de moins de quatre heures ou de plus de quatre heures (91).<br />
Tous ces essais ont cependant confirmé la faisabilité de cette intervention, qui pourrait être associée <strong>à</strong><br />
la prise de médicaments ARVs puisque d'autres bénéfices, notamment une réduction de près d'un quart<br />
de la mortalité néonata<strong>le</strong> précoce et des infections postpartum chez la mère ont été observées au<br />
Malawi (92).
50<br />
• Supplémentation maternel<strong>le</strong> en vitamines<br />
La principa<strong>le</strong> hypothèse était que la supplémentation vitaminique (A, B, C et E) pourrait réduire la<br />
TME du VIH-1 et la progression de l'infection maternel<strong>le</strong> <strong>à</strong> VIH en augmentant <strong>le</strong>s fonctions<br />
immunitaires de la mère et de l'enfant, en réduisant la charge vira<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> sang, <strong>le</strong> lait et <strong>le</strong>s<br />
secrétions vagina<strong>le</strong>s maternel<strong>le</strong>s et en renforçant la barrière placentaire. (93).<br />
Des essais de supplémentation en vitamines ont été conduits en Afrique du Sud (94), au Malawi et en<br />
Tanzanie (65, 95) avec l’objectif de réduire la transmission intrapartum de l'infection <strong>à</strong> VIH-1. Tous<br />
ces essais ont conclu <strong>à</strong> l’absence d'effet de cette intervention.<br />
En Afrique du Sud, aucune différence n'a été trouvée <strong>à</strong> trois mois de vie entre <strong>le</strong> groupe des femmes<br />
ayant reçu une supplémentation en vitamine A (20,3%) et <strong>le</strong>s femmes recevant un placebo (22,3%). La<br />
vitamine A n'a pas non plus démontré d'effet sur la mortalité fœta<strong>le</strong> et infanti<strong>le</strong>. Cependant, on notait<br />
une réduction significative des accouchements prématurés dans cette étude avec 11,4% de prématurés<br />
dans <strong>le</strong> groupe recevant la vitamine A contre 17,4% dans <strong>le</strong> groupe placebo (p=0,03) (94).<br />
En Tanzanie, une première étude réalisée pour évaluer la supplémentation en vitamine A ou avec des<br />
multivitamines n'a pas retrouvé d’association avec une diminution de la TME du VIH pendant la<br />
période in utero, intrapartum ou postnata<strong>le</strong> précoce (95).<br />
Une deuxième étude sur l'impact de la vitamine A par rapport <strong>à</strong> une supplémentation vitaminique sans<br />
vitamine A chez <strong>le</strong>s femmes qui pratiquent un allaitement a montré que la supplémentation en<br />
vitamine A entraînait en fait une augmentation du risque de TME par allaitement (RR =1,34, IC95%<br />
[1,1-1,8], p = 0,009), tandis que la supplémentation en vitamines (B, C et E) permettait la réduction de<br />
la mortalité infanti<strong>le</strong> et de la TME par l'allaitement parmi <strong>le</strong>s femmes présentant une<br />
immunodépression. (65).<br />
Cependant, dans un autre essai thérapeutique randomisé réalisé en Tanzanie et portant sur 1075<br />
femmes enceintes, <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> bénéfique de la supplémentation en vitamine B12, C, E et acide folique a été<br />
clairement démontré avec une réduction significative de la mortalité fœta<strong>le</strong>, des petits poids de<br />
naissance (
51<br />
1.9 Questions de recherche <strong>à</strong> envisager en Afrique<br />
Malgré <strong>le</strong>s résultats encourageants des essais thérapeutiques effectués jusqu’<strong>à</strong> présent et des<br />
recherches opérationnel<strong>le</strong>s menées pour évaluer la faisabilité de ces interventions sur <strong>le</strong> terrain,<br />
beaucoup de questions restent encore posées sur la TME du VIH en Afrique et sa prévention, dix ans<br />
après <strong>le</strong> résultat du premier essai thérapeutique ayant apporté une solution pour réduire cette<br />
transmission, <strong>à</strong> savoir l’essai ACTG 076 et ANRS 024. On peut ainsi distinguer deux types de<br />
questions de recherche selon <strong>le</strong>s modalités de transmission envisagées.<br />
• Problématique de recherche pour la réduction de la transmission intrapartum du VIH-1<br />
- La tolérance et l'efficacité des HAART pour la PTME restent <strong>à</strong> évaluer en Afrique<br />
afin d’envisager l’éradication de la TME dans <strong>le</strong>s circonstances où cela serait possib<strong>le</strong>.<br />
- L'efficacité des ARVs chez des femmes qui ont bénéficié une première fois d'un<br />
traitement de PTME par des ARVs reste éga<strong>le</strong>ment <strong>à</strong> évaluer dans <strong>le</strong> cas des nouvel<strong>le</strong>s<br />
grossesses.<br />
- La mise en évidence d’une certaine fréquence de résistance vira<strong>le</strong> chez <strong>le</strong>s femmes qui<br />
ont bénéficié d'un traitement de PTME avec des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP et <strong>à</strong><br />
la ZDV pourrait amener <strong>à</strong> tester l'efficacité d'autres ARVs pour la PTME comme <strong>le</strong><br />
Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) ou l’extension de la prophylaxie maternel<strong>le</strong><br />
postnata<strong>le</strong> et de la prophylaxie néonata<strong>le</strong>.<br />
- Des études pharmacologiques d'autres ARVs pourront aussi être menées pour disposer<br />
d'une gamme plus variée d'ARVs pour la PTME en Afrique. A ce jour, seu<strong>le</strong>ment<br />
trois molécu<strong>le</strong>s sont utilisées pour la réduction du VIH-1 de la mère <strong>à</strong> son enfant en<br />
Afrique (ZDV, NVP et 3TC). Par exemp<strong>le</strong>, l’effet du TDF pourrait être étudié en<br />
phase II chez la femme enceinte et <strong>le</strong> nouveau-né avant d’envisager d’étudier son<br />
efficacité dans un essai de phase III.<br />
- La réponse viro-immunologique des femmes infectées ayant bénéficié d’un traitement<br />
de PTME et actuel<strong>le</strong>ment sous HAART devra être explorée de manière rigoureuse<br />
compte tenu des résultats préoccupants observés en Thaïlande (97).
52<br />
• Problématique de recherche pour la réduction de la transmission postnata<strong>le</strong> du VIH-1<br />
- La prescription des ARVs sur une période plus longue que cel<strong>le</strong> prévue par des<br />
protoco<strong>le</strong>s actuels qui ne proposent qu’une prophylaxie post-exposition de la période<br />
postnata<strong>le</strong> précoce doit être envisagée. Même si l'étude SIMBA a apporté un début de<br />
réponse. D'autres schémas thérapeutiques pourront être évalués.<br />
- La vaccination ou multithérapie passive chez <strong>le</strong>s enfants pour prévenir la transmission<br />
postnata<strong>le</strong>.<br />
- La question de savoir si une femme infectée mais traitée par multithérapie ARV pour<br />
el<strong>le</strong>-même peut allaiter sans risque son enfant est éga<strong>le</strong>ment une piste de recherche <strong>à</strong><br />
explorer.<br />
- Enfin l’identification des stratégies innovantes pour la pratique de l'allaitement<br />
exclusif et de l'alimentation artificiel<strong>le</strong> chez <strong>le</strong>s enfants nés de mère infectée par <strong>le</strong><br />
VIH-1 reste par ail<strong>le</strong>urs une priorité.<br />
• Problématique de recherche pour <strong>le</strong>s études de résistance<br />
- L’étude de la résistance vira<strong>le</strong> chez <strong>le</strong>s mères et <strong>le</strong>s enfants en fonction des différentes<br />
combinaisons thérapeutiques étudiées et notamment cel<strong>le</strong>s proposant une prophylaxie<br />
postnata<strong>le</strong> mérite d’être poursuivie.<br />
- L’étude de la résistance vira<strong>le</strong> chez <strong>le</strong>s mères transmettrices en période postnata<strong>le</strong> n’a<br />
quasiment pas été menée pour l’instant.<br />
- Enfin l’étude de l'influence des sous-types de VIH sur <strong>le</strong> développement des<br />
résistances devra être poursuivie.
53<br />
Chapitre 2<br />
Mise en place du projet ANRS 1201/1202<br />
Ditrame Plus<br />
"Il faut que partout dans <strong>le</strong> monde <strong>le</strong>s dirigeants montrent que par<strong>le</strong>r franchement du SIDA est un motif de fierté,<br />
pas une source de honte. Il ne doit plus y avoir de politique de l'autruche, plus d'embarras, on ne doit ne plus se<br />
cacher derrière <strong>le</strong> voi<strong>le</strong> de l'indifférence."<br />
Kofi Annan (Secrétaire Général des Nations Unies)<br />
Bangkok, Thaïlande, Juil<strong>le</strong>t 2004
54<br />
Le Projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus est un projet de recherche qui regroupe cinq études dont<br />
l’objectif général est de proposer un paquet d’interventions dirigées contre l’infection <strong>à</strong> VIH de la mère et<br />
l’enfant en Afrique. Il regroupe :<br />
• L’étude ANRS 1201 dont l’objectif était d’évaluer des interventions peripartum <strong>à</strong> base d’ARVs pour<br />
la réduction de la TME;<br />
• L’étude ANRS 1202 dont l’objectif était d’évaluer des interventions nutritionnel<strong>le</strong>s pour la réduction<br />
de la transmission postnata<strong>le</strong>;<br />
• L’étude ANRS 1203 qui s’intéresse aux comportements sexuels en matière de procréation chez <strong>le</strong>s<br />
femmes négatives, ou qui ont refusé de faire <strong>le</strong> test VIH. Les comportements de ces femmes seront<br />
comparés avec ceux observés chez <strong>le</strong>s patientes dépistées VIH positives;<br />
• L’étude ANRS 1209 dont l’objectif était d’étudier la tolérance des ARVs chez <strong>le</strong>s enfants exposés en<br />
peripartum <strong>à</strong> ces médicaments;<br />
• L’étude ANRS 1263 qui avait pour objectif de valider la technique PCR en temps réel pour <strong>le</strong><br />
diagnostic précoce de l’infection pédiatrique <strong>à</strong> VIH et d’étudier <strong>le</strong>s résistances aux ARVs utilisés<br />
pour la prévention de la TME.<br />
Le projet Ditrame Plus se dérou<strong>le</strong> <strong>à</strong> Abidjan en Côte d’Ivoire. Il a commencé en mai 2000 avec l’ouverture<br />
des centres de dépistage et en mars 2001 avec la première inclusion dans l’étude ANRS 1201. Ce chapitre<br />
présente un aperçu de la situation épidémiologique du VIH en Côte d’Ivoire au moment de la mise en place<br />
de l’étude Ditrame Plus. Au cours de cette mise en place, deux études de base ont été réalisées. Les<br />
principaux résultats de ces études sont rapportés. Une de ces études a été publiée dans une revue française et<br />
est présentée en annexe 1. Pour terminer ce chapitre, nous présenterons une étude spécifique sur l’obtention<br />
du consentement éclairé chez des femmes ayant participé au projet de recherche Ditrame Plus. Cette étude<br />
est une contribution au débat plus large sur l’éthique de la recherche sur <strong>le</strong> VIH engagée en Afrique.<br />
2.1 . Situation épidémiologique du VIH/SIDA en Côte d’Ivoire<br />
La Côte d’Ivoire est <strong>le</strong> pays <strong>le</strong> plus touché par l’infection <strong>à</strong> VIH-Sida en Afrique de l’Ouest (carte 1). La<br />
transmission du VIH dans ce pays est essentiel<strong>le</strong>ment hétérosexuel<strong>le</strong> et de la mère <strong>à</strong> l’enfant. Il n’y a pas eu<br />
d’étude épidémiologique récente en population généra<strong>le</strong>. Les données épidémiologiques dont <strong>le</strong> ministère<br />
Délégué auprès du Premier Ministre chargé de la lutte contre <strong>le</strong> VIH/SIDA (MLS) dispose aujourd’hui sont<br />
irrégulières compte tenu du con<strong>texte</strong> politique.<br />
A la fin de l’année 2003, l’ONUSIDA estimait <strong>à</strong> un million <strong>le</strong> nombre de personnes vivant avec <strong>le</strong> VIH en<br />
Côte d’Ivoire (1). Le nombre d’adultes et d’enfants ayant atteint <strong>le</strong> stade de SIDA maladie depuis <strong>le</strong> début de
l’épidémie <strong>à</strong> VIH en Côte d’Ivoire était d’environ 450000 cas en 1999 selon <strong>le</strong> PNLS et on estime <strong>à</strong> 6000 <strong>le</strong><br />
nombre de nouveaux cas par an. La préva<strong>le</strong>nce médiane de l’infection <strong>à</strong> VIH en 2002 était estimée <strong>à</strong> 8%<br />
dans <strong>le</strong> pays dans son ensemb<strong>le</strong>, 10% en milieu urbain et 6% en milieu rural (98). Une étude de préva<strong>le</strong>nce<br />
réalisée dans huit centres anténataux entre 1997 et 2003 a montré que la préva<strong>le</strong>nce de l’infection <strong>à</strong> VIH<br />
restait stab<strong>le</strong>. El<strong>le</strong> était estimée <strong>à</strong> 9,8% en 1997-1998, et a légèrement augmenté en 2001 avec une préva<strong>le</strong>nce<br />
de 10,6%, et ensuite ce taux est revenu <strong>à</strong> 9,8% en 2002 (98).<br />
55<br />
Bien que chaque année, l’on note une augmentation importante des cas notifiés de Sida, ce nombre est<br />
largement en deç<strong>à</strong> des estimations de l’ONUSIDA. En effet, l’on estime qu’en Côte d’Ivoire, seu<strong>le</strong>ment un<br />
cas de SIDA sur 17 est notifié.<br />
Les conséquences de la pandémie sur <strong>le</strong>s enfants sont importantes. On estime ainsi <strong>à</strong> près de 420000 <strong>le</strong><br />
nombre d’enfants infectés et/ou affectés par <strong>le</strong> VIH/SIDA en Côte d’Ivoire et près de 90 % des enfants<br />
infectés <strong>le</strong> sont par la TME.<br />
2.2. Organisation du projet Ditrame Plus<br />
La mise en place du projet Ditrame Plus a débuté en janvier 2000, après l’obtention de l’avis favorab<strong>le</strong> du<br />
Ministère de la Santé Publique ivoirien <strong>le</strong> 30 décembre 1999 sur proposition du Comité d'Ethique. Le<br />
protoco<strong>le</strong> Ditrame Plus prévoyait dans son ca<strong>le</strong>ndrier une phase de préparation de quatre mois dont <strong>le</strong>s<br />
principaux éléments seront relatés dans ce chapitre.<br />
2.2.1 Sites de recrutement et de suivi<br />
Une mission réalisée en novembre 1999 avait permis de déterminer <strong>le</strong>s sites de dépistage et de suivi<br />
potentiels pour la mise en place du projet. Le projet se dérou<strong>le</strong> dans des Formations Sanitaires Urbaines <strong>à</strong><br />
base communautaire (FSUcom) qui sont des structures privées <strong>à</strong> but non lucratif gérées par des associations<br />
et sont liées <strong>à</strong> l’Etat par une convention de service public. El<strong>le</strong>s ont été mises en place par <strong>le</strong> Projet Santé<br />
Abidjan (PSA), un projet de la coopération franco-ivoirienne qui a débuté en 1992. Les FSUcom dépendent<br />
actuel<strong>le</strong>ment de la Direction Régiona<strong>le</strong> de la Santé Sud (DRS) et bientôt du district autonome d’Abidjan. Il<br />
faut souligner que l'un des objectifs du PSA était d’amener ces formations sanitaires <strong>à</strong> une gestion financière<br />
autonome (consultations et soins médicaux payants) permettant la rémunération du personnel et l’achat du<br />
matériel et des médicaments.<br />
Chaque FSUcom est régie par un conseil d’administration, composé de personnes vivant obligatoirement<br />
dans <strong>le</strong> quartier, n’appartenant pas au milieu médical, et ayant une certaine aura dans la population. Le
conseil d’administration, se réunit de façon régulière pour décider des orientations des activités de la<br />
FSUcom, tout en respectant <strong>le</strong> mode de fonctionnement établi par <strong>le</strong> PSA et la DRS.<br />
56<br />
Carte 1. Carte de la République de Côte d’Ivoire.<br />
Le projet Ditrame Plus a ciblé <strong>le</strong>s deux plus grandes communes de la vil<strong>le</strong> d’Abidjan, Abobo et Yopougon<br />
(carte 2). Les FSUcom suivantes ont ainsi abrité <strong>le</strong> projet Ditrame Plus :
- Dans la commune d’Abobo : <strong>le</strong>s FSUcom d'Anonkouakouté, de Sagbé, d’Abobo-Sud et d'Avocatier<br />
- Dans la commune de Yopougon : <strong>le</strong>s FSUcom de Niangon Sud, de Toit Rouge, et de Oussakara.<br />
Parmi ces FSUcom, deux ont été retenues pour être des centres de suivi du projet, ceux d’Avocatier (photo 1)<br />
et de Niangon Sud, <strong>le</strong>s autres étant uniquement des centres de dépistage. Des bâtiments ont été construits<br />
dans ces deux structures spécifiquement pour <strong>le</strong> projet Ditrame Plus. L’ouverture des centres de suivi et de<br />
dépistage s’est faite très progressivement, comme <strong>le</strong> montre <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 9. Les activités de dépistage et<br />
d’inclusion ont pris fin <strong>le</strong> 31 juil<strong>le</strong>t 2003. Cependant, au centre de dépistage d’Abobo-Sud, <strong>le</strong>s activités ont<br />
été arrêtées prématurément <strong>le</strong> 13 février 2002 pour des raisons logistiques.<br />
57<br />
Tab<strong>le</strong>au 9. Description des sites du projet Ditrame Plus et ca<strong>le</strong>ndrier d’ouverture des centres de<br />
dépistage et de suivi<br />
FSUCom Centre de Dépistage Centre de suivi<br />
Commune d’ABOBO<br />
Anonkouakouté 16 mai 2000<br />
Sagbé 05 octobre 2000<br />
Avocatier 13 mars 2001 06 mars 2001<br />
Abobo-Sud 12 novembre 2001<br />
Commune de Yopougon<br />
Niangon-Sud 08 avril 2002 11 avril 2002<br />
Toît Rouge 08 avril 2002<br />
Ouassakara 02 septembre 2002<br />
Le Centre de Diagnostic et de Recherche sur <strong>le</strong> SIDA (CeDReS) au CHU de Treichvil<strong>le</strong> est <strong>le</strong> laboratoire de<br />
référence pour <strong>le</strong>s examens biologiques <strong>à</strong> réaliser dans <strong>le</strong> cadre du projet Ditrame Plus, comme c'est <strong>le</strong> cas<br />
pour <strong>le</strong>s autres projets du programme PACCI, regroupant toutes <strong>le</strong>s activités de recherche menées sous<br />
l’égide de l’Agence Nationa<strong>le</strong> de la Recherches sur <strong>le</strong> SIDA (ANRS) en partenariat avec <strong>le</strong> ministère<br />
français des Affaires Etrangères et de la Coopération et <strong>le</strong> Programme National de Lutte contre <strong>le</strong> SIDA<br />
(PNLS) du Ministère ivoirien de la Santé Publique.<br />
Le CeDReS est impliqué dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus pour :<br />
- <strong>le</strong> diagnostic sérologique de l’infection <strong>à</strong> VIH et de la syphilis.<br />
- <strong>le</strong>s sérologies de confirmation de tous <strong>le</strong>s prélèvements dont <strong>le</strong> résultat est positif dans <strong>le</strong>s<br />
laboratoires des FSUcom.<br />
- la formation des laborantins des FSUcom <strong>à</strong> la technique des tests rapides et <strong>à</strong> l’enregistrement des<br />
résultats.<br />
- <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de qualité de routine dans <strong>le</strong>s laboratoires des FSUcom.<br />
- la réalisation des examens biologiques de diagnostic pour la prise en charge des mères et des enfants,<br />
incluant la PCR pour <strong>le</strong> diagnostic d'infection pédiatrique.<br />
- La préparation et <strong>le</strong> stockage des prélèvements pour la constitution de la biothèque du projet.
58<br />
Carte 2. Carte de la vil<strong>le</strong> d’Abidjan montrant <strong>le</strong>s sites de dépistage et de suivi du projet ANRS<br />
1201/1202 Ditrame Plus.<br />
Photo 1. Centre de suivi et de dépistage d’Avocatier <strong>à</strong> Abobo (Vue de face)
59<br />
2.2.2 Equipe Ditrame Plus<br />
L'ensemb<strong>le</strong> du personnel de l'essai précedent ANRS 049 DITRAME a été engagé dans <strong>le</strong> projet<br />
Ditrame Plus <strong>à</strong> partir du 1 er janvier 2000, hormis ceux qui ont été recrutés dans <strong>le</strong>s programmes pilote<br />
de PTME mis en place <strong>à</strong> Abidjan par <strong>le</strong> Fond de Solidarité Thérapeutique Internationa<strong>le</strong> (FSTI) ou<br />
l’UNICEF. Ce personnel présentait alors l'intérêt évident d'être déj<strong>à</strong> formé aux activités nécessaires<br />
pour <strong>le</strong> dérou<strong>le</strong>ment d'un projet de recherche. Le personnel a participé <strong>à</strong> l'élaboration des procédures<br />
d’inclusion, de suivi et de prise en charge mises en place pour <strong>le</strong> projet Ditrame Plus et <strong>à</strong> la formation<br />
des personnes nouvel<strong>le</strong>ment recrutées. Pour la formation, des ateliers de travail ont été initiés sur <strong>le</strong>s<br />
thèmes suivants : dépistage, prise en charge psychosocia<strong>le</strong>, alimentation infanti<strong>le</strong>, planification<br />
familia<strong>le</strong>, soins obstétricaux, suivi prénatal et prise du traitement, prise en charge clinique adulte et<br />
enfant.<br />
En moyenne c’est une équipe de 50 personnes qui a travaillé sur <strong>le</strong> projet Ditrame Plus. El<strong>le</strong> était<br />
constituée de médecins, de sages femmes, d’assistantes socia<strong>le</strong>s de laborantins, de conseillères en<br />
dépistage, de psychologues etc. L’équipe était coordonnée par une équipe de direction constituée de<br />
quatre médecins. Pour <strong>le</strong> dépistage, 18 personnes, trois par centre, étaient chargées de faire <strong>le</strong> conseil<br />
prétest et post-test des femmes enceintes et la préinclusion des femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-<br />
1. Le reste de l’équipe réalisait <strong>le</strong>s activités d’inclusion et de suivi des enfants dans deux centres<br />
dédiés <strong>à</strong> cet effet.<br />
L’ensemb<strong>le</strong> de l’équipe se réunissait de manière hebdomadaire pour faire <strong>le</strong> point sur l'état<br />
d'avancement de la mise en place du projet Ditrame Plus.<br />
2.2.3 Implicaton personnel<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> projet<br />
J’ai intégré l’équipe Ditrame Plus <strong>à</strong> Bordeaux en avril 2001 en tant que chef de projet par interim.<br />
Ainsi, j’ai participé <strong>à</strong> la mise en place de cette étude : rédaction des questionnaires et des procédures,<br />
création et mise en place des bases de données. J’effectuais par ail<strong>le</strong>urs des missions d’évaluation<br />
régulières sur <strong>le</strong> site <strong>à</strong> Abidjan.<br />
Depuis janvier 2002, je suis en place <strong>à</strong> Abidjan et mon rô<strong>le</strong> au sein de l’étude Ditrame Plus consiste <strong>à</strong><br />
participer <strong>à</strong> la coordination du projet en assistant <strong>le</strong> chef de projet et <strong>à</strong> apporter mon expertise pour <strong>le</strong>s<br />
aspects méthodologiques et épidémiologiques. Je me suis par ail<strong>le</strong>urs investi dans la valorisation<br />
scientifique de ce projet en participant aux analyses statistiques et <strong>à</strong> la préparartion des<br />
communications et des publications.<br />
Au quotidien, je suis responsab<strong>le</strong> de l’équipe de gestion et de traitement des données qui est constituée<br />
de six personnes : un gestionnaire de bases de données, une attachée de recherche clinique et quatre
60<br />
opératrices de saisie. Mon rô<strong>le</strong> est de superviser la saisie des données, <strong>le</strong> codage des fiches<br />
d'événements cliniques graves, la mise <strong>à</strong> jour des thésaurus et l’apurement des données. Cette équipe a<br />
par ail<strong>le</strong>urs mis en place <strong>le</strong>s bases de données (biologie, cliniques, hospitalisations) avec l’aide des<br />
biostatisticiens de l’unité INSERM 593. Mon rô<strong>le</strong> consiste éga<strong>le</strong>ment <strong>à</strong> animer <strong>le</strong>s réunions de<br />
l’équipe du dépistage et de suivi et <strong>à</strong> rédiger <strong>le</strong>s rapports d'activités et du comité de pilotage.<br />
J'ai éga<strong>le</strong>ment assuré la coordination de l’étude CD4 chez <strong>le</strong>s femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH,<br />
de l’étude Ditrame Plus Safe ANRS 1209 et aussi de l’étude sur <strong>le</strong> consentement. Ces études sont<br />
présentées en détail dans cette thèse. Enfin, j’ai participé <strong>à</strong> la conception et <strong>à</strong> la planification des<br />
études de résistance aux antirétroviraux (étude ANRS 1263, Ditrame Plus Viro).<br />
2.3 Con<strong>texte</strong> de la mise en place : Etudes de base<br />
Le but de ces études était d'évaluer un ensemb<strong>le</strong> d'indicateurs nécessaires pour <strong>le</strong> dérou<strong>le</strong>ment<br />
des activités sanitaires de base dans <strong>le</strong>s FSUcom impliquées dans <strong>le</strong> projet. Ces indicateurs avaient un<br />
intérêt pour la conduite du projet Ditrame Plus.<br />
Deux études ont été ainsi conduites:<br />
- l'une évaluait <strong>le</strong>s connaissances vis-<strong>à</strong>-vis de l'infection par <strong>le</strong> VIH du personnel des FSUcom<br />
devant participer au projet (Etude n°1);<br />
- l'autre estimait <strong>le</strong>s activités dans <strong>le</strong>s consultations prénata<strong>le</strong>s et postnata<strong>le</strong>s dans ces FSUcom<br />
(Etude n°2)<br />
Etude N°1.<br />
Connaissances et attitudes vis-<strong>à</strong>-vis de l'infection par <strong>le</strong> VIH du personnel des Formations<br />
Sanitaires impliquées dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus<br />
Il s’agissait d’une étude transversa<strong>le</strong> menée auprès du personnel des FSUcom devant assister <strong>à</strong> la<br />
présentation du projet Ditrame Plus. Un auto-questionnaire anonyme comprenant des questions<br />
ouvertes et fermées permettait entre autres d’appréhender la signification des sig<strong>le</strong>s VIH et SIDA, la<br />
connaissance des maladies associées <strong>à</strong> l'infection par <strong>le</strong> VIH, la formation qu'ils avaient<br />
éventuel<strong>le</strong>ment déj<strong>à</strong> reçue pour la prise en charge des patients infectés, <strong>le</strong>ur comportement vis-<strong>à</strong>-vis<br />
des patients qu'ils savent infectés.<br />
Cette enquête montre que l’infection <strong>à</strong> VIH/SIDA reste encore mal connue du personnel soignant <strong>à</strong><br />
Abidjan, ceci donnant lieu <strong>à</strong> des attitudes inadéquates. La signification du sig<strong>le</strong> VIH était connue par<br />
59 (42,4%) de l’ensemb<strong>le</strong> du personnel, avec 18,9% de non réponse ou de réponse incomplète chez <strong>le</strong>s<br />
médecins. Globa<strong>le</strong>ment 17,3% de réponses incomplètes ou incorrectes ont été re<strong>le</strong>vées pour la<br />
signification du sig<strong>le</strong> SIDA. La réticence <strong>à</strong> soigner était citée par deux agents de santé (un médecin et
61<br />
un paramédical) et 28 (20,1%) des professionnels de santé se déclaraient être mal <strong>à</strong> l’aise devant <strong>le</strong>s<br />
sujets infectés par <strong>le</strong> VIH.<br />
Cette étude a été présentée <strong>à</strong> la conférence Africaine du VIH/SIDA et des MST <strong>à</strong> Ouagadougou en<br />
Décembre 2001 (Résumé 10BT5-2) et est actuel<strong>le</strong>ment soumise pour publication <strong>à</strong> la revue française<br />
Presse Médica<strong>le</strong>.<br />
Etude n°2.<br />
Comportements de santé des femmes consultant en Protection Maternel<strong>le</strong> et Infanti<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s<br />
Formations Sanitaires impliquées dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus.<br />
Il s’agit d’une enquête transversa<strong>le</strong> réalisée auprès de 260 femmes consultant en PMI dans <strong>le</strong>s<br />
FSUcom de Sagbé et d’Anonkoua-Kouté, de Niangon-Sud et de Port-Bouët II. Un questionnaire<br />
comprenant des informations sur <strong>le</strong> suivi prénatal (dont <strong>le</strong> nombre de consultations, la prévention de<br />
l'anémie gravidique et du paludisme), <strong>le</strong>s conditions d'accouchement, <strong>le</strong> mode d'alimentation de<br />
l'enfant depuis la naissance, et la planification familia<strong>le</strong>.<br />
Cette étude montre qu’en médiane, quatre consultations prénata<strong>le</strong>s avaient été réalisées lors de la<br />
dernière grossesse, au cours desquel<strong>le</strong>s la recherche d'albumine et de sucre dans <strong>le</strong>s urines était quasi<br />
systématique comme la vaccination anti-tétanique et la mise sous prophylaxie anti-paludéenne ou antianémique<br />
(> 90 %). Le groupage sanguin avait été pratiqué chez la moitié des femmes, la recherche<br />
d'une infection syphilitique et <strong>le</strong> dosage de l'hémoglobine chez moins d'un tiers des femmes. Selon la<br />
FSUcom, 3 <strong>à</strong> 23 % des femmes avaient accouché <strong>à</strong> domici<strong>le</strong>. Nos observations ont ainsi montré une<br />
assez bonne prise en charge prénata<strong>le</strong> dans ces FSUcom d’Abidjan mais aussi un certain nombre de<br />
difficultés quant aux conditions d'accouchement et du suivi postpartum.<br />
Les résultats de l’analyse des comportements des femmes pendant <strong>le</strong> suivi prénatal et postnatal ont été<br />
présentés <strong>à</strong> la conférence africaine du VIH/SIDA et des MST <strong>à</strong> Ouagadougou en Décembre 2001<br />
(Abstract 13PT2-693) et ont été récemment publiés dans la revue française de Gynécologie-<br />
Obstétrique & fertilité (annexe 1).<br />
Ces deux enquêtes ont permis une planification plus précise du projet Ditrame Plus.<br />
Le préalab<strong>le</strong> pour toutes <strong>le</strong>s études épidémiologiques et <strong>le</strong>s essais thérapeutiques est l’obtention d’un<br />
consentement éclairé. Il était bien sûr nécessaire avant la réalisation du test de dépistage VIH et<br />
l’inclusion des femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus. Nous avons voulu<br />
apporter une contribution sur <strong>le</strong> débat relatif <strong>à</strong> l’éthique de la recherche dans <strong>le</strong>s pays en voie de<br />
développement en réalisant une enquête sur un échantillon des femmes incluses au sein du projet<br />
Ditrame Plus et pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s un consentement avait été obtenu. Cette étude est ainsi présentée dans
62<br />
la suite de ce chapitre avant d’aborder la question de l’acceptabilité du dépistage et des interventions<br />
de PTME dans <strong>le</strong> chapitre suivant.
2.4 L’obtention du consentement des femmes enceintes infectées par <strong>le</strong> VIH<br />
et la participation au projet Ditrame Plus<br />
2.4.1 Con<strong>texte</strong> de l’étude<br />
La Déclaration d'Helsinki, élaborée par l'Association médica<strong>le</strong> mondia<strong>le</strong>, constitue une déclaration de<br />
principes éthiques dont l'objectif est de fournir des recommandations aux médecins et autres<br />
participants <strong>à</strong> la recherche médica<strong>le</strong> sur des êtres humains. Cel<strong>le</strong>-ci comprend <strong>le</strong>s études réalisées sur<br />
des données <strong>à</strong> caractère personnel ou des échantillons biologiques non anonymes (99).<br />
Les grands codes internationaux qui régissent l’expérimentation chez l’homme, et notamment, <strong>le</strong>s<br />
principes éthiques de la déclaration d’Helsinki, modifiée <strong>à</strong> Hong-Kong en septembre 1989, et <strong>à</strong> la 52e<br />
assemblée généra<strong>le</strong> qui s’est tenue <strong>à</strong> Edimbourg en octobre 2000 affirment que <strong>le</strong> bien-être du sujet<br />
doit toujours prévaloir sur <strong>le</strong>s besoins de la science ou <strong>le</strong>s intérêts de la société et imposent au médecin<br />
d’obtenir <strong>le</strong> «consentement libre et éclairé du sujet» avant sa participation <strong>à</strong> tout essai clinique ou<br />
projet de recherche (99).<br />
Ainsi <strong>le</strong>s sujets se prêtant <strong>à</strong> des recherches médica<strong>le</strong>s doivent être des volontaires informés des<br />
modalités de <strong>le</strong>ur participation au projet de recherche. Le sujet doit être informé qu'il a la faculté de ne<br />
pas participer <strong>à</strong> l'étude et qu'il est libre de revenir <strong>à</strong> tout moment sur son consentement sans crainte de<br />
préjudices. Après s'être assuré de la bonne compréhension par <strong>le</strong> sujet de l'information donnée, <strong>le</strong><br />
médecin doit obtenir son consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Lorsque <strong>le</strong><br />
consentement ne peut être obtenu sous forme écrite, la procédure de recueil doit être formel<strong>le</strong>ment<br />
explicitée et reposer sur l'intervention de témoins (99).<br />
Lors de l’élaboration initia<strong>le</strong> de ces règ<strong>le</strong>s et <strong>texte</strong>s, peu de recherches cliniques étaient réalisées dans<br />
<strong>le</strong>s pays en voie de développement. Les difficultés et <strong>le</strong>s spécificités des pays en voie de<br />
développement n’avaient donc pu être entièrement prises en compte dans ces <strong>texte</strong>s (100-102).<br />
63<br />
Avec la pandémie de l’infection <strong>à</strong> VIH en Afrique ont été menés dans <strong>le</strong>s pays en voie de<br />
développement, de nombreux projets de recherche ou essais thérapeutiques. Toutes ces études ont<br />
essayé de recueillir <strong>le</strong> consentement éclairé selon <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s strictes établies par la déclaration<br />
d’Helsinki. Des difficultés ont été ainsi rencontrées par de nombreux investigateurs compte tenu<br />
notamment du faib<strong>le</strong> niveau de scolarisation et de compréhension de la notice d’information par <strong>le</strong>s<br />
patients (100-102).<br />
Très peu d’études ont cependant été réalisées sur l’obtention du consentement éclairé chez <strong>le</strong>s patients<br />
infectés par <strong>le</strong> VIH-1 qui doivent participer <strong>à</strong> un projet de recherche en Afrique. Une étude qualitative<br />
a été réalisée au sein du projet ANRS 049 <strong>à</strong> Abidjan et une autre <strong>à</strong> Haïti (101, 102). Ces deux études<br />
ont décrit <strong>le</strong>s difficultés observées et critiqué <strong>le</strong> processus actuel<strong>le</strong>ment établi dans <strong>le</strong>s PVD pour<br />
l’obtention du recueil du consentement.
64<br />
Le projet Ditrame Plus a utilisé <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s éthiques formulées dans la déclaration d’Helsinki et selon la<br />
charte de la recherche dans <strong>le</strong>s pays du sud de l’ANRS. Il nous a paru nécessaire de documenter au<br />
sein du projet, <strong>le</strong> niveau de compréhension du formulaire de consentement éclairé signé par <strong>le</strong>s<br />
femmes infectées par <strong>le</strong> VIH ayant décidé de participer <strong>à</strong> ce projet. L’intérêt de cette étude était de<br />
savoir si <strong>le</strong>s approches actuel<strong>le</strong>ment utilisées sont adaptées dans <strong>le</strong> con<strong>texte</strong> de la pandémie africaine <strong>à</strong><br />
VIH.<br />
Cette étude a fait l’objet d’une publication dans AIDS sous forme d’une <strong>le</strong>ttre de recherche qui figure<br />
<strong>à</strong> la fin de ce chapitre.<br />
2.4.2 Objectifs<br />
Notre étude a voulu répondre <strong>à</strong> trois questions :<br />
• Quel est <strong>le</strong> niveau de compréhension de la notice d’information distribuée aux personnes<br />
participant <strong>à</strong> une recherche médica<strong>le</strong> et thérapeutique en Afrique <br />
• Quel<strong>le</strong> notice d’information faut–il utiliser chez <strong>le</strong>s personnes participant aux études cliniques<br />
dans <strong>le</strong>s pays en voie de développement <br />
• Les principes qui s’appliquent aux patients dans <strong>le</strong>s pays développés doivent-ils être appliqués<br />
<strong>à</strong> l’identique en Afrique <br />
Les objectifs spécifiques de notre étude étaient ainsi de décrire <strong>le</strong> processus pour <strong>le</strong> recueil du<br />
consentement et d’étudier <strong>le</strong> niveau de compréhension (<strong>le</strong>cture et compréhension de la notice<br />
d’information) chez <strong>le</strong>s femmes incluses dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus et qui ont signé un consentement<br />
éclairé.<br />
2.4.3 Méthodes<br />
Une enquête transversa<strong>le</strong> a été réalisée pendant deux mois sur un échantillon des femmes incluses<br />
dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus.<br />
Les Critères d’inclusion pour cette étude étaient <strong>le</strong>s suivants :<br />
• Toutes <strong>le</strong>s femmes enceintes incluses dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus vues au centre de suivi<br />
pendant la période de l’étude;<br />
• Avoir signé un consentement éclairé pour participer au projet Ditrame Plus;<br />
• Etre encore suivies dans <strong>le</strong> projet après la naissance d’un enfant vivant.
65<br />
Pour cette étude transversa<strong>le</strong>, nous n’avons pas fait de calcul du nombre de sujets nécessaire. Toutes<br />
<strong>le</strong>s femmes vues consécutivement pendant la période de l’étude ont eu la proposition de participer <strong>à</strong><br />
cette enquête.<br />
L’enquête comprenait un entretien individuel réalisé dans <strong>le</strong> dia<strong>le</strong>cte de la femme interrogée complété<br />
par un questionnaire donné par <strong>le</strong>s conseillères du projet. Cet entretien a duré en moyenne 30 minutes<br />
incluant <strong>le</strong> remplissage du questionnaire (annexe 2). Après l’entretien, <strong>le</strong> formulaire de consentement<br />
était récupéré dans <strong>le</strong>s archives du projet pour vérifier <strong>le</strong>s données suivantes :<br />
• Numéro de la patiente<br />
• Nom et prénoms de la patiente<br />
• Nom et prénoms du médecin<br />
• Signature de la patiente<br />
• Signature du médecin<br />
Après vérification de la complétude des questionnaires, <strong>le</strong>s données ont été saisies avec <strong>le</strong> logiciel<br />
Epidata 2.1. L’analyse des données a été réalisée avec <strong>le</strong> logiciel Stata 6.0.<br />
2.4.4 Résultats<br />
Au total, 55 femmes infectées par <strong>le</strong> VIH-1, incluses dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus ont accepté de<br />
participer <strong>à</strong> cette étude. L’interview a eu lieu en médiane 136 jours après la date de la signature du<br />
consentement éclairé correspondant au jour d’inclusion dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus. L’interview a été<br />
réalisée dans <strong>le</strong> dia<strong>le</strong>cte local c'est-<strong>à</strong>-dire en « Dioula » chez 26 femmes soit 47,3% des femmes et en<br />
français pour <strong>le</strong>s autres. L’âge médian était de 26 ans. Cette population était composée de 26 (47,3%)<br />
femmes analphabètes, 21 (38,2%) avaient réalisé des études primaires et 8 (14,5%) avaient réalisé des<br />
études secondaires ou supérieures.<br />
En vérifiant <strong>le</strong> formulaire de consentement, <strong>le</strong> nom et <strong>le</strong> prénom du médecin étaient bien mentionnés<br />
dans tous <strong>le</strong>s cas. Il n’y a généra<strong>le</strong>ment pas <strong>le</strong> nom de la patiente sur ce formulaire mais uniquement <strong>le</strong><br />
numéro attribué aux femmes <strong>à</strong> l’inclusion.<br />
On note que toutes <strong>le</strong>s femmes avaient signé <strong>le</strong> formulaire. Cependant, plus de la moitié des femmes<br />
(27/55) avaient signé ce formulaire en apposant <strong>le</strong>ur empreinte digita<strong>le</strong>. El<strong>le</strong>s étaient toutes<br />
analphabètes. Le formulaire de consentement éclairé avait été effectivement contresigné par <strong>le</strong>s<br />
médecins.<br />
Nous avons cependant noté dans <strong>le</strong>s entretiens que seu<strong>le</strong>ment 44 femmes (81,5%) se souvenaient<br />
d’avoir signé un formulaire de consentement éclairé (tab<strong>le</strong>au 10). Parmi ces femmes, 42 ont déclaré<br />
avoir reçu la notice d’information.
66<br />
Seu<strong>le</strong>ment 48% des femmes ont déclaré avoir compris <strong>le</strong>s informations contenues dans la notice après<br />
<strong>le</strong>s explications données par <strong>le</strong> médecin et seu<strong>le</strong>ment sept femmes incluses dans cette étude ont déclaré<br />
avoir lu réel<strong>le</strong>ment la notice d’information du projet Ditrame Plus.<br />
Nous avons noté enfin que parmi <strong>le</strong>s 35 femmes qui n’ont pas lu la notice d’information, 71% ont<br />
déclaré qu’el<strong>le</strong>s ne savaient pas lire. Dix femmes (18%) ont posé des questions aux médecins pour<br />
connaître <strong>le</strong>s risques et <strong>le</strong>s bénéfices attendus concernant <strong>le</strong> suivi de <strong>le</strong>ur enfant. Cependant, toutes <strong>le</strong>s<br />
femmes savaient la principa<strong>le</strong> raison de <strong>le</strong>ur suivi dans <strong>le</strong> projet<br />
Le tab<strong>le</strong>au 10 synthétise <strong>le</strong>s principaux résultats obtenus.<br />
Tab<strong>le</strong>au 10. Procédure d’obtention du consentement éclairé et niveau de compréhension de la<br />
notice d’information chez <strong>le</strong>s femmes infectées par <strong>le</strong> VIH-1 participant au projet ANRS<br />
1201/1202 Ditrame Plus <strong>à</strong> Abidjan, Côte d’Ivoire (2001).<br />
Effectif Pourcentage<br />
Procédure d’obtention du consentement<br />
Se souvient d’avoir signé <strong>le</strong> consentement de l’étude 44/55 81,5<br />
Se souvient d’avoir reçu la notice d’information 42/55 76,5<br />
Se souvient d’avoir reçu des explications concernant <strong>le</strong> projet par <strong>le</strong> médecin* 39/42 95,1<br />
Déclare avoir compris <strong>le</strong>s informations et <strong>le</strong>s explications données par <strong>le</strong> 20/42 47,6<br />
médecin de l’étude*<br />
Se souvient d’avoir lu la notice d’information* 7/42 16,7<br />
Droit des patients; la femme a compris qu’el<strong>le</strong> avait la possibilité de :<br />
Arrêter <strong>à</strong> tout moment sa participation <strong>à</strong> l’étude 15/55 27,3<br />
Arrêter <strong>le</strong>s traitements de l’étude <strong>à</strong> tout moment 9/55 16,4<br />
Voir <strong>à</strong> tout moment <strong>le</strong>s médecins du projet 50/55 90,9<br />
Que <strong>le</strong>s données individuel<strong>le</strong>s recueillies seraient informatisées 3/55 5,5<br />
* parmi <strong>le</strong>s femmes ayant reçu la notice d’information<br />
2.4.5 Discussion<br />
Nous avons ainsi montré au travers de cette étude que l’obtention du consentement éclairé était<br />
réalisée dans <strong>le</strong>s conditions norma<strong>le</strong>s selon <strong>le</strong>s standards internationaux puisque <strong>le</strong> nom du médecin et<br />
la signature ou empreintes digita<strong>le</strong>s du malade ont été recueillis dans 100% des cas. Cependant, la<br />
bonne compréhension de la recherche n’est pas toujours garantie principa<strong>le</strong>ment <strong>à</strong> cause du niveau<br />
scolaire bas des participants. Ces observations ont été faites éga<strong>le</strong>ment dans d’autres pays en voie de<br />
développement comme au Bangladesh (100) et en Haïti (101). Les mêmes observations ont été notées<br />
dans certains pays industrialisés comme en Suède (103).
67<br />
L’étude en Haïti a montré que l’obtention d’un consentement éclairé par <strong>le</strong> médecin ne garantit pas<br />
toujours une bonne compréhension des objectifs de l’étude (101).<br />
Il décou<strong>le</strong> de ces observations que dans <strong>le</strong>s pays en voie de développement une attitude moins rigide<br />
s’impose tenant compte essentiel<strong>le</strong>ment de trois facteurs : <strong>le</strong> niveau scolaire, <strong>le</strong> con<strong>texte</strong> culturel et <strong>le</strong><br />
con<strong>texte</strong> socio-économique.<br />
On notera que <strong>le</strong> Département VIH/SIDA de l’OMS a organisé une réunion spécia<strong>le</strong> en juin 2003 pour<br />
faire des recommandations plus conformes aux situations rencontrées dans <strong>le</strong>s pays en voie de<br />
développement (tab<strong>le</strong>au 11).<br />
Tab<strong>le</strong>au 11. Propositions de l’Organisation Mondia<strong>le</strong> de la Santé pour améliorer l’obtention du<br />
consentement des patients souhaitant participer <strong>à</strong> un essai thérapeutique dans <strong>le</strong>s pays en voie<br />
de développement. (Extrait des conclusions de la réunion du département du VIH/SIDA de<br />
l’OMS, Genève 2003).<br />
1. Simplifier <strong>le</strong> formulaire: limiter <strong>le</strong> questionnaire <strong>à</strong> une page, utiliser un langage simp<strong>le</strong><br />
2. Offrir la possibilité d’utiliser plusieurs langues<br />
3. Possibilité d’obtenir <strong>le</strong> consentement oral : lire <strong>le</strong> formulaire de consentement aux participants<br />
4. Réaliser des discussions de groupe : former des groupes de participants et <strong>le</strong>ur expliquer <strong>le</strong> protoco<strong>le</strong><br />
5. Réaliser des sessions de questions-réponses après avoir expliqué <strong>le</strong> protoco<strong>le</strong> avant de prendre la décision<br />
fina<strong>le</strong> de participer <strong>à</strong> l’étude<br />
Notre étude bien que limitée en effectif apporte une nouvel<strong>le</strong> contribution sur l’éthique dans <strong>le</strong>s pays<br />
en voie de développement en particulier dans <strong>le</strong> champ de la recherche VIH en Afrique.
68<br />
Chapitre 3<br />
Acceptabilité du dépistage VIH prénatal et des<br />
interventions peripartum de PTME<br />
« N'imaginons pas que nous pouvons nous contenter de distribuer des médicaments et nous dispenser<br />
de toute autre action. Nous devons faire évoluer <strong>le</strong>s comportements, <strong>le</strong>s attitudes. Et il faut procéder de<br />
façon organisée, disciplinée et systématique ».<br />
Bill Clinton (Président des Etats-Unis)<br />
17 février 2000
3.1. Dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 chez la femme enceinte en Afrique<br />
69<br />
3.1.1. Introduction<br />
Les techniques diagnostiques ont beaucoup évolué depuis la commercialisation en 1985 des premiers<br />
tests de détection du virus ou des anticorps dirigés contre <strong>le</strong> virus (104, 105, 106, 107). Le dépistage<br />
de l'infection <strong>à</strong> VIH-1 chez la femme enceinte peut se faire par des tests classiques de type ELISA et<br />
maintenant <strong>le</strong> plus souvent par des tests rapides (108). Pour <strong>le</strong> dépistage de l'infection <strong>à</strong> VIH en<br />
Afrique, <strong>le</strong>s tests rapides offrent en effet un certain nombre d'avantages, outre <strong>le</strong>ur coût de plus en plus<br />
faib<strong>le</strong> et de plus en plus fréquemment couvert par des donations et <strong>le</strong>ur simplicité de manipulation.<br />
L’utilisation des tests simp<strong>le</strong>s/rapides permet de raccourcir la période qui s’écou<strong>le</strong> entre <strong>le</strong> test de<br />
dépistage et <strong>le</strong> début de l’intervention (108).<br />
Ce chapitre présente tout d’abord brièvement <strong>le</strong>s avantages et <strong>le</strong>s limites de chaque test et <strong>le</strong>s<br />
implications de <strong>le</strong>ur utilisation en termes de santé publique. Nous présenterons dans la suite de ce<br />
chapitre notre étude sur l’évaluation des tests rapides pour <strong>le</strong> dépistage de l'infection <strong>à</strong> VIH chez la<br />
femme enceinte <strong>à</strong> Abidjan, Côte d'Ivoire.<br />
3.1.2. Test ELISA<br />
3.1.2.1 Principes généraux<br />
Les anticorps anti-VIH sont détectés <strong>à</strong> la suite d’une réaction antigène-anticorps. Ceci est visualisé<br />
grâce <strong>à</strong> la technique ELISA « enzyme linked immunosorbent assay » qui est <strong>le</strong> test <strong>le</strong> plus utilisé pour<br />
<strong>le</strong> diagnostic de l’infection <strong>à</strong> VIH (106, 107). Le diagnostic de l'infection <strong>à</strong> VIH repose dans ce cas sur<br />
la mise en évidence des anticorps anti-VIH. On observe la fixation d’une enzyme qui transforme un<br />
substrat incolore en substrat coloré mis en évidence au spectophotomètre. Ce test a connu des<br />
évolutions depuis l’apparition des tests de première génération <strong>à</strong> base de lysats de cellu<strong>le</strong>s infectées<br />
contenant des protéines vira<strong>le</strong>s et cellulaires, puis de deuxième génération et maintenant de troisième<br />
génération. La particularité des tests de 2 ème et de 3 ème génération est l’introduction de protéines<br />
recombinées et d’antigènes peptidiques de synthèse. La spécificité des tests ainsi que <strong>le</strong>ur sensibilité<br />
ont ainsi été améliorées. Les tests ELISA ont aussi permis une détection plus précoce des<br />
séroconversions avec une moyenne de 10 jours pour <strong>le</strong>s tests de 2 ème génération et de 5 jours pour <strong>le</strong>s<br />
tests de 3 ème génération.<br />
Les tests de quatrième génération sont apparus en 1998. Ils combinent un test ELISA de 2 ème et de 3 ème<br />
génération, avec la détection des anticorps avec cel<strong>le</strong> de l’antigène de capside p24 du VIH-1 (109).<br />
Ceci permettra de détecter l’antigène et l’anticorps du VIH par un seul test. Ces derniers tests peuvent
70<br />
ainsi assurer une détection plus précoce du stade initial de l’infection (en moyenne 5 jours après<br />
l’apparition des anticorps IgM).<br />
Dans <strong>le</strong>s tests actuel<strong>le</strong>ment disponib<strong>le</strong>s on peut citer :<br />
• Vironistika HIV Uni-Form II plus O ® (Organon Teknika, Boxtel, The Netherlands)<br />
• Murex HIV-1.2.0 ® (Abbot Laboratories, Abbot, Park, IL, USA)<br />
Les tests Elisa ont une sensibilité (100%) et une spécificité (>99%) très é<strong>le</strong>vées pour détecter <strong>le</strong> VIH-<br />
1, <strong>le</strong> VIH-2 et <strong>le</strong>s variants du VIH. Mais <strong>le</strong>s tests ELISA sont destinés aux titrages par lot, c'est-<strong>à</strong>-dire<br />
au dépistage de 96 échantillons par jour ou plus. Ces tests ELISA demandent un matériel sophistiqué<br />
et sont techniquement diffici<strong>le</strong>s <strong>à</strong> réaliser. Le matériel minimum requis est : pipettes, étuves, laveurs et<br />
<strong>le</strong>cteurs é<strong>le</strong>ctriques et une alimentation é<strong>le</strong>ctrique constante. De plus, ces matériels doivent être<br />
régulièrement entretenus et ajustés pour garantir la validité des résultats qui repose sur la compétence<br />
de techniciens qui préparent correctement <strong>le</strong>s réactifs nécessaires et effectuent <strong>le</strong> pipetage avec<br />
précision. En Afrique, ces tests ELISA sont donc seu<strong>le</strong>ment réalisés dans <strong>le</strong>s grandes vil<strong>le</strong>s où existe<br />
un minimum d'équipement biologique et de personnel dans <strong>le</strong>s laboratoires de bon niveau. Le nombre<br />
de techniciens formés est limité et la réalisation du diagnostic dans <strong>le</strong>s zones rura<strong>le</strong>s voire urbaines<br />
reste souvent problématique. Les conditions requises pour appliquer des tests ELISA ne sont toujours<br />
pas réunies. Enfin des réactivités faussement positives avec la performance intrinsèque des tests<br />
ELISA sont encore possib<strong>le</strong>s nécessitant l’apport de test de confirmation dans certains cas.<br />
3.1.3 Test Western-blot<br />
3.1.3.1 Principes généraux<br />
Le Western-blot est la technique de référence pour la confirmation de l’infection <strong>à</strong> VIH (109, 110).<br />
Les protéines vira<strong>le</strong>s sont séparées par é<strong>le</strong>ctrophorèse et transférées sur membrane nitrocellulose. Les<br />
anticorps dirigés contre une protéine vira<strong>le</strong> sont visualisés par une réaction immuno-enzymatique sous<br />
forme de bande colorée.<br />
En France, on considère qu’un résultat est positif que ce soit VIH-1 ou VIH-2, uniquement s’il y a<br />
présence d’anticorps dirigés contre <strong>le</strong>s protéines d’enveloppes (gp160, gp120, gp41 pour <strong>le</strong> VIH-1 et<br />
gp140, gp105, gp36 pour <strong>le</strong> VIH-2), associés <strong>à</strong> au moins un anticorps dirigé contre une protéine<br />
interne de virus, soit deux bandes en V plus une bande gag (p55, p24, p18) ou pol (p68, p34).<br />
Le test Western-blot reste bien aujourd’hui <strong>le</strong> test de référence pour la confirmation de l’infection <strong>à</strong><br />
VIH. Il n’y a cependant pas de consensus sur l’interprétation des résultats du test Western-blot qui est<br />
moins sensib<strong>le</strong> que <strong>le</strong> test ELISA et est indiqué que si ce dernier est positif.
71<br />
3.1.4 Tests rapides<br />
Il existe toute une série de tests rapides qui sont de grande qualité. Ces tests présentent des avantages<br />
pour <strong>le</strong> dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH en Afrique. Les résultats qu’ils donnent sont très semblab<strong>le</strong>s <strong>à</strong><br />
ceux des tests ELISA. L’OMS recommande donc l’utilisation des tests rapides fiab<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong>s<br />
situations où <strong>le</strong>s caractéristiques opérationnel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s rendent plus appropriés que <strong>le</strong>s tests ELISA (108).<br />
3.1.4.1 Principes généraux<br />
Ils permettent la détection rapide des anticorps anti-VIH dans <strong>le</strong> sang total, <strong>le</strong> sérum et <strong>le</strong> plasma, mais<br />
éga<strong>le</strong>ment dans la salive et dans <strong>le</strong>s urines. Les progrès de la technologie ont conduit <strong>à</strong> mettre au point<br />
toute une série de tests rapides qui font appel <strong>à</strong> une agglutination ou <strong>à</strong> une absorption du comp<strong>le</strong>xe sur<br />
une membrane puis une coloration visib<strong>le</strong> <strong>à</strong> l’œil nu.<br />
Ces tests sont présentés sous forme de nécessaires d’épreuve (kits) qui n’exigent aucun autre réactif ni<br />
matériel. La possibilité d’obtenir des résultats exacts dépend bien sûr toujours non seu<strong>le</strong>ment des<br />
qualités intrinsèques du test lui-même mais aussi des facteurs extrinsèques tels que <strong>le</strong>s compétences de<br />
celui qui l’applique et <strong>le</strong> respect de normes rigoureuses par <strong>le</strong> laboratoire dans <strong>le</strong>quel il est appliqué.<br />
3.1.4.2 Avantages<br />
- Pas d’utilisation de réactif ou d’autre matériel ;<br />
- Technique faci<strong>le</strong> <strong>à</strong> appliquer ;<br />
- Applicab<strong>le</strong> par du personnel n’ayant aucune formation spécia<strong>le</strong> en laboratoire;<br />
- Interprétation simp<strong>le</strong> des résultats avec un contrô<strong>le</strong> de qualité interne qui valide chaque<br />
résultat ;<br />
- Obtention d’un résultat en quelques minutes ;<br />
- Soup<strong>le</strong>sse dans <strong>le</strong> nombre de tests <strong>à</strong> effectuer <strong>à</strong> un moment donné ;<br />
- Réfrigération non indispensab<strong>le</strong> ; <strong>le</strong>s tests rapides peuvent être conservés <strong>à</strong> des températures<br />
variant entre 2°C et 30°C.<br />
- Résultats de qualité analogue aux tests ELISA,<br />
- Résultats aussi précis que <strong>le</strong>s tests ELISA (test fiab<strong>le</strong> et sensib<strong>le</strong>).<br />
3.1.4.3. Inconvénients<br />
Les tests rapides permettent de déce<strong>le</strong>r avec quelques jours de retard par rapport aux tests ELISA une<br />
séroconversion. La différence observée n’est cependant pas statistiquement significative. Enfin, ils<br />
sont moins sensib<strong>le</strong>s, notamment lors de la séroconversion, en comparaison avec <strong>le</strong>s tests de 3 ème<br />
génération.
72<br />
3.1.4.4. Présentation des différents tests rapides<br />
Nous résumons dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 12 <strong>le</strong>s différents tests rapides disponib<strong>le</strong>s.<br />
Tab<strong>le</strong>au 12. Présentation des différents tests sérologiques rapides disponib<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong> diagnostic<br />
de l’infection <strong>à</strong> VIH en Afrique.<br />
Tests rapides Principes Prélèvements Anticorps<br />
Determine TM<br />
(Abbot laboratories, IL, USA )<br />
Immunochromatographie<br />
Sérum, Plasma, Sang total VIH-1 et VIH-2<br />
InstantScreen TM<br />
(GAIFAR GmbH, Potsdam, Germany)<br />
Immunochromatographie<br />
Sérum, Plasma, Sang total VIH-1 et VIH-2<br />
Advanced Quality TM<br />
(InTec Products Inc., Xiamen, China)<br />
Immunochromatographie<br />
Sérum, Plasma, Sang total VIH-1 et VIH-2<br />
MedMira TM<br />
(MedMira Inc., Toronto, Canada )<br />
Immunofiltration<br />
Sérum, Plasma, Sang total VIH-1 et VIH-2<br />
First Reponse TM<br />
(PMC Medical Pty. Ltd., Daman,<br />
India)<br />
Immunochromatographie<br />
Sérum, Plasma, Sang total VIH-1 et VIH-2<br />
Capillus TM<br />
(Trinity Biotech PLC., Bray, Ireland)<br />
Agglutination avec latex<br />
Sérum, Plasma, Sang total VIH-1 et VIH-2<br />
Uni-Gold TM<br />
(Trinity Biotech PLC., Bray, Ireland)<br />
Immunochromatographie<br />
Sérum, Plasma, Sang total VIH-1 et VIH-2<br />
Genie II TM<br />
(Bio-Rad, Marnes-La-Coquette,<br />
France)<br />
Immunochromatographie<br />
Sérum, Plasma, Sang total VIH-1 et VIH-2<br />
De nombreuses études ont été réalisées dans <strong>le</strong>s pays en voie de développement pour étudier la va<strong>le</strong>ur<br />
intrinsèque des tests rapides. Dans toutes ces études, <strong>le</strong> test ELISA a été <strong>le</strong> test de référence. Le<br />
tab<strong>le</strong>au 13 présente une synthèse de l’évaluation des principaux tests rapides étudiés. On observe<br />
globa<strong>le</strong>ment que la sensibilité des test rapides varie entre 98,4% et 100% et la spécificité entre 97,3%<br />
et 100%.
73<br />
Tab<strong>le</strong>au 13. Sensibilité et spécificité des tests rapides utilisés dans <strong>le</strong>s pays en voie de développement pour <strong>le</strong> diagnostic de l’infection <strong>à</strong> VIH<br />
Tests rapides (Fabricant) Publication Sensibilité (%)<br />
(IC95%)<br />
Spécificité (%)<br />
(IC95%)<br />
Determine TM<br />
(Abbot Laboratories, Tokyo, Japan) Palmer CJ et al. (J Clin Microbiol, 1999)<br />
Koblavi-Deme S et al. (J Clin Microbiol, 2001)<br />
Wilkinson D et al. (AIDS, 1999)<br />
Urassa W et al. (J Virol Methods, 2002)<br />
100% (96,4 – 100)<br />
100%<br />
100% (97,9-100)<br />
97,9%<br />
100 (94,6 – 100)<br />
99,4% (98,7-99,9)<br />
99,6% (97,2-100)<br />
ND<br />
Capillus TM<br />
(Cambridge, Diagnostics Ireland<br />
Limited, Galway , Ireland)<br />
Dowing RG et al. (JAIDS, 1998)<br />
Koblavi-Deme S et al. (J Clin Microbiol, 2001)<br />
Anderson S et al. (AIDS, 1997)<br />
Urassa W et al. (J Virol Methods, 2002)<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
97,3%<br />
99,7% (99,1-99,9)<br />
99,8 (99,2 – 100)<br />
98,7%<br />
Genie II TM<br />
(Bio-Rad, Marnes-La-Coquette, France)<br />
Harrison C et al. (AIDS, 1997)<br />
Koblavi-Deme S et al. (J Clin Microbiol, 2001)<br />
99,3% (95,9 – 100)<br />
100%<br />
100% (99,7 – 100)<br />
100% (99,5-100)<br />
Serocard TM<br />
(Trinity Biotech PLC., Bray, Ireland)<br />
Sero-Trip TM<br />
(Saliva Diagnostic Systems, Singapore)<br />
Enzygnost TM<br />
(Behringwerke Marking Germany)<br />
ND : Non disponib<strong>le</strong>, IC=Interval<strong>le</strong> de confiance.<br />
Dowing RG et al. (JAIDS, 1998)<br />
100%<br />
Urassa W et al. (J Virol Methods, 2002)<br />
100%<br />
99,5%<br />
98,2%<br />
Dowing RG et al. (JAIDS, 1998) 98,4% 100,0%<br />
Anderson S et al. (AIDS, 1997) 100% 98,0 (96,9 – 98,9)
74<br />
3.1.5. Evaluation sur <strong>le</strong> terrain de deux tests rapides utilisés en série pour <strong>le</strong> diagnostic<br />
et la différenciation des VIH-1, VIH-2 et des coinfections VIH-1 +2 chez <strong>le</strong>s femmes<br />
enceintes dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus<br />
Nous avons utilisé deux tests rapides dans <strong>le</strong> cadre du projet Ditrame Plus pour <strong>le</strong> diagnostic de<br />
l’infection maternel<strong>le</strong> <strong>à</strong> VIH-1 centres de dépistage selon <strong>le</strong>s recommandations de l’OMS (108). Très<br />
peu de contrô<strong>le</strong>s de qualité ont été publiés en Afrique par <strong>le</strong>s équipes utilisant ces tests rapides en<br />
routine. De plus, la majorité des évaluations réalisées en Afrique subsaharienne ont été faites<br />
rétrospectivement sur des échantillons stockés et sur un nombre très limité d’échantillons sanguins.<br />
Enfin, Abidjan est un con<strong>texte</strong> virologique intéressant dans la mesure où <strong>le</strong> virus de type 1 et 2<br />
coexiste. Ceci a des implications pour la PTME et d’une manière généra<strong>le</strong> pour la prise en charge<br />
(PEC) dans la mesure où l’infection <strong>à</strong> VIH-2 seu<strong>le</strong>, bien que rare contre-indique l’utilisation des INN<br />
dont la NVP.<br />
3.1.5.1 Questions de recherche<br />
• Quel<strong>le</strong> est la sensibilité et la spécificité des tests rapides utilisés sur <strong>le</strong>s sites de dépistage du<br />
projet Ditrame Plus pour <strong>le</strong> diagnostic de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 chez la femme enceinte <strong>à</strong> Abidjan <br />
• Quel<strong>le</strong> est la va<strong>le</strong>ur discriminante du test Génie II ® pour <strong>le</strong> diagnostic des sous types de VIH <br />
3.1.5.2. Objectif<br />
L’objectif de cette étude était de valider <strong>le</strong>s tests rapides utilisés dans <strong>le</strong>s laboratoires périphériques<br />
pour <strong>le</strong> dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 chez <strong>le</strong>s femmes enceintes participant au projet Ditrame Plus<br />
et de proposer un algorithme décisionnel plus adapté.<br />
3.1.5.3. Méthodologie<br />
• Population étudiée<br />
La population d’étude était constituée de femmes enceintes :<br />
- vues en consultation prénata<strong>le</strong>, de rang 1 dans <strong>le</strong>s centres de dépistage du projet Ditrame Plus<br />
- âgées de plus de 18 ans<br />
- ayant signé un consentement éclairé<br />
- dont la hauteur utérine est supérieure <strong>à</strong> 16 cm<br />
- avec qui la communication est possib<strong>le</strong> pour un conseil prétest
75<br />
• Cadre de l’étude<br />
L’étude s’est déroulée dans <strong>le</strong>s six centres de dépistage du projet Ditrame Plus. Ces centres sont situés<br />
dans <strong>le</strong>s deux plus grandes communes de la vil<strong>le</strong> d’Abidjan. Dans la commune de Yopougon, <strong>le</strong><br />
dépistage était réalisé dans trois FSUcom notamment de Toit Rouge, de Ouassakara et de Niangon<br />
Sud. Dans la commune d’Abobo, <strong>le</strong> dépistage était éga<strong>le</strong>ment réalisé dans trois FSUcom :<br />
Anonkouakouté, Avocatier et Sagbé.<br />
Le contrô<strong>le</strong> de qualité a été réalisé au CeDReS qui est <strong>le</strong> laboratoire de référence du CHU de<br />
Treichvil<strong>le</strong>.<br />
• Algorithme du dépistage proposé dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus<br />
La figure 2 présente la procédure mise au point dans <strong>le</strong> cadre du projet ANRS pour <strong>le</strong> dépistage de<br />
l’infection <strong>à</strong> VIH chez la femme enceinte.
76<br />
Sur site : laboratoires FSU<br />
(rendu des résultats dans 24 heures)<br />
Prélèvement 1 (Test rapide 1)<br />
Determine ® (Abbot)<br />
Indéterminé Positif Négatif<br />
Test rapide 2<br />
Genie 2 ® (Pasteur)<br />
sur même prélèvement<br />
Rendre Résultat<br />
NEGATIF<br />
Indéterminé<br />
Négatif<br />
Positif<br />
Ne pas rendre de résultats<br />
(confirmation nécessaire)<br />
Rendre<br />
Résultat positif<br />
Au CeDReS<br />
(résultats dans une semaine)<br />
*Confirmation inclusion dans DP<br />
Prélèvement 2 : deux tests ELISA<br />
Murex Ice 1-2.0 et Organon HIV Uniform 2+0<br />
2 tests discordants 2 tests négatifs 2 tests positifs<br />
Ne pas rendre de résultat<br />
Examen complémentaire<br />
au cas par cas<br />
(nouveau prélèvement <strong>à</strong> prévoir)<br />
Rendre résultat<br />
NEGATIF<br />
Rendre résultat<br />
POSITIF<br />
Figure 2. Algorithme de dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH pour <strong>le</strong>s femmes enceintes proposé dans<br />
<strong>le</strong> projet Ditrame Plus.
77<br />
3.1.5.4. Réalisation et interprétation des tests rapides<br />
• Réalisation du test Determine ® et interprétation des résultats<br />
Le test Determine ® (Abbot) est un test immunochromatographique <strong>à</strong> <strong>le</strong>cture visuel<strong>le</strong> pour la détection<br />
qualitative des anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2 dans <strong>le</strong> sérum, <strong>le</strong> plasma ou <strong>le</strong> sang total.<br />
Après <strong>le</strong> prélèvement de sang, l’échantillon est déposé sur la zone dépôt de la bande<strong>le</strong>tte de la fenêtre<br />
patient. On observe alors une migration de l’échantillon. Cette migration du sérum se mélange avec <strong>le</strong><br />
conjugué colloïde de se<strong>le</strong>nium-antigène. Ce mélange continue <strong>à</strong> migrer sur la phase solide jusqu’aux<br />
antigènes recombinants immobilisés et aux peptides synthétiques au niveau de la fenêtre du patient. Si<br />
<strong>le</strong>s anticorps anti-VIH-1 et/ ou anti-VIH-2 sont présents dans l’échantillon, il se lient <strong>à</strong> l’antigène du<br />
conjugué antigène colloïde de sélénium et <strong>à</strong> l’antigène de la fenêtre patient en formant une ligne rouge<br />
dans la fenêtre patient. Si <strong>le</strong>s anticorps anti-VIH-1 et/ ou anti-VIH-2 sont absents dans l’échantillon, <strong>le</strong><br />
conjugué antigène colloïde de sélénium traverse la fenêtre patient sans former de ligne rouge. La<br />
fenêtre de contrô<strong>le</strong> ou témoin sur la bande<strong>le</strong>tte présente une ligne rouge pour assurer <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de<br />
qualité interne et la validité du test.<br />
La photo 2 réalisée dans <strong>le</strong> centre de Santé de Niangon Sud, vous présente :<br />
- Un résultat d’un test positif : <strong>le</strong>s deux barres rouges apparaissent dans la fenêtre contrô<strong>le</strong> (annoté<br />
« Control ») et la fenêtre patient (annoté « Patient »).<br />
- Un résultat d’un test négatif : une barre rouge apparaît dans la fenêtre contrô<strong>le</strong> (annoté « Control ») et<br />
aucune bande n’apparaît dans la fenêtre patient (annoté « Patient »).<br />
- Un résultat est non valide : si aucune barre n’apparaît dans la fenêtre contrô<strong>le</strong> (annoté « Control ») et<br />
même si une barre rouge apparaît dans la fenêtre patient (annoté « Patient »). Le résultat n’est pas valide<br />
et <strong>le</strong> test doit être recommencé.<br />
Photo 2. Dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH. Résultat d’un test VIH positif et négatif par <strong>le</strong><br />
Determine ® obtenus sur <strong>le</strong> site de Niangon-Sud, Abidjan, Côte d’Ivoire, 2003.
78<br />
• Réalisation du Génie II ® et interprétation des résultats<br />
Le test Génie II ® est un test immuoenzymatique rapide basé sur la détection spécifique des anticorps<br />
anti VIH-1 et VIH-2 présents dans <strong>le</strong> sérum ou <strong>le</strong> plasma humain par des antigènes. Le test utilise<br />
l’immuno-chromatographie et l’immuno-concentration en combinaison.<br />
Le support de réaction est constitué de deux puits : <strong>le</strong> puits A de forme circulaire, pour <strong>le</strong> dépôt de<br />
l’échantillon et <strong>le</strong> puits B plus grand et elliptique, qui est <strong>le</strong> puits de réaction.<br />
Pour la réalisation du test, on dépose dans <strong>le</strong> puit A l’échantillon dilué. Les anticorps anti-VIH<br />
contenus dans l’échantillon se fixent spécifiquement aux antigènes biotinylés et migrent <strong>le</strong> long de la<br />
membrane chromatographique. Au niveau du puits de réaction B, <strong>le</strong>s comp<strong>le</strong>xes antigènes –anticorps<br />
se lient aux antigènes VIH immobilisés au cours d’une étape de doub<strong>le</strong> reconnaissance. Le comp<strong>le</strong>xe<br />
résultant réagit avec un conjugué streptavidine-phospahatase alcaline.<br />
L’apparition de deux ou trois spots gris b<strong>le</strong>u dans <strong>le</strong> puits B indique la présence d’anticorps anti-VIH.<br />
Dans <strong>le</strong> cas d’un résultat négatif, seul <strong>le</strong> spot de Contrô<strong>le</strong> interne sera visib<strong>le</strong>.<br />
On considère que :<br />
- <strong>le</strong> résultat d’un test est positif pour <strong>le</strong> VIH-1 : apparition du spot VIH-1 de gauche avec <strong>le</strong> spot de<br />
contrô<strong>le</strong> interne indiquant la présence d’anticorps anti-VIH-1.<br />
- <strong>le</strong> résultat d’un test est positif pour <strong>le</strong> VIH-2 : apparition du spot VIH-2 du milieu avec <strong>le</strong> spot de<br />
contrô<strong>le</strong> interne indiquant la présence d’anticorps anti-VIH-2.<br />
- <strong>le</strong> résultat d’un test est positif pour <strong>le</strong> VIH-1 et/ou VIH-2 : apparition de trois spots indiquant la<br />
présence d’anticorps anti VIH-1 et/ou anti VIH-2.<br />
- <strong>le</strong> résultat d’un test est négatif : apparition du spot de contrô<strong>le</strong> interne indiquant l’absence d’anticorps<br />
anti-VIH.<br />
• Contrô<strong>le</strong> de qualité<br />
Ce contrô<strong>le</strong> de qualité (CQ) a pour objet de définir <strong>le</strong>s modalités de réalisation des techniques<br />
sérologiques ELISA au CeDReS afin de contrô<strong>le</strong>r et si nécessaire d’optimiser la réalisation des tests<br />
rapides VIH effectués sur <strong>le</strong>s sites du projet Ditrame Plus.<br />
Pour la sé<strong>le</strong>ction des prélèvements faisant l’objet du CQ, 2 tubes de prélèvement primaire étaient<br />
nécessaires; l’un était techniqué par <strong>le</strong> laborantin du site de prélèvement Ditrame Plus, l’autre par <strong>le</strong><br />
technicien spécialisé en sérologie au CeDReS. Une quinzaine de tubes étaient sé<strong>le</strong>ctionnés <strong>le</strong> premier<br />
mardi de chaque mois. Ce nombre de tubes a été choisi sur la base d’une quinzaine de<br />
prélèvements/mois/site, soit environ 5% de la totalité des tests rapides réalisés. Les échantillons<br />
faisant l’objet du CQ étaient des prélèvements de type DP1 (dépistage initial), DP2 (femme VIH<br />
indéterminée lors du dépistage initial DP1), ou DP3 (femme VIH positive lors du dépistage initial<br />
DP1).
79<br />
Les tubes primaires de prélèvement arrivaient au CeDReS bouchés, sur des portoirs métalliques<br />
contenus dans une glacière. Après centrifugation, <strong>le</strong>s tubes sont placés <strong>à</strong> 28°C en vue de la réalisation<br />
des tests ELISA.<br />
Après un contrô<strong>le</strong> visuel permettant de vérifier la concordance entre <strong>le</strong>s tubes reçus et la feuil<strong>le</strong> de<br />
transmission établie par <strong>le</strong>s conseillères de la FSUcom. Les techniciens du CeDReS réalisaient <strong>le</strong>s<br />
tests ELISA environ 2 fois/semaine. La réalisation des tests ELISA a été faite donc en aveug<strong>le</strong> des<br />
résultats obtenus par <strong>le</strong>s tests rapides. En outre, la pratique au CeDReS du test rapide Determine ® était<br />
effective pour <strong>le</strong>s tubes faisant l’objet de ce CQ.<br />
3.1.5.5. Résultats<br />
Les résultats de notre étude ont porté sur <strong>le</strong>s 10135 premiers tests de dépistage prénatal réalisés dans <strong>le</strong><br />
cadre du projet Ditrame Plus entre mai 2000 et février 2002 et ont été publiés récemment dans la revue<br />
Journal of Clinical Microbiology en 2004. Nous avons résumé dans cette partie de la thèse quelques<br />
principaux résultats. Des résultats plus détaillés se trouvent dans <strong>le</strong> manuscrit publié qui est disponib<strong>le</strong><br />
<strong>à</strong> la fin de ce chapitre.<br />
• Préva<strong>le</strong>nce<br />
La préva<strong>le</strong>nce de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 était de 11,6%, IC95% [11,0-12,3%]. La figure 3 présente <strong>le</strong>s<br />
résultats du dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 avec <strong>le</strong>s tests rapides utilisés sur <strong>le</strong>s sites du projet<br />
Ditrame Plus. Cette préva<strong>le</strong>nce n’était pas significativement différente selon <strong>le</strong>s six sites de dépistage<br />
(p=0,76).<br />
• Performance des tests rapides : Sensibilité et Spécificité<br />
Nous avons estimé la sensibilité et la spécificité des tests rapides <strong>à</strong> partir de 395 sérums provenant de<br />
314 femmes préincluses dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus. Un test ELISA a été réalisé sur tous ces<br />
prélèvements. Ainsi, la sensibilité du test Détermine ® est estimée <strong>à</strong> 100% (395/395). La limite<br />
inférieure de l’interval<strong>le</strong> de confiance <strong>à</strong> 95% était de 99,1% et pour <strong>le</strong> test Génie II ® , la sensibilité était<br />
estimée <strong>à</strong> 99,5% (393/395), IC95% [98,2-99,9%]. Aucun sérum n’a été retrouvé positif par <strong>le</strong> test<br />
Determine ® et négatif par <strong>le</strong> test ELISA.<br />
• Les résultats du contrô<strong>le</strong> de qualité<br />
Pour <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de qualité, 605 sérums testés sur sites ont été tirés au sort et envoyés au CeDReS. Le<br />
tab<strong>le</strong>au 14 présente <strong>le</strong>s résultats obtenus avec <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de qualité.
80<br />
Tab<strong>le</strong>au 14. Résultats du contrô<strong>le</strong> de qualité du diagnostic de l’infection <strong>à</strong> VIH effectué par des<br />
test rapides dans <strong>le</strong> cadre projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus.<br />
Determine ® Genie II ®<br />
Sensibilité 49/49 (100%) 49/49 (100%)<br />
Spécificité 547/556 (98,4%) 556/556 (100%)<br />
Va<strong>le</strong>ur prédictive positive 49/58 (84,5%) 49/49 (100%)<br />
Va<strong>le</strong>ur prédictive négative 547/547 (100%) 556/556 (100%)<br />
Reproductibilité 343/345 (99,4%) -
81<br />
Sérum<br />
N=10135<br />
Determine ®<br />
Négatif<br />
N=8842 (872%)<br />
Positif<br />
N=1293 (12,8%)<br />
Genie II ®<br />
Négatif<br />
(n=113)<br />
Positif<br />
(n=1180)<br />
Résultat<br />
Négatif<br />
Résultat<br />
Indéterminé<br />
Résultat Positif<br />
VIH-1 (n=1078 ; 91,4%)<br />
VIH-2 (n=14 ; 1,2%)<br />
VIH-1 et 2 (n=88 ; 7,4%)<br />
Figure 3. Résultats du dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 avec l’utilisation des tests rapides dans <strong>le</strong> projet<br />
Ditrame Plus de mai 2000 <strong>à</strong> février 2002.
82<br />
• Différenciation des sous types de virus VIH<br />
Pour la discrimination du sous type de VIH, nous avons sé<strong>le</strong>ctionné 20 sérums de patients identifiés<br />
sur site comme porteur du VIH-1, 8 sérums de patients VIH-2 et 71 sérums de patients présentant une<br />
co-infection VIH-1 et 2. Ces résultats sont obtenus par différenciation par <strong>le</strong> test Génie II ® pour la<br />
différenciation.<br />
Une analyse complémentaire au CeDReS a été ensuite réalisée avec ces mêmes sérums avec <strong>le</strong> test<br />
Peptilav 1-2 ® , Western-blot VIH-1 et VIH-2 et enfin avec <strong>le</strong> test ELISA synthétique peptides maison<br />
VIH-1 et VIH-2.<br />
Les résultats suivants ont été trouvés avec <strong>le</strong>s différents tests réalisés concernant <strong>le</strong>s 71 sérums<br />
identifiés comme une coinfection d’après <strong>le</strong> test Génie II ® (tab<strong>le</strong>au 15).<br />
Tab<strong>le</strong>au 15. Identification du type de VIH par la réalisation d’autres tests biologiques chez <strong>le</strong>s 71<br />
patients identifiés VIH-1 et 2 par <strong>le</strong> test Génie II ® . Projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus,<br />
Abidjan.<br />
VIH-1 VIH-2 VIH-1 et 2<br />
Génie II ® - - 71<br />
Peptilav 1-2 ® 2 35 34<br />
Western Blot HIV-1 et 2 4 30 37<br />
ELISA synthétique peptide « maison » 10 38 23<br />
Nous avons ensuite étudié la concordance entre <strong>le</strong>s différents tests avec un test de Kappa. Le<br />
coefficient Kappa entre l’ELISA peptide « maison », <strong>le</strong> Peptilav ® et <strong>le</strong> test Western-Blot était<br />
respectivement de 0,73 et de 0,67 (tab<strong>le</strong>au 16).<br />
En plus des examens sérologiques, nous avons aussi réalisé des examens virologiques plus poussés<br />
avec la technique de PCR en temps réel pour <strong>le</strong> diagnostic des patients inclus dans Ditrame Plus et<br />
ayant une co-infection (tab<strong>le</strong>au 17).
83<br />
Tab<strong>le</strong>au 16. Coefficient Kappa évaluant la concordance de trois tests sérologiques pour la discrimination du type de VIH. Analyse réalisée chez 71<br />
femmes enceintes identifiées VIH-1 et VIH-2 sur site par <strong>le</strong> test rapide Génie II ® . Projet Ditrame Plus, Abidjan, Année 2000-2002.<br />
Peptilav 1-2 ®<br />
Western Blot HIV-1&2<br />
VIH-1 (n=2)<br />
VIH-2 (n=35)<br />
VIH-1+2 (n=34)<br />
K a<br />
VIH-1 (n=4)<br />
VIH-2 (n=30)<br />
VIH-1+2 (n=37)<br />
K a<br />
n (%)<br />
n (%)<br />
n (%)<br />
n (%)<br />
n (%)<br />
n (%)<br />
Statut VIH selon ELISA<br />
synthétique peptides maison<br />
0,73<br />
0,67<br />
VIH-1 (n=10)<br />
2 (100,0)<br />
0<br />
8 (23,5)<br />
4 (100,0)<br />
0<br />
6 (16,2)<br />
VIH-2 (n=38)<br />
0<br />
35 (100,0)<br />
3 (8,8)<br />
0<br />
30 (100,0)<br />
8 (21,6)<br />
VIH-1+2 (n=23)<br />
0<br />
0<br />
23 (67,7)<br />
0<br />
0<br />
23 (62,2)<br />
a : coefficient de Kappa<br />
.
84<br />
Tab<strong>le</strong>au 17. Résultats sérologiques et virologiques chez 35 femmes incluses et diagnostiquées comme porteuses d’une coinfection VIH-1 et 2 par <strong>le</strong> test<br />
rapide Génie II ® sur site. Projet Ditrame Plus, Abidjan, 2000-2002.<br />
Résultats sérologiques Résultats virologiques CD4 +<br />
Patient Génie II ® Peptilav ® WBs VIH-1 et-2 ELISA peptide « maison » (gp41/36 et V3) AND proviral-1&2 PCR en temps réél % cells/mm 3<br />
10 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 32 466<br />
11 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 24,3 561<br />
16 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 7 169<br />
19 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 16,8 379<br />
26 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 36,4 530<br />
33 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 25,6 506<br />
34 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 14,5 198<br />
1 1+2 1+2 1+2 1 1+2 15,5 165<br />
21 1+2 1+2 1+2 1 1+2 44,4 1038<br />
7 1+2 2 2 2 2 34 532<br />
8 1+2 2 2 2 2 42,9 645<br />
12 1+2 2 2 2 2 32,9 688<br />
13 1+2 2 2 2 2 40,4 664<br />
14 1+2 2 2 2 2 2 12<br />
15 1+2 2 2 2 2 46,8 724<br />
17 1+2 2 2 2 2 46,7 1062<br />
22 1+2 2 2 2 2 42,4 1213<br />
24 1+2 2 2 2 2 28,1 451<br />
25 1+2 2 2 2 2 35,5 457<br />
27 1+2 2 2 2 2 48,3 1056<br />
28 1+2 2 2 2 2 20,2 504<br />
31 1+2 2 2 2 2 39,9 555<br />
35 1+2 2 2 2 2 23,6 338<br />
9 1+2 1 1 1 1 24,5 270<br />
23 1+2 1 1 1 1 22,7 392<br />
18 1+2 2 1+2 2 2 31,7 514<br />
20 1+2 2 1+2 2 2 33 416<br />
3 1+2 1+2 1+2 2 2 37,5 574<br />
30 1+2 1+2 1 1 1 23,3 326<br />
5 1+2 1+2 1+2 1 1 19,8 330<br />
2 1+2 1+2 1+2 1+2 1 26,5 445<br />
4 1+2 1+2 1+2 1+2 1 3,9 22<br />
6 1+2 2 2 2 Tous <strong>le</strong>s deux négatifs 33,1 543<br />
29 1+2 2 2 2 Tous <strong>le</strong>s deux négatifs 30 693<br />
32 1+2 2 2 2 Tous <strong>le</strong>s deux négatifs 39 936
85<br />
3.1.5.6. Discussion<br />
Cette étude représente une évaluation <strong>à</strong> très large échel<strong>le</strong> des tests rapides sur <strong>le</strong> terrain avec plus de<br />
10000 tests rapides effectués dans <strong>le</strong> cadre du dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH-1 chez des femmes<br />
enceintes <strong>à</strong> Abidjan, Côte d’Ivoire. Nos résultats sont concordants en terme de sensibilité et de<br />
spécificité avec <strong>le</strong>s données rapportées par une équipe du Retroci <strong>à</strong> Abidjan (111) et portant sur <strong>le</strong>s<br />
mêmes tests rapides (Determine ® et Genie II ® ).<br />
Nous pouvons ainsi souligner <strong>le</strong>s informations suivantes :<br />
• aucun résultat faux positif n’a été observé avec <strong>le</strong> test Determine ® dans notre étude. La<br />
sensibilité du Determine ® est ainsi de 100%,<br />
• tout <strong>le</strong>s résultats considérés comme indéterminés (Determine ® positif et Génie II ® négatif ) ont<br />
tous été confirmés comme étant négatifs par des tests ELISA,<br />
• <strong>le</strong>s tests rapides utilisés en séries sont 2,5 fois moins coûteux que <strong>le</strong>s tests rapides utilisés en<br />
parallè<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s zones où la préva<strong>le</strong>nce du VIH-1 est supérieure <strong>à</strong> 10%,<br />
• deux résultats discordants seu<strong>le</strong>ment ont été retrouvés au cours des tests de reproductibilité<br />
réalisés sur 345 prélèvements avec deux résultats considérés comme positifs par <strong>le</strong> test<br />
Determine ® sur site et qui se sont retrouvés être négatifs par <strong>le</strong> test Determine ® au CeDReS.<br />
Ceci peut être lié plus <strong>à</strong> des erreurs de numérotage qu’<strong>à</strong> une interprétation différente de<br />
résultat.<br />
Enfin, pour l’étude de la différenciation, on peut noter que cinq autres tests biologiques<br />
complémentaires ont été réalisés. Nos résultats ont montré la difficulté d’identifier <strong>le</strong> type de VIH avec<br />
des tests sérologiques classiques. L’intérêt d’utiliser un troisième test rapide en cas de résultat<br />
indéterminé avec deux tests rapides reste <strong>à</strong> étudier et <strong>le</strong> rapport coût/ efficacité d’une tel<strong>le</strong> stratégie<br />
reste <strong>à</strong> évaluer<br />
3.1.5.7. Difficultés rencontrées<br />
Nous avons modifié au cours de la période de l’étude une partie de l’algorithme concernant <strong>le</strong>s<br />
résultats considérés comme indéterminés. Comme la majorité de ces femmes ne revenait pas pour un<br />
deuxième prélèvement pour la confirmation de <strong>le</strong>ur statut, tous <strong>le</strong>s prélèvements de dépistage avec des<br />
résultats indéterminés par des tests rapides ont été envoyés directement au CeDReS pour la réalisation<br />
d’un test ELISA. Ce qui permet d’avoir <strong>le</strong> diagnostic définitif pour chaque patiente. Le second<br />
algorithme utilisé est présenté en annexe 3.<br />
.
86<br />
3.1.5.8. Implications de l’utilisation des tests rapides pour la PTME<br />
Le délai moyen entre la réalisation du test et la disponibilité du résultat du test était de 7 jours en<br />
moyenne avec <strong>le</strong> test ELISA contre moins d’un jour pour <strong>le</strong>s tests rapides (112). Dans l’étude de<br />
Ki<strong>le</strong>wo et al en Tanzanie, <strong>le</strong> délai pour l’annonce du test ELISA classique était de 15 jours (113).<br />
L’utilisation des tests rapides, avec <strong>le</strong>s résultats rendus <strong>le</strong> même jour, ne permet pas nécessairement<br />
d’accroître l’acceptabilité des interventions de PTME en Afrique. C’est du moins la conclusion d’un<br />
essai randomisé réalisé par Malonza et al qui a montré qu’il n’ y a pas de différence significative entre<br />
<strong>le</strong>s patients inclus dépistés avec <strong>le</strong> test ELISA et <strong>le</strong>s patients dépistés avec un test rapide en terme de<br />
mise sous régime d’ARVs de PTME (112). Il faut noter que cette étude a porté cependant sur un<br />
nombre limité d’individus puisque seu<strong>le</strong>ment 24 femmes sur <strong>le</strong>s 161 dépistées infectées ont été<br />
réparties dans <strong>le</strong>s deux bras (112).<br />
Nous reviendrons dans la section suivante de ce chapitre sur notre expérience en matière<br />
d’acceptabilité des interventions de PTME suite <strong>à</strong> l’utilisation des tests rapides pour <strong>le</strong> dépistage<br />
prénatal.<br />
3.1.5.9. Recommandations<br />
1) Compte tenu de la sensibilité des tests rapides, l’utilisation de deux tests rapides en série, pour <strong>le</strong><br />
dépistage prénatal de l’infection <strong>à</strong> VIH, nous paraît plus avantageux que des tests rapides utilisés en<br />
parallè<strong>le</strong> en tenant compte du rapport coût-efficacité de chacune de ces deux stratégies.<br />
2) Pour la discrimination du type de VIH, <strong>le</strong>s observations faites nous suggèrent d’utiliser chez des<br />
patients présentant une co-infection d’autres techniques comme <strong>le</strong> test ELISA <strong>à</strong> base de peptide<br />
« maison » pour identifier avec une grande fiabilité <strong>le</strong> type de VIH puisque <strong>le</strong> test Génie II ® ne paraît<br />
pas être un bon test de discrimination pour identifier <strong>le</strong> type de VIH du moins <strong>à</strong> Abidjan. Il est fort<br />
possib<strong>le</strong> que ce type de conclusion soit spécifique au con<strong>texte</strong> viro-épidémiologique.
3.2. Acceptabilité du dépistage et des interventions peripartum de PTME<br />
87<br />
3.2.1. Con<strong>texte</strong> de la recherche<br />
L'acceptabilité des interventions peripartum proposées en Afrique pour réduire la TME demeure<br />
très faib<strong>le</strong> en Afrique. El<strong>le</strong> varie entre 20% et 30% d’après la littérature que ce soit dans <strong>le</strong> cadre<br />
des projets opérationnels ou d'essais cliniques randomisés (3, 114, 115). On entend ici par<br />
acceptabilité, la proportion de femmes VIH-positives dépistées qui bénéficient de l’utilisation<br />
d’une prophylaxie ARV pour la PTME.<br />
Plusieurs hypothèses ont été <strong>le</strong> plus souvent évoquées pour expliquer cette faib<strong>le</strong> acceptabilité.<br />
Parmi <strong>le</strong>s hypothèses évoquées, il y a l’utilisation du test ELISA classique dont <strong>le</strong> résultat est<br />
disponib<strong>le</strong> après deux semaines en moyenne et qui favorise ainsi <strong>le</strong> non retour pour <strong>le</strong> rendu des<br />
résultats.<br />
Nous avons, dans <strong>le</strong> cadre du projet ANRS 1201/1202 où des tests rapides ont été utilisés pour <strong>le</strong><br />
diagnostic de l’infection <strong>à</strong> VIH, réalisé des investigations pour estimer d’une part l’acceptabilité<br />
des interventions de PTME dans <strong>le</strong> cadre de notre programme de recherche et d’autre part<br />
déterminer <strong>le</strong> profil des femmes qui ont refusé <strong>le</strong>s interventions de PTME proposées.<br />
Nous avons enfin étudié la relation entre <strong>le</strong> statut immunitaire des femmes infectées par <strong>le</strong> VIH,<br />
mesuré par <strong>le</strong> taux de lymphocytes CD4 et l'acceptabilité des interventions. Notre hypothèse de<br />
travail pour cette étude était que <strong>le</strong>s femmes <strong>le</strong>s plus immunodéprimées acceptaient plus <strong>le</strong>s<br />
interventions de PTME que <strong>le</strong>s femmes moins fortement immunodéprimées. Cette hypothèse a été<br />
formulée après que l’on ait observé que <strong>le</strong>s femmes <strong>le</strong>s plus récemment incluses dans <strong>le</strong> projet<br />
Ditrame Plus étaient plus immunodéprimées que cel<strong>le</strong>s incluses dans <strong>le</strong> projet DITRAME ANRS<br />
049.<br />
Nous présentons donc dans ce chapitre <strong>le</strong>s résultats de deux études réalisées au sein du projet<br />
ANRS 1201/1202 et portant sur l'acceptabilité des interventions de PTME proposées aux femmes<br />
enceintes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH, <strong>à</strong> Abidjan en Côte d'Ivoire.
88<br />
3.2.2. Présentation des études et de <strong>le</strong>urs résultats<br />
3.2.1.1. Acceptability and uptake of a package to Prevent Mother-to-Child<br />
Transmission (PMTCT) using rapid HIV testing in Abidjan, Côte d’Ivoire (Research <strong>le</strong>tter<br />
Ekouévi DK et al, AIDS 2004; 18:697-700).<br />
Pour cette première étude sur l’acceptabilité des interventions, nos questions de recherche étaient<br />
<strong>le</strong>s suivantes :<br />
• Quel<strong>le</strong> est l’acceptabilité des interventions de PTME avec l’utilisation des tests rapides<br />
pour <strong>le</strong> dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH <br />
• Quel est <strong>le</strong> profil des femmes infectées par <strong>le</strong> VIH-1 qui ne participent pas au projet de<br />
recherche <br />
Nous avons réalisé au sein du projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus une étude transversa<strong>le</strong><br />
portant sur <strong>le</strong>s données disponib<strong>le</strong>s du dépistage prénatal jusqu'<strong>à</strong> l'inclusion dans <strong>le</strong> projet. Toutes<br />
<strong>le</strong>s femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 pendant la période ont été incluses dans cette étude.<br />
Le dépistage du VIH a été réalisé par des tests rapides en série (Détermine ® et Génie II ® ).<br />
L’algorithme utilisé pour <strong>le</strong> dépistage des tests rapides était présenté dans <strong>le</strong> chapitre précédent<br />
(figure 2). Une femme enceinte était considérée comme infectée si <strong>le</strong>s deux tests étaient positifs.<br />
En cas de résultats discordants un test ELISA a été réalisé pour confirmation.<br />
Au total, 14067 femmes ont eu la proposition du test VIH. Nous résumons sur la figure 4<br />
l’acceptabilité du test du dépistage rapide de l’infection <strong>à</strong> VIH et des interventions PTME<br />
proposées. La préva<strong>le</strong>nce de l’infection <strong>à</strong> VIH sur la période 2000-2002 a été estimée <strong>à</strong> 11,1%,<br />
(IC95% [10,5-11,6%]). Il n’y avait pas de différence significative de la préva<strong>le</strong>nce du VIH en<br />
fonction du retour ou non <strong>à</strong> la visite post-test. Cette préva<strong>le</strong>nce était de 11,5% chez <strong>le</strong>s femmes qui<br />
ne sont pas revenues <strong>à</strong> la visite post test et de 10,9% chez <strong>le</strong>s femmes revenues pour connaître <strong>le</strong>ur<br />
statut sérologique (p=0,31).
89<br />
Proposition du test VIH<br />
Femmes enceintes (N=14607)<br />
Acceptation de la proposition du test : 89,4% (n=12583)<br />
Préva<strong>le</strong>nce du VIH-1 ou VIH1+2 : 11,5% ; IC95% [10,6-11,6%], (n=1396)<br />
Préva<strong>le</strong>nce du VIH-2 : 0,22% ; IC95% [0,14-0,32%], (n=28)<br />
Annonce du résultat du test : 74,2% (9340/12583)<br />
VIH-1 ou VIH-1+2 : 73,3% (1023/1396)<br />
VIH-2 : 67,9% (19/28)<br />
VIH négative : 74,3% (8298/11159)<br />
Visite de Préinclusion<br />
VIH-1 ou VIH-1+2 : 51,1% (523/1023)<br />
Prophylaxie antirétrovira<strong>le</strong> pour la<br />
PTME (n=366)<br />
Acceptation a : 69,9% (366/523)<br />
Acceptation b : 35,7% (366/1023)<br />
Acceptation c : 26,2% (366/1396)<br />
Figure 4. Etapes de la proposition du test VIH <strong>à</strong> l’administration de la prophylaxie<br />
antirétrovira<strong>le</strong> pour la prévention de la transmission du VIH de la mère <strong>à</strong> l'enfant. Expérience<br />
du projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus, Abidjan, Côte d’Ivoire, Mai 2000-Octobre 2002.<br />
a= Acceptation de la PTME parmi <strong>le</strong>s femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 ou VIH-1 et 2 venues <strong>à</strong> la<br />
visite de préinclusion.<br />
b= Acceptation de la PTME parmi <strong>le</strong>s femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 ou VIH-1 et 2 ayant eu<br />
connaissance de <strong>le</strong>ur statut sérologique.<br />
c= Acceptation de la PTME parmi <strong>le</strong>s femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 ou VIH-1 et 2 ayant accepté<br />
la proposition du test VIH.
90<br />
Nous avons ensuite étudié <strong>le</strong>s facteurs qui sont associés <strong>à</strong> l’acceptation des interventions de PTME<br />
dans notre projet afin de caractériser <strong>le</strong> profil des femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 qui<br />
bénéficient de ces interventions.<br />
• Pour la visite post-test.<br />
En analyse univariée, on observe une association entre l’âge et <strong>le</strong> fait de ne pas retourner <strong>à</strong> la visite<br />
post-test. Ainsi on note que <strong>le</strong>s femmes âgées de moins de 25 ans, retournent moins <strong>à</strong> la visite post-test<br />
que <strong>le</strong>s femmes plus âgées (p=0,04). En analyse multivariée, <strong>le</strong> risque de ne pas retourner au centre<br />
pour connaître son statut sérologique était de 1,3 (IC95% [1,0-1,6]) pour <strong>le</strong>s femmes infectées âgées<br />
de moins de 25 ans par rapport aux femmes plus âgées.<br />
• Pour <strong>le</strong>s inclusions dans <strong>le</strong> programme Ditrame Plus et donc de l’acceptation de l’intervention<br />
de PTME<br />
En analyse univariée, on observe une association entre <strong>le</strong> niveau scolaire et l’acceptation de la<br />
prophylaxie antirétrovira<strong>le</strong>. Les femmes analphabètes participent moins au programme de PTME que<br />
<strong>le</strong>s femmes qui ont été au collège ou <strong>à</strong> l’université (OR=1,6 en analyse multivariée, IC95% [1,2-2,3]).<br />
On observe cette situation éga<strong>le</strong>ment avec <strong>le</strong>s femmes qui vivent avec <strong>le</strong>ur partenaire. Cette<br />
association persiste en analyse multivariée avec un OR estimé <strong>à</strong> 1,5 (IC95% [1,1-2,0]).<br />
Le tab<strong>le</strong>au 18 présente une synthèse du profil des femmes qui ne retournent pas au centre pour la<br />
visite post-test et des femmes qui ne reçoivent pas une prophylaxie antirétrovira<strong>le</strong> pour la PTME.
91<br />
Tab<strong>le</strong>au 18. Profil socio-démographique des femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 n’ayant pas connaissance de <strong>le</strong>ur statut VIH et qui n’ont pas reçu une<br />
intervention de PTME <strong>à</strong> Abidjan, Côte d’Ivoire. 2000-2002.<br />
Non incluses dans <strong>le</strong> projet DP<br />
et pas d’intervention de PTME (n=1030 )<br />
Non revenue pour <strong>le</strong><br />
post-test (n=373)<br />
n (%)<br />
Connaissance<br />
Statut VIH+<br />
(n=657)<br />
n (%)<br />
Incluses dans DP et<br />
intervention de PTME<br />
(n=366 )<br />
Risque de ne pas revenir<br />
pour <strong>le</strong> conseil post-test<br />
Risque pour ne pas recevoir<br />
l’intervention de PMTE *<br />
n (%) OR [IC95%] p OR [IC95%] p<br />
Age (ans)<br />
< 25 ans 167 (44,8) 259 (39,4) 137 (37,4) 1,28 [1,01–1,63] 0,04 1,08 [0,83–1,41] 0,53<br />
≥ 25 ans 206 (55,2) 398 (60,6) 229 (62,6) 1,00 1,00<br />
Niveau scolaire<br />
Analphabète 203 (54,4) 319 (48,6) 148 (40,4) 1,32 [0,95–1,82] 0,09 1,70 [1,21–2,40] 0,002<br />
Eco<strong>le</strong> primaire 105 (28,2) 228 (34,7) 131 (35,9) 0,89 [0,62–1,27] 0,50 1,38 [0,97–1,96] 0,08<br />
Collège ou Université 65 (17,4) 110 (16,7) 87 (23,7) 1,00 1,00<br />
Antécédent de grossesse<br />
Non 65 (17,4) 99 (15,1) 46 (12,6) 1,27 [0,93–1,75] 0,13 1,23 [0,84–1,80] 0,27<br />
Oui 308 (82,6) 558 (84,9) 320 (87,4) 1,00 1,00<br />
Avoir eu un enfant vivant<br />
Non 112 (30,0) 175 (26,6) 91 (24,9) 1,22 [0,93–1,59] 0,14 1,09 [0,82–1,47] 0,57<br />
Oui 261 (70,0) 482 (73,4) 275 (75,1) 1,00 1,00<br />
Activité génératrice de revenus<br />
Non 158 (42,4) 290 (44,1) 163 (44,5) 0,93 [0,73–1,17] 0,52 0,98 [0,76–1,24] 0,90<br />
Oui 215 (57,6) 367 (55,9) 203 (55,5) 1,00 1,00<br />
Vit avec son partenaire<br />
Non 121 (29,8) 147 (22,4) 114 (31,2) 1,00 0,11 1,00 0,002<br />
Oui 262 (70,2) 510 (77,6) 252 (68,8) 0,80 [0,62–1,05] 1,57 [1,17–2,09]<br />
* Risque de ne pas recevoir une intervention parmi <strong>le</strong>s femmes dépistées positives qui ont pris connaissance de <strong>le</strong>ur statut sérologique (n=1023)<br />
CI: Interval<strong>le</strong> de Confiance <strong>à</strong> 95%; OR: Odds ratio, DP : projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus, p=P values<br />
PMTE: Prévention de la transmission du VIH de la mère <strong>à</strong> l’enfant<br />
Analyse univariée
92<br />
3.2.2.2. Pregnancy, Immune status and uptake of a package to Prevent Motherto-Child<br />
Transmission in Abidjan, Côte d’Ivoire. (Brief Report; Ekouévi DK et al, J Acquir<br />
Immune Defic Syndr 2004; 36 :755-757.)<br />
• Justification<br />
Au cours des inclusions dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus, nous avons noté que la médiane des CD4+ des<br />
248 premières femmes incluses dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus (mars 2001-février 2002) était de 365<br />
cellu<strong>le</strong>s/mm 3 avec 18% de femmes ayant des CD4+
93<br />
réalisé dans cinq des centres de dépistage du projet : Anonkouakouté, Sagbé, Avocatier dans la<br />
commune d’Abobo et dans la commune de Yopougon, <strong>le</strong>s FSUcom de Niangon-Sud et de Toit Rouge.<br />
Les procédures de dépistage préalab<strong>le</strong>ment décrites étaient identiques tout <strong>le</strong> long de l’étude. Des<br />
prélèvements sanguins ont été faits dans deux tubes pendant cette période. Le premier tube était<br />
destiné pour <strong>le</strong> dépistage et <strong>le</strong> second tube pour la NFS et la quantification des CD4. Le dépistage de<br />
l’infection <strong>à</strong> VIH par des tests rapides était réalisé sur <strong>le</strong>s sites. Le prélèvement des patientes dépistées<br />
infectées était ensuite acheminé <strong>le</strong> jour du prélèvement avant 15 heures au CeDReS pour la réalisation<br />
de la NFS et la quantification des CD4+ par la technique de cytométrie en flux (FACSCAN, Beckton<br />
Dickisson).<br />
Toutes <strong>le</strong>s femmes infectées ont été suivies jusqu’au jour de l’accouchement dans <strong>le</strong>s centres de<br />
dépistage et <strong>le</strong>s centres de suivi afin d’estimer la proportion de femmes qui ont pris connaissance de<br />
<strong>le</strong>ur statut sérologique et qui ont accepté <strong>le</strong>s interventions de PTME qui <strong>le</strong>ur étaient proposées. Les<br />
tests t de Student et U de Mann-Withney ont été utilisés pour la comparaison des moyennes et des<br />
médianes respectivement. Le test de Chi2 de Pearson a été utilisé pour la comparaison des variab<strong>le</strong>s<br />
qualitatives.<br />
• Principaux Résultats<br />
Le recrutement s’est déroulé entre avril et juin 2002. Au cours de cette période de trois mois, 2407<br />
propositions de test VIH ont été faites aux femmes enceintes dans cinq centres de dépistage anténatal.<br />
L’acceptabilité de la proposition du test VIH était de 89,1%. La préva<strong>le</strong>nce du VIH-1 était de 10,5%<br />
(IC95% [9,2-11,9%]). Au total 226 femmes étaient dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 et ont été incluses<br />
dans cette étude. Seu<strong>le</strong>ment 32% des femmes (n=72) ont reçu l’intervention de PTME proposée par <strong>le</strong><br />
projet. Parmi <strong>le</strong>s femmes dépistées infectées, 24% (n=54) ne sont pas revenues chercher <strong>le</strong>urs résultats<br />
après la réalisation du test rapide de dépistage.<br />
On note que 221 des 226 prélèvements pour la NFS ont pu être analysés, <strong>le</strong>s cinq autres n’ayant pu<br />
l’être pour des raisons logistiques. La médiane des CD4+ était de 408/mm3, étendue interquarti<strong>le</strong><br />
(EIQ) [304-570/mm3]. Le tab<strong>le</strong>au 19 montre la répartition des CD4+ des femmes infectées selon <strong>le</strong>ur<br />
degré de participation au programme entre <strong>le</strong> dépistage et l’inclusion. On ne retrouve pas de différence<br />
significative entre la médiane de CD4+ des femmes ayant pris connaissance de <strong>le</strong>ur statut ou non<br />
(389/mm3 vs 420/mm3 ; p=0,19). Nous n’avons pas retrouvé non plus de différence significative entre<br />
la médiane des CD4+ des femmes ayant reçu <strong>le</strong>s interventions de PTME (n=72) et <strong>le</strong>s femmes qui<br />
n’ont reçu aucune prophylaxie pour la PTME qu’el<strong>le</strong>s aient eu ou non connaissance de <strong>le</strong>ur statut<br />
sérologique (405 éléments/mm 3 vs 425 éléments/mm3, p=0,47).<br />
Les analyses par classes de CD4+ n’ont montré aucune différence significative entre <strong>le</strong>s différents<br />
groupes considérés.
94<br />
Tab<strong>le</strong>au 19. Nombre absolu et pourcentage de lymphocytes CD4+ chez <strong>le</strong>s femmes enceintes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 dans cinq centres de<br />
santé <strong>à</strong> Abidjan, Côte d’ Ivoire, Projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus, Avril - Juin 2002.<br />
TOTAL<br />
(N=226)<br />
Non revenue <strong>à</strong> la<br />
visite post-test<br />
(n=54)<br />
Total (n=172)<br />
Connaissance du Statut VIH (n=100)<br />
Pas d’ARV<br />
pour la PTME<br />
ARV pour la PTME p<br />
Mesure de CD4+ (n) 221 50 A 171 B 99 C 72 D A vs B C vs D A+C vs D<br />
Nombre absolu de CD4<br />
Moyenne ± Ecart-type 452,5 ± 251,7 433,9 ± 326,2 457,9 ± 226,2 466,7 ± 223,0 445,8 ± 231,5 0,62 0,55 0,78<br />
Médiane [EIQ] 408 [304 – 570] 389 [262 – 515] 420 [313 – 602] 425 [313 – 616] 405 [308 – 516] 0,19 0,47 0,86<br />
Distribution des CD4+<br />
< 200/mm 3 31 (14,0) 10 (20,0) 21 (12,3) 11 (11,1) 10 (13,9) 0,43 0,59 0,54<br />
200 – 349/mm 3 47 (21,3) 12 (24,0) 35 (20,5) 22 (22,2) 13 (18,1)<br />
350 - 499/mm 3 66 (29,9) 12 (24,0) 54 (31,5) 28 (28,3) 26 (36,1)<br />
>=500/mm 3 77 (34,8) 16 (32,0) 61 (35,7) 38 (38,4) 23 (31,9)<br />
Pourcentage de CD4+<br />
Moyenne ± Ecart-type 26, 2 ± 10,3 25,1 ± 10,7 26,5 ± 10,1 26,6 ± 10,5 26,4 ± 9,6 0,38 0,90 0,84<br />
Médiane [EIQ] 26,6 [19,5–32,0] 25,1 [19,3–30,5] 27,3 [19,8–32,6] 27,0 [20,0–32,7] 27,3 [19,6–31,8] 0,27 0,98 0,67<br />
< 15% 29 (13,1) 8 (16,0) 21 (12,3) 12 (12,1) 9 (12,5) 0,48 0,94 0,85<br />
EIQ: Etendue interquarti<strong>le</strong>, DP: Ditrame Plus, ARV: Traitement antirétroviral pour la PTME (Zidovudine + Nevirapine monodose),<br />
PTME : Prévention de la transmission du VIH de la mère <strong>à</strong> l’enfant.
95<br />
• Commentaires<br />
La faib<strong>le</strong> acceptabilité des interventions de PTME est un sérieux problème pour la mise en place des<br />
programmes de santé publique. A chaque niveau d’intervention, on note dans notre étude comme dans<br />
beaucoup d’autres en Afrique (115, 118) un nombre non négligeab<strong>le</strong> de femmes qui sont perdues de<br />
vue ou qui refusent l’intervention proposée.<br />
Le premier constat est que 10% environ des femmes refusent la proposition du test VIH. Nous avons<br />
documenté dans <strong>le</strong> cadre du projet Ditrame Plus <strong>le</strong>s raisons <strong>le</strong>s plus souvent évoquées par <strong>le</strong>s femmes<br />
qui refusent <strong>le</strong> test du VIH (données non présentées). Il s’agit <strong>le</strong> plus souvent de recueillir l’avis du<br />
partenaire avant la réalisation du test VIH. Il faut souligner que <strong>le</strong>s femmes qui ont refusé <strong>le</strong> test<br />
n’avaient pas accès au traitement. Donner de la NVP monodose ou un autre régime d’ARVs aux<br />
femmes qui ont refusé <strong>le</strong> test, pour prévenir la PTME sans que ces femmes soient informées ou non de<br />
<strong>le</strong>ur statut est une approche qui n’a pas encore été retenue sur <strong>le</strong> plan national en Côte d’Ivoire bien<br />
qu’el<strong>le</strong> ait fait l’objet de recommandation en matière de recherche par l’OMS (119).<br />
Le deuxième constat est que 30% des femmes qui acceptent <strong>le</strong> test de dépistage ne reviennent pas<br />
chercher <strong>le</strong>ur résultat, disponib<strong>le</strong> pourtant dès <strong>le</strong> <strong>le</strong>ndemain. Il s’agit soit d’un refus déguisé d’accepter<br />
<strong>le</strong> test, ou d’un problème de compréhension pendant la visite prétest.<br />
L’utilisation du test ELISA (test classique) avec <strong>le</strong> rendu des résultats entre <strong>le</strong> 5ème et 15ème jour<br />
après la réalisation du test était considéré comme <strong>le</strong> facteur limitant <strong>le</strong> plus l’acceptabilité des<br />
programmes de PTME <strong>à</strong> cause du délai entre la proposition du test et <strong>le</strong> rendu des résultats (112).<br />
L’apport des tests rapides a permis d’avoir un nombre plus important de femmes qui viennent chercher<br />
<strong>le</strong>ur résultat, surtout si <strong>le</strong> résultat du test VIH est donné <strong>le</strong> même jour que sa réalisation. Cette stratégie<br />
de rendu de résultat <strong>le</strong> même jour, utilisée en Côte d’Ivoire sur un autre site a montré que <strong>le</strong> résultat<br />
donné <strong>le</strong> jour de la réalisation du test fait accroître de façon significative <strong>le</strong> pourcentage de femmes<br />
ayant reçu <strong>le</strong>ur résultat. On note ainsi 70% de résultats rendus avec <strong>le</strong> test ELISA contre 90% avec <strong>le</strong>s<br />
tests rapides (120). Il en était de même au Kenya. Dans un essai thérapeutique réalisé dans ce pays, <strong>le</strong>s<br />
femmes qui ont eu <strong>le</strong> dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH par un test rapide ont eu plus fréquemment<br />
connaissance de <strong>le</strong>ur statut sérologique que cel<strong>le</strong>s dépistées par un test ELISA (96% versus 73%, avec<br />
un OR estimé <strong>à</strong> 1,3; IC95% [1,2-1,4], p
96<br />
Le troisième constat est que plus de 40% des femmes ayant pris connaissance de <strong>le</strong>ur statut<br />
sérologique ne viennent pas initier la prophylaxie ARV. Trois raisons peuvent expliquer cette situation<br />
1) <strong>le</strong> déni du résultat donné par la conseillère au moment de la visite post-test 2) un problème de<br />
stigmatisation, c'est-<strong>à</strong>-dire la peur d’être suivie dans un centre étiqueté comme suivant des PVVIH ou<br />
d’être considérée soi-même comme une PVVIH 3) la peur de la réaction du partenaire et de<br />
l’entourage.<br />
Le quatrième constat est que seu<strong>le</strong>ment 25 <strong>à</strong> 30% des femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH acceptent<br />
<strong>le</strong>s interventions de PTME qui <strong>le</strong>ur ont été proposées. Dans <strong>le</strong> cadre du projet Ditrame Plus, <strong>le</strong>s<br />
femmes analphabètes et <strong>le</strong>s femmes qui vivent avec <strong>le</strong>ur partenaire ont moins fréquemment reçu des<br />
ARVs pour la PTME que <strong>le</strong>s autres. Nous avons cependant démontré que l’état d’immunodépression<br />
(mesuré par <strong>le</strong> taux de lymphocytes CD4) n’était pas un facteur influençant la prise des interventions<br />
de PTME.<br />
Plusieurs solutions ont été proposées dans la littérature pour résoudre en partie la question de la faib<strong>le</strong><br />
acceptabilité des interventions comme :<br />
1) la distribution de la NVP en traitement de masse qualifiée parfois de stratégie de NVP<br />
universel<strong>le</strong><br />
Il faudrait tenir compte des avantages en terme de cas évités et des effets secondaires, plus<br />
particulièrement <strong>le</strong>s problèmes de résistance pour toutes <strong>le</strong>s mères infectées et <strong>le</strong>s enfants infectés qui<br />
<strong>le</strong> seront malgré cette intervention. Cela suppose une distribution de NVP <strong>à</strong> toutes <strong>le</strong>s femmes <strong>le</strong> jour<br />
de la proposition du test ou en sal<strong>le</strong> de travail (115, 119).<br />
2) la réalisation du dépistage prénatal en sal<strong>le</strong> d’accouchement « late HIV testing »<br />
Cette approche récemment proposée a été étudiée par <strong>le</strong> projet ANRS 1205 Perikam study au<br />
Cambodge. Il s'agit de proposer <strong>le</strong>s tests VIH aux femmes enceintes en sal<strong>le</strong> d'accouchement pour<br />
cel<strong>le</strong>s qui ne connaissent pas <strong>le</strong>ur statut. La NVP est ensuite distribuée aux femmes dépistées infectées<br />
par <strong>le</strong> VIH en sal<strong>le</strong> d'accouchement. Dans cette étude, 878 /1643 femmes (53%) ont eu une tel<strong>le</strong><br />
proposition de test. Toutes <strong>le</strong>s femmes n'ont pas pu recevoir la proposition de test parce qu’el<strong>le</strong>s<br />
étaient très avancées dans <strong>le</strong> travail. Le manque de sages-femmes disponib<strong>le</strong>s était éga<strong>le</strong>ment une des<br />
raisons citées par <strong>le</strong>s auteurs pour mettre en place efficacement un tel programme. L'acceptation de la<br />
proposition de test était cependant de 84% (121). Très récemment l’équipe de Temmerman au Kenya a<br />
abordé dans <strong>le</strong> même sens en proposant d'inclure systématiquement la réalisation du test VIH en sal<strong>le</strong><br />
d'accouchement, chez <strong>le</strong>s femmes qui n'avaient pas accès au prétest avant d'accoucher (115).
97<br />
3) L’approche « opt out » est éga<strong>le</strong>ment une option suggérée dans la littérature pour augmenter<br />
l’acceptabilité des interventions de PTME. Nous aborderons plus en détail ce sujet dans la discussion<br />
généra<strong>le</strong> de cette thèse.<br />
4) la sensibilisation communautaire<br />
La sensibilisation communautaire est essentiel<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> processus de réduction de la stigmatisation<br />
des personnes infectées par <strong>le</strong> VIH. Il semb<strong>le</strong> aujourd'hui que la stigmatisation est <strong>le</strong> facteur limitant <strong>le</strong><br />
plus l'acceptabilité des interventions de PTME. Toutefois, il existe très peu d'études qui ont confirmé<br />
ou infirmé cette hypothèse.<br />
5) l'implication des partenaires dans la PTME<br />
Le conseil de coup<strong>le</strong> a été proposé pour permettre une meil<strong>le</strong>ure implication des partenaires dans la<br />
PTME (122). Mais il faudra tenir compte du fait que certains coup<strong>le</strong>s peuvent être concordants ou<br />
discordants sur <strong>le</strong> plan sérologique et éventuel<strong>le</strong>ment de la réaction négative du partenaire avec<br />
comme conséquence possib<strong>le</strong>: <strong>le</strong> divorce, la séparation, la vio<strong>le</strong>nce verba<strong>le</strong> et physique.<br />
L'exemp<strong>le</strong> de la Thaïlande et d'autres pays en Afrique comme <strong>le</strong> Botswana montre que la PTME est<br />
réalisab<strong>le</strong> <strong>à</strong> grande échel<strong>le</strong>. Mais ceci repose avant tout sur une volonté politique et sur des<br />
infrastructures bien équipées et suffisamment bien dotées en personnel. En Thaïlande <strong>le</strong> programme<br />
national a mis en place un système de monitorage des activités de PTME. Ainsi, d'octobre 2000 <strong>à</strong><br />
juil<strong>le</strong>t 2001, la PTME a été mise en place dans 669 hôpitaux de 65 provinces et 65% des 3958 femmes<br />
infectées dépistées avaient reçu de la ZDV ainsi que 86% des 3865 enfants nés vivants (123).<br />
Il apparaît désormais de façon claire qu'il n'existe pas de solution simp<strong>le</strong> et universel<strong>le</strong> pour la mise en<br />
place des programmes opérationnels de PTME en Afrique. Cependant, compte tenu de notre<br />
expérience <strong>à</strong> Abidjan et de l'importance de la stigmatisation envers <strong>le</strong>s PVVIH, la mobilisation<br />
communautaire reste l’approche privilégiée et devait être mise en œuvre <strong>le</strong> plus rapidement possib<strong>le</strong><br />
avec <strong>le</strong>s <strong>le</strong>aders de quartiers et <strong>le</strong>s chefs religieux avant que toute approche plus systématique, pouvant<br />
al<strong>le</strong>r jusqu’<strong>à</strong> la NVP universel<strong>le</strong> soit sérieusement considérée.
98<br />
Chapitre 4<br />
Protoco<strong>le</strong> de l’Etude ANRS 1201, Ditrame Plus<br />
Efficacité des interventions antirétrovira<strong>le</strong>s de PTME<br />
« A ce stade, l'erreur la plus grave que nous pourrions faire est de laisser la pandémie nous diviser.<br />
Quand 8000 personnes meurent chaque jour du SIDA, la division est un luxe<br />
que nous ne pouvons pas nous offrir ».<br />
Tobias Randall (Coordonnateur américain de la lutte antisida)<br />
Bangkok, Thaïlande, Juil<strong>le</strong>t 2004
99<br />
Le Projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus est un projet de recherche qui regroupe cinq études<br />
principa<strong>le</strong>s dont l’objectif est de proposer un paquet d’interventions dirigées contre l’infection <strong>à</strong> VIH<br />
de la mère et de l’enfant en Afrique. Il regroupe :<br />
• L’étude ANRS 1201 dont l’objectif est d’évaluer <strong>le</strong>s interventions d’ARVs en peripartum;<br />
• L’étude ANRS 1202 dont l’objectif est d’évaluer <strong>le</strong>s interventions nutritionnel<strong>le</strong>s pour la<br />
réduction de la transmission postnata<strong>le</strong> du VIH;<br />
• L’étude ANRS 1203 qui étudie <strong>le</strong>s comportements sexuels et de procréation chez <strong>le</strong>s femmes<br />
négatives, ou qui ont refusé <strong>le</strong> test VIH en comparaison des femmes séropositives;<br />
• L’étude ANRS 1209 qui a pour objectif d’étudier la tolérance des ARVs chez <strong>le</strong>s enfants<br />
exposés en peripartum;<br />
• L’étude ANRS 1263 dont l’objectif est d’une part de valider la technique de PCR en temps<br />
réel pour <strong>le</strong> diagnostic précoce de l’infection <strong>à</strong> VIH chez <strong>le</strong>s enfants et d’autre part d’étudier<br />
<strong>le</strong>s résistances aux ARVs utilisés pour la PTME.<br />
Nous présenterons essentiel<strong>le</strong>ment dans ce chapitre la composante ANRS 1201 ou Ditrame Plus 1.<br />
L’étude comprend l’évaluation successive de deux protoco<strong>le</strong>s thérapeutiques pour la réduction<br />
intrapartum de la TME suite <strong>à</strong> un amendement du protoco<strong>le</strong> par <strong>le</strong> comité scientifique du projet. Nous<br />
nommerons la première partie de l’étude DP1.0 et la deuxième partie DP 1.1.<br />
4.1. Justification<br />
4.1.1. Justification de l’étude DP 1.0<br />
En Afrique, en l’absence de toute intervention, <strong>le</strong> risque pour une femme VIH+ de transmettre <strong>le</strong> virus<br />
<strong>à</strong> son enfant est estimé entre un cas sur quatre (25%) et un cas sur trois (33%) (22). Depuis 1999 et<br />
toujours en Afrique subsaharienne dans une population pratiquant en majorité l’allaitement, un régime<br />
court de ZDV diminue de plus d’un tiers <strong>le</strong> risque de TME (6-8). Ainsi <strong>le</strong> risque de TME <strong>à</strong> S4-S8 avec<br />
la ZDV est estimé <strong>à</strong> 14,7% (8), tandis qu’avec la NVP en monodose, il est estimé <strong>à</strong> 11,9% (9).<br />
Dans <strong>le</strong>s pays industrialisés comme en France, avec l’utilisation des combinaisons thérapeutiques de<br />
type HAART et la césarienne programmée, <strong>le</strong> risque de TME est estimée <strong>à</strong> 1,6% (17).<br />
Il était donc concevab<strong>le</strong> en Afrique de réduire la TME peripartum avec un traitement plus efficace que<br />
la ZDV ou la NVP, mais en restant simp<strong>le</strong> et d’un coût acceptab<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s programmes de santé<br />
publique. Lors de l’élaboration de ce projet, en dehors de l’essai PETRA (11) ayant étudié l’efficacité<br />
de la combinaison ZDV+3TC, aucune autre étude n’avait envisagé l’utilisation de combinaison
100<br />
thérapeutiques. Or, <strong>le</strong> mode d’action et <strong>le</strong>s modalités d’administration de la ZDV et de la NVP sont<br />
suffisamment différents pour qu’on puisse envisager <strong>le</strong>ur action synergique.<br />
4.1.2. Justification de l’étude DP 1.1 : Amendement du protoco<strong>le</strong> 1.0<br />
Le 31 mai 2001, <strong>le</strong> conseil scientifique du projet Ditrame Plus s’est réuni <strong>à</strong> Bordeaux et a pris<br />
connaissance de l'état d'avancement du projet, <strong>le</strong>s premières inclusions dans DP 1.0 ayant eu lieu <strong>le</strong> 6<br />
mars 2001, ainsi que des résultats actualisés de l'analyse conjointe DITRAME-RETROCI de<br />
l'efficacité <strong>à</strong> long terme de la prophylaxie par ZDV et enfin des données en cours de publication des<br />
essais PETRA et SAINT. Le conseil scientifique recommandait alors que <strong>le</strong> traitement ARV soit<br />
modifié pour une PTME plus efficace mais toujours applicab<strong>le</strong> en Afrique. Les arguments suivants ont<br />
été avancés :<br />
a) <strong>le</strong>s données existantes indiquent que <strong>le</strong>s schémas courts de prophylaxie par ZDV en monothérapie<br />
ont une efficacité insuffisante, notamment en cas d'allaitement. Les résultats <strong>à</strong> 24 mois sont décevants<br />
et nécessitent une meil<strong>le</strong>ure prévention de la TME in utero et intrapartum afin de maintenir un<br />
bénéfice <strong>à</strong> long terme.<br />
b) l'utilisation de la NVP périnata<strong>le</strong> entraîne la sé<strong>le</strong>ction de variants résistants aux INN, en cas<br />
d’utilisation de cette molécu<strong>le</strong> en monodose et en particulier chez des femmes ayant une charge vira<strong>le</strong><br />
décelab<strong>le</strong> sous traitement. Ce qui sera <strong>le</strong> cas de la plupart des femmes recevant la monothérapie de<br />
ZDV dans <strong>le</strong> protoco<strong>le</strong> DP1.0.<br />
Le conseil scientifique a donc recommandé pour la suite de l’étude de :<br />
• débuter plus précocement <strong>le</strong> traitement des femmes enceintes avec un traitement qui<br />
commencera <strong>à</strong> partir de la 32 ème SA. Le rationnel économique pour repousser <strong>à</strong> la 36 ème SA <strong>le</strong><br />
début du traitement ne semblait plus d'actualité dans la mesure où <strong>le</strong> prix de la ZDV avait<br />
considérab<strong>le</strong>ment baissé. Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s données publiées en Thaïlande (essai PHPT-1)<br />
indiquent que la ZDV en schéma court est moins efficace qu’ un schéma débuté plus<br />
précocement.<br />
• de remplacer la ZDV par <strong>le</strong> Combivir ® (ZDV+3TC)<br />
Il s'agit en effet de la seu<strong>le</strong> combinaison largement étudiée en période périnata<strong>le</strong>. Les données<br />
françaises montrent une excel<strong>le</strong>nte efficacité préventive. L'option ZDV+3TC est considérée alors en<br />
France comme une alternative <strong>à</strong> l'association ZDV+césarienne programmée. Dans <strong>le</strong> con<strong>texte</strong> africain,<br />
<strong>le</strong> coût de la césarienne n'autorise pas son utilisation comme prophylaxie de la TME, l'option<br />
ZDV+3TC paraît alors intéressante. Les problèmes sou<strong>le</strong>vés sont :<br />
a) <strong>le</strong>s risques de toxicité supplémentaire pour la mère et pour l'enfant, notamment une toxicité<br />
mitochondria<strong>le</strong>. Si l'on estime que ce risque est de l'ordre de 1% (ce qui est encore contesté par des<br />
équipes américaines), <strong>le</strong> bénéfice en terme de réduction de la TME serait nettement supérieur au
101<br />
risque. La tolérance dans <strong>le</strong> con<strong>texte</strong> africain reste cependant <strong>à</strong> surveil<strong>le</strong>r attentivement. Le comité<br />
scientifique recommande la poursuite de l'utilisation de la NVP en monodose en association avec <strong>le</strong><br />
traitement nucléosidique (ZDV+3TC). Afin de tenter de limiter l'incidence des mutations <strong>à</strong> la NVP, il<br />
recommande la poursuite du traitement maternel par la combinaison de ZDV+3TC pendant 3 <strong>à</strong> 5 jours<br />
postpartum, conformément <strong>à</strong> ce qui est fait lors d'une interruption programmée de traitement.<br />
4.2. Objectifs de l’étude<br />
4.2.1. Objectif principal<br />
Evaluer l’efficacité et la tolérance des combinaisons thérapeutiques suivantes 1) ZDV+NVP<br />
monodose en intrapartum, 2) ZDV+3TC+NVP monodose en intrapartum, administrées en peripartum<br />
<strong>à</strong> la femme enceinte et au nouveau-né pour la réduction de la TME du VIH-1.<br />
4.2.2. Questions spécifiques<br />
Les questions spécifiques de cette étude peuvent être formulées de la façon suivante :<br />
• Quel<strong>le</strong> est l’efficacité sur <strong>le</strong> terrain des combinaisons d’ARVs de courte durée pour prévenir la<br />
TME En particulier quel<strong>le</strong> est la contribution de la NVP monodose en intrapartum <strong>à</strong> ces<br />
régimes thérapeutiques courts<br />
• Quel<strong>le</strong> est la tolérance de ces régimes d’ARVs chez la femme et chez l’enfant <br />
4.3. Méthodes<br />
4.3.1. Choix méthodologique<br />
La méthode de référence pour évaluer l’efficacité d’une intervention est l’essai thérapeutique<br />
randomisé bien conduit (124). Pour <strong>le</strong> projet ANRS 1201, la méthode choisie est cel<strong>le</strong> d’une cohorte<br />
thérapeutique non randomisée. En effet, dans un con<strong>texte</strong> où des médicaments comme la ZDV et la<br />
NVP sont disponib<strong>le</strong>s après une évaluation individuel<strong>le</strong> préalab<strong>le</strong> dans des essais d’efficacité, une<br />
cohorte thérapeutique nous a paru plus uti<strong>le</strong> parce que :<br />
• la clause d’ambiva<strong>le</strong>nce ne nous paraît pas respectée, entre la ZDV d’une part et la<br />
combinaison ZDV+NVP d’autre part; a fortiori avec la combinaison (ZDV+3TC+NVP).<br />
• il existait déj<strong>à</strong> dans cette vil<strong>le</strong> et dans <strong>le</strong>s mêmes communes une cohorte historique ayant reçu<br />
<strong>le</strong> traitement de référence : la ZDV en monothérapie et recrutée entre 1995-2000 qui pouvait<br />
constituer un groupe de comparaison pour notre étude. Il était en fait prévu que la cohorte<br />
FSTI concomitante <strong>à</strong> DP serve aussi de référence.
102<br />
4.3.2. Schéma d’étude<br />
Il s’agit d’une cohorte thérapeutique, ouverte, non randomisée<br />
4.4. Population d’étude<br />
Toutes <strong>le</strong>s femmes enceintes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 sont éligib<strong>le</strong>s pour cette étude. Les<br />
femmes enceintes infectées répondant aux critères d’inclusion sont incluses consécutivement dans <strong>le</strong>s<br />
deux centres de suivi des deux plus grandes communes de la vil<strong>le</strong> d’Abidjan : <strong>le</strong> centre de Niangon<br />
Sud <strong>à</strong> Yopougon et <strong>le</strong> centre d’Avocatier <strong>à</strong> Abobo. Le suivi des patientes s’est effectué <strong>à</strong> des temps<br />
fixes selon un ca<strong>le</strong>ndrier bien précis. La durée du suivi est de deux ans pour chaque coup<strong>le</strong> mèreenfant<br />
pour satisfaire <strong>le</strong>s objectifs de l’étude Ditrame Plus 1202.<br />
4.4.1. Critères d'inclusion<br />
• Infection <strong>à</strong> VIH-1 ou VIH 1+2 dont <strong>le</strong> diagnostic sérologique est confirmé sur deux<br />
prélèvements effectués <strong>à</strong> des temps différents (au dépistage et <strong>à</strong> la préinclusion)<br />
• Femme ayant bénéficié d'un conseil prétest et post-test et ayant pris connaissance du résultat<br />
de son statut sérologique<br />
• Femme âgée de 18 ans ou plus <strong>le</strong> jour de l'inclusion<br />
• Grossesse évolutive d'âge gestationnel de 36 semaines ou plus d'aménorrhée révolues <strong>le</strong> jour<br />
de l’inclusion pour la cohorte 1.0 et de 32 semaines ou plus d'aménorrhée révolues <strong>le</strong> jour de<br />
l’inclusion pour la cohorte 1.1. Cette estimation sera basée sur la connaissance de la date des<br />
dernières règ<strong>le</strong>s, ou du résultat d'une échographie ou bien encore sur la mesure de la hauteur<br />
utérine, selon la meil<strong>le</strong>ure méthode disponib<strong>le</strong><br />
• Taux d'hémoglobine ≥ 7g/dl dans <strong>le</strong> mois qui précède l'inclusion<br />
• Résidence permanente dans un périmètre autour du centre où se dérou<strong>le</strong> <strong>le</strong> projet tel que <strong>le</strong><br />
suivi est envisageab<strong>le</strong> selon <strong>le</strong> protoco<strong>le</strong><br />
• Absence de contre-indication <strong>à</strong> l’un ou l’autre des médicaments ARVs<br />
• Obtention d'un consentement éclairé avec remise et explication de la note d'information et<br />
signature du formulaire de consentement du projet au plus tard <strong>le</strong> jour de l'inclusion.
103<br />
4.4.2. Critères de non inclusion<br />
• Infection <strong>à</strong> VIH-2 exclusive ou absence d'infection <strong>à</strong> VIH<br />
• Pathologie gravidique sévère (pré-éclampsie, …) mettant en jeu <strong>le</strong> pronostic vital de la mère<br />
et/ou de l'enfant<br />
• Vomissements sévères empêchant l'absorption des comprimés<br />
• Refus de participer <strong>à</strong> l’étude<br />
• Accouchement prévu de la femme hors de la vil<strong>le</strong> d’Abidjan.
104<br />
4.5. Les interventions thérapeutiques<br />
4.5.1. Le traitement antirétroviral et <strong>le</strong>s interventions nutritionnel<strong>le</strong>s<br />
Le tab<strong>le</strong>au 20 résume <strong>le</strong>s différentes interventions thérapeutiques proposées aux femmes<br />
Tab<strong>le</strong>au 20. Interventions thérapeutiques proposées au sein du projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus.<br />
Prepartum Intrapartum Postpartum<br />
(Mère)<br />
Traitement Postnatal<br />
(Enfant)<br />
Interventions<br />
nutritionnel<strong>le</strong>s<br />
Ditrame Plus 1.0<br />
ZDV (36 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2/j<br />
ZDV : 600 mg per os<br />
NVP 200mg per os<br />
- ZDV sirop : 2 mg/kg/ x 4/j<br />
(1 semaine)<br />
NVP : 2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2<br />
- Allaitement maternel<br />
et sevrage précoce <strong>à</strong> 3-4 mois<br />
- Alimentation artificiel<strong>le</strong><br />
Jusqu'<strong>à</strong> l’âge de 9-12 mois<br />
Ditrame Plus 1.1<br />
ZDV + 3TC (32 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2/j<br />
150 mg 3TC per os x 2/j<br />
ZDV: 600 mg per os<br />
3TC : 300 mg per os<br />
NVP : 200mg per os<br />
ZDV + 3TC (3 jours)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
150 mg 3TC per os x 2<br />
ZDV sirop: 2 mg/kg/ x 4/j<br />
(1 semaine)<br />
NVP : 2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2<br />
- Allaitement maternel<br />
et sevrage précoce <strong>à</strong> 3-4 mois<br />
- Alimentation artificiel<strong>le</strong><br />
Jusqu'<strong>à</strong> l’âge de 9-12 mois<br />
DITRAME<br />
ZDV (36 ème SA)<br />
ZDV: 600 mg per os<br />
ZDV + 3TC (7 jours)<br />
- Allaitement maternel<br />
ANRS 049*<br />
300 mg ZDV per os x 2/j<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
* Pour mémoire, nous rappelons <strong>le</strong> régime thérapeutique reçu par <strong>le</strong>s femmes incluses entre 1995 et 2000. Ce groupe a servi de groupe de référence pour estimer l’efficacité<br />
des nouveaux régimes d’ARVs administrés.
105<br />
4.5.2 Traitements associés<br />
- Chaque femme incluse dans la cohorte recevait une dose quotidienne de vitamines, de<br />
l’inclusion jusqu’<strong>à</strong> la fin de la première semaine postpartum, selon <strong>le</strong> protoco<strong>le</strong> évalué par Fawzi et al :<br />
une gélu<strong>le</strong> combinant 20 mg de vitamine B1, 20 mg de vitamine B2, 25 mg de vitamine B6, 100 mg<br />
de niacine, 50 µg de vitamine B12, 500 mg de vitamine C et 30 mg de vitamine E, 30 mg de beta<br />
carotène et 5000 UI de vitamine A préformée (96).<br />
- Une dose de 200 000 UI de vitamine A était donnée per os <strong>à</strong> la femme une semaine après<br />
l’accouchement, couvrant <strong>le</strong>s besoins des premiers mois du postpartum quel que soit <strong>le</strong> mode<br />
d’alimentation du nourrisson, selon <strong>le</strong>s recommandations OMS (125).<br />
- Chaque femme incluse dans la cohorte recevait une prophylaxie de l’anémie : 120 mg de fer et<br />
0,50 mg d'acide folique <strong>à</strong> prendre chaque jour, au plus tard <strong>à</strong> partir de l'inclusion et jusqu'au 7ème jour<br />
postpartum, selon <strong>le</strong>s recommandations nationa<strong>le</strong>s ivoiriennes.<br />
- Une dose de 600 mg de chloroquine était donnée par semaine pour la prophylaxie palustre,<br />
selon <strong>le</strong>s recommandations nationa<strong>le</strong>s.<br />
- La prise de tout autre traitement anti-rétroviral autre que celui de l’étude par la mère et <strong>le</strong><br />
nouveau-né était <strong>à</strong> priori proscrite pendant <strong>le</strong>s deux premiers mois après l’accouchement.<br />
4.6. Dérou<strong>le</strong>ment de l’étude<br />
4.6.1 Dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH<br />
Le dépistage sérologique des femmes enceintes a été réalisé avec des tests rapides dans <strong>le</strong>s centres de<br />
dépistage selon <strong>le</strong>s recommandations de l’OMS (108). Après un conseil prétest et la signature d’un<br />
consentement selon <strong>le</strong>s recommandations nationa<strong>le</strong>s ivoiriennes, la réalisation d’un premier test rapide<br />
: (Determine ® Laboratoires Abbot, Abbot Park IL, USA), suivi d’un deuxième test de principe<br />
différent était appliqué sur <strong>le</strong> même prélèvement si <strong>le</strong> premier test était positif (Genie II ® , Bio-Rad,<br />
Marnes-La-Coquette, France). En cas de doub<strong>le</strong> positivité, la femme enceinte pouvait être informée,<br />
24 heures après, du caractère positif du résultat et de la nécessité d’effectuer un deuxième prélèvement<br />
<strong>à</strong> la visite de préinclusion avec la réalisation d’un test sérologique ELISA réalisé au laboratoire de<br />
référence (CeDReS). Un contrô<strong>le</strong> de qualité des tests rapides réalisés a été effectué dans <strong>le</strong> cadre de<br />
cette étude. Les femmes dépistées comme séropositives pour <strong>le</strong> VIH-1 ou VIH 1+2 étaient référées <strong>à</strong><br />
l’équipe du projet dans <strong>le</strong>s deux centres de suivi situés dans <strong>le</strong>s communes de Yopougon et d’Abobo.
106<br />
4.6.2. Dérou<strong>le</strong>ment de la Préinclusion.<br />
La préinclusion a été réalisée <strong>à</strong> la 32 ème semaine pour <strong>le</strong>s femmes débutant la prophylaxie par <strong>le</strong><br />
régime ZDV et <strong>à</strong> la 28 ème semaine pour <strong>le</strong>s femmes ayant débuté <strong>le</strong> régime ZDV+3TC.<br />
La préinclusion a été réalisée au centre de dépistage pour <strong>le</strong>s patientes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1<br />
et <strong>le</strong> VIH-1+2 en consultations prénata<strong>le</strong>s et au centre de suivi pour <strong>le</strong>s femmes connaissant déj<strong>à</strong> <strong>le</strong>ur<br />
statut d'infection <strong>à</strong> VIH ou dépistées dans des centres autres que <strong>le</strong>s centres de dépistage du projet.<br />
Le projet Ditrame Plus était alors présenté <strong>à</strong> la femme, suivi d'un deuxième conseil post-test.<br />
Le bilan prescrit était <strong>le</strong> suivant :<br />
o NFS<br />
o Numération lymphocytaire : lymphocytes CD4+, CD8+<br />
o Sérologie VIH par ELISA<br />
o Sérologie de la syphilis<br />
o Stockage plasmatique et cellulaire<br />
Le bilan biologique était réalisé au laboratoire de référence du CHU de Treichvil<strong>le</strong> <strong>à</strong> Abidjan : Centre<br />
de Diagnostic et de Recherches sur <strong>le</strong> SIDA (CeDReS).<br />
Pour la sérologie VIH, <strong>le</strong> test ELISA était réalisé par deux méthodes différentes : Vironistika VIH<br />
Uniform II plus O ® (Organon Teknika, boxtel, Pays-bas) et <strong>le</strong> test Murex VIH-1.2 ® (Laboratoires<br />
Abbot). Ces deux tests permettaient de faire la confirmation de l'infection <strong>à</strong> VIH-1 avant <strong>le</strong> traitement<br />
et de faire la discrimination du type d'infection <strong>à</strong> VIH.<br />
4.6.3. Dérou<strong>le</strong>ment de l’inclusion<br />
L’inclusion dans la cohorte est réalisée au centre de suivi du projet après l’obtention du<br />
consentement éclairé (annexe 4) qui a fait l’objet d’un sous-chapitre dans cette thèse.<br />
L'inclusion a été réalisée <strong>à</strong> la 36 ème semaine pour <strong>le</strong>s femmes traitées par <strong>le</strong> régime ZDV+NVP<br />
monodose et <strong>à</strong> la 32 ème semaine pour <strong>le</strong>s femmes ayant reçu <strong>le</strong> régime ZDV+3TC+NVP en monodose.<br />
Un contrô<strong>le</strong> du taux d'hémoglobine était réalisé sur site <strong>à</strong> l’aide d’un hémoglobinomètre pour <strong>le</strong>s<br />
femmes ayant des taux d'hémoglobine
107<br />
4.6.4. Dérou<strong>le</strong>ment du suivi<br />
Le suivi dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus est divisé en deux périodes : la période prepartum et la période<br />
postpartum<br />
• Dérou<strong>le</strong>ment du suivi : de l'inclusion <strong>à</strong> l'accouchement<br />
Cette période était marquée par <strong>le</strong>s consultations prénata<strong>le</strong>s. La première consultation prénata<strong>le</strong> se<br />
déroulait une semaine après l’inclusion puis tous <strong>le</strong>s 15 jours au centre de suivi. El<strong>le</strong> comprenait un<br />
examen gynécologique et un recueil de données sur <strong>le</strong> traitement prénatal de l'étude.<br />
• Dérou<strong>le</strong>ment du suivi : après l'accouchement<br />
Il comprenait <strong>le</strong> suivi de la mère et de l'enfant selon un ca<strong>le</strong>ndrier bien précis. Le ca<strong>le</strong>ndrier des<br />
consultations pendant cette période est résumé dans <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux 21 et 22.
108<br />
Tab<strong>le</strong>au 21. Rythme de suivi des femmes incluses dans <strong>le</strong> projet ANRS 1201/1202 : de l'inclusion au diagnostic de l'infection <strong>à</strong> VIH de l’enfant.<br />
Consentement ̌<br />
Inclusion # CPN-1* CPN-2 CPN-3 Accouchement J2 S1 S2 S3 S4 S5 S6<br />
Examen Clinique ̌ ̌ ̌ ̌ ̌ ̌<br />
Observance** ̌ ̌ ̌ ̌ ̌<br />
NFS-CD4 ̌<br />
Taux Hb ̌ ̌<br />
Stockage ̌ ̌<br />
# Consultation d'inclusion <strong>à</strong> partir de 36 semaines révolues d'aménorrhée pour la cohorte 1.0 (ZDV+NVP) et <strong>à</strong> partir de la 32 ème SA pour la cohorte 1.1 (ZDV + 3TC + NVP)<br />
*CPN =Consultation de suivi prénatal n°1, 2, 3<br />
** observance du traitement : entretien et questionnaire<br />
Tab<strong>le</strong>au 22. Rythme de suivi des enfants au sein du projet ANRS 1201/1202 : de la naissance jusqu’au diagnostic de l'infection pédiatrique <strong>à</strong> VIH <strong>à</strong> S6.<br />
Accouchement J2 S1 S2 S3 S4 S5 S6<br />
Examen clinique ̌ ̌ ̌ ̌ ̌ ̌ ̌ ̌<br />
NFS ̌<br />
Charge vira<strong>le</strong> ̌<br />
Stockage ̌ ̌ ̌
109<br />
Au cours du suivi, la totalité des frais médicaux (dépistage, consultations systématiques, consultations<br />
pour événement médical imprévu, médicaments, examens complémentaires, hospitalisations<br />
éventuel<strong>le</strong>s) et <strong>le</strong>s frais de transport des malades étaient pris en charge par <strong>le</strong> projet depuis l'inclusion<br />
jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant. L'accouchement et <strong>le</strong>s frais d'hospitalisation étaient<br />
éga<strong>le</strong>ment pris en charge par <strong>le</strong> projet.<br />
• Suivi des femmes ayant interrompu <strong>le</strong> traitement ou identifiées négatives ou VIH-2<br />
Le suivi de la mère et de l’enfant était maintenu <strong>à</strong> l’identique jusqu’<strong>à</strong> la fin de l’étude en cas<br />
d’interruption du traitement après identification d’un effet indésirab<strong>le</strong> grave, notamment biologique.<br />
Une fois inclus, <strong>le</strong>s femmes et <strong>le</strong>s enfants qui refusaient d’être suivis étaient considérés comme des<br />
abandons de l’étude. Leur suivi dans la cohorte pourrait être repris <strong>à</strong> tout moment entre la naissance et<br />
<strong>le</strong> deuxième anniversaire de l'enfant.<br />
• Suivi des enfants infectés<br />
Le résultat individuel du diagnostic de l’infection pédiatrique <strong>à</strong> VIH était rendu <strong>à</strong> la mère dès que <strong>le</strong><br />
résultat était disponib<strong>le</strong>, souvent <strong>à</strong> partir du troisième mois de vie. Les enfants infectés étaient suivis<br />
tous <strong>le</strong>s mois au centre de suivi et au service de pédiatrie du CHU de Yopougon dans <strong>le</strong> cadre de<br />
l'initiative ivoirienne de prise en charge. Les enfants ayant des pourcentages de CD4
110<br />
4.7. Critères de jugement<br />
4.7.1. Critère de jugement principal<br />
Le taux de TME du VIH-1 était défini comme la probabilité pour un enfant d’être infecté <strong>à</strong> l’âge de<br />
J30 ou J45 (J0 correspondant au jour de la naissance).<br />
4.7.2. Critères de jugement secondaires<br />
• L'incidence de l'anémie sévère de l'enfant, définie par un taux d'hémoglobine < 8 g/dl <strong>à</strong> J30<br />
après la naissance.<br />
• L’incidence des rashs de la mère et de l’enfant <strong>à</strong> J8 postpartum.<br />
• La fréquence de la mortinatalité (mort-nés) rapportée au nombre cumulé de mort-nés et de<br />
naissances vivantes.<br />
• La fréquence de la mortalité néonata<strong>le</strong> précoce, calculée <strong>à</strong> la fin de la première semaine de<br />
suivi des enfants nés vivants.<br />
• La fréquence de la mortalité néonata<strong>le</strong>, calculée <strong>à</strong> la fin des quatre premières semaines de<br />
suivi des enfants nés vivants.<br />
4.8. Nombre de sujets nécessaire<br />
4.8.1. Nombre de sujets nécessaire pour la cohorte 1.0 : ZDV+NVP monodose<br />
Pour <strong>le</strong> calcul du nombre de sujets nécessaire, nous avons utilisé une comparaison de deux proportions<br />
en estimant que <strong>le</strong> taux de TME dans la cohorte sous <strong>le</strong> régime pouvait être réduit de moitié chez <strong>le</strong>s<br />
femmes traitées par la combinaison ZDV+NVP monodose soit 7,5%. En formulant cette hypothèse de<br />
travail, nous nous basons sur <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong> traitement de référence (ZDV en monothérapie pendant la<br />
même période) donnait un taux de TME de 14,7% <strong>à</strong> l’âge de six semaines dans <strong>le</strong> cadre de l’analyse<br />
poolée ANRS-RETROCI (8).<br />
Ainsi, pour estimer la tail<strong>le</strong> de cet échantillon, on a choisi un risque alpha de première espèce de 5% et<br />
une puissance (1-β) de 80%. Il fallait ainsi au moins 398 femmes dans chaque groupe. Si nous<br />
considérons que 10% des dossiers seraient non exploitab<strong>le</strong>s du fait de décès périnataux, des refus et<br />
des perdus de vue avant et après accouchement, la tail<strong>le</strong> de la cohorte doit être au minimum de 438<br />
femmes enceintes infectées par <strong>le</strong> VIH. Une tel<strong>le</strong> réduction de la TME aboutissant <strong>à</strong> un risque absolu<br />
inférieur <strong>à</strong> un enfant sur dix, aurait une importance de santé publique significative par rapport au<br />
traitement de référence, approximativement de même durée et d’un coût comparab<strong>le</strong>.
111<br />
4.8.2. Nombre de sujets nécessaire pour la cohorte 1.1 : ZDV + 3TC+ NVP<br />
Pour <strong>le</strong> calcul du nombre de sujets nécessaire, réalisé après l'analyse intermédiaire des données de la<br />
cohorte 1.0, nous avons utilisé une comparaison de deux proportions en estimant que <strong>le</strong> taux de TME<br />
dans la cohorte sous <strong>le</strong> nouveau régime prophylactique pourrait être réduit éga<strong>le</strong>ment de moitié pour<br />
<strong>le</strong>s femmes traitées par la combinaison ZDV+3TC+ NVP monodose soit 4,0%. En formulant cette<br />
hypothèse de travail, nous nous basions sur <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong> traitement de référence (ZDV+NVP<br />
monodose) donnait alors un taux de TME de 9,0% <strong>à</strong> l’âge de six semaines (données non publiées).<br />
Ainsi,pour estimer la tail<strong>le</strong> de cet échantillon, on a choisi un risque alpha de première espèce de 5% et<br />
une puissance (1-β) de 80%. Il fallait alors au moins 420 femmes dans chaque groupe. Si nous<br />
considérons que 10% des dossiers seraient non exploitab<strong>le</strong>s du fait de décès périnataux, des refus et<br />
des perdus de vue avant et après accouchement, la tail<strong>le</strong> de la cohorte doit être au minimum de 452<br />
femmes enceintes infectées par <strong>le</strong> VIH. Une tel<strong>le</strong> réduction de la TME <strong>à</strong> 4%, soit un risque absolu<br />
inférieur <strong>à</strong> un enfant sur vingt aurait <strong>à</strong> nouveau une importance de santé publique significative par<br />
rapport au traitement de référence, approximativement de même durée et d’un coût comparab<strong>le</strong>.<br />
Les inclusions ont été arrêtées dans la cohorte ZDV+3TC+ NVP monodose dès la mise en place du<br />
programme MTCT PLUS en Août 2003 avec la possibilité d’utiliser des HAART pour <strong>le</strong>s femmes qui<br />
en avaient l'indication. Comme nous <strong>le</strong> verrons ici, <strong>le</strong>s résultats intermédiaires (tab<strong>le</strong>au 23) indiquaient<br />
alors qu’il était peu probab<strong>le</strong> que l’hypothèse de travail soit atteinte en terme de réduction de la TME <strong>à</strong><br />
un niveau aussi bas que 4%.<br />
4.9. Analyse<br />
4.9.1. Analyse des données<br />
Les recommandations du groupe de Ghent ont été utilisées pour cette analyse (126). Une analyse en<br />
intention de traiter a été réalisée. Pour garantir l'indépendance des observations, seul <strong>le</strong> premier<br />
jumeau a été pris en compte quand la femme a donné naissance <strong>à</strong> des jumeaux ou <strong>à</strong> des triplés. La<br />
comparaison des moyennes a été réalisée avec un test t de Student ou par un test non paramétrique : <strong>le</strong><br />
test U de Mann-Withney. Pour <strong>le</strong>s variab<strong>le</strong>s qualitatives, <strong>le</strong> test de chi-2 de Pearson ou <strong>le</strong> test exact de<br />
Fisher a été utilisé selon <strong>le</strong>s indications. La probabilité de survenue d'une infection <strong>à</strong> quatre semaines a<br />
été estimée par la méthode de Kaplan-Meier en considérant la date de survenue de l'infection comme<br />
<strong>le</strong> délai entre <strong>le</strong> premier test positif et <strong>le</strong> dernier test négatif (126). Un test de logrank a été utilisé pour<br />
la comparaison brute et une analyse multivariée avec <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> <strong>à</strong> risques proportionnels de Cox a été<br />
utilisée pour estimer l'efficacité de chaque régime thérapeutique. L'efficacité des combinaisons de<br />
ZDV+NVP monodose, ZDV+3TC+NVP monodose par rapport <strong>à</strong> la monothérapie de ZDV a été
112<br />
calculée comme la différence entre un et <strong>le</strong> risque relatif estimé par <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> de Cox (1 - Ii /Io). Le<br />
RR a été rapporté avec son interval<strong>le</strong> de confiance <strong>à</strong> 95%.<br />
4.9.2 Analyses intermédiaires<br />
Une analyse intermédiaire a été réalisée après 173 inclusions en février 2002 dans la cohorte Ditrame<br />
Plus 1.0 afin d’examiner la tolérance et l’efficacité du régime ZDV+NVP monodose. Le taux de<br />
transmission <strong>à</strong> 6 semaines était alors de 8,8% (IC95% [4,4-17,4%]). Le taux de transmission dans la<br />
cohorte historique de comparaison était de 14,7% (IC95% [10,6-18,8]). Le taux de TME par strates de<br />
CD4 est résumé dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 23.<br />
Tab<strong>le</strong>au 23. Analyse intermédiaire, Estimation du taux de transmission <strong>à</strong> S4-S6, Projet ANRS<br />
1201/1202 Ditrame Plus, Abidjan, Février 2002.<br />
Lymphocytes T4 >=500/mm3
113<br />
4.10.2. Définition d'un événement indésirab<strong>le</strong> grave chez l'enfant<br />
Un événement indésirab<strong>le</strong> grave correspond <strong>à</strong> tout événement suivant<br />
- décès<br />
- événement menaçant <strong>le</strong> pronostic vital<br />
- événement entraînant une hospitalisation prolongée d'au moins 24 heures<br />
- anémie sévère définie par un taux d’hémoglobine < 8 g/dl <strong>à</strong> J30<br />
- acidose lactique sévère définie chez l’enfant par un taux d’acide lactique sanguin > 2<br />
mmol / litre <strong>à</strong> partir du troisième jour de vie<br />
- événement entraînant un handicap ou une incapacité<br />
- anomalie congénita<strong>le</strong><br />
- tout événement résultant d'un surdosage<br />
4.10.3. Notification d'un événement indésirab<strong>le</strong> grave<br />
Tout événement indésirab<strong>le</strong> grave tel que défini ci-dessus fait l'objet d'une déclaration sur une fiche<br />
spécia<strong>le</strong> "fiche EIG mère" et "fiche EIG enfant" qui est <strong>à</strong> transmettre immédiatement au centre<br />
coordonnateur (INSERM U593) par télécopie. Un classeur est tenu par <strong>le</strong> centre coordonnateur qui est<br />
chargé d'informer <strong>le</strong> promoteur des événements qu'il considère comme liés <strong>à</strong> la recherche.<br />
4.11. Organisation pratique du projet<br />
4.11.1. Recueil des données<br />
Un classeur standardisé contenant des questionnaires spécifiques a permis d'effectuer <strong>le</strong> recueil des<br />
données. La liste des questionnaires utilisés au sein du projet Ditrame Plus est présentée dans <strong>le</strong>s<br />
tab<strong>le</strong>aux 24 et 25.
114<br />
Tab<strong>le</strong>au 24. Liste des questionnaires utilisés pour <strong>le</strong> recueil des données chez <strong>le</strong>s femmes au sein<br />
du projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus, Abidjan.<br />
Num Nom questionnaires<br />
Commentaires<br />
1 Critères d'inclusion* Vérification des critères d’inclusion<br />
2 Inclusion* Recueil des données socio-démographiques<br />
3 Consultation prepartum Suivi des consultations prepartum<br />
4 Traitement et observance Observance des médicaments en prepartum<br />
5 Complications obstétrica<strong>le</strong>s Recueil des données sur <strong>le</strong>s complications<br />
obstétrica<strong>le</strong>s<br />
6 Consultation postpartum S1 Première visite après accouchement<br />
7 Consultation postpartum S4 Bilan clinique et recherche d’effets secondaires<br />
8 Consultation postpartum trimestriel<strong>le</strong> Stade clinique et événements intercurrents<br />
9 Contraception Distribution et observance des méthodes<br />
contraceptives<br />
10 Examen des seins Recueil des données sur <strong>le</strong>s pathologies mammaires<br />
11 Refus du suivi Raisons des refus du suivi<br />
12 Evénement indésirab<strong>le</strong> grave Recueil de la morbidité et de la mortalité<br />
13 Nouvel<strong>le</strong> grossesse Diagnostic et issue d’une nouvel<strong>le</strong> grossesse<br />
14 Fiche de mise sous Cotrimoxazo<strong>le</strong> Prescription et suivi de la prophylaxie par <strong>le</strong> CMX<br />
* Annexe 5<br />
Tab<strong>le</strong>au 25. Liste des questionnaires pour <strong>le</strong> recueil des données chez <strong>le</strong>s enfants au sein du<br />
projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus, Abidjan.<br />
Num Nom questionnaires<br />
Commentaires<br />
1 Naissance* / naissance multip<strong>le</strong> Conditions d’accouchement et statut de l’enfant<br />
2 Score de Finnström Age clinique de l’enfant, prématurité ou postmaturité<br />
3 Visite J2 Première modalité d’alimentation et traitement par NVP<br />
4 Visite de suivi des enfants Modalité d’alimentation des enfants<br />
5 Arrêt allaitement maternel Arrêt et conséquences de l’allaitement maternel<br />
6 Evénement indésirab<strong>le</strong> grave Recueil de la morbidité et de la mortalité<br />
7 Fiche de mise sous Cotrimoxazo<strong>le</strong> Suivi des enfants sous cotrimoxazo<strong>le</strong><br />
8 Validation des événements cliniques Recueil de la morbidité grave chez <strong>le</strong>s enfants<br />
* Annexe 5
115<br />
4.11.2. Gestion des données<br />
El<strong>le</strong> comportait plusieurs étapes<br />
- <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> manuel : <strong>le</strong>cture des fiches par <strong>le</strong> moniteur d’étude clinique (MEC) et <strong>le</strong>s attachés de<br />
recherche clinique (ARC) pour vérifier l’exhaustivité des données et faire <strong>le</strong>s demandes de correction;<br />
- <strong>le</strong> codage des fiches avec l’utilisation d’un thesaurus spécifique,<br />
- <strong>le</strong>s demandes de corrections,<br />
- la saisie des fiches était réalisée sur <strong>le</strong>s sites avec <strong>le</strong> logiciel Epidata 2.1, puis <strong>le</strong>s données étaient<br />
transférées dans une base de données ACCESS. Des contrô<strong>le</strong>s informatiques programmés dans la base<br />
ACCESS permettaient d’éditer des listes d’erreur,<br />
- <strong>le</strong>s corrections dans la base des données étaient effectuées par <strong>le</strong> gestionnaire de base de données,<br />
- une sauvegarde régulière de la base de données était faite et une copie envoyée tous <strong>le</strong>s mois au<br />
centre investigateur <strong>à</strong> Bordeaux pour une seconde sauvegarde des données.<br />
4.11.3. Rétro-information<br />
Un bilan mensuel des activités et des inclusions était envoyé aux investigateurs <strong>à</strong> Bordeaux et un bilan<br />
trimestriel était présenté au comité de pilotage <strong>à</strong> tous <strong>le</strong>s investigateurs. Les membres du conseil<br />
scientifique recevaient un bilan annuel des données du projet Ditrame Plus.<br />
4.11.4. Coordination de l'étude et organisation scientifique<br />
Le centre coordonnateur du projet était l’Unité INSERM 593 <strong>à</strong> Bordeaux pour <strong>le</strong>s aspects<br />
méthodologiques, statistiques et organisationnels. Le monitorage était assuré par un moniteur d'étude<br />
clinique et un gestionnaire de base de données, sous la responsabilité du centre coordonnateur. Lors de<br />
chaque déplacement sur site, <strong>le</strong>s cahiers d'observation ou classeurs étaient vérifiés sur un échantillon<br />
de données.<br />
Le Comité de Pilotage était l'instance décisionnaire pour tout ce qui a trait <strong>à</strong> l'organisation du projet<br />
au quotidien et <strong>à</strong> la production scientifique du projet Ditrame Plus. Le comité de pilotage se réunissait<br />
tous <strong>le</strong>s trimestres en 2001 et 2002 puis tous <strong>le</strong>s semestres depuis 2003. Au total, 15 comités de<br />
pilotage ont été réalisés depuis <strong>le</strong> début du projet. Un compte rendu et un re<strong>le</strong>vé de décisions ont été<br />
envoyés <strong>à</strong> tous <strong>le</strong>s membres du comité de pilotage.<br />
Le Comité Scientifique était composé des membres du Comité de Pilotage et d’experts qualifiés dans<br />
<strong>le</strong>s différents domaines et connaissant <strong>le</strong> terrain où se dérou<strong>le</strong> la recherche. Le comité scientifique se<br />
réunissait périodiquement, en moyenne, tous <strong>le</strong>s ans pour évaluer l'état d'avancement de la recherche,<br />
identifier <strong>le</strong>s erreurs, <strong>le</strong>s obstac<strong>le</strong>s entravant la bonne marche du projet et proposer des solutions
116<br />
appropriées. Trois comités scientifiques ont été réalisés pendant la durée du projet. Les amendements<br />
au protoco<strong>le</strong> ont été proposés par <strong>le</strong>s membres du comité de pilotage (annexe 6) et validés par <strong>le</strong><br />
comité scientifique de l’étude (annexe 6). Ces amendements ont été chaque fois transmis au promoteur<br />
de l’étude.<br />
4.11.5. Promotion<br />
La promotion de ce projet a été assurée par l’Agence Nationa<strong>le</strong> de Recherches sur <strong>le</strong> SIDA (ANRS).<br />
Ce projet dépendait de l’action coordonnée N°12 de l’ANRS.<br />
4.11.6. Partenariat<br />
Les partenaires de cette étude étaient:<br />
• Ministère de la Santé Publique et de la population de Côte d’Ivoire<br />
• Ministère délégué chargé de la Lutte contre <strong>le</strong> SIDA de Côte d’Ivoire<br />
• Agence Nationa<strong>le</strong> de Recherches sur <strong>le</strong> SIDA (ANRS) en France<br />
• Service de coopération et d’action culturel<strong>le</strong> <strong>à</strong> Abidjan et <strong>le</strong> ministère des Affaires étrangères<br />
en France<br />
• Laboratoires Glaxo-Wellcome International<br />
• Ensemb<strong>le</strong> contre <strong>le</strong> SIDA (Sidaction)<br />
• Institut National de la Santé et de la Recherche Médica<strong>le</strong> (INSERM) en France<br />
• Pharmacie de l’hôpital du Haut-Levêque <strong>à</strong> Pessac en France<br />
4.12. Aspects éthiques et rég<strong>le</strong>mentaires<br />
Ce protoco<strong>le</strong> a obtenu un avis favorab<strong>le</strong> du ministère de la Santé de Côte d’Ivoire et du comité<br />
d’éthique du programme national de lutte contre <strong>le</strong> SIDA en Côte d’Ivoire en Octobre 1999.<br />
L’ANRS, promoteur de cette étude a assuré la responsabilité léga<strong>le</strong> au nom de l’investigateur de tout<br />
préjudice direct ou indirect causé aux patients par <strong>le</strong>s médicaments ou <strong>le</strong>s méthodes utilisées pour la<br />
réalisation de la recherche. L’ANRS a souscrit une assurance en responsabilité civi<strong>le</strong> conformément<br />
aux dispositions de l'artic<strong>le</strong> L 209.7 du code de la Santé Publique du 20/12/1988 et art 5 du<br />
25/07/1991.
117<br />
4.13. Ca<strong>le</strong>ndrier de la recherche<br />
Le tab<strong>le</strong>au 26 récapitu<strong>le</strong> <strong>le</strong> ca<strong>le</strong>ndrier d’exécution du projet ANRS 1201.<br />
Tab<strong>le</strong>au 26. Ca<strong>le</strong>ndrier d’exécution du projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus.<br />
Ca<strong>le</strong>ndrier<br />
Agenda de la recherche<br />
16 mai 2000 Début du dépistage prénatal<br />
06 mars 2001 Début des inclusion dans la cohorte 1.0 (ZDV+NVP monodose)<br />
31 mai 2001 Conseil scientifique : amendement au protoco<strong>le</strong> DP1.0<br />
26 août 2002 Fin des inclusions dans la cohorte DP 1.0<br />
30 août 2002 Début des inclusion dans la cohorte 1.1 (ZDV+3TC+NVP monodose)<br />
31 juil<strong>le</strong>t 2003 Fin des inclusions dans la cohorte 1.1<br />
4.14. Circuit des médicaments<br />
Les médicaments (Retrovir ® et Combivir ® ) utilisés pour cette étude ont été donnés gratuitement par <strong>le</strong>s<br />
Laboratoires Glaxo-Wellcome et la Viramune ® ou NVP a été achetée <strong>à</strong> Boehringer-Ingelheim. Les<br />
médicaments ont été livrés en vrac par <strong>le</strong>s laboratoires Glaxo-Wellcome et Boehringer-Ingelheim <strong>à</strong> la<br />
pharmacie centra<strong>le</strong> du groupe hospitalier sud de l’hôpital Haut-Lévêque, du CHU de Bordeaux (Pr<br />
Marie-Claude Saux) qui a assuré <strong>le</strong> conditionnement en boîtes de traitement individuel et en plaquettes<br />
plastifiées et réalisé l'étiquetage en conformité avec la loi Huriet (artic<strong>le</strong> R5120). Une ordonnance type<br />
rappelant en particulier la posologie a été fournie avec chaque boîte de traitement individuel.<br />
L'approvisionnement des centres a été réalisé par lots en fonction du ca<strong>le</strong>ndrier des inclusions et des<br />
dates de péremption des produits. La sécurité du stockage et de la distribution des produits a été<br />
réalisée sous la responsabilité <strong>à</strong> Abidjan du Dr François Rouet, pharmacien biologiste et directeur du<br />
CeDreS au CHU de Treichvil<strong>le</strong>.<br />
Des conditionnements sur <strong>le</strong> site d’Abidjan ont été réalisés au début des inclusions dans la cohorte 1.1<br />
pour éviter <strong>le</strong>s ruptures de traitement.<br />
Pour la cohorte Ditrame Plus 1.0 <strong>le</strong> paquet de traitement était constitué de :<br />
• 6 plaquettes x (14 comprimés de ZDV) pour <strong>le</strong> traitement prépartum, considérant que <strong>le</strong> terme est<br />
estimé <strong>à</strong> l’inclusion de manière variab<strong>le</strong>.<br />
• 2 plaquettes x (2 comprimés de ZDV + 1 comprimé de NVP) pour <strong>le</strong> traitement intrapartum,<br />
considérant qu’un traitement peut être donné <strong>à</strong> tort en cas de faux travail.<br />
• 1 flacon de sirop de ZDV, forme pédiatrique, avec des seringues verseuses graduées <strong>à</strong> 1 ml.<br />
• 1 flacon de sirop de NVP, forme pédiatrique, avec la seringue verseuse graduée <strong>à</strong> 1 ml, pour <strong>le</strong><br />
traitement sous observation directe.
118<br />
Pour la cohorte Ditrame Plus 1.1, <strong>le</strong> paquet de traitement était constitué de :<br />
• 11 plaquettes x 14 comprimés de Combivir ® (ZDV+3TC) pour <strong>le</strong> traitement prépartum, considérant que<br />
<strong>le</strong> terme est estimé <strong>à</strong> l’inclusion de manière variab<strong>le</strong>.<br />
• 2 plaquettes x (2 comprimés de Combivir ® + 1 comprimé de NVP) pour <strong>le</strong> traitement intrapartum,<br />
considérant qu’un traitement peut être donné <strong>à</strong> tort en cas de faux travail.<br />
• 1 plaquette de 6 comprimés de Combivir ® (ZDV+3TC) pour <strong>le</strong> traitement postpartum.<br />
• 1 flacon de sirop de ZDV, forme pédiatrique, avec des seringues verseuses graduées <strong>à</strong> 1 ml.<br />
• 1 flacon de sirop de NVP, forme pédiatrique, avec la seringue verseuse graduée <strong>à</strong> 1 ml, pour <strong>le</strong><br />
traitement sous observation directe.<br />
4.15. Fin de l’étude<br />
Le bilan clinique et biologique a permis de référer deux mois après l’accouchement, <strong>le</strong>s mères<br />
éligib<strong>le</strong>s pour une HAART aux initiatives offrant l’accès aux ARVs en Côte d’Ivoire, en conformité<br />
avec <strong>le</strong>s recommandations nationa<strong>le</strong>s ivoiriennes ou <strong>à</strong> l’équipe coordonnant l’essai ANRS 1269<br />
d’interruption thérapeutique programmée (TRIVACAN). A la fin des deux années de suivi, <strong>le</strong>s mères<br />
qui ont participé au projet ont été orientées vers l’Unité de Soins Ambulatoires et Cliniques (USAC)<br />
du CHU de Treichvil<strong>le</strong>, puis vers <strong>le</strong> projet MTCT PLUS, ou <strong>à</strong> la PMI de Yopougon Attié. En fonction<br />
du stade immunitaire de la femme, la mise sous traitement antirétroviral hautement actif a été<br />
prescrite. Cette prise en charge thérapeutique était gratuite dans <strong>le</strong> programme MTCT PLUS et l’essai<br />
TRIVACAN.<br />
4.16. Suivi des enfants infectés<br />
Les enfants dépistés infectés par <strong>le</strong> VIH-1 <strong>à</strong> S4-S6 ou en postpartum ont été référés au Centre accrédité<br />
de prise en charge des enfants infectés du CHU de Yopougon pour la mise sous HAART. Ces enfants<br />
recevaient aussi une prophylaxie par cotrimoxazo<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> cadre de l’étude Ditrame Plus 2.<br />
Ils ont été suivis une fois par mois au centre de suivi de l’étude DP et au service de pédiatrie du CHU<br />
de Yopougon pour <strong>le</strong>ur traitement. La mise sous traitement antirétroviral a été proposée si <strong>le</strong><br />
pourcentage de CD4 des enfants était
119<br />
4.17. Principaux Résultats : efficacité des interventions<br />
Les principaux résultats de l’efficacité des interventions antirétrovira<strong>le</strong>s étudiées sont présentés dans<br />
l’artic<strong>le</strong> princeps du projet Ditrame Plus actuel<strong>le</strong>ment en révision <strong>à</strong> AIDS. La version pdf de ce<br />
manuscrit se trouve <strong>à</strong> la fin de ce chapitre.<br />
Le taux de transmission chez <strong>le</strong>s enfants issus de trois groupes de cohorte : ZDV (1995-2000),<br />
ZDV+NVP monodose (2001-2002) et ZDV+3TC+NVP monodose (2002-2003) y est rapporté ainsi<br />
que l’efficacité relative de ces différentes interventions. Nous avons réalisé une analyse en intention de<br />
traiter en ajustant sur <strong>le</strong>s facteurs maternels (CD4 et charge vira<strong>le</strong> notamment).<br />
Le taux de transmission <strong>à</strong> S4-S6 observé avec <strong>le</strong>s différentes prophylaxies ARV étudiées au sein du<br />
projet Ditrame Plus et de la cohorte historique est représenté sur la figure 5. Ce taux de transmission<br />
était de 6,5% (IC95% [3,9-9,1%]) dans la cohorte 1.0 et de 4,7% (IC95% [2,4-7,0%]) dans la cohorte<br />
1.1. Pour rappel, dans <strong>le</strong> groupe de référence qui est la cohorte historique et qui a inclus des femmes<br />
ayant reçu une monothérapie de ZDV, <strong>le</strong> taux de transmission <strong>à</strong> S4-S6 était estimé <strong>à</strong> 12,5%.<br />
14<br />
12,5%<br />
12<br />
10<br />
Taux de transmission (%)<br />
8<br />
6<br />
6,5%<br />
4,7%<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Monothérapie de ZDV (36-38ème SA) ZDV (36ème SA) + NVP monodose ZDV+3TC (32ème SA) + NVP monodose<br />
Régimes thérapeutiques<br />
Figure 5. Taux de transmission S4-S6 des différents régimes thérapeutiques étudiés au sein du<br />
projet ANRS 1201/1202 Ditrame Plus (2001-2003) et de la cohorte historique chez <strong>le</strong>s femmes<br />
traitées par une monothérapie de zidovudine (1995-2000), Abidjan, Côte d’Ivoire.
120<br />
Ainsi, avec la combinaison de ZDV+NVP monodose, on obtient une réduction du TME de 72%<br />
(IC95% [52-88%], p=0,002]) par rapport <strong>à</strong> la monothérapie de ZDV après avoir ajusté sur <strong>le</strong>s CD4+<br />
maternels, <strong>le</strong> stade clinique et <strong>le</strong>s modalités d’alimentation. Il n’y a pas de différence statistiquement<br />
significative entre la TME observée chez <strong>le</strong>s femmes traitées par la combinaison de ZDV+NVP<br />
monodose et la combinaison de ZDV+3TC+NVP monodose (p=0,34).<br />
4.18. Discussion<br />
Nous avons constitué une cohorte observationnel<strong>le</strong> pour étudier l’efficacité des régimes d’ARVs pour<br />
la PTME. Les raisons de ce choix <strong>à</strong> la place d’un essai randomisé ont été présentées dans ce chapitre.<br />
Nous n’aborderons pas en détail <strong>le</strong> débat entre la réalisation d’une étude de cohorte observationnel<strong>le</strong> et<br />
d’un essai thérapeutique randomisé. On sait que seul un essai thérapeutique randomisé peut permettre<br />
d’étudier l’efficacité d’un nouveau traitement ou d’une combinaison thérapeutique (124). Cependant<br />
<strong>le</strong>s études de cohorte ont apporté une contribution importante dans la prise en charge clinique des<br />
patients et dans l’étude des facteurs pronostiques de certaines maladies. Très récemment en mai 2004,<br />
deux artic<strong>le</strong>s (127, 128) et un commentaire de J Concato et R Horwitz (129) ont été publiés dans <strong>le</strong><br />
Lancet pour apporter des éléments de discussion sur ce sujet. Les avantages d’une étude de cohorte et<br />
<strong>le</strong>s limites des essais randomisés ont été abordés dans ces artic<strong>le</strong>s.<br />
En comparaison avec <strong>le</strong>s autres études réalisées en Afrique sur la PTME, nous présentons <strong>le</strong> taux de<br />
TME des différentes interventions thérapeutiques réalisées en Afrique depuis <strong>le</strong>s premiers essais<br />
thérapeutiques et incluant <strong>le</strong>s régimes évalués dans cette étude (figure 6). On observe ainsi qu’avec la<br />
combinaison ZDV+3TC+NVP monodose, on peut obtenir en Afrique des taux de TME
121<br />
Placebo (ANRS 049 + KZT)<br />
24,8<br />
Monodose ZDV (HIVNET012)<br />
ZDV enfant (NVAZ-1)<br />
21,3<br />
20,9<br />
NVPmd (mère) + ZDV+NVPmd enfant (NVAZ-2)<br />
16,3<br />
ZDV + NVPmd enfant (NVAZ-1)<br />
15,3<br />
ZDV (ANRS 049)<br />
15,1<br />
Régimes thérapeutiques<br />
ZDV + 3TC (Petra/ Bras C)<br />
ZDV (ANRS 049 + KZT)<br />
NVPmd (mère) + ZDV enfant (NVAZ-2)<br />
Monodose NVP (SAINT)<br />
ZDV (KZT)<br />
Monodose NVP (HIVNET012)<br />
12,3<br />
12,2<br />
11,9<br />
14,2<br />
14,7<br />
14,1<br />
ZDV+ 3TC (SAINT)<br />
ZDV + 3TC (Petra/ Bras B)<br />
8,9<br />
9,3<br />
ZDV + NVPmd (ANRS 1201)<br />
6,5<br />
ZDV + 3TC (Petra/ Bras A)<br />
5,7<br />
ZDV+ 3TC + NVPmd (ANRS 1201)<br />
4,7<br />
0 5 10 15 20 25 30<br />
Taux de transmission (S4-S6) en %<br />
Figure 6. Taux de transmission de l'infection <strong>à</strong> VIH de la mère <strong>à</strong> son enfant <strong>à</strong> S4-S8 avec <strong>le</strong>s différents régimes antirétroviraux utilisés dans <strong>le</strong>s essais<br />
de PTME en Afrique
122<br />
Chapitre 5<br />
Effets secondaires des antirétroviraux utilisés pour<br />
la PTME en Afrique<br />
« Nous avons combattu très dur pour l'argent. Luttons dorénavant aussi fort pour rendre cet argent efficace »<br />
Peter Piot (Directeur général de l'ONUSIDA)<br />
Bangkok, Thaïlande Juil<strong>le</strong>t 2004
123<br />
5.1. Mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine<br />
5.1.1. Généralités<br />
Les ARVs actuel<strong>le</strong>ment disponib<strong>le</strong>s ont comme cib<strong>le</strong>s des protéines clés du VIH, la<br />
transcriptase inverse, la protéase, et la glycoprotéine d’enveloppe gp41. La résistance est liée <strong>à</strong> la<br />
sé<strong>le</strong>ction de mutations dans <strong>le</strong>s gènes viraux codant pour ces trois protéines qui, ainsi modifiées,<br />
deviennent insensib<strong>le</strong>s aux ARVs concernés.<br />
La grande variabilité génétique, due aux erreurs d’appariement des nucléotides effectuées<br />
par la transcriptase inverse lors de la réplication vira<strong>le</strong> et la multiplicité des cyc<strong>le</strong>s de réplication<br />
conduisent chez une personne infectée par <strong>le</strong> VIH, <strong>à</strong> l’existence d’une population vira<strong>le</strong> sous forme de<br />
quasi-espèces, ou variants génétiquement distincts provenant du virus initial contaminant. Au sein de<br />
cette population hétérogène de variants viraux, chaque mutation du virus pourrait être représentée en<br />
plusieurs milliers d’exemplaires <strong>à</strong> tout instant chez une personne infectée. Certaines de ces mutations<br />
vont diminuer la sensibilité du virus aux ARVs ; ce sont <strong>le</strong>s mutations de résistance (130).<br />
Toutes ces mutations sont introduites au hasard dans <strong>le</strong> génome viral, mais el<strong>le</strong>s permettent au virus de<br />
disposer d’un large répertoire qui lui confère une grande capacité d’adaptation face aux pressions de<br />
sé<strong>le</strong>ction de l’environnement, notamment cel<strong>le</strong>s exercées par <strong>le</strong>s ARVs. Ainsi, l’antiviral n’est pas<br />
directement responsab<strong>le</strong> des mutations; il opère une sé<strong>le</strong>ction sur des populations de mutants<br />
préexistants <strong>à</strong> son instauration, sur la base de <strong>le</strong>ur capacité de résistance et de réplication. Pour certains<br />
ARVs comme <strong>le</strong> 3TC ou la NVP, une seu<strong>le</strong> mutation de la transcriptase inverse suffit <strong>à</strong> conférer au<br />
virus un niveau é<strong>le</strong>vé de résistance (131). Au contraire quand <strong>le</strong> virus doit présenter plusieurs<br />
mutations avant de résister aux antiviraux (la ZDV ou <strong>le</strong>s IP par exemp<strong>le</strong>), il est très peu probab<strong>le</strong> que<br />
la combinaison des mutations requises préexiste au traitement sur un même génome viral. La sé<strong>le</strong>ction<br />
des mutations se fera alors par étape, si <strong>le</strong> virus continue <strong>à</strong> se multiplier sous traitement (132).<br />
La résistance aux INN est due <strong>à</strong> la sé<strong>le</strong>ction de mutations ponctuel<strong>le</strong>s situées sur <strong>le</strong>s bords de <strong>le</strong>ur site<br />
de fixation, la poche hydrophobe de la transcriptase inverse. Ces mutations sont situées dans deux<br />
régions distinctes (entre <strong>le</strong>s codons 100 – 108 et 179 – 190) et sont communes <strong>à</strong> toutes <strong>le</strong>s molécu<strong>le</strong>s,<br />
entraînant une résistance croisée de très haut niveau, d’augmentation de plus de 100 fois la CI 50 , entre<br />
toutes <strong>le</strong>s molécu<strong>le</strong>s de première génération de cette classe en particulier la NVP et l’efavirenz (EFV).<br />
La faib<strong>le</strong> barrière génétique conduit <strong>à</strong> une sé<strong>le</strong>ction rapide de ces mutations déj<strong>à</strong> présentes dans la<br />
population vira<strong>le</strong> s’il persiste une réplication vira<strong>le</strong>.
124<br />
La résistance <strong>à</strong> l’EFV est associée de façon prédominante <strong>à</strong> la sé<strong>le</strong>ction de virus muté en K103N seu<strong>le</strong><br />
ou combinée avec d’autres substitutions, L100I, K101E, V108I, Y188L, G190S et P225H (133). La<br />
résistance <strong>à</strong> la NVP est associée <strong>à</strong> la sé<strong>le</strong>ction de mutations aux codons L100I, K103N, V106I, V108I,<br />
Y181C/I, Y188L/C et G190A/S (134).<br />
5.1.2. Tests de Résistance<br />
5.1.2.1. Tests génotypiques<br />
Les tests génotypiques permettent l’analyse des mutations présentes dans <strong>le</strong>s gènes de la transcriptase<br />
inverse (TI), de la protéase ou de la gp41 (135). Après PCR, <strong>le</strong> séquençage des gènes avec migration<br />
é<strong>le</strong>ctrophorétique sur séquenceurs automatiques est la technique de référence. Des logiciels traduisent<br />
<strong>le</strong>s séquences nucléotidiques en acides aminés. La <strong>le</strong>cture s’effectue en analysant chaque position<br />
connue comme associée <strong>à</strong> des mutations de résistance, par rapport <strong>à</strong> une séquence de référence; la<br />
population vira<strong>le</strong> <strong>à</strong> ce codon peut être sauvage, mutée ou mixte.<br />
Deux kits de séquençage qui incluent un logiciel d’analyse des profils de mutations sont actuel<strong>le</strong>ment<br />
disponib<strong>le</strong>s: <strong>le</strong>s kits des firmes Visib<strong>le</strong> Genetics (Trugene ® HIV-1 genotyping kit) et PE Applied<br />
Biosystems (Perkin Elmer ABI ViroSeq Genotyping system) qui ont reçu l’agrément d’utilisation de<br />
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire et de la Food and Drug Administration aux États-Unis. Ces<br />
deux kits donnent des résultats concordants dans 97,8 % des cas analysés. Un grand nombre de<br />
laboratoires utilisent d’autres techniques de séquençage avec différentes méthodes dont cel<strong>le</strong> du<br />
groupe de résistance AC11 de l’ANRS. Les résultats de cette dernière méthode sont bien corrélés <strong>à</strong><br />
ceux des techniques commercialisées. Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s tests d’hybridation sur bande<strong>le</strong>ttes qui<br />
n’analysent que certains codons ont été abandonnés. Enfin, la technologie des puces ADN reste encore<br />
<strong>à</strong> évaluer.<br />
Il faut souligner que <strong>le</strong> séquençage qui est la technique standard génotypique ne permet d’analyser que<br />
la population vira<strong>le</strong> majoritaire représentant au moins 20 <strong>à</strong> 30% de la population vira<strong>le</strong> tota<strong>le</strong> circulant<br />
dans <strong>le</strong> plasma. Les techniques de détection des populations vira<strong>le</strong>s minoritaires sortent actuel<strong>le</strong>ment<br />
du cadre de la pratique clinique et sont réservées aux protoco<strong>le</strong>s de recherche.<br />
Établir des règ<strong>le</strong>s d’interprétation des tests génotypiques ou « algorithmes » est un exercice long,<br />
diffici<strong>le</strong>, nécessitant des mises <strong>à</strong> jour répétées. Un groupe international s’est mis en place pour<br />
construire des algorithmes avec une méthodologie standardisée, <strong>à</strong> partir de plusieurs bases de données<br />
regroupées (http://hivforum.org/projects/standardization.html).<br />
Les algorithmes du groupe « Résistance » de l’ANRS sont revus tous <strong>le</strong>s 6 <strong>à</strong> 12 mois, et sont<br />
disponib<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong>ur site internet : http://www.hivfrenchresistance.org.
125<br />
5.1.2.2. Tests phénotypiques<br />
Les tests phénotypiques mesurent la production vira<strong>le</strong> en culture cellulaire sous concentrations<br />
croissantes de l'antirétroviral. On définit ainsi <strong>le</strong>s concentrations inhibitrices 50% et 90% (CI 50 ou<br />
CI 90 ) capab<strong>le</strong>s d'inhiber respectivement 50 et 90% de la réplication vira<strong>le</strong>. Les virus résistants sont<br />
capab<strong>le</strong>s de se multiplier en présence d'une concentration d'antirétroviral qui inhibe la réplication des<br />
virus sensib<strong>le</strong>s. Trois firmes proposent des tests phénotypiques avec une technique utilisant des virus<br />
recombinants : <strong>le</strong> test Antivirogram ® de Virco, PhenoSense ® de Virologic et Phenoscript ® de<br />
VIRalliance (135). Les résultats des tests phénotypiques sont exprimés par <strong>le</strong> rapport entre la CI 50 ou<br />
CI 90 de la souche du patient et cel<strong>le</strong> d’un isolat sensib<strong>le</strong> de référence. La détermination des va<strong>le</strong>urs<br />
seuils de ce rapport correspondant <strong>à</strong> une réel<strong>le</strong> diminution de sensibilité phénotypique pose des<br />
problèmes diffici<strong>le</strong>s. Les trois techniques commercia<strong>le</strong>s ont été comparées dans une seu<strong>le</strong> étude, qui<br />
analysait <strong>le</strong>s augmentations de CI 50 de virus provenant de 30 patients traités par rapport <strong>à</strong> une souche<br />
contrô<strong>le</strong>. Globa<strong>le</strong>ment, la concordance entre <strong>le</strong>s résultats des trois techniques était é<strong>le</strong>vée pour <strong>le</strong>s INN<br />
et <strong>le</strong>s IP (86 % <strong>à</strong> 91 %), mais moins bonne pour <strong>le</strong>s IN (136). Une tel<strong>le</strong> étude mériterait d’être répétée<br />
en comparant l’interprétation des résultats.<br />
Au total, <strong>le</strong>s tests phénotypiques restent aujourd’hui un outil de recherche qui doit continuer <strong>à</strong> être<br />
évalué et amélioré, en particulier dans la perspective de l’évaluation de nouvel<strong>le</strong>s molécu<strong>le</strong>s et de<br />
l’utilisation de ces tests en association avec <strong>le</strong>s mesures plasmatiques des ARVs. Ils ne sont pas<br />
d’actualité pour <strong>le</strong>s études africaines.<br />
5.1.3. Mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP utilisée en monodose pour la PTME<br />
La NVP utilisée en monodose pour la PTME peut entraîner des mutations de résistance des virus<br />
circulant chez la mère comme des virus circulant chez l’enfant (82, 83, 137).<br />
La résistance <strong>à</strong> la NVP est définie par la présence des mutations K103N, V106A/M, Y181C, Y188C et<br />
la G190A (138). La liste des mutations de résistance évolue encore. Ainsi, une équipe en Afrique du<br />
Sud a récemment décrit une nouvel<strong>le</strong> mutation de résistance associée <strong>à</strong> la NVP chez <strong>le</strong>s femmes<br />
infectées par <strong>le</strong> VIH-1 avec <strong>le</strong> sous-type C : la V106M. Cette mutation a été retrouvée six semaines<br />
après l'accouchement chez 7/141 femmes ayant reçu une monodose de NVP (86).<br />
Trois études dont deux en Afrique ont rapporté la préva<strong>le</strong>nce des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP<br />
utilisée en monodose chez la femme enceinte, ainsi que <strong>le</strong>s facteurs associés <strong>à</strong> ces mutations de<br />
résistance (82, 83, 137, 139). Les mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP ont été éga<strong>le</strong>ment investiguées<br />
chez <strong>le</strong>s enfants dans ces études (tab<strong>le</strong>au 27).
126<br />
Tab<strong>le</strong>au 27. Fréquence des mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine estimée <strong>à</strong> S4 postpartum<br />
chez <strong>le</strong>s mères et <strong>le</strong>s enfants (Revue de la littérature).<br />
Mère (S4-S8) Enfant infecté (S4 – S8)<br />
Cunningham CK (JID 2002)<br />
Essai ACTG 316<br />
14/95<br />
15% [8-23%]<br />
Non disponib<strong>le</strong><br />
Eschelman S (AIDS 2002)<br />
Essai HIVNET 012 en Ouganda<br />
21/111<br />
19% [12-27%]<br />
11/24<br />
46% [26-67%]<br />
Martinson N (CROI 2004)<br />
Etude en Afrique du Sud<br />
-<br />
39% [34-44%]<br />
-<br />
42% [30-55%]<br />
Dans l’essai HIVNET 012, la préva<strong>le</strong>nce des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP <strong>à</strong> S6-S8 postpartum<br />
était estimée <strong>à</strong> 19% chez <strong>le</strong>s femmes (82). Cette étude a été réalisée chez 111 femmes et la mutation de<br />
résistance la plus observée était la K103N. Il en était de même dans l’étude menée en Afrique du Sud<br />
avec 31% de mutations K103N (137). Chez <strong>le</strong>s enfants, la mutation <strong>à</strong> la NVP était retrouvée chez<br />
11/46 enfants testés soit une préva<strong>le</strong>nce de 46%. La mutation Y181C était identifiée dans 10 cas/11<br />
(82).<br />
Toujours dans l’étude HIVNET 012 (82), en analyse univariée, <strong>le</strong>s facteurs suivants étaient associés<br />
aux mutations de résistance, la charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> (OR=3,9, IC95% [1,5-10,2] pour chaque<br />
augmentation d’un log de CV) et <strong>le</strong>s lymphocytes T4 (OR=1,6, IC95% [1,2-2,2] pour chaque<br />
diminution de 100 cellu<strong>le</strong>s de CD4) (82). Une relation statistiquement significative a été retrouvée<br />
aussi dans l’étude menée en Afrique du Sud entre <strong>le</strong>s mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP et <strong>le</strong>s CD4, la<br />
charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> avant l’inclusion (137).<br />
Par contre, dans l’essai ACTG 316 aucun facteur <strong>à</strong> savoir la charge vira<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s lymphocytes CD4, la<br />
prise d’autres ARVs, n’a été retrouvé associé aux mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP (83). Toujours<br />
dans l’essai HIVNET 012, une relation entre la souche vira<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s mutations a été retrouvée. Ainsi <strong>le</strong>s<br />
femmes infectées par une souche vira<strong>le</strong> de sous-type D avaient un risque plus é<strong>le</strong>vé de sé<strong>le</strong>ctionner un<br />
virus résistant <strong>à</strong> la NVP que <strong>le</strong>s femmes infectées par un virus de sous type A (OR=4,9; IC95% [1,2-<br />
20,2] (84).
127<br />
5.1.4. Etude de résistance <strong>à</strong> la Névirapine dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus<br />
5.1.4.1. Justification de l’étude<br />
En Afrique, seu<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s données de l’essai HIVNET 012 étaient disponib<strong>le</strong>s lors de la planification de<br />
l’étude ANRS 1263. Ainsi, <strong>le</strong>s cas de mutations de résistance étaient rapportés avec l’utilisation d’une<br />
monodose de NVP (131, 140) dans une population où prédominent <strong>le</strong>s souches vira<strong>le</strong>s de sous-type A,<br />
de sous-type D ou de sous-type C (84). Aucune étude, en Afrique n’avait décrit <strong>à</strong> ce jour des cas de<br />
mutations en cas d’association de la NVP avec d’autres molécu<strong>le</strong>s comme la ZDV administrée en<br />
peripartum. Selon Beckerman dans un éditorial accompagnant la publication des résultats d’efficacité<br />
<strong>à</strong> long terme de l’essai HIVNET 012 en 2003(73), pour diminuer <strong>le</strong>s mutations liées <strong>à</strong> la NVP, il serait<br />
souhaitab<strong>le</strong> d’utiliser d’autres molécu<strong>le</strong>s en association avec la NVP. Ainsi, <strong>le</strong> schéma thérapeutique<br />
pourrait être constitué de NVP en monodose plus 2 <strong>à</strong> 3 jours de traitement de ZDV ou de 3TC (85). Il<br />
s’agit justement de la combinaison que l’équipe d’investigation du projet Ditrame Plus avait retenu en<br />
2002 sur avis de son conseil scientifique.<br />
Il était aussi uti<strong>le</strong> de pouvoir confirmer ces données de mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP dans une<br />
population où circulait un virus de sous-type CRF02 (141-144) comme en Côte d’Ivoire et avec un<br />
schéma thérapeutique différent.<br />
C’est dans ce con<strong>texte</strong>, fortement évolutif que deux études sur <strong>le</strong>s mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP<br />
avec <strong>le</strong>s régimes thérapeutiques étudiés au sein du projet Ditrame Plus (ZDV+NVP monodose et<br />
ZDV+3TC+NVP monodose) ont été menées. Nous n’aborderons dans cette thèse que <strong>le</strong>s résultats des<br />
données observées dans la cohorte DP1.0. Les résultats obtenus avec la combinaison ZDV+3TC+NVP<br />
monodose ne sont pas encore disponib<strong>le</strong>s au moment de la rédaction de cette thèse.<br />
J’ai été responsab<strong>le</strong> de la méthodologie de ces deux études. J’ai ainsi participé <strong>à</strong> la planification et <strong>à</strong> la<br />
conception du schéma d’étude, réalisé <strong>le</strong> tirage au sort des femmes <strong>à</strong> inclure dans <strong>le</strong>s études et enfin<br />
j’ai effectué <strong>le</strong>s analyses statistiques de ces études.<br />
5.1.4.2. Objectifs de l’étude<br />
Les objectifs de cette étude étaient :<br />
1) d’estimer la préva<strong>le</strong>nce des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP chez <strong>le</strong>s mères traitées par une<br />
combinaison de ZDV+NVP monodose et chez <strong>le</strong>s enfants dépistés infectés par <strong>le</strong> VIH-1 ;<br />
2) de rechercher <strong>le</strong>s facteurs associés aux mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP chez la mère
128<br />
5.1.4.3. Méthode d’étude<br />
Une étude cas-témoins nichée dans la cohorte a été réalisée au sein de la cohorte Ditrame Plus 1.0.<br />
Nous avons défini <strong>le</strong>s cas et <strong>le</strong>s témoins de la façon suivante :<br />
• Les cas sont toutes <strong>le</strong>s mères des enfants diagnostiqués infectés par <strong>le</strong> VIH-1 <strong>à</strong> S4 (mères<br />
transmettrices)<br />
• Les témoins sont <strong>le</strong>s mères dont <strong>le</strong>s enfants sont non infectés par <strong>le</strong> VIH-1 <strong>à</strong> S4 (mères non<br />
transmettrices). La sé<strong>le</strong>ction des mères a été faite par randomisation après avoir défini quatre<br />
strates de charge vira<strong>le</strong>. Les quatre strates correspondent aux quarti<strong>le</strong>s de la distribution de la<br />
charge vira<strong>le</strong> chez <strong>le</strong>s femmes non infectées.<br />
Une mutation de résistance <strong>à</strong> la NVP a été définie comme la présence d’au moins une des mutations<br />
suivantes L100I, K101E, K103N, V106A, Y181C, Y188C/H/L, et G190A/C/E/Q/S/T/V. La liste de<br />
ces mutations est en accord avec <strong>le</strong>s recommandations de l’International Aids Society 2003<br />
(www.iasusa.org) et du groupe de résistance AC11 de l’ANRS (138)<br />
Les tests génotypiques ont été réalisés en suivant <strong>le</strong>s recommandations du groupe de résistance de<br />
l’ANRS sur <strong>le</strong>s techniques <strong>à</strong> utiliser pour la recherche des mutations de résistance (145, 146). Ces<br />
analyses ont été effectuées sur des échantillons plasmatiques recueillis <strong>à</strong> la préinclusion (32ème SA) et<br />
<strong>à</strong> la quatrième semaine après accouchement (S4 postpartum).<br />
La névirapinémie (concentration de NVP) dans <strong>le</strong> plasma a été réalisée par <strong>le</strong> test HPLC (LOQ : 50<br />
ng/ml) sur des échantillons maternels recueillis <strong>à</strong> la visite de J2 postpartum.<br />
5.1.4.4. Analyse statistique<br />
La préva<strong>le</strong>nce des mutations de résistance a été estimée en pourcentage avec son interval<strong>le</strong> de<br />
confiance <strong>à</strong> 95%. Pour la comparaison des moyennes et des médianes, <strong>le</strong>s tests t de Student et U de<br />
Mann-Whitney ont été utilisés. Une analyse univariée a été réalisée avec l’estimation de l’Odds Ratio<br />
(OR) et son interval<strong>le</strong> de confiance <strong>à</strong> 95%. Pour l’analyse multivariée, nous avons utilisé la régression<br />
logistique conditionnel<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s données appariées. La variab<strong>le</strong> conditionnel<strong>le</strong> était l’infection par <strong>le</strong><br />
VIH <strong>à</strong> S4. La variab<strong>le</strong> dépendante était la présence d’une mutation de résistance <strong>à</strong> S4. Les variab<strong>le</strong>s<br />
explicatives ont été sé<strong>le</strong>ctionnées après l’analyse univariée avec un degré de signification p
129<br />
5.1.4.5. Résultats de l’étude<br />
• La population étudiée<br />
Au total 63 femmes ont été incluses dans cette étude, 21 mères dont <strong>le</strong>s enfants sont infectés par <strong>le</strong><br />
VIH-1 <strong>à</strong> S4 et 42 mères dont <strong>le</strong>s enfants sont non infectés par <strong>le</strong> VIH-1 <strong>à</strong> S4 (figure7). Il n’y a pas de<br />
différence significative entre la charge vira<strong>le</strong> des mères ayant des enfants dépistés négatifs inclus dans<br />
cette étude (n=42) par rapport au reste des femmes ayant des enfants non infectés <strong>à</strong> S4 dans la cohorte<br />
(n=199). La médiane de la charge vira<strong>le</strong> était de 4,6 log, EIQ [4,0-4,9] chez ces femmes incluses dans<br />
l’étude résistance et de 4,4, EIQ [4,0-4,7], chez <strong>le</strong>s femmes non incluses ayant accouché d’un enfant<br />
non infecté (p=0,26). Tous <strong>le</strong>s enfants dépistés infectés par <strong>le</strong> VIH-1 ont été inclus dans cette étude.<br />
Au total 26 enfants étaient ainsi inclus dont cinq nés de mères n’ayant pas pris de la NVP pendant <strong>le</strong><br />
travail.<br />
• Fréquence des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP<br />
Les mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP ont été retrouvées chez 21 femmes parmi <strong>le</strong>s 63 incluses soit une<br />
fréquence de 33,3%, IC95% [21,4-45,3%]. Il n’ y a pas de différence significative entre la proportion<br />
de mères transmettrices présentant une résistance <strong>à</strong> la NVP <strong>à</strong> S4 par rapport aux mères non<br />
transmettrices (p=1,00). Cette fréquence était de 33,3% chez <strong>le</strong>s transmettrices (7/21) et éga<strong>le</strong>ment de<br />
33,3% chez <strong>le</strong>s non transmettrices (14/42).<br />
• Types de mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP<br />
La mutation K103 N était la plus fréquente des mutations de NVP identifiée dans notre étude. Le<br />
détail des mutations retrouvées est présenté dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 28.<br />
Tab<strong>le</strong>au 28. Différents types de mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine identifiés pour l’étude<br />
ANRS 1263 « Ditrame Plus Viro » dans <strong>le</strong> projet ANRS 1201/1202, Ditrame Plus.<br />
Non transmettrices<br />
(n=42)<br />
Transmettrices<br />
(n=21)<br />
Total<br />
(n=74)<br />
K103N 13 7 20/21 (95,2%)<br />
179I - 1 1/21 (4,8%)<br />
106A 3 1 4/21 (19,0%)<br />
Y181 1 0 1/21 (4,8%)<br />
Parmi <strong>le</strong>s femmes présentant une mutation de résistance <strong>à</strong> la NVP (n=21), 14 (66,6%) femmes avaient<br />
une seu<strong>le</strong> mutation retrouvée, cinq (23,8%) avaient deux mutations et deux (9,6%) femmes avaient<br />
quatre mutations différentes identifiées.
130<br />
Mères analysab<strong>le</strong>s<br />
Diagnostic pédiatrique réalisé<br />
(n=361)<br />
Mères Transmettrices<br />
Enfants infectés <strong>à</strong> S4<br />
(n=26)<br />
Mères non Transmettrices <strong>à</strong> S4<br />
Enfants non infectés<br />
(n=335)<br />
Echantillon S4<br />
non disponib<strong>le</strong><br />
(n=1) / PDV<br />
CV =3,53 et =4,21 et =4,69 15/72<br />
Pas de Prise NVP<br />
(n=4)<br />
Séquençage non<br />
réalisé<br />
(n=2)<br />
CV>=4,69 log<br />
Pas de prise de<br />
NVP<br />
(n=1)<br />
CV>=4,69 log<br />
Inclusion mères transmettrices<br />
(n=21)<br />
Inclusion mères non transmettrices<br />
(n=42)<br />
Figure 7. Sé<strong>le</strong>ction de la population étudiée pour l'étude des mutations de résistance <strong>à</strong> la<br />
Névirapine en fonction du statut de transmettrice et de non transmettrice et selon <strong>le</strong>s quarti<strong>le</strong>s<br />
de charge vira<strong>le</strong>. Etude DP Viro au sein de la cohorte DP1.0 (ZDV+NVP monodose).
131<br />
• Concentration plasmatique de Névirapine<br />
Figure 8. Médiane de concentration de Névirapine plasmatique chez <strong>le</strong>s femmes selon la<br />
présence ou non d’une mutation de résistance <strong>à</strong> la Névirapine. Etude DP Viro au sein de la<br />
cohorte DP1.0 (ZDV+NVP monodose).<br />
La concentration de NVP <strong>à</strong> J2 est statistiquement différente chez <strong>le</strong>s femmes présentant une mutation<br />
de NVP <strong>à</strong> S4 : 851 ng/ml, EIQ [633-1063] par rapport aux femmes ne présentant pas de mutation de<br />
résistance <strong>à</strong> la NVP : 598 ng/ml, EIQ [315-885] (p=0,01) (figure 8).<br />
• Mutations de résistance dans <strong>le</strong> plasma et dans l’ADN<br />
Parmi <strong>le</strong>s 21 mères ayant développé des virus résistants dans <strong>le</strong> plasma, une analyse des virus intégrés<br />
dans <strong>le</strong>s cellu<strong>le</strong>s mononuclées du sang périphérique (PBMC) a pu être réalisée pour 20 d'entre el<strong>le</strong>s.<br />
Des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP ont été retrouvées chez 15 femmes soit 75% de l’échantillon. Le<br />
type de mutations est présenté dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 29.
132<br />
Tab<strong>le</strong>au 29. Présence des mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine dans <strong>le</strong> plasma maternel et<br />
dans <strong>le</strong>s cellu<strong>le</strong>s <strong>à</strong> S4. Etude DP Viro au sein de la cohorte DP1.0 (ZDV+NVP monodose).<br />
Mutation (Plasma) <strong>à</strong> S4<br />
Mutation (PBMC) <strong>à</strong> S4<br />
1 103N 67D/N ; 103N<br />
2 103N 103N/K<br />
3 103N/K 103N/K<br />
4 103N/K ; 106V/A 103N/K<br />
5 103N/K ; 179V/I 103N/K ; 179I<br />
6 103N/K ; 106V/A 106V/A<br />
7 103N/K; 106V/A 103N/K; 106V/A<br />
8 103N/K, 106A/V ; 188Y/C ; 190G/A Pas de mutation<br />
9 103N/K ; 181Y/C 181Y/C<br />
10 103N/K Pas de mutation<br />
11 103N/K ; 106A/V ; 188Y/C ; 190G/A 106A<br />
12 103N/K Pas de mutation<br />
13 103N/K ; 106A/V 103N/K<br />
14 103N/K 103N/K<br />
15 103N/K Pas de mutation<br />
16 103N/K 103N<br />
17 106V/A 106V/A<br />
18 103N/K Echantillon non disponib<strong>le</strong><br />
19 103N/K Pas de mutation<br />
20 103N/K ; 181YC 181YC<br />
21 103N/K 103N/K<br />
• Facteurs associés aux mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine<br />
En analyse univariée (tab<strong>le</strong>au 30), la charge vira<strong>le</strong> <strong>à</strong> la préinclusion et la concentration de NVP<br />
corrigée <strong>à</strong> J2 étaient associées aux mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP <strong>à</strong> S4. L’odds ratio brut était de 3,1<br />
pour chaque augmentation d’un log de charge vira<strong>le</strong> et de 1,24 pour chaque augmentation de 100<br />
ng/ml de concentration de NVP corrigée <strong>à</strong> J2. On note une tendance <strong>à</strong> la signification statistique entre<br />
<strong>le</strong>s mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP et la quantité de lymphocytes T4 exprimées en deux classes :<br />
81% des patients ayant une mutation de résistance avaient des CD4
133<br />
Seu<strong>le</strong>ment quatre patientes sur <strong>le</strong>s 61 incluses dans l’analyse multivariée avaient pris une seconde dose<br />
de NVP et parmi ces quatre patientes, trois présentaient une mutation de résistance <strong>à</strong> la NVP <strong>à</strong> S4.<br />
Tab<strong>le</strong>au 30. Facteurs associés <strong>à</strong> la présence de mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP dans <strong>le</strong> plasma<br />
maternel <strong>à</strong> S4 : Analyse univariée et multivariée. Etude DP Viro au sein de la cohorte DP1.0<br />
(ZDV+NVP monodose).<br />
Analyse Univariée<br />
Analyse Multivariée<br />
Charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong><br />
Préinclusion<br />
OR* p ORa* OR [IC95%] p<br />
3,1 0,02 3,3 [1,0-12,1] 0,05<br />
Doub<strong>le</strong> dose Névirapine 6,8 0,10 12,6 [0,9-175,1] 0,06<br />
Concentration de Névirapine 1,2 0,01 1,3 [1,1-1,6] 0,006<br />
OR : Odds ratio, ORa : Odds ratio ajusté<br />
• Mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine chez <strong>le</strong>s enfants<br />
Au total 26 enfants infectés <strong>à</strong> S4-S6 de la cohorte 1.0 ont été inclus dans l’étude, 6/26 enfants<br />
présentaient une mutation de résistance <strong>à</strong> S4 soit 23,1% (IC95% [8,9-43,6%]). La mutation la plus<br />
fréquente était la mutation K103N retrouvée chez quatre enfants, soit 66%, suivie de la mutation<br />
106V/A et 190 A/G chez 2 enfants.<br />
• Mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine chez la mère et chez l’enfant<br />
Tab<strong>le</strong>au 31. Relation entre la présence des mutations de résistance <strong>à</strong> la Névirapine chez la mère<br />
et chez l’enfant.<br />
Enfant sans mutation<br />
R(-)<br />
Enfant avec mutation<br />
(R+)<br />
Mère sans mutation R (-) 17 (81,0%) 2*(33,3%)<br />
Mère avec mutation R (+) 4 (19,0%) 4 (66,6%)<br />
On observe (tab<strong>le</strong>au 31) que deux enfants ont une mutation de résistance <strong>à</strong> la NVP identifiée <strong>à</strong> S4<br />
alors qu’aucune mutation n’a été retrouvée chez la mère. Le détail de ces observations avec <strong>le</strong> type de<br />
mutation identifié est présenté dans <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au 32.
134<br />
Tab<strong>le</strong>au 32. Mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP observées chez l’enfant et chez la mère <strong>à</strong> S4.<br />
Etude DP Viro au sein de la cohorte DP1.0 (ZDV+NVP monodose).<br />
Timing infection Mutation chez l’enfant Mutation chez la mère<br />
A In utero 103N/K, 106 V/A 103N/K, 106 V/A<br />
B In utero 103N/K, 190A/G 103N<br />
C In utero 190A/G Pas de mutation<br />
D In utero 103N/K Pas de mutation<br />
E Intrapartum 103N 103N<br />
F Intrapartum 106A 103N/K<br />
5.1.4. Discussion<br />
La première partie de cette étude montre que <strong>le</strong>s mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP sont retrouvées chez<br />
près de 1/3 des femmes ayant reçu une monodose de NVP, ceci dans un con<strong>texte</strong> d'infection par une<br />
majorité de souches de sous-type CRF02. Ces résultats confirment <strong>le</strong>s données rapportées dans l’essai<br />
HIVNET 012 et dans l’étude menée récemment en Afrique du Sud (82, 137).<br />
Nous avons éga<strong>le</strong>ment montré que la mutation la plus fréquente chez <strong>le</strong>s mères est la K103N. Dans<br />
notre population, cette mutation était éga<strong>le</strong>ment la plus fréquente chez <strong>le</strong>s enfants alors que la<br />
mutation Y181C était la plus fréquente dans l’essai HIVNET 012 (82).<br />
L’originalité de notre étude est qu’el<strong>le</strong> a été réalisée dans une population présentant une souche vira<strong>le</strong><br />
différente avec un autre schéma thérapeutique : une combinaison de ZDV et de la NVP en monodose.<br />
De plus, cette étude a été couplée <strong>à</strong> un dosage de la névirapinémie <strong>à</strong> J2. L’effet de la prise d’une<br />
deuxième dose de NVP en cas de faux travail a été aussi documenté dans notre étude.<br />
Une autre particularité de notre étude est d’avoir recherché éga<strong>le</strong>ment dans l’ADN la présence de ces<br />
mutations. Ces mutations sont ainsi éga<strong>le</strong>ment retrouvées dans l’ADN et appairaissent archivées chez<br />
75% des femmes (15/20). La présence de ces mutations dans l’ADN est un argument fort en faveur<br />
d’une moins bonne réponse viro-immunologique <strong>à</strong> court et moyen terme chez des femmes qui seront<br />
traitées ultérieurement par des régimes de HAART contenant de la NVP.<br />
Notre étude confirme éga<strong>le</strong>ment que la charge vira<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> mesurée <strong>à</strong> la préinclusion est associée<br />
au développement de mutation de résistance <strong>à</strong> la NVP <strong>à</strong> S4. Il en est de même pour la concentration de<br />
NVP plasmatique <strong>à</strong> J2. On observe donc que la concentration de NVP est plus é<strong>le</strong>vée chez <strong>le</strong>s mères<br />
qui ont une résistance <strong>à</strong> la NVP <strong>à</strong> S4 et que <strong>le</strong> risque augmente de 23% pour chaque augmentation de
135<br />
100 ng/ml de concentration de NVP. La prise d’une deuxième dose de NVP est <strong>à</strong> la limite de la<br />
signification statistique <strong>à</strong> cause avant tout d’un manque de puissance statistique du au nombre limité<br />
d’observations.<br />
Notre étude a été réalisée sur un petit échantillon. Ceci est dû au nombre de cas limité de femmes<br />
transmettrices avec la combinaison ZDV+NVP monodose avec laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong> taux de transmission mèreenfant<br />
était estimé <strong>à</strong> 6,5% (18). Cependant, il faut souligner que toutes <strong>le</strong>s femmes transmettrices qui<br />
ont reçu de la NVP pendant <strong>le</strong> travail ont été a priori incluses dans cette étude et aucun biais de<br />
sé<strong>le</strong>ction n’a pu être introduit de ce point de vue.<br />
5.1.5. Perspectives et Conclusion<br />
L’étude des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP et au 3TC est en cours dans la cohorte 1.1 dans laquel<strong>le</strong><br />
<strong>le</strong>s femmes ont été traitées par une combinaison de ZDV+3TC <strong>à</strong> partir de la 32 ème semaine et de la<br />
NVP monodose au moment de l'accouchement plus trois jours de ZDV+3TC en postpartum. On<br />
pourra ainsi regrouper <strong>le</strong>s données de résistance <strong>à</strong> la NVP en faisant une analyse poolée. Ce qui pourra<br />
augmenter la puissance de notre analyse. On pourra éga<strong>le</strong>ment étudier s’il y a moins de mutations avec<br />
la monodose de NVP lorsqu’el<strong>le</strong> est précédée d’une monothérapie ou d’une bithérapie.<br />
Nous prévoyons éga<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong> futur, d’estimer <strong>le</strong> taux de TME du VIH chez <strong>le</strong>s femmes ayant une<br />
résistance <strong>à</strong> la NVP après une première prise de NVP pour la PTME au cours d’une grossesse<br />
antérieure, et qui prendraient un régime thérapeutique comprenant de la NVP au cours d’une seconde<br />
grossesse.<br />
Enfin une étude prospective ayant pour objectif d’étudier la réponse immuno-virologique chez <strong>le</strong>s<br />
femmes débutant une HAART après la prise de NVP est en cours de planification. Ces réponses seront<br />
ajustées sur la présence ou non de mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP.<br />
L étude DP Viro dont j’ai été <strong>le</strong> responsab<strong>le</strong> sur <strong>le</strong> plan méthodologique confirme donc bien un risque<br />
très é<strong>le</strong>vé de présenter des mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP après avoir pris un seul comprimé de 200<br />
mg de NVP. Ces mutations sont archivées dans <strong>le</strong>s PBMC, ce qui risque bien d’entraîner une moins<br />
bonne réponse viro-immunologique. Ce constat démontre l’urgence de trouver une alternative <strong>à</strong> la<br />
monodose de NVP, surtout dans <strong>le</strong> con<strong>texte</strong> d’accès au traitement HAART pour la mère et l’enfant.
136<br />
Recul du gouvernement Sud Africain<br />
Après avoir résisté cinq ans aux pressions des malades sud africains pour accepter puis<br />
retarder la mise <strong>à</strong> disposition des trithérapies aux centaines de milliers de malades du SIDA<br />
qui en ont un besoin urgent, <strong>le</strong> gouvernement Sud Africain par la voie de son Ministre de la santé<br />
a décidé au cours de la conférence de Bangkok d'interdire l'utilisation de la névirapine chez <strong>le</strong>s<br />
femmes enceintes infectées par <strong>le</strong> VIH pour réduire <strong>le</strong> risque de la transmission du VIH de la<br />
mère <strong>à</strong> l'enfant <strong>à</strong> cause des problèmes de résistance. Cette décision a sou<strong>le</strong>vé un mouvement de<br />
protestation auquel s'est joint un caricaturiste d’un journal d’Afrique du Sud.<br />
Juil<strong>le</strong>t 2004
5.2. Hyperlactatémies chez des enfants exposés in utéro aux ARVs pour la<br />
prévention de la transmission de l’infection <strong>à</strong> VIH de la mère <strong>à</strong> l’enfant.<br />
Etude ANRS 1209, Ditrame Plus Safe.<br />
137<br />
5.2.1. Introduction<br />
5.2.1.1. Etat des connaissances<br />
La toxicité mitochondria<strong>le</strong> des IN est bien connue et des cas ont été décrits dans la littérature. L’équipe<br />
de Stéphane Blanche en France a rapporté chez <strong>le</strong>s enfants exposés aux ARVs pendant la grossesse,<br />
des anomalies mitochondria<strong>le</strong>s (147). Dans une cohorte thérapeutique non randomisée qui visait <strong>à</strong><br />
évaluer la tolérance et l’efficacité de l’association de la ZDV + 3TC dans la réduction de la TME, huit<br />
cas de mitochondriopathie prouvés ont été rapportés. Dans cinq cas, <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au clinique était<br />
particulièrement sévère avec des atteintes neurologiques conduisant dans deux cas <strong>à</strong> des décès. Dans<br />
trois autres cas, des anomalies biologiques ont été trouvées en l’absence de symptomatologie clinique<br />
(147). Récemment une documentation plus poussée avec la mise en place d’un registre national a<br />
permis de recenser 12 cas certains de dysfonctionnement mitochondrial et 14 autres cas probab<strong>le</strong>s<br />
(148). Ces anomalies mitochondria<strong>le</strong>s sont associées <strong>à</strong> une hyperlactatémie dans 60% des cas (148).<br />
Ainsi, on peut faire l’hypothèse que la toxicité mitochondria<strong>le</strong> peut être identifiée précocement grâce <strong>à</strong><br />
la mesure des lactates. En effet, la lactatémie est considérée dans la littérature comme un bon<br />
marqueur de substitution pour étudier <strong>le</strong> dysfonctionnement mitochondrial (149).<br />
Pour l’instant, quelques rares études ont été réalisées pour étudier la préva<strong>le</strong>nce des hyperlactatémies<br />
chez <strong>le</strong>s enfants exposés in utero aux ARVs, particulièrement chez <strong>le</strong>s enfants exposés aux HAART en<br />
période peripartum (150). Dans une étude réalisée au Canada entre 1999 et 2001, chez <strong>le</strong>s enfants, une<br />
hyperlactatémie >=5mmol/l a été observée chez 26% des 38 enfants non infectés et exposés aux<br />
HAART et/ou une prophylaxie néonata<strong>le</strong> par ZDV pendant six semaines (150). En Italie, la préva<strong>le</strong>nce<br />
des hyperlactatémies (>2.5 mmol/l) était de 62% chez 55 enfants non infectés avec une moyenne de<br />
lactatémie estimée <strong>à</strong> 9,8 mmol/l (Ecart-type : 32 mmol/l) (151).<br />
Une des difficultés de toutes ces études semb<strong>le</strong>nt être l’interprétation de ces hyperlactatémies<br />
asymptomatiques. Pour Alimenti et al, il s’agit bien de la conséquence d’une toxicité mitochondria<strong>le</strong><br />
(150).<br />
En Afrique, plusieurs schémas thérapeutiques avec des IN sont utilisés pour la réduction de la TME<br />
comme nous l’avons vu dans notre travail. Ces ARVs sont désormais utilisés <strong>à</strong> large échel<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s
138<br />
populations africaines, mais aucune étude, dans un con<strong>texte</strong> de surveillance primaire de ces ARVs n’a<br />
pour l’instant été effectuée pour étudier <strong>le</strong>s effets secondaires chez <strong>le</strong>s enfants et plus particulièrement<br />
la recherche d’une éventuel<strong>le</strong> toxicité mitochondria<strong>le</strong> liée <strong>à</strong> l’utilisation des ARVs par la mère.<br />
C’est ainsi que dans <strong>le</strong> cadre du projet Ditrame Plus, nous avons étudié la tolérance des ARVs chez <strong>le</strong>s<br />
enfants exposés en peripartum en établissant une surveillance <strong>à</strong> court et moyen terme des enfants<br />
exposés, tout en sachant que seul un suivi <strong>à</strong> long terme pourrait permettre d’étudier de manière<br />
définitive la tolérance <strong>à</strong> ces ARVs.<br />
5.2.1.2. Rappel sur <strong>le</strong>s données biologiques et <strong>le</strong>s examens complémentaires pour<br />
l’étude du dysfonctionnement mitochondrial<br />
Le lactate est une navette énergétique entre <strong>le</strong>s cellu<strong>le</strong>s. Il sera oxydé par d’autres cellu<strong>le</strong>s si <strong>le</strong>ur<br />
mitochondrie fonctionne. Il peut être transformé en glucose (surtout au niveau du foie) où il<br />
s’accumu<strong>le</strong>ra lorsque toutes <strong>le</strong>s cellu<strong>le</strong>s seront en défaillance énergétique.<br />
La lactatémie n’est que <strong>le</strong> résultat de l’équilibre entre production et consommation du lactate par<br />
l’organisme : c’est <strong>le</strong> moyen <strong>le</strong> plus simp<strong>le</strong> d’estimer la fonction mitochondria<strong>le</strong>.<br />
C’est donc <strong>le</strong> marqueur <strong>le</strong> plus utilisé pour étudier un dysfonctionnement mitochondrial. Les autres<br />
examens pour mettre en évidence un dysfonctionnement mitochondrial sont :<br />
• Les biopsies du tissu anormal avec analyse de l’oxydation phosphorylante de l’ADN<br />
mitochondrial, diffici<strong>le</strong> <strong>à</strong> réaliser et <strong>à</strong> répéter ;<br />
• L’étude du métabolisme du lactate, au repos ou <strong>à</strong> l’effort ;<br />
• Le rapport lactate/pyruvate (va<strong>le</strong>ur norma<strong>le</strong> 10/1). Cependant, <strong>le</strong> dosage du pyruvate<br />
est rarement réalisab<strong>le</strong> en routine.<br />
5.2.1.3. Rappel sur <strong>le</strong>s manifestations cliniques<br />
Les manifestations cliniques communément décrites chez <strong>le</strong>s enfants en faveur d’un<br />
dysfonctionnement mitochondrial sont <strong>le</strong>s suivantes (138, 148)].<br />
• des manifestations neurologiques : hypertonie, retard cognitif, convulsions et des troub<strong>le</strong>s du<br />
comportement<br />
• des anomalies biologiques, <strong>le</strong> plus souvent une hyperlactatémie isolée ou associée <strong>à</strong> d’autres<br />
perturbations biologiques tel<strong>le</strong>s que l’élévation des LDH, CPK, des transaminases et des<br />
lipases.<br />
• un déficit enzymatique des enzymes mitochondria<strong>le</strong>s (comp<strong>le</strong>xe I, III et IV)<br />
• des troub<strong>le</strong>s de la croissance plus particulièrement un retard staturo-pondéra<strong>le</strong>
139<br />
5.2.1.4. Questions de recherche<br />
L’étude DP SAFE réalisée au sein du projet Ditrame Plus voulait répondre <strong>à</strong> deux questions :<br />
- Existe-t-il un risque chez l’enfant africain d’anomalie biologique précoce même<br />
transitoire en faveur d’un dysfonctionnement mitochondrial en cas d’exposition<br />
perpartum <strong>à</strong> la ZDV <br />
- Observe t-on des tab<strong>le</strong>aux cliniques majeurs permettant de confirmer ou d’infirmer un<br />
diagnostic de mitochondriopathie dans une population africaine <br />
5.2.1.5. Objectifs<br />
L’objectif principal de cette étude était de comparer l’incidence des hyperlactatémies chez des enfants<br />
nés de mères infectées par <strong>le</strong> VIH-1 au cours des trois premiers mois de vie et exposés <strong>à</strong> des IN (ZDV<br />
et ZDV+3TC) et <strong>à</strong> des INN (groupe contrô<strong>le</strong>) pour la réduction de la TME du VIH-1.<br />
Les objectifs secondaires étaient d’étudier <strong>le</strong>s facteurs de risque associés <strong>à</strong> la survenue d’une<br />
hyperlactatémie et l’évolution clinique et biologique de ces hyperlactatémies.<br />
5.2.2. Méthodologie<br />
5.2.2.1. Schéma d’étude<br />
Il s’agit d’une étude comparative prospective observationnel<strong>le</strong> d’enfants vivants nés de mères<br />
infectées traitées pendant la grossesse par des ARVs pour la PTME.<br />
5.2.2.2. Cadre de l’étude<br />
Cette étude est réalisée au sein du projet Ditrame Plus ANRS qui propose un paquet d’interventions <strong>à</strong><br />
la femme infectée par <strong>le</strong> VIH-1 et <strong>à</strong> son enfant pour la PTME.
140<br />
5.2.2.3. Antirétroviraux pour la réduction de la TME<br />
Les enfants inclus dans cette étude étaient exposés <strong>à</strong> trois régimes différents (tab<strong>le</strong>au 33).<br />
Tab<strong>le</strong>au 33. Interventions thérapeutiques dans l’étude ANRS 1209 Ditrame Plus Safe, Abidjan.<br />
Traitement Groupe 1<br />
Mère<br />
Prepartum<br />
(ZDV)<br />
- ZDV (36 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2/j<br />
Groupe 2<br />
(ZDV+3TC)<br />
- ZDV + 3TC (32 ème SA)<br />
300 mg ZDV per os x 2/j<br />
150 mg 3TC per os x 2/j<br />
Groupe 3 (Contrô<strong>le</strong>)<br />
(NVP)<br />
Intrapartum<br />
- ZDV : 600 mg per os<br />
- NVP 200mg per os<br />
- ZDV: 600 mg per os<br />
- 3TC : 300 mg per os<br />
- NVP 200mg per os<br />
NVP 200 mg per os<br />
Postpartum<br />
ZDV + 3TC (3 jours)<br />
300 mg ZDV per os x 2<br />
150 mg 3TC per os x 2<br />
Enfant<br />
Néonatal<br />
- ZDV sirop (1 semaine)<br />
2 mg/kg/ x 4/j<br />
- NVP :<br />
2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2<br />
- ZDV sirop (1 semaine)<br />
2 mg/kg/ x 4/j<br />
- NVP :<br />
2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2<br />
NVP :<br />
2 mg/kg en une prise <strong>à</strong> J2<br />
Les traitements adjuvants chez la mère comprenaient une supplémentation en vitamines, en fer, en<br />
folate et une prophylaxie antipalustre.<br />
5.2.2.4. Critère de jugement principal<br />
Le principal critère biologique évoquant un possib<strong>le</strong> dysfonctionnement mitochondrial est<br />
l’hyperlactatémie. Cel<strong>le</strong>-ci est définie dans cette étude par une va<strong>le</strong>ur de lactatémie supérieure ou<br />
éga<strong>le</strong> <strong>à</strong> 2,5 mmol/l sur au moins deux prélèvements consécutifs.<br />
5.2.2.5. Examens biologiques<br />
• Prélèvements et mesure de la lactatémie<br />
Les conditions de prélèvement pour <strong>le</strong> protoco<strong>le</strong> DP Safe respectaient <strong>le</strong>s recommandations du groupe<br />
ACTG mitochondrial dysfunction Focus Group Guidelines.<br />
Les prélèvements sanguins se font dans des tubes gris contenant du Fluoro-oxalate de calcium afin<br />
d’éviter la glycolyse. Pour chaque tube, 1ml de sang est ajouté dans 2 ml d’acide perchloridrique<br />
dilué, préalab<strong>le</strong>ment préparé et placé <strong>à</strong> 4°C. Le tube est ensuite agité par retournement quelques
141<br />
secondes pour formation d’un coagulum de cou<strong>le</strong>ur marron. Les tubes sont ensuite envoyés au<br />
laboratoire de référence (CeDReS) dans une glacière contenant du Freeze-back.<br />
Trois prélèvements sanguins sont réalisés <strong>à</strong> J30, J45 et J90 de vie dans des tubes gris de 2 ml<br />
contenant du fluorure oxalate. En cas d’hyperlactatémie identifiée sur deux prélèvements consécutifs,<br />
un quatrième prélèvement est réalisé <strong>à</strong> M6 ou M12 pour étudier l’évolution des hyperlactatémies<br />
confirmées.<br />
Les mesures des lactates ont été réalisées au CeDReS, au Centre Hospitalier Universitaire de<br />
Treichvil<strong>le</strong>. La mesure de l’acide lactique se fait sur du sang déprotéinéisé compte tenu du délai entre<br />
<strong>le</strong>s prélèvements et <strong>le</strong> dosage. Le lactate est mesuré par un automate Roche COBAS INTEGRA 400.<br />
Un contrô<strong>le</strong> de qualité interne est effectué lors de chaque dosage des lactates au CeDReS. Ce contrô<strong>le</strong><br />
est fourni par la société Roche : Precinorm U (PNU) et Precipath U (PPU) (Roche Diagnostics,<br />
Mannheim, Germany). Un contrô<strong>le</strong> de qualité externe a été effectué avec la collaboration du Dr Anne<br />
Vassaux de l’Hôpital Necker <strong>à</strong> Paris. Ce contrô<strong>le</strong> de qualité a été réalisé en pratique dans <strong>le</strong> laboratoire<br />
de biochimie de l’Hôpital Corentin Celton (Issy <strong>le</strong>s Moulineaux, France) dans <strong>le</strong> cadre du programme<br />
d’assurance qualité des laboratoires d’analyses médica<strong>le</strong>s (ASQUALAB).<br />
• Autres examens biologiques<br />
La mesure des CD4 a été réalisée <strong>à</strong> la préinclusion <strong>à</strong> la 32ème semaine d’aménorrhée pour <strong>le</strong>s mères<br />
issues de la cohorte 1.0 et <strong>à</strong> la 28 ème semaine d’aménorrhée pour <strong>le</strong>s mères incluses dans la cohorte 1.1.<br />
Les prélèvements ont été réalisés sur des tubes vio<strong>le</strong>ts EDTA. La numération lymphocytaire et <strong>le</strong><br />
comptage des CD4 ont été effectués par la Cytométrie en flux (Becton Dickison).<br />
Chez <strong>le</strong>s enfants, <strong>le</strong> diagnostic précoce de l’infection <strong>à</strong> VIH repose sur au moins deux tests<br />
virologiques positifs. Les prélèvements sont effectués <strong>à</strong> S4 de vie et un stockage pour la confirmation<br />
<strong>à</strong> S6 de vie. Le stockage de J2 est utilisé seu<strong>le</strong>ment chez <strong>le</strong>s enfants positifs pour déterminer avec plus<br />
de précision <strong>le</strong> moment de l’acquisition de l’infection <strong>à</strong> VIH. Les prélèvements sont réalisés sur des<br />
microtubes EDTA (Becton Dickinson). La charge vira<strong>le</strong> est mesurée <strong>à</strong> S4 de vie par bDNA pour <strong>le</strong>s<br />
enfants de la cohorte 1.0 (37). Un enfant est considéré comme infecté si la charge vira<strong>le</strong> plasmatique<br />
(VIH RNA) est supérieure <strong>à</strong> 5000 copies/ml. Le seuil de détection est de 250 copies d’ARN VIH/ml<br />
avec 0,2 ml de plasma utilisé. Pour <strong>le</strong>s enfants de la cohorte 1.1, la mesure de la charge vira<strong>le</strong><br />
plasmatique est faite par la PCR Taqman en temps réel. Le seuil de détection est de 300 copies/ml<br />
(152, 153).
142<br />
5.2.2.6. Analyse statistique des données<br />
L’ensemb<strong>le</strong> des données (condition de prélèvements, fiches de paillasse) a été saisi avec <strong>le</strong> Logiciel<br />
Epidata 2.1 et transféré dans une base de données ACCESS. L’analyse statistique a été réalisée sous<br />
STATA TM 8.0. (Stata Corporation, Col<strong>le</strong>ge Station, Texas USA). La préva<strong>le</strong>nce des hyperlactatémies a<br />
été estimée en pourcentage avec son interval<strong>le</strong> de confiance <strong>à</strong> 95%. Pour la recherche des facteurs<br />
associés <strong>à</strong> une hyperlactatemie, nous avons défini la variab<strong>le</strong> dépendante comme <strong>le</strong> diagnostic d’une<br />
hyperlactatémie et <strong>le</strong>s variab<strong>le</strong>s explicatives sont chez l’enfant : <strong>le</strong> sexe, <strong>le</strong> statut HIV, la prise correcte<br />
ou non du traitement postnatal, la gémellité, <strong>le</strong> petit poids de naissance. Les variab<strong>le</strong>s explicatives<br />
retenues chez la mère sont l’âge, <strong>le</strong> délai de la prise du traitement antepartum et la prise du traitement<br />
intrapartum. Un test de Chi2 a été utilisé pour la comparaison des proportions et un test t de Student ou<br />
U de Mann-Withney pour la comparaison des moyennes ou des médianes. Un seuil p
143<br />
3,5<br />
3<br />
3<br />
2,7 2,7<br />
2,5<br />
Va<strong>le</strong>urs lactate (mmol/l)<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
2,1 2,1<br />
1,5<br />
1,5<br />
1,2 1,2<br />
0,5<br />
0<br />
AZT (36 semaine) + NVPmd AZT+3TC (32 semaine) + NVPmd Monodose NVP<br />
Groupe de traitement<br />
Figure 9. Va<strong>le</strong>urs médianes et étendue interquarti<strong>le</strong> des lactates plasmatiques en fonction des trois types de régime antirétroviral. Etude ANRS 1209<br />
Ditrame Plus Safe<br />
.
144<br />
On note que 408 mesures de lactates étaient supérieures ou éga<strong>le</strong>s <strong>à</strong> 2,5 mmol/l soient 52,9% des<br />
mesures effectuées. Les va<strong>le</strong>urs des 770 mesures de lactates actuel<strong>le</strong>ment disponib<strong>le</strong>s se répartissent<br />
par classe comme suit (tab<strong>le</strong>au 34).<br />
Tab<strong>le</strong>au 34. Répartition en classes des va<strong>le</strong>urs de lactates obtenues sur du sang déprotéinéisé,<br />
Etude ANRS 1209 Ditrame Plus Safe, Abidjan.<br />
Groupe ZDV Groupe ZDV+3TC Groupe NVP Total<br />
n (%) n (%) n (%) n (%)<br />
< 2,00 mmol/l 105 (32,5) 84 (26,3) 30 (23,4) 219 (28,4)<br />
2,00 – 2,49 mmol/l 36 (11,1) 54 (16,9) 53 (41,4) 143 (18,6)<br />
2,50 – 2,99 mmol/l 21 (6,5) 50 (15,7) 8 (6,3) 79 (10,3)<br />
3,00 – 4,99 mmol/l 72 (22,3) 81 (25,4) 33 (25,8) 186 (24,2)<br />
>= 5,00 mmol/l 89 (27,6) 50 (15,7) 4 (3,1) 143 (18,5)<br />
Total 323 (100,0) 319 (100,0) 128 (100,0) 770 (100,0)<br />
5.2.3.2. Comparaison des va<strong>le</strong>urs d’acide lactique obtenues sur du sang<br />
déprotéinéisé et du plasma<br />
Les va<strong>le</strong>urs de lactates ont été mesurées sur du sang déprotéinéisé et sur du plasma. Au total 551<br />
prélèvements ont bénéficié de ces deux mesures (tab<strong>le</strong>au 35).<br />
Tab<strong>le</strong>au 35. Comparaison des va<strong>le</strong>urs de lactates obtenues sur du sang déprotéinéisé et sur du<br />
plasma. Etude ANRS 1209, Ditrame Plus Safe.<br />
Sang déprotéinéisé<br />
(n=551)<br />
Plasma<br />
(n=551)<br />
Moyenne ± Ecart type 2,15 ± 1,37 mmol/l 2,83 ± 1,63 mmol/l<br />
Médiane [EIQ] 1,8 [1,2-2,7] mmol/l 2,4 [1,7-3,4] mmol/l<br />
Extrêmes (0,2-9,9) mmol/l (0,5-10,9) mmol/l<br />
>=2.5 mmol/l 64 (26,4%) 104 (42,9%)
145<br />
Tab<strong>le</strong>au 36. Différence absolue et différence relative entre la lactatémie plasmatique et la<br />
lactatémie réalisée sur du sang déprotéinéisé, Etude ANRS 1209 Ditrame Plus Safe.<br />
Différence absolue<br />
(n=551)<br />
Différence relative*<br />
(n=551)<br />
Moyenne ± Ecart type 0,67 ± 0,75 mmol/l 22,5 ± 26,5%<br />
Médiane [EIQ] 0,5 [0,3-0,8] mmol/l 20% [14-28]<br />
* différence relative = (va<strong>le</strong>ur lactate plasmatique -va<strong>le</strong>ur lactate sur du sang déprotéinéisé) /va<strong>le</strong>ur lactate<br />
plasmatique<br />
La différence absolue et la différence relative entre la va<strong>le</strong>ur plasmatique et la va<strong>le</strong>ur obtenue sur du<br />
plasma déprotéinéisé étaient estimées <strong>à</strong> 0,67 ± 0,75 mmol/l et 22,5% respectivement.<br />
5.2.3.3. Préva<strong>le</strong>nce des hyperlactatémies chez <strong>le</strong>s enfants exposés in utero aux<br />
antirétroviraux et prophylaxie néonata<strong>le</strong> par la ZDV<br />
Parmi <strong>le</strong>s 323 enfants qui ont été inclus consécutivement dans cette étude, 266 (82%) avaient eu au<br />
moins deux mesures de lactates et ont été sé<strong>le</strong>ctionnés pour estimer la préva<strong>le</strong>nce des<br />
hyperlactatémies. On notait, 112 enfants de la cohorte 1.0, 110 enfants de la cohorte 1.1 et 44 enfants<br />
issus du groupe contrô<strong>le</strong>.<br />
Parmi <strong>le</strong>s 112 enfants de la cohorte 1.0, 12 avaient deux va<strong>le</strong>urs consécutives de lactatémie obtenue<br />
sur du sang déprotéinéisé supérieures ou éga<strong>le</strong>s <strong>à</strong> 2,5 mmol/l. La préva<strong>le</strong>nce des hyperlactatémies était<br />
estimée <strong>à</strong> 10,7% (IC95% [4,9-16,5%]). Cette préva<strong>le</strong>nce était estimée <strong>à</strong> 17,2% (IC95% [10,1-24,4%])<br />
dans la cohorte 1.1. Dans <strong>le</strong> groupe contrô<strong>le</strong> avec des enfants exposés uniquement <strong>à</strong> la monodose de<br />
NVP, huit enfants ont présenté pour l’instant une hyperlactatémie soit une préva<strong>le</strong>nce de 18,2% ;<br />
(IC95% [8,2-32,7%]). Il n’y a pas de différence significative entre la préva<strong>le</strong>nce des hyperlactatémies<br />
chez <strong>le</strong>s enfants exposés aux trois régimes thérapeutiques (p=0,168).<br />
La figure 10 résume <strong>le</strong>s résultats de la préva<strong>le</strong>nce des hyperlactatémies chez <strong>le</strong>s enfants en fonction<br />
des groupes de traitement.<br />
.
146<br />
100%<br />
n=112 n=110 n=44<br />
80%<br />
60%<br />
52%<br />
55%<br />
40%<br />
41%<br />
20%<br />
11%<br />
17% 18%<br />
0%<br />
ZDV (36 semaine) + NVPmd AZT+ 3TC (32 semaine) + NVPmd Monodose NVP<br />
Au moins 2 mesures >=2,5 mmol Une mesure >=2,5 mmol Va<strong>le</strong>urs norma<strong>le</strong>s<br />
Figure 10. Préva<strong>le</strong>nce des hyperlactatémies chez des enfants exposés aux antirétroviraux pendant la grossesse en fonction des groupes de traitement ;<br />
Etude ANRS 1209 Ditrame Plus Safe.
147<br />
5.2.3.4. Facteurs associés <strong>à</strong> la présence d’une hyperlactatémie chez <strong>le</strong>s enfants<br />
exposés aux antirétroviraux.<br />
Les facteurs de risque des hyperlactatémies ont été étudiés uniquement chez <strong>le</strong>s enfants exposés aux<br />
INRTI, c'est-<strong>à</strong>-dire chez <strong>le</strong>s 222 enfants exposés <strong>à</strong> la ZDV ou <strong>à</strong> la ZDV + 3TC. Les inclusions des<br />
enfants issus du groupe contrô<strong>le</strong> sont en cours et nous n’avons pas pour l’instant intégré ces données<br />
dans l’analyse. L’analyse fina<strong>le</strong> est prévue en décembre 2004. La variab<strong>le</strong> dépendante est <strong>le</strong> diagnostic<br />
d’une hyperlactatémie.<br />
Les variab<strong>le</strong>s explicatives sont <strong>le</strong>s caractéristiques recueillies chez l’enfant et chez la mère avant la<br />
mesure de la lactatémie.<br />
• Facteurs pédiatriques<br />
Tab<strong>le</strong>au 37. Association entre <strong>le</strong>s facteurs mesurés chez l’enfant associé et une hyperlactatémie.<br />
Etude ANRS 1209, Ditrame Plus Safe.<br />
Sexe<br />
Garçons<br />
Fil<strong>le</strong>s<br />
Total<br />
(N=222)<br />
109 (49,1)<br />
113 (50,9)<br />
Hyperlactatémie<br />
(n=31)<br />
16 (51,6)<br />
15 (48,4)<br />
Pas<br />
hyperlactatémie<br />
(n=191)<br />
93 (49,7)<br />
98 (51,3)<br />
p<br />
0,212<br />
Statut VIH <strong>à</strong> S4<br />
Infecté<br />
Non infecté<br />
10 (4,5)<br />
212 (95,5)<br />
0 (0,0)<br />
31 (100,0)<br />
10 (5,2)<br />
181 (94,8)<br />
0,192<br />
Jumeau<br />
Oui<br />
Non<br />
14 (6,3)<br />
208 (93,7)<br />
1 (3,2)<br />
30 (96,8)<br />
13 (6,8)<br />
178 (93,2)<br />
0,447<br />
Poids de naissance (g)<br />
Hypotrophie (28 doses<br />
27 [24 – 29]<br />
61 (27,5)<br />
28 [25 – 28]<br />
54 (28,3)<br />
27 [24 – 29]<br />
7 (22,6)<br />
0,595<br />
0,510<br />
* En théorie : prescription d’une dose de 2mg/Kg de Zidovudine sirop x 4 par jour pendant 7 jours<br />
consécutifs=28 doses<br />
EIQ : Etendue Interquarti<strong>le</strong><br />
Aucun des facteurs ci-dessus décrits (tab<strong>le</strong>au 37) n’était associé <strong>à</strong> une hyperlactatémie définie par<br />
deux mesures consécutives de lactates chez <strong>le</strong>s enfants.
148<br />
• Facteurs maternels<br />
Tab<strong>le</strong>au 38. Association des facteurs maternels avec une hyperlactatémie pédiatrique. Etude<br />
ANRS 1209, Ditrame Plus Safe.<br />
Age <strong>à</strong> l’inclusion<br />
Médiane [EIQ]<br />
Age > 25 ans<br />
Total<br />
(N=222)<br />
26 [24 – 30]<br />
131 (59,0%)<br />
Hyperlactatémie<br />
(n=31)<br />
26 [24 – 29]<br />
17 (54,8)<br />
Pas<br />
d’hyperlactatémie<br />
(n=191)<br />
26 [24 – 30]<br />
114 (59,7)<br />
p<br />
0,840<br />
0,611<br />
Stade OMS<br />
Stade 1<br />
Stade 2<br />
Stade 3 et 4<br />
89 (40,1)<br />
87 (39,2)<br />
46 (20,7)<br />
10 (32,3)<br />
14 (45,2)<br />
7(22,5)<br />
79 (41,4)<br />
73 (38,2)<br />
39 (20,4)<br />
0,759<br />
CD4 <strong>à</strong> l’inclusion<br />
Médiane [EIQ]<br />
CD4 < 500/mm3<br />
415 [257 – 584]<br />
142 (63,9)<br />
451 [357 – 703]<br />
18 (58,1)<br />
410 [251 – 583]<br />
124 (64,9)<br />
0,190<br />
0,461<br />
Durée du traitement<br />
prépartum (jours)<br />
Médiane [EIQ]<br />
TTT>=30 jours<br />
38 [25 – 55]<br />
150 (67,7)<br />
44 [26 – 62]<br />
20 (64,5)<br />
38 [25 – 53]<br />
130 (68,1)<br />
0,248<br />
0,696<br />
Aucun des facteurs ci-dessus décrits (tab<strong>le</strong>au 38) n’était associé <strong>à</strong> une hyperlactatémie définie par<br />
deux mesures consécutives de lactates chez <strong>le</strong>s enfants.<br />
5.2.3.5. Evolution biologique des hyperlactatémies<br />
Parmi <strong>le</strong>s 31 enfants qui ont présenté une hyperlactatémie sur la base de deux mesures é<strong>le</strong>vées, une<br />
autre mesure de lactates a été réalisée <strong>à</strong> 6 mois de vie selon <strong>le</strong> ca<strong>le</strong>ndrier de prélèvement du projet<br />
Ditrame Plus. On note que 28/31 enfants ont pu avoir ces mesures de lactates <strong>à</strong> <strong>distance</strong>. Les va<strong>le</strong>urs<br />
de lactates étaient redevenues norma<strong>le</strong>s (
149<br />
5,5<br />
mmol/l<br />
5<br />
4,5<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
S4 S6 M3 M6-M9<br />
Période des mesures<br />
Figure 11. Evolution biologique des hyperlactatémies observées chez <strong>le</strong>s 31 enfants exposés aux inhibiteurs nucléosidiques (ZDV ou ZDV+3TC).<br />
Etude ANRS1209 Ditrame Plus Safe.
150<br />
5.2.3.6. Manifestations cliniques associées<br />
Les manifestations cliniques classiquement décrites dans <strong>le</strong>s cas d’hyperlactatémie ont été<br />
systématiquement recherchées chez <strong>le</strong>s 310 enfants qui avaient une hyperlactatémie biologique (deux<br />
mesures de lactates supérieures ou éga<strong>le</strong>s <strong>à</strong> 2,5mmol/l). Il s’agit de manifestations abdomina<strong>le</strong>s, de<br />
signes neurologiques, d’atteintes musculaires. L’étude des dossiers cliniques n’a pas retrouvé de<br />
manifestations cliniques associées aux hyperlactatémies dans notre série.<br />
5.2.3.7. Résultats du contrô<strong>le</strong> qualité<br />
Pour <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> interne, il y a eu deux contrô<strong>le</strong>s effectués : Precinorm U (PNU) et Precipath U (PPU),<br />
tous deux proposés par Roche Diagnostics. Les va<strong>le</strong>urs cib<strong>le</strong>s sont 1,5 et 2,8 mmol/l pour <strong>le</strong> PNU et <strong>le</strong><br />
PPU, respectivement. Avec l’appareil de mesure utilisé pour cette étude, nous avons effectué 23<br />
mesures pour <strong>le</strong> PNU et 41 pour <strong>le</strong> PPU. Les moyennes calculées sont de 1,5 et 2,8 mmol/l, soit<br />
exactement <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs cib<strong>le</strong>s définies par <strong>le</strong> fabricant.<br />
Le contrô<strong>le</strong> qualité externe réalisé en collaboration avec l’hôpital Necker a été effectué <strong>à</strong> ASQUALAB<br />
<strong>à</strong> l’hôpital Corentin CELTON d’Issy <strong>le</strong>s moulineaux. Le rapport entre <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs cib<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs<br />
retrouvées était compris entre 90% et 96%. Ces résultats obtenus pour <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de qualité interne et<br />
externe confirment la validité des mesures de lactates réalisées au CeDReS.<br />
5.2.4. Discussion<br />
Les inclusions pour constituer <strong>le</strong> groupe de référence, c'est-<strong>à</strong>-dire <strong>le</strong> groupe d’enfants exposés<br />
uniquement <strong>à</strong> la NVP monodose sont en cours. Nous prévoyons d’inclure au moins 100 enfants dans<br />
ce groupe. Ces inclusions prendront fin en décembre 2004 et la fin du suivi de ces enfants est prévue<br />
en avril 2005.<br />
Cette étude réalisée chez des enfants exposés aux ARVs montre qu’il existe un risque chez l’enfant<br />
africain d’hyperlactatémie précoce en cas d’exposition aux IN utilisés dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus.<br />
La préva<strong>le</strong>nce des hyperlactatémies est donc estimée <strong>à</strong> 15,0% dans la population des enfants inclus<br />
dans notre étude. El<strong>le</strong> est estimée <strong>à</strong> 10,7% chez des enfants exposés <strong>à</strong> partir de la 36 ème SA <strong>à</strong> la ZDV et<br />
<strong>à</strong> 17,2% chez des enfants exposés <strong>à</strong> partir de la 32 ème SA <strong>à</strong> la combinaison ZDV+3TC. El<strong>le</strong> est de 18%<br />
chez <strong>le</strong>s enfants exposés <strong>à</strong> la monodose de NVP sans IN, sans que l’on puisse pour l’instant confirmer<br />
qu’il s’agit de différence statistiquement significative et qui plus est sans signification clinique<br />
évidente.<br />
Cette préva<strong>le</strong>nce observée est faib<strong>le</strong> par rapport aux résultats de deux autres études disponib<strong>le</strong>s sur ce<br />
sujet. En effet, nous observons une préva<strong>le</strong>nce de 64% pour Giaquinto en Italie et 50% pour Noguera
151<br />
en Espagne. (151, 154). L’équipe de Giaquinto dans l’étude réalisée en Italie chez 87 enfants suivis en<br />
médiane pendant 400 jours a noté 45 cas d’hyperlactatémie <strong>à</strong> la première visite. Tous ces enfants sauf<br />
un, avaient été exposés <strong>à</strong> la ZDV pendant la grossesse (150, 151, 154). Des hyperlactatémies ont été<br />
observées chez 34/55 enfants non infectés, tous exposés aux IN pendant la grossesse (151).<br />
Noguera et al, dans une étude prospective réalisée en Espagne chez 78 enfants (40 garçons et 38 fil<strong>le</strong>s)<br />
nés de mère infectée par <strong>le</strong> VIH-1 et suivis de la naissance <strong>à</strong> l’âge de deux ans a observé des cas<br />
d’hyperlactatémie associée <strong>à</strong> une hyperalaninémie chez 50% des enfants. Les va<strong>le</strong>urs moyennes de<br />
lactates étaient de 4,22 mmol/l, avec des va<strong>le</strong>urs extrêmes comprises entre 2,47 et 10,1 mmol/l (154).<br />
Ces différences observées entre études sont principa<strong>le</strong>ment dues <strong>à</strong> des définitions différentes de<br />
l’hyperlactatémie. El<strong>le</strong> est, en effet définie selon <strong>le</strong>s cas par une mesure > 2 mmol/l ou 2,5 mmol ou<br />
5mmol/l) (150, 151, 154).<br />
Les deux autres études observées ont défini <strong>le</strong>s hyperlactatémies avec au minimum une mesure de<br />
lactatémie sanguine supérieure <strong>à</strong> 2,5 mmol/l. Nous avons choisi pour notre part de considérer deux<br />
mesures de lactates supérieures <strong>à</strong> 2,5 mmol/l pour éliminer <strong>le</strong>s cas d’hyperlactatémie artéfactuel<strong>le</strong><br />
secondaire aux conditions de prélèvement. Ce choix sous-estime très probab<strong>le</strong>ment la préva<strong>le</strong>nce des<br />
hyperlactatémies, mais a l’avantage de mettre en évidence des vrais cas d’hyperlactatémie biologique.<br />
Ainsi, devant des variations des lactates, la mise en évidence de deux résultats supérieurs <strong>à</strong> 2,5 mmol/l<br />
constitue un argument fort pour <strong>le</strong> diagnostic. Une autre étude réalisée au Canada et incluant 38<br />
enfants nés de mères VIH infectés et exposés aux HAART in utero ainsi qu’<strong>à</strong> une prophylaxie<br />
néonata<strong>le</strong> par la ZDV pendant six semaines a noté une hyperlactatémie chez 35 enfants (92%) ; dans<br />
ce groupe, 26% des enfants ont présenté une hyperlactatémie sévère >=5 mmol/l (150).<br />
Dans notre étude, nous n’avons trouvé aucun facteur maternel ou infanti<strong>le</strong> associé aux<br />
hyperlactatémies. Il en est de même pour une étude réalisée <strong>à</strong> Vancouver au Canada chez 38 enfants<br />
où aucun facteur n’était associé <strong>à</strong> une hyperlactatémie >=5mmol/l (150). Par contre, l’étude de<br />
Giaquinto rapportait que <strong>le</strong>s enfants d’origine africaine avaient un risque plus é<strong>le</strong>vé de présenter des<br />
hyperlactatémies par rapport aux enfants caucasiens (p=0,032) (151).<br />
Nous avons adopté une définition stricte des hyperlactatémies pour notre étude en ne retenant que <strong>le</strong>s<br />
cas pour <strong>le</strong>squels deux mesures consécutives étaient >= 2,5 mmol/l. On sait que <strong>le</strong>s définitions mais<br />
aussi <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs des lactates sont très variab<strong>le</strong>s. Cette variabilité liée aux conditions de prélèvement<br />
que nous souhaitons prendre en compte aussi complètement que possib<strong>le</strong> nous a amené <strong>à</strong> définir<br />
l’hyperlactatémie sur deux prélèvements positifs réalisés <strong>à</strong> deux moments différents. De plus, nous<br />
avons réalisé des contrô<strong>le</strong>s de qualité avec un laboratoire de référence en France pour valider <strong>le</strong>s
152<br />
résultats de lactatémie rendus et nous avons eu des résultats très concordants avec ceux du laboratoire<br />
de référence.<br />
Dans <strong>le</strong> protoco<strong>le</strong> initial, il était prévu l’étude du cyc<strong>le</strong> des pyruvates chez <strong>le</strong>s enfants présentant une<br />
hyperlactatémie biologique. Ceci n’a pas pu être réalisé pour des raisons de faisabilité et de logistique.<br />
De plus, <strong>le</strong> fait qu’aucun cas symptomatique n’ait été détecté, n’était par ail<strong>le</strong>urs pas très incitatif pour<br />
engager ce type de procédure très comp<strong>le</strong>xe.<br />
Dans notre étude, nous n’avons donc pas utilisé d’autres moyens d’exploration pour identifier un<br />
dysfonctionnement mitochondrial. Il faut souligner que l’étude de Barret et al a montré qu’avec des<br />
investigations comportant une imagerie par résonance magnétique et <strong>le</strong> dosage des enzymes, on a<br />
estimé l’incidence des hyperlactatémies <strong>à</strong> 18 mois <strong>à</strong> 0,26% seu<strong>le</strong>ment (IC95% ; [0,10-0,54]) (148).<br />
5.2.5. Conclusions préliminaires<br />
L’hyperlactatémie a éga<strong>le</strong>ment été retrouvée chez des enfants exposés <strong>à</strong> la monodose de NVP avec<br />
une préva<strong>le</strong>nce de 18% parmi <strong>le</strong>s 44 premiers enfants inclus dans ce groupe contrô<strong>le</strong>. Les premières<br />
observations nous amènent donc <strong>à</strong> penser que <strong>le</strong>s hyperlactatémies sont artéfactuel<strong>le</strong>s plutôt qu’en<br />
faveur d’un dysfonctionnement mitochondrial. Nous estimons donc que la mesure des lactates n’est<br />
pas un bon moyen d’identification de la toxicité mitochondria<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> milieu africain.<br />
Nous avons rencontré des difficultés logistiques considérab<strong>le</strong>s dans la réalisation de cette étude :<br />
difficultés du prélèvement surtout chez <strong>le</strong> nouveau-né; favorisant une stase veineuse pouvant perturber<br />
la mesure des lactates. Les prélèvements étaient effectués <strong>le</strong> matin entre 8h00 et 10h00 et transportés<br />
au CeDReS <strong>à</strong> partir de 13h, voire 14h00 depuis <strong>le</strong>s sites du projet qui sont situés <strong>à</strong> <strong>distance</strong> du<br />
CeDReS. Les prélèvements devraient enfin être analysés l'après-midi au CeDReS vers 15h00 ou<br />
16h00.<br />
D’autres moyens d’exploration pourraient être utilisés comme la quantification de l’ADN<br />
mitochondrial pour affirmer ou non un dysfonctionnement mitochondrial avec des régimes courts de<br />
ZDV (155). Mais la quantification de l’ADN mitochondrial ne peut être recommandée que chez des<br />
enfants présentant des signes cliniques en faveur d’une toxicité mitochondria<strong>le</strong>. Ce qui n’a pu être<br />
objectivé que dans des observations fragmentaires (N. E<strong>le</strong>nga, communication personnel<strong>le</strong>) De plus,<br />
cet examen ne pourra pas être réalisé pour l’instant sur <strong>le</strong>s sites en Afrique.
153<br />
Compte tenu de la faib<strong>le</strong> incidence attendue des anomalies mitochondria<strong>le</strong>s chez <strong>le</strong>s enfants, il ne peut<br />
être proposé systématiquement d’effectuer un tel dépistage dans une population généra<strong>le</strong> d’enfants<br />
exposés aux ARVs pendant la grossesse.<br />
Il demeure donc plus important pour l’instant de rechercher un éventuel dysfonctionnement<br />
mitochondrial avec la mise en place au plus vite de registres d’enfants exposés au IN et présentant des<br />
signes neurologiques évocateurs (148), puis de compléter <strong>le</strong>s investigations par la réalisation d’autres<br />
examens complémentaires plus poussés. Le suivi <strong>à</strong> long terme de ces enfants présentant une<br />
hyperlactatémie transitoire s’avère par ail<strong>le</strong>urs indispensab<strong>le</strong> pour commencer <strong>à</strong> étudier l’effet <strong>à</strong> long<br />
terme de ces anomalies biologiques précoces transitoires observées chez <strong>le</strong>s enfants exposés aux<br />
ARVs en peripartum.
154<br />
Chapitre 6<br />
Discussion généra<strong>le</strong> et Conclusion<br />
" Un mauvais gouvernement, de mauvais <strong>le</strong>aderships tuent encore plus que <strong>le</strong> VIH "<br />
Raoul Fransen, membre de l'IAS (International AIDS Society).<br />
15 Juil<strong>le</strong>t 2004, Bangkok, Thaïlande
155<br />
6.1. Spécificités africaines de la PTME<br />
L’Afrique subsaharienne ne compte que 10% de la population mondia<strong>le</strong>, mais compte 75% des<br />
PVVIH soit environ 28 millions de personnes infectées (1). La préva<strong>le</strong>nce de l’infection <strong>à</strong> VIH dans<br />
cette région d’Afrique est comprise entre 7,5% et 8,5% mais est très variab<strong>le</strong> selon <strong>le</strong>s pays (1). La<br />
préva<strong>le</strong>nce moyenne chez <strong>le</strong>s femmes enceintes est estimée <strong>à</strong> 26% en Afrique du Sud, <strong>à</strong> 8% en Côte<br />
d’Ivoire et <strong>à</strong> 2% au Benin (98). Les femmes sont désormais clairement <strong>le</strong>s plus touchées en Afrique<br />
subsaharienne avec 58% des personnes infectées par <strong>le</strong> VIH (1).<br />
La TME représente la deuxième cause d’acquisition de l’infection <strong>à</strong> VIH après la transmission<br />
hétérosexuel<strong>le</strong> avec 16000 nouveaux cas d’enfants infectés par la TME chaque année en Afrique<br />
subsaharienne (3).<br />
Bien que plusieurs études aient désormais montré l’efficacité des ARVs dans la PTME, la mise en<br />
place des activités de PTME reste très limitée en Afrique. La majorité des actions actuel<strong>le</strong>s sont<br />
limitées en capita<strong>le</strong> et surtout en milieu public urbain sauf dans quelques pays comme <strong>le</strong> Botswana,<br />
l’Ouganda et <strong>le</strong> Zimbabwe. En plus, seu<strong>le</strong>ment un quart voire la moitié des femmes dépistées infectées<br />
par <strong>le</strong> VIH-1 au sein des projets opérationnels ou des programmes de recherche bénéficient d’une<br />
intervention PTME, malgré la gratuité des interventions proposées.<br />
Face <strong>à</strong> cette situation, de nouvel<strong>le</strong>s approches doivent être initiées pour mettre en œuvre ces<br />
interventions sur <strong>le</strong> plan national, afin d’obtenir une réduction importante du nombre d’enfants<br />
infectés.<br />
L’un des grands défis actuels est par ail<strong>le</strong>urs de réduire la stigmatisation comme cela a été<br />
fréquemment suggéré par Peter Piot, <strong>le</strong> Directeur de l’ONUSIDA (156). Il faudrait éga<strong>le</strong>ment prévenir<br />
l’infection chez la femme, prévenir la grossesse non désirée chez la femme infectée par <strong>le</strong> VIH,<br />
renforcer la PTME et enfin assurer la prise en charge des femmes infectées par VIH.<br />
Le deuxième défi est l’implication des partenaires dans la PTME. L’implication des partenaires est<br />
pour l’instant très faib<strong>le</strong> et <strong>le</strong>ur influence sur la femme africaine constitue un obstac<strong>le</strong> majeur qu’il faut<br />
essayer de <strong>le</strong>ver. Très peu de partenaires sont informés du statut de <strong>le</strong>ur femme <strong>à</strong> cause de la réaction<br />
négative attendue de ces derniers. Des cas de vio<strong>le</strong>nces verba<strong>le</strong>s et physiques ont été rapportés en<br />
Afrique ainsi que des cas de séparation et de rupture suite au partage du statut sérologique (122, 157).<br />
Le troisième défi est d’oser initier d’autres approches novatrices et plus agressives pour augmenter<br />
l’acceptabilité des interventions PTME. Ces approches seront développées dans cette partie de la
156<br />
thèse. Une plus grande mobilisation communautaire impliquant des <strong>le</strong>aders de quartiers, <strong>le</strong>s chefs<br />
religieux, pourra aussi permettre une meil<strong>le</strong>ure sensibilisation des populations.<br />
Eu égard aux facteurs exposés ci dessus, <strong>le</strong>s problèmes posés par <strong>le</strong> VIH, et en particulier par la TME<br />
varient considérab<strong>le</strong>ment d’une région <strong>à</strong> l’autre, mais aussi sans doute selon <strong>le</strong> type de virus et <strong>le</strong><br />
niveau de progression de la maladie et des facteurs individuels. Les solutions doivent donc être<br />
loca<strong>le</strong>s, harmonisées et adaptées aux réalités du pays <strong>à</strong> travers des politiques nationa<strong>le</strong>s bien définies.<br />
Se pose alors <strong>le</strong> problème de coordination des activités de PTME entre programme dans un même<br />
pays, entre <strong>le</strong>s autres pays en Afrique subsaharienne et bien entendu entre <strong>le</strong>s bail<strong>le</strong>urs de fonds.<br />
Il faut signa<strong>le</strong>r enfin <strong>le</strong> manque de plus en plus crucial d’infrastructures de santé, de personnel<br />
soignant qualifié, qui freine la progression pour la mise en place des activités PMTE aussi bien en<br />
milieu urbain que rural <strong>à</strong> une échel<strong>le</strong> susceptib<strong>le</strong> de faire la différence. Nous examinons ci-dessous<br />
quelques pistes et solutions éventuel<strong>le</strong>s.<br />
6.2. Acceptabilité du dépistage et des interventions peripartum<br />
6.2.1. Approche « opt in » et « opt out »<br />
La prévention de l’infection <strong>à</strong> VIH en Afrique doit reposer sur une approche de la connaissance du<br />
statut sérologique vis-<strong>à</strong>-vis de l’infection <strong>à</strong> VIH de chaque individu. Ceci passe par la réalisation d’un<br />
test de VIH avec l’annonce du résultat (158). Il faudrait de ce fait simplifier et faciliter la réalisation du<br />
test de l’infection <strong>à</strong> VIH autant que possib<strong>le</strong> en Afrique. L’acceptabilité de la proposition du test VIH<br />
chez la femme enceinte est très bonne et estimée <strong>à</strong> 90%. Mais nous savons que l’acceptabilité globa<strong>le</strong><br />
du dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH chez la femme enceinte est encore très médiocre. On estime entre<br />
50% et 60%, la proportion de femmes qui ont pour l’instant connaissance de <strong>le</strong>ur statut sérologique (3,<br />
115, 159, 160). Si <strong>le</strong> test est réalisé, trop peu de femmes enceintes reviennent chercher <strong>le</strong>urs résultats<br />
même s’il est donné <strong>le</strong> même jour que la réalisation du test.<br />
Dans ce con<strong>texte</strong>, d’autres approches doivent donc être étudiées pour la proposition du test de<br />
l’infection <strong>à</strong> VIH. Il s’agit par exemp<strong>le</strong> de l’approche « opt-out » proposée par certains auteurs (161-<br />
163). On sait aujourd’hui que dans la majorité des pays en Afrique, <strong>le</strong> test du VIH n’est pas obligatoire<br />
mais fortement recommandé, alors que d’autres tests comme la sérologie de la syphilis, de la rubéo<strong>le</strong>,<br />
de la toxoplasmose et des examens biologiques comme <strong>le</strong> taux d’hémoglobine et <strong>le</strong> groupage sanguins<br />
sont des examens obligatoires. Partant de ce principe, l’idée est de proposer aux femmes enceintes<br />
« un paquet » de tests incluant <strong>le</strong> test VIH.
157<br />
Au Canada, cette approche a permis une augmentation du nombre de femmes ayant connaissance de<br />
<strong>le</strong>ur statut sérologique (161-163). On a noté une augmentation moyenne annuel<strong>le</strong> de 9,2%<br />
comparativement <strong>à</strong> la période où des propositions classiques étaient faites. En Afrique, aucune étude<br />
n’a encore été réalisée montrant <strong>le</strong>s avantages de cette approche ainsi que son impact sur la PTME.<br />
Cependant, dans une récente <strong>le</strong>ttre publiée dans <strong>le</strong> Lancet en réponse <strong>à</strong> un artic<strong>le</strong> de de Cock et al,<br />
l’auteur a souligné que cette nouvel<strong>le</strong> approche nécessitait une discussion devant regrouper des<br />
représentants des droits de l’homme et PVVIH avant d’être proposée <strong>à</strong> une large échel<strong>le</strong> (164). Ceci<br />
pourrait constituer une première étape avant de rendre obligatoire la réalisation du test VIH en Afrique<br />
subsaharienne chez <strong>le</strong>s femmes enceintes sous certaines conditions comme dans plusieurs pays<br />
développés. Bien évidemment, la prise en charge des autres examens de santé est nécessaire pour<br />
pouvoir évaluer l’impact de cette approche globa<strong>le</strong> en Afrique (figure 12).<br />
Syphilis<br />
Rubéo<strong>le</strong><br />
Toxoplasmose<br />
Groupage-rhesus<br />
NFS<br />
±<br />
VIH<br />
Syphilis<br />
Rubéo<strong>le</strong><br />
Toxoplasmose<br />
Groupage-rhesus<br />
NFS<br />
VIH<br />
Approche “opt-in”<br />
Approche “opt-out”<br />
Figure 12. Approche « opt in » et approche « opt out » pour <strong>le</strong> dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH.<br />
Cadre conceptionel.
158<br />
6.2.2. Traitement de masse universel<br />
Le traitement de masse universel est l’une des options discutées dès la fin 2001 par l’OMS. Cela<br />
consiste <strong>à</strong> donner dans <strong>le</strong>s pays où la préva<strong>le</strong>nce du VIH est é<strong>le</strong>vée de la NVP <strong>à</strong> toutes <strong>le</strong>s femmes<br />
enceintes en intrapartum sans connaître <strong>le</strong>ur statut sérologique (119). Il faudrait cependant étudier son<br />
avantage par rapport au traitement ciblé comme <strong>le</strong> recommande l’OMS (119). L’avantage serait de<br />
donner <strong>à</strong> toutes <strong>le</strong>s femmes enceintes infectées par <strong>le</strong> VIH-1 une prophylaxie pour prévenir la TME<br />
dans <strong>le</strong>s limites de l’efficacité de ce régime. L’intérêt de cette intervention de masse reste très discuté,<br />
puisqu’el<strong>le</strong> ne permet pas <strong>à</strong> la femme de bénéficier d’un conseil prétest afin de connaître son statut vis<strong>à</strong>-vis<br />
de l’infection <strong>à</strong> VIH. De plus <strong>le</strong> traitement de masse pose plusieurs problèmes a) de résistance<br />
observée avec la NVP (82, 165, 166), b) des échecs viro-immunologiques possib<strong>le</strong>s <strong>à</strong> long terme avec<br />
des traitements contenant des INN, c) du risque de stigmatisation en considérant toutes <strong>le</strong>s femmes<br />
enceintes comme des personnes infectées par <strong>le</strong> VIH ; d) d’absence d’intervention nutritionnel<strong>le</strong><br />
favorisant ainsi <strong>le</strong> risque de TME par l’allaitement.<br />
Une étude sur <strong>le</strong>s connaissances et attitudes des femmes enceintes en Zambie a montré que 60% des<br />
femmes enceintes accepteraient de recevoir la NVP s’il n’y avait pas la possibilité de réaliser un test<br />
de dépistage (167). Ce résultat doit être interprété avec prudence puisqu’ une autre question posée aux<br />
mêmes femmes notait que 74% des femmes accepteraient de prendre de la NVP après la connaissance<br />
de <strong>le</strong>ur statut sérologique si <strong>le</strong> diagnostic de l’infection <strong>à</strong> VIH pouvait être réalisé (167).<br />
Toujours dans cette optique, un essai randomisé a comparé la stratégie ciblée (prophylaxie par la NVP<br />
aux femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH) au traitement de masse. Au total, 1594 femmes enceintes<br />
ont été incluses dans cette étude; 694 avaient reçu la proposition d’un traitement universel, 496 (71%)<br />
l’ont accepté contre 529 (64%) parmi <strong>le</strong>s 830 femmes qui ont reçu la proposition d’un traitement ciblé.<br />
Ainsi, cette étude a montré une bonne acceptabilité du traitement universel par rapport au traitement<br />
de masse avec un OR estimé <strong>à</strong> 1,5, (IC95% [1,1-2,1] ; p
159<br />
6.2.3. Dépistage tardif en sal<strong>le</strong> de travail ou d’accouchement et la prophylaxie<br />
néonata<strong>le</strong><br />
Le dépistage tardif avec une prophylaxie urgente pour la PTME avec la NVP en monodose est une des<br />
options proposées pour diminuer substantiel<strong>le</strong>ment la TME. Cette approche consiste donc <strong>à</strong> proposer<br />
un test de dépistage de l’infection <strong>à</strong> VIH chez des femmes enceintes avec des tests rapides en sal<strong>le</strong><br />
d’accouchement ou pendant <strong>le</strong> travail, <strong>à</strong> donner une prophylaxie pour la PTME, notamment la NVP en<br />
monodose <strong>à</strong> la mère et <strong>à</strong> l’enfant. Chez <strong>le</strong>s enfants, on pourra proposer soit de la ZDV ou de la NVP<br />
ou une combinaison de ZDV+NVP, même si la mère n’a reçu que la NVP en monodose comme dans<br />
l’essai NVAZ-2 au Malawi (71). Cette stratégie est ainsi proposée chez <strong>le</strong>s femmes enceintes n’ayant<br />
jamais eu un conseil prétest avant l’accouchement. Cependant, cette stratégie pose un problème pour<br />
<strong>le</strong> rendu des résultats du test pour une femme en période de travail avancé. Il faudrait donc pouvoir<br />
évaluer l’effet de l’annonce du test chez <strong>le</strong>s femmes en travail et éga<strong>le</strong>ment évaluer <strong>le</strong> risque de<br />
stigmatisation de ces femmes en sal<strong>le</strong> d’accouchement. Très récemment, une étude réalisée dans 16<br />
centres aux Etats-Unis chez <strong>le</strong>s femmes venant en maternité pendant <strong>le</strong> travail sans connaître <strong>le</strong>ur<br />
statut VIH a été rapportée. On note que 4849 (84%) des femmes ont accepté la proposition du test<br />
pendant <strong>le</strong> travail. Les va<strong>le</strong>urs intrinsèques des tests rapides étaient de 100% pour la sensibilité et<br />
99,9% pour la spécificité dans ce con<strong>texte</strong>. Le délai médian entre la réalisation du test et <strong>le</strong> rendu des<br />
résultats était de 66 minutes vs 28 heures pour <strong>le</strong> test ELISA (p
160<br />
pourront être évaluées ultérieurement en étudiant notamment la tolérance de ces médicaments chez <strong>le</strong>s<br />
nouveaux-nés.<br />
Pour la réalisation d’une tel<strong>le</strong> approche dans <strong>le</strong>s structures de santé, une formation spécifique est<br />
nécessaire pour <strong>le</strong> personnel soignant afin qu’il adopte une attitude plus adéquate. En Côte d’Ivoire, <strong>le</strong><br />
personnel de santé est malheureusement pour l’instant très peu impliqué dans la prise en charge<br />
globa<strong>le</strong> des PVVIH et des attitudes négatives vis-<strong>à</strong>-vis des patients infectés ont été rapportées dans ce<br />
pays (170).<br />
En tenant compte des données aujourd’hui rapportées dans la littérature et désormais validées par<br />
l’OMS, <strong>le</strong> traitement PTME peut se réaliser <strong>à</strong> toutes <strong>le</strong>s étapes de la grossesse et même pendant et<br />
après l’accouchement. La mise en place de ces nouvel<strong>le</strong>s stratégies devra donc être proposée <strong>à</strong> court<br />
ou moyen terme dans la plupart des centres de santé en Afrique.<br />
6.3. Peut-on éliminer la transmission peri-partum avec des régimes<br />
courts<br />
6.3.1. Monodose de Névirapine et résistance<br />
La NVP est aujourd’hui la molécu<strong>le</strong> de choix pour la prévention de la TME de la mère <strong>à</strong> l’enfant, eu<br />
égard <strong>à</strong> son efficacité (9, 10), <strong>à</strong> sa facilité d’utilisation et <strong>à</strong> sa disponibilité grâce au don de la firme<br />
pharmaceutique Boehringer. Cependant, avec <strong>le</strong>s données de résistance présentées dans cette thèse,<br />
son utilisation semb<strong>le</strong> avoir aujourd’hui des limites. En effet, la monodose de NVP induit des<br />
mutations de résistance <strong>à</strong> la NVP <strong>à</strong> la fois chez la femme infectée par <strong>le</strong> VIH et chez <strong>le</strong>s enfants<br />
infectés (82, 83, 137, 139). Et ceci est désormais confirmé que ce soit en monodose isolée ou <strong>à</strong> la suite<br />
d’une monothérapie de ZDV. La préva<strong>le</strong>nce de ces mutations chez la mère varie entre 19% et 39%<br />
selon <strong>le</strong>s études (82, 83, 137, 139) et chez l’enfant infecté entre 17% et 46% (82, 83, 137, 139). La<br />
concentration de NVP jouerait peut être un rô<strong>le</strong> dans la survenue de ces mutations comme nous<br />
l’avons montré dans <strong>le</strong> projet Ditrame Plus (139). De plus, ces mutations sont archivées dans l’ADN<br />
(139). Ceci montre que ces mutations sont persistantes et peuvent probab<strong>le</strong>ment compromettre <strong>le</strong>s<br />
traitements ultérieurs contenant de la NVP ou un autre INN comme l’efavirenz. Ces mutations de<br />
résistance retrouvées chez la mère et l’enfant soulèvent plusieurs questions de recherche qui font ou<br />
pourraient faire l’objet de nouvel<strong>le</strong>s études. On peut citer ainsi au moins trois questions de recherche :<br />
• Quel<strong>le</strong> combinaison thérapeutique doit-on utiliser pour la PTME pour réduire la fréquence de<br />
la résistance <strong>à</strong> la NVP chez la femme et l’enfant infecté <br />
• Quel est l’impact de ces résistances sur <strong>le</strong>s grossesses ultérieures
161<br />
• Quel<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s conséquences cliniques <strong>à</strong> court et <strong>à</strong> moyen terme sur <strong>le</strong> traitement<br />
antirétroviral pour la santé maternel<strong>le</strong> et cel<strong>le</strong> de l’enfant infecté<br />
Plusieurs études cliniques sont en cours dont une étude cas-témoins en Afrique du Sud pour étudier<br />
l’effet de la NVP sur <strong>le</strong>s grossesses ultérieures après une première prise de NVP. Cette étude devra<br />
inclure 100 cas et 100 témoins. Les inclusions ont débuté en juin 2003.<br />
Malgré <strong>le</strong>s avancées thérapeutiques réalisées depuis 1994 pour réduire la TME, il n’y a pas de<br />
consensus sur l’utilisation d’une monothérapie ou de combinaisons thérapeutiques. Les<br />
recommandations de l’OMS n’ont pas tranché clairement ces positions avec pour conséquences des<br />
protoco<strong>le</strong>s thérapeutiques très variés selon <strong>le</strong>s sites, <strong>le</strong>s pays et <strong>le</strong>s programmes (75).<br />
Mais la NVP reste <strong>à</strong> ce jour la molécu<strong>le</strong> de choix, la plus simp<strong>le</strong> <strong>à</strong> utiliser. Nous avons souligné<br />
précédemment <strong>le</strong>s limites de cette monodose qui entraîne des mutations de résistance. Les<br />
combinaisons thérapeutiques incluant la monodose de NVP en intrapartum constituent l’une des<br />
meil<strong>le</strong>ures options en Afrique pour diminuer <strong>le</strong> risque de TME <strong>à</strong> moins de 7% sans résoudre, du moins<br />
pour l’instant la question de la résistance. La première alternative <strong>à</strong> laquel<strong>le</strong> on pourrait logiquement<br />
penser est la trithérapie pour toutes <strong>le</strong>s femmes enceintes mais cette stratégie s’avère problématique.<br />
En effet, une a<strong>le</strong>rte de la firme Boehringer en février 2004 a souligné <strong>le</strong> risque d’hépatotoxité chez <strong>le</strong>s<br />
patients traités par une HAART incluant la NVP et ayant des CD4>250/mm 3 (171, 172).<br />
L’autre option serait donc de modu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s interventions de PTME en fonction des CD4 et/ou de l’état<br />
clinique du patient. La HAART est aujourd’hui utilisée de manière indiscriminée dans plusieurs pays<br />
en Afrique pour la PTME même si cette stratégie n’est pas retenue dans <strong>le</strong>s recommandations de<br />
l’OMS de 2004. Dans une tel<strong>le</strong> stratégie, Boehringer propose une surveillance accrue pendant <strong>le</strong>s huit<br />
premières semaines de traitement avec un dosage des enzymes hépatiques (ASAT/ALAT) tous <strong>le</strong>s<br />
mois, ce qui serait très diffici<strong>le</strong> <strong>à</strong> réaliser <strong>à</strong> large échel<strong>le</strong> chez des femmes enceintes en Afrique.<br />
Dans <strong>le</strong> cadre du programme MTCT PLUS qui se dérou<strong>le</strong> sur <strong>le</strong>s mêmes sites que <strong>le</strong> projet Ditrame<br />
Plus <strong>à</strong> Abidjan, <strong>le</strong>s femmes ayant une indication de HAART, c'est-<strong>à</strong>-dire <strong>le</strong>s femmes enceintes au<br />
stade 4, stade 2 ou 3 avec des CD4
162<br />
comme dans <strong>le</strong>s pays développés et c’est dans cet esprit que l’OMS recommande <strong>le</strong>ur utilisation<br />
depuis cette année (75).<br />
En conclusion, la recommandation de l’OMS, d’octobre 2000 reste toujours d’actualité : « Tous <strong>le</strong>s<br />
régimes d’ARVs dont l’efficacité a été prouvée peuvent être des options possib<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong> paquet<br />
minimum de soins offerts aux femmes et <strong>à</strong> <strong>le</strong>urs enfants. Les molécu<strong>le</strong>s doivent être choisies en<br />
fonction des pratiques et des circonstances loca<strong>le</strong>s ».<br />
6.3.2. Réponse clinico-immunologique aux traitements antirétroviraux hautement<br />
actifs chez des femmes ayant reçu des interventions de PTME<br />
La monodose de NVP induit-el<strong>le</strong> des résistances et compromet-el<strong>le</strong> <strong>le</strong> succès d’un traitement ultérieur<br />
pour la santé maternel<strong>le</strong> A ce jour, il existe très peu de données sur la réponse viro-immunlogique et<br />
clinique <strong>à</strong> court et moyen terme chez <strong>le</strong>s femmes ayant reçu des interventions de PTME contenant de<br />
la NVP administrée en monodose (97, 174). Les résultats d’une étude réalisée en Thaïlande ont montré<br />
qu’après six mois de traitement par la combinaison D4T/3TC/NVP, on observe que parmi <strong>le</strong>s femmes<br />
qui ont reçu de la NVP en monodose prophylactique et qui avaient une mutation de résistance <strong>à</strong> la<br />
NVP, 35% avaient une virémie indécelab<strong>le</strong> (
6.4. La prévention de la transmission postpartum après une intervention<br />
peripartum<br />
163<br />
L’efficacité de la ZDV et de la NVP dans la PTME a été mise en évidence chez des femmes allaitantes<br />
avec des études portant sur l’efficacité <strong>à</strong> long terme c’est-<strong>à</strong>-dire <strong>à</strong> 18-24 mois (8, 61, 73, 179). Quatre<br />
essais thérapeutiques avec des groupes placebo ont montré la persistance de l’efficacité <strong>à</strong> long terme<br />
des ARVs administrés en peripartum dans une population pratiquant en majorité l’allaitement sauf<br />
dans l’essai PETRA (11).<br />
L’efficacité de la ZDV est très liée au taux de CD4 maternel <strong>à</strong> l’inclusion (8), ce qui semb<strong>le</strong> moins<br />
vrai avec la NVP (180).<br />
Les résultats de l’évaluation des stratégies pour la réduction de la durée de l’allaitement sont<br />
éga<strong>le</strong>ment très attendus. Une partie de ces résultats est en cours d’analyse dans <strong>le</strong> projet ANRS 1202.<br />
Malgré <strong>le</strong>s nombreuses études réalisées (30, 181-183), il n’existe pas <strong>à</strong> ce jour un consensus sur <strong>le</strong>s<br />
interventions nutritionnel<strong>le</strong>s pour réduire la transmission par <strong>le</strong> lait maternel. Ce mode de transmission<br />
est <strong>le</strong> plus important dans des populations pratiquant en majorité l’allaitement (31). Dans <strong>le</strong> cadre du<br />
projet Ditrame Plus, <strong>le</strong>s interventions nutritionnel<strong>le</strong>s retenues étaient :<br />
• une alimentation artificiel<strong>le</strong> dès la naissance<br />
• un allaitement exclusif avec un sevrage précoce <strong>à</strong> 3 mois de vie<br />
Il faut bien sûr garder <strong>à</strong> l’esprit que l’organisation d’un système de distribution et de fourniture des<br />
substituts du lait maternel (lait pour nourrissons, biberon, marmites pour la préparation de l’eau<br />
bouillante et <strong>le</strong>s autres matériels pour la préparation <strong>à</strong> domici<strong>le</strong>) est très comp<strong>le</strong>xe. Il faudrait donc<br />
garantir un approvisionnement régulier et une distribution en toute sécurité. Il faudrait<br />
systématiquement vérifier aussi <strong>le</strong>s cinq critères de l’OMS avant de recommander une alimentation<br />
artificiel<strong>le</strong> <strong>à</strong> toutes <strong>le</strong>s femmes inféctées par <strong>le</strong> VIH. Cel<strong>le</strong>-ci doit être 1) acceptab<strong>le</strong> (choix de la<br />
femme), 2) praticab<strong>le</strong>, 3) financièrement abordab<strong>le</strong>, 4) sûre (savoir bien préparer <strong>le</strong> biberon) et 5)<br />
durab<strong>le</strong>. Enfin, il y aurait bien sûr un risque de voir s’étendre l’utilisation de produits de substitution<br />
aux nourrissons nés de mères non infectées. Au total, l’utilisation de l’alimentation artificiel<strong>le</strong> risque<br />
de rester l’affaire de cas particuliers.<br />
Pour éviter la transmission postnata<strong>le</strong>, une autre approche a été étudiée dans l’essai SIMBA. Dans cet<br />
essai, des ARVs ont été utilisés chez l’enfant pendant toute la période de l’allaitement qui était réduite<br />
de quatre mois environ (69). Cet essai va dans <strong>le</strong> sens de la continuation des recherches sur<br />
l’utilisation des ARVs chez l’enfant comme chez la mère pour prévenir la transmission postnata<strong>le</strong>.
164<br />
6.5. Perspectives de santé publique<br />
6.5.1. Rapport coût-efficacité<br />
Les données sur <strong>le</strong> rapport coût-efficacité dans la PTME par ARVs sont assez fragmentaires en<br />
Afrique. Au-del<strong>à</strong> des modè<strong>le</strong>s théoriques, très peu d’études coût-efficacité ont été réalisées sur ce<br />
terrain (184-189). Jusqu’<strong>à</strong> ce jour ces rapports coût-efficacité n’ont pas été formel<strong>le</strong>ment pris en<br />
compte par <strong>le</strong>s décideurs pour investir dans la PTME. Pourtant, ces données économiques ont en<br />
général un impact très important sur la prise de décision dans d’autres domaines, surtout devant <strong>le</strong>s<br />
difficultés de choix pour <strong>le</strong>s gouvernants.<br />
Les études décrites dans la littérature concernent l’utilisation de la NVP ciblée et de la NVP<br />
administrée de manière universel<strong>le</strong>. Le tab<strong>le</strong>au 39 résume <strong>le</strong>s données disponib<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong> sujet et<br />
montre la grande variabilité des données de coût-efficacité de la PTME en Afrique (184, 186, 189).<br />
Face <strong>à</strong> la pandémie actuel<strong>le</strong> d’infection <strong>à</strong> VIH, <strong>le</strong>s moyens financiers doivent être investis dans <strong>le</strong>s<br />
programmes de PTME sur plusieurs années afin de pouvoir <strong>le</strong>s évaluer en espérant alors avoir des<br />
résultats tangib<strong>le</strong>s.<br />
En conclusion, <strong>le</strong>s données de coût-efficacité sont ainsi peu utilisées pour orienter <strong>le</strong>s politiques<br />
internationa<strong>le</strong>s et nationa<strong>le</strong>s des programmes de PTME en Afrique.<br />
Tab<strong>le</strong>au 39. Coût unitaire en dollars et estimation des interventions de PTME (Source, Cresse A<br />
et al. Lancet 2002 ; 3591635-1642).<br />
Monodose de Névirapine<br />
(Traitement universel)<br />
Monodose de Névirapine<br />
(Traitement universel)<br />
Monodose de Névirapine<br />
(Traitement ciblé)<br />
Monodose de Névirapine<br />
(Traitement ciblé)<br />
Régime de ZDV<br />
(type Thaïlande)<br />
Alimentation artificiel<strong>le</strong><br />
(conseil)<br />
Pays et année<br />
Coût en dollars<br />
par cas d’infection <strong>à</strong> VIH évité<br />
Ouganda (1999) 143<br />
Afrique subsaharienne (2000) 268<br />
Ouganda (1999) 308<br />
Afrique subsaharienne (2000) 20-341<br />
Afrique du Sud (2000) 949-2198<br />
Afrique du Sud (1999) 3834<br />
Provision alimentation artificiel<strong>le</strong> Afrique du Sud (1999) 6355<br />
Allaitement maternel 3 mois Afrique du Sud (1999) 5006<br />
Allaitement maternel 6 mois Afrique du Sud (1999) 21355
165<br />
6.5.2. Intégration des activités de PTME dans <strong>le</strong>s structures sanitaires<br />
Nous avons montré que l’acceptabilité des interventions de PTME est encore trop faib<strong>le</strong> et que<br />
seu<strong>le</strong>ment un quart des femmes dépistées infectées en moyenne bénéficient de tels programmes. De ce<br />
fait, d’autres approches sont nécessaires pour proposer la PTME <strong>à</strong> une plus grande échel<strong>le</strong>.<br />
Nous avons en partie discuté <strong>le</strong>s autres approches de la PTME dans cette discussion généra<strong>le</strong> :<br />
prophylaxie universel<strong>le</strong> de masse, prophylaxie pendant <strong>le</strong> travail, prophylaxie néonata<strong>le</strong>, conseil et<br />
dépistage systématique réalisé dans <strong>le</strong> cadre du paquet de soins prénataux. Nous voulons dans cette<br />
dernière partie souligner l’importance d’intégrer <strong>le</strong>s activités de PTME dans <strong>le</strong>s centres de santé ou<br />
dans <strong>le</strong>s programmes de santé maternel<strong>le</strong> et infanti<strong>le</strong> existants. Cette initiative doit émaner du<br />
ministère de la Santé, éventuel<strong>le</strong>ment du ministère du Sida avec <strong>le</strong> soutien des partenaires au<br />
développement. En Côte d’Ivoire, un document de politique nationa<strong>le</strong> rédigé par <strong>le</strong> ministère de la<br />
Santé et de la Population vient d’être adopté.<br />
Les actions suivantes ont été planifiées pour lutter plus efficacement contre la TME dans ce pays.<br />
• Evaluation des besoins sur <strong>le</strong>s nouveaux sites et mise <strong>à</strong> niveau des centres et rénovation si<br />
nécessaire.<br />
• Validation des documents officiels (documents de politique nationa<strong>le</strong>, manuels de<br />
procédures) avant <strong>le</strong>ur utilisation dans des programmes de formation initia<strong>le</strong> et continue.<br />
• Démarrage des activités avec <strong>le</strong> soutien du programme national pour l’approvisionnement, la<br />
supervision et <strong>le</strong> monitorage.<br />
Il faudrait désormais envisager de décentraliser en milieu rural <strong>le</strong>s activités de PTME et bien sûr lier ce<br />
programme <strong>à</strong> la prise en charge.<br />
6.5.3. PTME dans <strong>le</strong> con<strong>texte</strong> de la prise en charge des adultes et des enfants<br />
(approche MTCT PLUS : prise en charge de la cellu<strong>le</strong> familia<strong>le</strong>).<br />
La PTME doit dépasser <strong>le</strong> cadre restreint de la femme et de l’enfant mais impliquer aussi <strong>le</strong> père ou <strong>le</strong><br />
partenaire et la famil<strong>le</strong> en général. Cette approche est proposée aujourd’hui dans <strong>le</strong> programme MTCT<br />
PLUS (www.mtctplus.org). Celui-ci prévoit d’établir des services de soins primaires pour <strong>le</strong>s femmes<br />
dépistées séropositives <strong>à</strong> travers <strong>le</strong>s programmes de PTME, <strong>le</strong>urs nourrissons et <strong>le</strong>urs enfants ainsi que<br />
<strong>le</strong>s autres membres de la famil<strong>le</strong> ou du foyer. Ce programme est financé par des fondations<br />
américaines et coordonné par l’Université de Columbia (Éco<strong>le</strong> de Santé Publique de Mailman). Nos<br />
deux centres de suivi participent depuis Août 2003 <strong>à</strong> ce programme qui s’est engagé <strong>à</strong> soigner et <strong>à</strong><br />
traiter <strong>à</strong> vie par ARVs tous <strong>le</strong>s patients inscrits qui en auraient besoin. L’approche MTCT PLUS<br />
présente des limites bien sûr comme l’absence d’intervention nutritionnel<strong>le</strong> pour réduire la TME par<br />
l’allaitement. Ce nouveau modè<strong>le</strong> pourra être proposé sans doute dans d’autres structures <strong>à</strong> plus ou
166<br />
moins long terme et sera en tout cas adapté dans un nouveau programme d’accès au traitement qui<br />
démarre <strong>à</strong> Abidjan, <strong>le</strong> programme HEART « Help Expand Antiretroviral Therapy for Children and<br />
Families » de la Fondation pédiatrique Elisabeth Glaser (EGPAF). L’implication du partenaire<br />
constitue une originalité. Cette implication souhaitée a amené certains acteurs de la PTME <strong>à</strong> proposer<br />
plutôt <strong>le</strong> terme de prévention du VIH du parent <strong>à</strong> l’enfant plutôt que de la mère <strong>à</strong> l’enfant.Cependant,<br />
ceci est loin de faire l’objet d’un consensus.<br />
6.5.4. PTME dans <strong>le</strong> con<strong>texte</strong> de la prévention primaire et secondaire de la<br />
transmission sexuel<strong>le</strong> du VIH<br />
• Le dépistage anténatal de l’infection <strong>à</strong> VIH dans <strong>le</strong>s centres de santé permet d’identifier des femmes<br />
non infectées par <strong>le</strong> VIH. Ces femmes doivent pouvoir recevoir des conseils adaptés pour demeurer<br />
non infectées par <strong>le</strong> VIH. Les actions menées vis-<strong>à</strong>-vis de ces femmes sont encore trop souvent très<br />
limitées aujourd’hui en Afrique. Une cohorte de suivi des femmes dépistées négatives avec une<br />
proposition tous <strong>le</strong>s six mois du test de dépistage VIH est en cours de suivi dans l’étude ANRS 1203<br />
(Ditrame Plus 3) qui étudie <strong>le</strong>s comportements en matière de sexualité des femmes dépistées<br />
négatives ayant refusé <strong>le</strong> test VIH en comparaison avec <strong>le</strong>s femmes positives incluses dans l’étude<br />
ANRS 1201.<br />
• Il faut aussi souligner l’intérêt <strong>à</strong> promouvoir <strong>le</strong> soutien psychologique et <strong>le</strong> conseil <strong>à</strong> prodiguer aux<br />
coup<strong>le</strong>s sérodifférents. Il est impératif que ces partenaires masculins demeurent séronégatifs. Pour<br />
ces coup<strong>le</strong>s l’utilisation du préservatif est donc indispensab<strong>le</strong>. Le désir de procréation doit bien sûr<br />
être discuté avec <strong>le</strong> personnel de santé spécialisé. Il n’existe <strong>à</strong> ce jour que des moyens artisanaux en<br />
Afrique pour aider ces coup<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong>ur désir de procréation.<br />
• L’interruption thérapeutique de grossesse est parfois considérée comme un moyen de prévention<br />
primaire pour éviter la survenue de nouveaux cas d’infection pédiatriques chez <strong>le</strong>s femmes enceintes<br />
dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1. Ces actions doivent tenir compte de la législation en vigueur dans<br />
<strong>le</strong> pays concerné et dans <strong>le</strong> futur devraient être réduites en fréquence si l’on sait éviter aux femmes<br />
séropositives déj<strong>à</strong> dépistées des grossesses non désirées.<br />
• La prise en charge des enfants infectés par <strong>le</strong> VIH-1, malgré <strong>le</strong>s interventions de PTME, doit être<br />
une priorité et une urgence puisque plus de 50% de ces enfants décèdent avant la deuxième année de<br />
vie (190). En Côte d’Ivoire, ces enfants sont pris en charge par <strong>le</strong> centre accrédité du service de<br />
pédiatrie situé au CHU de Yopougon. Ces enfants infectés sont éligib<strong>le</strong>s pour une HAART, si <strong>le</strong><br />
pourcentage des CD4
167<br />
• La prise en charge des enfants orphelins nécessite enfin des actions spécifiques comme un soutien<br />
nutritionnel et scolaire.
168<br />
Conclusion<br />
• Nous avons montré dans ce travail de thèse que la préva<strong>le</strong>nce de l’infection <strong>à</strong> VIH chez la<br />
femme enceinte oscillait entre 10% et 11% <strong>à</strong> Abidjan entre 2000 et 2003 et que 65% des<br />
femmes ayant eu une proposition du dépistage ont eu connaissance effective de <strong>le</strong>ur statut<br />
sérologique vis-<strong>à</strong>-vis de l’infection <strong>à</strong> VIH.<br />
• Seu<strong>le</strong>ment 25% des femmes dépistées infectées par <strong>le</strong> VIH-1 acceptent l’intervention de<br />
PTME proposée. Il n’existe pas de solution universel<strong>le</strong> pour la mise en place des programmes<br />
de PTME, mais cel<strong>le</strong>-ci est diffici<strong>le</strong> et encore trop <strong>le</strong>nte en Afrique. Il existe encore trop de<br />
zones rura<strong>le</strong>s et urbaines où la NVP n’est même pas disponib<strong>le</strong>. Il faudra développer une<br />
politique de décentralisation de la PTME, réduire la stigmatisation et mettre en place des<br />
campagnes de sensibilisation communautaire si l’on veut augmenter la couverture. De<br />
nouvel<strong>le</strong>s approches comme <strong>le</strong> dépistage tardif en sal<strong>le</strong> d’accouchement, <strong>le</strong> dépistage de masse<br />
ou <strong>le</strong> traitement universel de masse doivent être très rapidement évaluées pour compléter <strong>le</strong><br />
dispositif dans la plupart des populations cib<strong>le</strong>s.<br />
• L’obtention du consentement éclairé pour la participation des patients <strong>à</strong> des programmes de<br />
recherche dans <strong>le</strong>s pays en développement doit être simplifiée et remplacer dans certaines<br />
situations par un consentement oral. La mise en place des groupes de discussion entre <strong>le</strong>s<br />
participants aux programmes de recherche et notamment aux essais cliniques pourra aider <strong>à</strong><br />
expliquer <strong>à</strong> chaque patient ses droits et devoirs.<br />
• Les combinaisons d’ARVs associant deux ou trois molécu<strong>le</strong>s ont démontré <strong>le</strong>ur efficacité par<br />
rapport <strong>à</strong> une monothérapie de ZDV et <strong>à</strong> la NVP monodose. Ainsi, on peut baisser <strong>à</strong> 6,5% <strong>le</strong><br />
taux de TME avec la combinaison (ZDV+NVP) et <strong>à</strong> 4,7% avec la combinaison<br />
(ZDV+3TC+NVP). A Abidjan, avec la ZDV en monodose, <strong>le</strong> risque de TME était estimé <strong>à</strong><br />
12,8% et <strong>à</strong> 24,8% avec un placebo.<br />
• La monodose de NVP utilisée dans la PTME favorise des mutations de résistance chez 1/3 des<br />
femmes ainsi que chez 1/4 des enfants infectés nécessitant l’évaluation d’autres régimes au<br />
moins équiva<strong>le</strong>nts en terme d’efficacité et entraînant moins de mutations de résistance. Il<br />
semb<strong>le</strong>rait que <strong>le</strong> Tenofovir soit une bonne molécu<strong>le</strong> pouvant être utilisée dans la PTME.<br />
Cependant, aucune étude n’a encore été entreprise dans ce sens.
169<br />
• La mesure de la lactatémie plasmatique au cours des trois premiers mois de vie ne semb<strong>le</strong> pas<br />
être un bon marqueur pour identifier une éventuel<strong>le</strong> toxicité mitochondria<strong>le</strong> chez <strong>le</strong>s enfants<br />
exposés in utero <strong>à</strong> la ZDV.<br />
• Dans <strong>le</strong>s pays où il existe déj<strong>à</strong> des moyens avancés de prise en charge de l’adulte et de<br />
l’enfant, comme <strong>à</strong> Abidjan, <strong>le</strong> traitement antirétroviral de la mère doit être privilégié en<br />
prophylaxie de PTME pour <strong>le</strong>s femmes qui en ont besoin pour el<strong>le</strong>s-mêmes comme nous<br />
l’avons récemment initié dans <strong>le</strong> programme MTCT Plus <strong>à</strong> Abidjan avec la prescription de la<br />
HAART au cours de la grossesse (175, 191, 192). Cette approche MTCT PLUS assurant la<br />
prise en charge de la famil<strong>le</strong> nucléaire reste <strong>à</strong> évaluer.<br />
• Il n’existe pas <strong>à</strong> ce jour des données de consensus sur l’alimentation des enfants nés de mères<br />
infectées par <strong>le</strong> VIH. Le seul consensus certain est de réduire de façon significative la durée de<br />
l’allaitement maternel. Le projet Ditrame Plus (ANRS 1202) apportera des éléments de<br />
réponses sur ce point dans un futur proche.<br />
• Enfin, <strong>le</strong>s données coût-efficacité de la PTME sont très fragmentaires et sont peu prises en<br />
compte dans la planification internationa<strong>le</strong> et nationa<strong>le</strong> des programmes de PTME. Ceci<br />
nécessite aussi dans <strong>le</strong> futur des études spécifiques.<br />
Sur <strong>le</strong> plan personnel, j’ai pu apporter pendant ces trois années où j’ai travaillé sur <strong>le</strong> projet Ditrame<br />
Plus mon expertise sur <strong>le</strong> plan méthodologique et épidémiologique pendant toute la mise en place de<br />
l’étude et son dérou<strong>le</strong>ment. Ce travail m’a permis de m’investir dans la lutte contre <strong>le</strong> SIDA et plus<br />
particulièrement dans la prévention de l’infection pédiatrique <strong>à</strong> VIH.<br />
J’ai pu bénéficier pendant ces trois années, de formation spécifique sur <strong>le</strong> VIH avec <strong>le</strong> programme<br />
MTCT PLUS <strong>à</strong> Kigali (Rwanda) en février 2002 et <strong>à</strong> Abidjan (Côte d’Ivoire) en avril 2004. En<br />
Septembre 2004, j’ai pu participer <strong>à</strong> l’Université des Jeunes Chercheurs travaillant sur <strong>le</strong> VIH<br />
organisée par l’association AIDES <strong>à</strong> Marseil<strong>le</strong> (France). J’ai pu, toujours dans <strong>le</strong> cadre de cette thèse,<br />
participer <strong>à</strong> une formation en analyse statistique <strong>à</strong> l’Université de Bern (Suisse) en février 2004 sous la<br />
direction de Mathias Egger et Jonathan Sterne. L’ensemb<strong>le</strong> de ces formations m’a permis d’élargir <strong>le</strong><br />
champ de mes connaissances sur <strong>le</strong> VIH et en épidémiologie.<br />
Mes participations aux congrès scientifiques sur <strong>le</strong> VIH <strong>à</strong> Ouagadougou (Burkina-Faso) en décembre<br />
2001, <strong>à</strong> Barcelone (Espagne) en juil<strong>le</strong>t 2002 et <strong>à</strong> Paris (France) en juil<strong>le</strong>t 2003 m’ont permis de<br />
rencontrer et de discuter avec d’autres acteurs travaillant sur <strong>le</strong> VIH et particulièrement la PTME.
170<br />
Les études présentées dans cette thèse ont fait l’objet de publications précisées en détail dans la partie<br />
publication scientifique de cette thèse. Mon investissement dans ce projet et dans <strong>le</strong>s travaux que nous<br />
avons présenté aux différents congrès m’a permis de bénéficier d’une bourse de recherche de<br />
Sidaction pendant une durée de trois ans et de recevoir deux prix scientifiques : « IAS Young<br />
Investigator Award » <strong>à</strong> la XIV Conférence Internationa<strong>le</strong> sur <strong>le</strong> SIDA <strong>à</strong> Barcelone (Espagne) en juil<strong>le</strong>t<br />
2002 et <strong>le</strong> prix de « meil<strong>le</strong>ur jeune chercheur scientifique » <strong>à</strong> la Convention Nationa<strong>le</strong> de Sidaction en<br />
avril 2004 <strong>à</strong> Paris (France).<br />
Comme perspective, je souhaiterais continuer la recherche sur <strong>le</strong> VIH et spécifiquement sur la PTME.<br />
Ceci semb<strong>le</strong> peut être possib<strong>le</strong> grâce <strong>à</strong> une bourse de recherche d’une durée de deux ans de l’European<br />
Developped Clinical Trial Partenership (EDCTP), obtenue en juil<strong>le</strong>t 2004 et qui sera effective en<br />
janvier 2005.
171<br />
REFERENCES<br />
1. UNAIDS. Report on the global AIDS epidemic 2004. Geneva, UNAIDS, 2004.<br />
(http://www.unaids.org/bangkok2004/GAR2004_html/ExecSummary_en/Execsumm_en.pdf,<br />
accessed 30 October 2004).<br />
2. The European Study Group on Heterosexual Transmission of HIV Comparison of fema<strong>le</strong> to<br />
ma<strong>le</strong> and ma<strong>le</strong> to fema<strong>le</strong> transmission of HIV in 563 stab<strong>le</strong> coup<strong>le</strong>s. BMJ<br />
1992;304(6830):809-813.<br />
3. Dabis F, Ekpini ER. HIV-1/AIDS and maternal and child health in Africa. Lancet<br />
2002;359(9323):2097-2104.<br />
4. Connor EM, Sperling RS, Gelber R, Kise<strong>le</strong>v P, Scott G, O'Sullivan MJ, et al. Reduction of<br />
maternal-infant transmission of human immunodeficiency virus type 1 with zidovudine<br />
treatment. Pediatric AIDS Clinical Trials Group Protocol 076 Study Group. N Engl J Med<br />
1994;331(18):1173-1180.<br />
5. Dorenbaum A, Cunningham CK, Gelber RD, Culnane M, Mofenson L, Britto P, et al. Twodose<br />
intrapartum/newborn nevirapine and standard antiretroviral therapy to reduce perinatal<br />
HIV transmission: a randomized trial. JAMA 2002;288(2):189-198.<br />
6. Dabis F, Msellati P, Meda N, Welffens-Ekra C, You B, Manigart O, et al. 6-month efficacy,<br />
to<strong>le</strong>rance, and acceptability of a short regimen of oral zidovudine to reduce vertical<br />
transmission of HIV in breastfed children in Cote d'Ivoire and Burkina Faso: a doub<strong>le</strong>-blind<br />
placebo-control<strong>le</strong>d multicentre trial. DITRAME Study Group. DIminution de la TRansmission<br />
Mere-Enfant. Lancet 1999;353(9155):786-792.<br />
7. Wiktor SZ, Ekpini E, Karon JM, Nkengasong J, Maurice C, Severin ST, et al. Short-course<br />
oral zidovudine for prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 in Abidjan, Cote<br />
d'Ivoire: a randomised trial. Lancet 1999;353(9155):781-785.<br />
8. Leroy V, Karon JM, Alioum A, Ekpini ER, Meda N, Greenberg AE, et al. Twenty-four month<br />
efficacy of a maternal short-course zidovudine regimen to prevent mother-to-child<br />
transmission of HIV-1 in West Africa. AIDS 2002;16(4):631-641.<br />
9. Guay LA, Musoke P, F<strong>le</strong>ming T, Bagenda D, Al<strong>le</strong>n M, Nakabiito C, et al. Intrapartum and<br />
neonatal sing<strong>le</strong>-dose nevirapine compared with zidovudine for prevention of mother-to-child<br />
transmission of HIV-1 in Kampala, Uganda: HIVNET 012 randomised trial. Lancet<br />
1999;354(9181):795-802.<br />
10. Mood<strong>le</strong>y D, Mood<strong>le</strong>y J, Coovadia H, Gray G, McIntyre J, Hofmyer J, et al. A multicenter<br />
randomized control<strong>le</strong>d trial of nevirapine versus a combination of zidovudine and lamivudine<br />
to reduce intrapartum and early postpartum mother-to-child transmission of human<br />
immunodeficiency virus type 1. J Infect Dis 2003;187(5):725-735.<br />
11. The PETRA study team. Efficacy of three short-course regimens of zidovudine and<br />
lamivudine in preventing early and late transmission of HIV-1 from mother to child in<br />
Tanzania, South Africa, and Uganda (PETRA study): a randomised, doub<strong>le</strong>-blind, placebocontrol<strong>le</strong>d<br />
trial. Lancet 2002;359(9313):1178-1186.
172<br />
12. United Nations General Assembly. Final declaration of commitment on HIV/AIDS. (A/s-<br />
26/L.2). New York, 2001.<br />
13. Msellati P, Ramon R, Viho I, Noba V, Mandelbrot L, Dabis F, et al. Prevention of mother-tochild<br />
transmission of HIV in Africa: uptake of pregnant women in a clinical trial in Abidjan,<br />
Cote d'Ivoire. AIDS 1998;12(10):1257-1258.<br />
14. Msellati P, Hingst G, Kaba F, Viho I, Welffens-Ekra C, Dabis F. Operational issues in<br />
preventing mother-to-child transmission of HIV-1 in Abidjan, Cote d'Ivoire, 1998-99. Bull<br />
World Health Organ 2001;79(7):641-647.<br />
15. Cartoux M, Msellati P, Rouamba O, Coulibaly D, Meda N, Blibolo D, et al. Acceptability of<br />
interventions to reduce mother-to-child transmission of HIV-1 in west Africa. J Acquir<br />
Immune Defic Syndr 1996;12(3):290-292.<br />
16. Shaffer N, Chuachoowong R, Mock PA, Bhadrakom C, Siriwasin W, Young NL, et al. Shortcourse<br />
zidovudine for perinatal HIV-1 transmission in Bangkok, Thailand: a randomised<br />
control<strong>le</strong>d trial. Bangkok Collaborative Perinatal HIV Transmission Study Group. Lancet<br />
1999;353(9155):773-780.<br />
17. Mandelbrot L, Landreau-Mascaro A, Rekacewicz C, Berrebi A, Benifla JL, Burgard M, et al.<br />
Lamivudine-zidovudine combination for prevention of maternal-infant transmission of HIV-1.<br />
JAMA 2001;285(16):2083-2093.<br />
18. Dabis F, Ekouevi DK, Bequet L, Rouet F, Horo A, Fassinou P, et al. Effectiveness of a short<br />
course of zidovudine + lamivudine and peripartum nevirapine to prevent HIV-1 mother-tochild<br />
transmission. The ANRS 1201 Ditrame Plus Trial, Abidjan, Côte d'Ivoire. The 2nd IAS<br />
Conference on HIV Pathogenesis; 13-16 July 2003; Paris, France (abstract 219). Antiviral<br />
Therapy 2003;8(Suppl.1):S236-S237.<br />
19. Kourtis AP, Bulterys M, Nesheim SR, Lee FK. Understanding the timing of HIV transmission<br />
from mother to infant. JAMA 2001;285(6):709-712.<br />
20. Adjorlolo-Johnson G, De Cock KM, Ekpini E, Vetter KM, Sibailly T, Brattegaard K, et al.<br />
Prospective comparison of mother-to-child transmission of HIV-1 and HIV-2 in Abidjan,<br />
Ivory Coast. JAMA 1994;272(6):462-466.<br />
21. Burgard M, Blanche S, Mayaux M, Allisy C, Ciraru N, Firtion G, et al. HIV-2 mother-to-child<br />
transmission risk assessed by Real Time DNA PCR technology. The 2nd IAS Conference on<br />
HIV Pathogenesis; 13-16 July 2003; Paris, France (abstract 65). Antiviral Therapy<br />
2003;8(Suppl.1):S200-S201.<br />
22. De Cock KM, Fow<strong>le</strong>r MG, Mercier E, de Vincenzi I, Saba J, Hoff E, et al. Prevention of<br />
mother-to-child HIV transmission in resource-poor countries: translating research into policy<br />
and practice. JAMA 2000;283(9):1175-1182.<br />
23. Chouquet C, Burgard M, Richardson S, Rouzioux C, Costagliola D. Timing of mother-to-child<br />
HIV-1 transmission and diagnosis of infection based on polymerase chain reaction in the<br />
neonatal period by a non-parametric method. AIDS 1997;11(9):1183-1184.<br />
24. Mundy DC, Schinazi RF, Gerber AR, Nahmias AJ, Randall HW, Jr. Human<br />
immunodeficiency virus isolated from amniotic fluid. Lancet 1987;2(8556):459-460.<br />
25. Wabwire-Mangen F, Gray RH, Mmiro FA, Ndugwa C, Abramowsky C, Wabinga H, et al.<br />
Placental membrane inflammation and risks of maternal-to-child transmission of HIV-1 in<br />
Uganda. J Acquir Immune Defic Syndr 1999;22(4):379-385.
173<br />
26. Kaneda T, Shiraki K, Hirano K, Nagata I. Detection of maternofetal transfusion by placental<br />
alkaline phosphatase <strong>le</strong>vels. J Pediatr 1997;130(5):730-735.<br />
27. Gaillard P, Verhofstede C, Mwanyumba F, Claeys P, Chohan V, Mandaliya K, et al. Exposure<br />
to HIV-1 during delivery and mother-to-child transmission. AIDS 2000;14(15):2341-2348.<br />
28. Nduati R, Richardson BA, John G, Mbori-Ngacha D, Mwatha A, Ndinya-Achola J, et al.<br />
Effect of breastfeeding on mortality among HIV-1 infected women: a randomised trial. Lancet<br />
2001;357(9269):1651-1655.<br />
29. Miotti PG, Taha TE, Kumwenda NI, Broadhead R, Mtimavalye LA, Van der Hoeven L, et al.<br />
HIV transmission through breastfeeding: a study in Malawi. JAMA 1999;282(8):744-749.<br />
30. Mbori-Ngacha D, Nduati R, John G, Reilly M, Richardson B, Mwatha A, et al. Morbidity and<br />
mortality in breastfed and formula-fed infants of HIV-1-infected women: A randomized<br />
clinical trial. JAMA 2001;286(19):2413-2420.<br />
31. Coutsoudis A, Dabis F, Fawzi W, Gaillard P, Haverkamp G, Harris DR, et al. Late postnatal<br />
transmission of HIV-1 in breast-fed children: an individual patient data meta-analysis. J Infect<br />
Dis 2004;189(12):2154-2166.<br />
32. Van de Perre P, Simonon A, Msellati P, Hitimana DG, Vaira D, Bazubagira A, et al. Postnatal<br />
transmission of human immunodeficiency virus type 1 from mother to infant. A prospective<br />
cohort study in Kigali, Rwanda. N Engl J Med 1991;325(9):593-598.<br />
33. Mood<strong>le</strong>y D, Bobat R, Coutsoudis A, Coovadia H. Predicting perinatal human<br />
immunodeficiency virus infection by antibody patterns. Pediatr Infect Dis J 1995;14(10):850-<br />
852.<br />
34. Young NL, Shaffer N, Chaowanachan T, Chotpitayasunondh T, Vanparapar N, Mock PA, et<br />
al. Early diagnosis of HIV-1-infected infants in Thailand using RNA and DNA PCR assays<br />
sensitive to non-B subtypes. J Acquir Immune Defic Syndr 2000;24(5):401-407.<br />
35. Cunningham CK, Charbonneau TT, Song K, Patterson D, Sullivan T, Cummins T, et al.<br />
Comparison of human immunodeficiency virus 1 DNA polymerase chain reaction and<br />
qualitative and quantitative RNA polymerase chain reaction in human immunodeficiency virus<br />
1-exposed infants. Pediatr Infect Dis J 1999;18(1):30-35.<br />
36. Simonds RJ, Brown TM, Thea DM, Orloff SL, Steketee RW, Lee FK, et al. Sensitivity and<br />
specificity of a qualitative RNA detection assay to diagnose HIV infection in young infants.<br />
Perinatal AIDS Collaborative Transmission Study. AIDS 1998;12(12):1545-1549.<br />
37. Rouet F, Montcho C, Rouzioux C, Leroy V, Msellati P, Kottan JB, et al. Early diagnosis of<br />
paediatric HIV-1 infection among African breast-fed children using a quantitative plasma HIV<br />
RNA assay. AIDS 2001;15(14):1849-1856.<br />
38. Steketee RW, Abrams EJ, Thea DM, Brown TM, Lambert G, Orloff S, et al. Early detection of<br />
perinatal human immunodeficiency virus (HIV) type 1 infection using HIV RNA<br />
amplification and detection. New York City Perinatal HIV Transmission Collaborative Study.<br />
J Infect Dis 1997;175(3):707-711.<br />
39. Delamare C, Burgard M, Mayaux MJ, Blanche S, Doussin A, Ivanoff S, et al. HIV-1 RNA<br />
detection in plasma for the diagnosis of infection in neonates. The French Pediatric HIV<br />
Infection Study Group. J Acquir Immune Defic Syndr 1997;15(2):121-125.
174<br />
40. Bertolli J, St Louis M, Simonds R, Nieburg P, Kamenga M, Brown C, et al. Estimation the<br />
timing of mother-to-child transmission of human immunodeficiency virus in a breast-feeding<br />
population in Kinshasa, Zaire. J Infect Dis 1996;174(4):722-726.<br />
41. Rouzioux C, Costagliola D, Burgard M, Blanche S, Mayaux M, Griscelli C, et al. Estimated<br />
timing of mother-to-child human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) transmission by use<br />
the Markov model. The HIV Infection in Newborns French Collaborative Study Group. Am J<br />
Epidemiol 1995;142(12):1330-1337.<br />
42. Simonon A, Lepage P, Karita E, Hitimana D, Dabis F, Msellati P, et al. An assessment of the<br />
timing of mother-to-child tranmission of human immunodeficiency virus type 1 by means of<br />
polymerase chain reaction. J Acq Immune Defic Syndr 1994;7(9):952-957.<br />
43. Landesman S, Kalish LA, Burns D. Obstetrical factors and the transmission of human<br />
immunodeficiency virus type 1 from mother-to-child. The Women and Infants Transmission<br />
Study. N Engl J Med 1996;334(25):1617-1623.<br />
44. Rodriguez EM, Mofenson LM, Chang BH, Rich KC, Fow<strong>le</strong>r MG, Smeriglio V, et al.<br />
Association of maternal drug use during pregnancy with maternal HIV culture positivity and<br />
perinatal HIV transmission. AIDS 1996;10(3):273-282.<br />
45. Bulterys M, Chao A, Dushimimana A, Habimana P, Nawrocki P, Kurawige JB, et al. Multip<strong>le</strong><br />
sexual partners and mother-to-child transmission of HIV-1. AIDS 1993;7(12):1639-1645.<br />
46. Bulterys M, Landesman S, Burns DN, Rubinstein A, Goedert JJ. Sexual behavior and injection<br />
drug use during pregnancy and vertical transmission of HIV-1. J Acquir Immune Defic Syndr<br />
1997;15(1):76-82.<br />
47. Lal<strong>le</strong>mant M, Le Coeur S, Samba L, Cheynier D, M'Pe<strong>le</strong> P, Nzingoula S, et al. Mother-tochild<br />
transmission of HIV-1 in Congo, central Africa. Congo<strong>le</strong>se Research Group on Motherto-Child<br />
Transmission of HIV. AIDS 1994;8(10):1451-1456.<br />
48. Matheson PB, Thomas PA, Abrams EJ, Pliner V, Lambert G, Bamji M, et al. Heterosexual<br />
behavior during pregnancy and perinatal transmission of HIV-1. New York City Perinatal HIV<br />
Transmission Collaborative Study Group. AIDS 1996;10(11):1249-1256.<br />
49. Taha TE, Kumwenda NI, Gibbons A, Broadhead RL, Fiscus S, Lema V, et al. Short<br />
postexposure prophylaxis in newborn babies to reduce mother-to-child transmission of HIV-1:<br />
NVAZ randomised clinical trial. Lancet 2003;362(9391):1171-1177.<br />
50. Sperling RS, Shapiro DE, Coombs RW, Todd JA, Herman SA, McSherry GD, et al. Maternal<br />
viral load, zidovudine treatment, and the risk of transmission of human immunodeficiency<br />
virus type 1 from mother to infant. Pediatric AIDS Clinical Trials Group Protocol 076 Study<br />
Group. N Engl J Med 1996;335(22):1621-1629.<br />
51. John GC, Nduati RW, Mbori-Ngacha DA, Richardson BA, Pante<strong>le</strong>eff D, Mwatha A, et al.<br />
Correlates of mother-to-child human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) transmission:<br />
association with maternal plasma HIV-1 RNA load, genital HIV-1 DNA shedding, and breast<br />
infections. J Infect Dis 2001;183(2):206-212.<br />
52. Nair P, Alger L, Hines S, Seiden S, Hebel R, Johnson JP. Maternal and neonatal<br />
characteristics associated with HIV infection in infants of seropositive women. J Acquir<br />
Immune Defic Syndr 1993;6(3):298-302.
175<br />
53. Duliege AM, Amos CI, Felton S, Biggar RJ, Goedert JJ. Birth order, delivery route, and<br />
concordance in the transmission of human immunodeficiency virus type 1 from mothers to<br />
twins. International Registry of HIV-Exposed Twins. J Pediatr 1995;126(4):625-632.<br />
54. Biggar RJ, Janes M, Pilon R, Roy R, Broadhead R, Kumwenda N, et al. Human<br />
immunodeficiency virus type 1 infection in twin pairs infected at birth. J Infec Dis<br />
2002;186(2):281-285.<br />
55. The International Perinatal HIV Group. The mode of delivery and the risk of vertical<br />
transmission of human immunodeficiency virus type 1. A meta-analysis of 15 prospective<br />
cohort studies. N Engl J Med 1999;340(13):977-87.<br />
56. The European Mode of Delivery Collaboration. E<strong>le</strong>ctive caesarean-section versus vaginal<br />
delivery in prevention of vertical HIV-1 transmission: a randomised clinical trial. Lancet<br />
1999;353(9158):1035-9.<br />
57. Tovo PA, de Martino M, Gabiano C, Galli L, Cappello N, Ruga E, et al. Mode of delivery and<br />
gestational age influence perinatal HIV-1 transmission. Italian Register for HIV Infection in<br />
Children. J Acquir Immune Defic Syndr 1996;11(1):88-94.<br />
58. Newell ML, Dunn DT, Peckham CS, Semprini AE, Pardi G. Vertical transmission of HIV-1:<br />
maternal immune status and obstetric factors. The European Collaborative Study. AIDS<br />
1996;10(14):1675-1681.<br />
59. Coutsoudis A, Pillay K, Kuhn L, Spooner E, Tsai WY, Coovadia HM. Method of feeding and<br />
transmission of HIV-1 from mothers to children by 15 months of age: prospective cohort study<br />
from Durban, South Africa. AIDS 2001;15(3):379-387.<br />
60. Semba RD, Kumwenda N, Hoover DR, Taha TE, Quinn TC, Mtimavalye L, et al. Human<br />
immunodeficiency virus load in breast milk, mastitis, and mother-to-child transmission of<br />
human immunodeficiency virus type 1. J Infect Dis 1999;180(1):93-98.<br />
61. Leroy V, Karon JM, Alioum A, Ekpini ER, Van de Perre P, Greenberg AE, et al. Postnatal<br />
transmission of HIV-1 after a maternal short-course zidovudine peripartum regimen in West<br />
Africa. AIDS 2003;17(10):1493-1501.<br />
62. Embree JE, Njenga S, Datta P, Nagelkerke NJ, Ndinya-Achola JO, Mohammed Z, et al. Risk<br />
factors for postnatal mother-child transmission of HIV-1. AIDS 2000;14(16):2535-2541.<br />
63. Nduati RW, John GC, Richardson BA, Overbaugh J, Welch M, Ndinya-Achola J, et al.<br />
Human immunodeficiency virus type 1-infected cells in breast milk: association with<br />
immunosuppression and vitamin A deficiency. J Infect Dis 1995;172(6):1461-1468.<br />
64. Semba RD, Miotti PG, Chiphangwi JD, Saah AJ, Canner JK, Dallabetta GA, et al. Maternal<br />
vitamin A deficiency and mother-to-child transmission of HIV-1. Lancet<br />
1994;343(8913):1593-1597.<br />
65. Fawzi WW, Msamanga GI, Hunter D, Renjifo B, Antelman G, Bang HJ, et al. Randomized<br />
trial of vitamin supp<strong>le</strong>ments in relation to transmission of HIV-1 through breastfeeding and<br />
early child mortality. AIDS 2002;16(14):1935-1944.<br />
66. Stewart GJ, Mbori-Ngacha D, Ekpini R, Janoff EN, Nkengasong J, Read J, et al. Breastfeeding<br />
and transmission of HIV-1. J Acq Immune Defic Syndr 2003;35(2):196-200.<br />
67. Kosel BW, Beckerman KP, Hayashi S, Homma M, Aweeka FT. Pharmacokinetics of<br />
nelfinavir and indinavir in HIV-1-infected pregnant women. AIDS 2003;17(8):1195-1199.
176<br />
68. Delfraissy JF. Grossesse. In: Prise en charge thérapeutiques des personnes infectées par <strong>le</strong><br />
VIH-1. Médecines-Sciences Flammarion, Paris ed; 2004. p. 185-202.<br />
69. Vyankandondera J, Luchters S, Hassnk E, Pakker F, Mmiro F, Okong P, et al. Reducing risk<br />
of HIV-1 transmission from mother to infant through breastfeeding using antiretroviral<br />
prophylaxis in infants (SIMBA). 2 nd IAS Conference on HIV Pathogenesis Treatment, July 13-<br />
16, 2003; Paris, France (abstract Lb7).<br />
70. Lal<strong>le</strong>mant M, Jourdain G, Le Coeur S, Mary JY, Ngo-Giang-Huong N, Koetsawang S, et al.<br />
Sing<strong>le</strong>-dose perinatal nevirapine plus standard zidovudine to prevent mother-to-child<br />
transmission of HIV-1 in Thailand. N Engl J Med 2004;351(3):217-28.<br />
71. Taha TE, Kumwenda NI, Hoover DR, Fiscus SA, Kafulafula G, Nkhoma C, et al. Nevirapine<br />
and zidovudine at birth to reduce perinatal transmission of HIV in an African setting: a<br />
randomized control<strong>le</strong>d trial. JAMA 2004;292(2):202-9.<br />
72. Lal<strong>le</strong>mant M, Jourdain G, Le Coeur S, Kim S, Koetsawang S, Comeau AM, et al. A trial of<br />
shortened zidovudine regimens to prevent mother-to-child transmission of human<br />
immunodeficiency virus type 1. Perinatal HIV Prevention Trial (Thailand) Investigators.<br />
N Engl J Med 2000;343(14):982-991.<br />
73. Jackson JB, Musoke P, F<strong>le</strong>ming T, Guay LA, Bagenda D, Al<strong>le</strong>n M, et al. Intrapartum and<br />
neonatal sing<strong>le</strong>-dose nevirapine compared with zidovudine for prevention of mother-to-child<br />
transmission of HIV-1 in Kampala, Uganda: 18-month follow-up of the HIVNET 012<br />
randomised trial. Lancet 2003;362(9387):859-868.<br />
74. Far<strong>le</strong>y T, Gaillard P, deVincenzi I, Osborne C, deZoysa I. Mother-to-child transmission of<br />
HIV-1 infection. Lancet 2002;360(9349):1974-1975.<br />
75. WHO. Antiretroviral drugs for treating pregnant women and preventing HIV infection in<br />
infants. Guidelines on care, treatment, and support for women living with HIV/AIDS and their<br />
children in resource-constrained settings. Geneva, WHO, 2004<br />
(http://www.who.int/reproductive-health/rtis/docs/arvdrugsguidelines.pdf, accessed 30<br />
October 2004).<br />
76. Gaillard P, Fow<strong>le</strong>r MG, Dabis F, Coovadia H, Van Der Horst C, Van Rompay K, et al. Use of<br />
antiretroviral drugs to prevent HIV-1 transmission through breast-feeding: from animal studies<br />
to randomized clinical trials. J Acquir Immune Defic Syndr 2004;35(2):178-187.<br />
77. Safrit J. HIV vaccines in infants and children: past trials, present plans and future perspectives.<br />
Curr Mol Med 2003;3:302-12.<br />
78. Safrit J, Ruprecht R, Ferrantelli F, Xu W, Kitabwalla M, Van Rompay K, et al.<br />
Immunoprophylaxis to prevent mother-to-child transmission of HIV-1. J Acquir Immune<br />
Defic Syndr 2004;35(2):169-177.<br />
79. Wiktor SZ, Ekpini E, Nduati RW. Prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 in<br />
Africa. AIDS 1997;11 Suppl B:S79-87.<br />
80. Ekpini RA, Nkengasong JN, Sibailly T, Maurice C, Adje C, Monga BB, et al. Changes in<br />
plasma HIV-1-RNA viral load and CD4 cell counts, and lack of zidovudine resistance among<br />
pregnant women receiving short-course zidovudine. AIDS 2002;16(4):625-30.
177<br />
81. Eastman PS, Shapiro DE, Coombs RW, Frenkel LM, McSherry GD, Britto P, et al. Maternal<br />
viral genotypic zidovudine resistance and infrequent failure of zidovudine therapy to prevent<br />
perinatal transmission of human immunodeficiency virus type 1 in pediatric AIDS Clinical<br />
Trials Group Protocol 076. J Infect Dis 1998;177(3):557-564.<br />
82. Esh<strong>le</strong>man SH, Mracna M, Guay LA, Deseyve M, Cunningham S, Mirochnick M, et al.<br />
Se<strong>le</strong>ction and fading of resistance mutations in women and infants receiving nevirapine to<br />
prevent HIV-1 vertical transmission (HIVNET 012). AIDS 2001;15(15):1951-7.<br />
83. Cunningham CK, Chaix ML, Rekacewicz C, Britto P, Rouzioux C, Gelber RD, et al.<br />
Development of resistance mutations in women receiving standard antiretroviral therapy who<br />
received intrapartum nevirapine to prevent perinatal human immunodeficiency virus type 1<br />
transmission: a substudy of pediatric AIDS clinical trials group protocol 316. J Infect Dis<br />
2002;186(2):181-8.<br />
84. Esh<strong>le</strong>man SH, Becker-Pergola G, Deseyve M, Guay LA, Mracna M, F<strong>le</strong>ming T, et al. Impact<br />
of human immunodeficiency virus type 1 (hiv-1) subtype on women receiving sing<strong>le</strong>-dose<br />
nevirapine prophylaxis to prevent hiv-1 vertical transmission (HIV network for prevention<br />
trials 012 study). J Infect Dis 2001;184(7):914-917.<br />
85. Beckerman KP. Long-term findings of HIVNET 012: the next steps. Lancet<br />
2003;362(9387):842-843.<br />
86. Morris L, Pillay C, Chezzi C, Lupondwana P, Ntsala M, Levin L, et al. Low frequency of the<br />
V106M mutation among HIV-1 subtype C-infected pregnant women exposed to nevirapine.<br />
AIDS 2003;17(11):1698-1700.<br />
87. Giuliano M, Palmisano L, Galluzzo CM, Amici R, Germinario E, Okong P, et al. Se<strong>le</strong>ction of<br />
resistance mutations in pregnant women receiving zidovudine and lamivudine to prevent HIV<br />
perinatal transmission. AIDS 2003;17(10):1570-1572.<br />
88. Biggar RJ, Miotti PG, Taha TE, Mtimavalye L, Broadhead R, Justesen A, et al. Perinatal<br />
intervention trial in Africa: effect of a birth canal c<strong>le</strong>ansing intervention to prevent HIV<br />
transmission. Lancet 1996;347(9016):1647-1650.<br />
89. Msellati P, Meda N, Leroy V, Likikouet R, Van de Perre P, Cartoux M, et al. Safety and<br />
acceptability of vaginal disinfection with benzalkonium chloride in HIV infected pregnant<br />
women in west Africa: ANRS 049b phase II randomized, doub<strong>le</strong> blinded placebo control<strong>le</strong>d<br />
trial. DITRAME Study Group. Sex Transm Infect 1999;75(6):420-425.<br />
90. Mandelbrot L, Msellati P, Meda N, Leroy V, Likikouet R, VandePerre P, et al. 15 Month<br />
follow up of African children following vaginal c<strong>le</strong>ansing with benzalkonium chloride of their<br />
HIV infected mothers during late pregnancy and delivery. Sex Transm Infect 2002;78(4):267-<br />
270.<br />
91. Gaillard P, Mwanyumba F, Verhofstede C, Claeys P, Chohan V, Goetghebeur E, et al. Vaginal<br />
lavage with chlorhexidine during labour to reduce mother-to-child HIV transmission: clinical<br />
trial in Mombasa, Kenya. AIDS 2001;15(3):389-96.<br />
92. Taha TE, Biggar RJ, Broadhead RL, Mtimavalye LA, Justesen AB, Liomba GN, et al. Effect<br />
of c<strong>le</strong>ansing the birth canal with antiseptic solution on maternal and newborn morbidity and<br />
mortality in Malawi: clinical trial. BMJ 1997;315(7102):216-219.<br />
93. Fawzi WW, Msamanga GI, Spiegelman D, Urassa EJ, Hunter DJ. Rationa<strong>le</strong> and design of the<br />
Tanzania Vitamin and HIV Infection Trial. Control Clin Trials 1999;20(1):75-90.
178<br />
94. Coutsoudis A, Pillay K, Spooner E, Kuhn L, Coovadia HM. Randomized trial testing the<br />
effect of vitamin A supp<strong>le</strong>mentation on pregnancy outcomes and early mother-to-child HIV-1<br />
transmission in Durban, South Africa. South African Vitamin A Study Group. AIDS<br />
1999;13(12):1517-1524.<br />
95. Fawzi WW, Msamanga G, Hunter D, Urassa E, Renjifo B, Mwakagi<strong>le</strong> D, et al. Randomized<br />
trial of vitamin supp<strong>le</strong>ments in relation to vertical transmission of HIV-1 in Tanzania. J<br />
Acquir Immune Defic Syndr 2000;23(3):246-254.<br />
96. Fawzi WW, Msamanga GI, Spiegelman D, Urassa EJ, McGrath N, Mwakagi<strong>le</strong> D, et al.<br />
Randomised trial of effects of vitamin supp<strong>le</strong>ments on pregnancy outcomes and T cell counts<br />
in HIV-1-infected women in Tanzania. Lancet 1998;351(9114):1477-1482.<br />
97. Jourdain G, Ngo-Giang-Huong N, Le Coeur S, Bowonwatanuwong C, Kantipong P,<br />
Leechanachai P, et al. Intrapartum exposure to nevirapine and subsequent maternal responses<br />
to nevirapine-based antiretroviral therapy. N Engl J Med 2004;351(3):229-240.<br />
98. Asamoah-Odei E, Garcia Cal<strong>le</strong>ja JM, Boerma JT. HIV preva<strong>le</strong>nce and trends in sub-Saharan<br />
Africa: no decline and large subregional differences. Lancet 2004;364(9428):35-40.<br />
99. World Medical Association. Helsinki declaration. 52nd WMA General Assembly, October<br />
2000 Edinburgh, Scotland (http://www.wma.net/e/policy/b3.htm, accessed 30 October 2004).<br />
100. Lynoe N, Hyder Z, Chowdhury M, Ekstrom L. Obtaining informed consent in Bangladesh.<br />
N Engl J Med 2001;344(6):460-461.<br />
101. Fitzgerald DW, Marotte C, Verdier RI, Johnson WD, Jr., Pape JW. Comprehension during<br />
informed consent in a <strong>le</strong>ss-developed country. Lancet 2002;360(9342):1301-1302.<br />
102. CoulibalyTraore D, Msellati P, Vidal L, Ekra CW, Dabis F. The understanding, by the women<br />
participating, of the princip<strong>le</strong>s of the Ditrame clinical study (ANRS 049) aimed at reducing the<br />
mother- child transmission of HIV in Abidjan. Presse Medica<strong>le</strong> 2003;32(8):343-350.<br />
103. Lynoe N, Sandlund M, Dahlqvist G, Jacobsson L. Informed consent: study of quality of<br />
information given to participants in a clinical trial. BMJ 1991;303(6803):610-613.<br />
104. Barre-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, et al. Isolation of<br />
a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome<br />
(AIDS). Science 1983;220(4599):868-871.<br />
105. Gallo RC, Sarin PS, Gelmann EP, Robert-Guroff M, Richardson E, Kalyanaraman VS, et al.<br />
Isolation of human T-cell <strong>le</strong>ukemia virus in acquired immune deficiency syndrome (AIDS).<br />
Science 1983;220(4599):865-867.<br />
106. Update: serologic testing for HIV-1 antibody--United States, 1988 and 1989. MMWR Morb<br />
Mortal Wkly Rep 1990;39(22):380-383.<br />
107. Centers for Disease Control. Update: serologic testing for HIV-1 antibody-United States, 1988<br />
and 1989. JAMA 1990;264(2):171-173.<br />
108. WHO/UNAIDS. The importance of simp<strong>le</strong>/rapid assays in HIV testing. WHO/UNAIDS<br />
recommendation. Weekly Epidemiological Record 1998;73:321-326.
179<br />
109. Weber B, Hess G, Enzensberger R, Harms F, Evans CJ, Hamann A, et al. Multicenter<br />
evaluation of the novel ABN Western blot (immunoblot) system in comparison with an<br />
enzyme-linked immunosorbent assay and a different Western blot. J Clin Microbiol<br />
1992;30(3):691-697.<br />
110. Mortimer PP. The fallibility of HIV Western blot. Lancet 1991;337(8736):286-287.<br />
111. Koblavi-Deme S, Maurice C, Yavo D, Sibailly TS, N'Guessan K, Kamelan-Tano Y, et al.<br />
Sensitivity and specificity of human immunodeficiency virus rapid serologic assays and<br />
testing algorithms in an antenatal clinic in Abidjan, Ivory Coast. J Clin Microbiol<br />
2001;39(5):1808-1812.<br />
112. Malonza IM, Richardson BA, Kreiss JK, Bwayo JJ, Stewart GCJ. The effect of rapid HIV-1<br />
testing on uptake of perinatal HIV-1 interventions: a randomized clinical trial. AIDS<br />
2003;17(1):113-118.<br />
113. Ki<strong>le</strong>wo C, Massawe A, Lyamuya E, Semali I, Kalokola F, Urassa E, et al. HIV counseling and<br />
testing of pregnant women in sub-Saharan Africa: experiences from a study on prevention of<br />
mother-to-child HIV-1 transmission in Dar es Salaam, Tanzania. J Acquir Immune Defic<br />
Syndr 2001;28(5):458-462.<br />
114. Meda N, Leroy V, Viho I, Msellati P, Yaro S, Mandelbrot L, et al. Field acceptability and<br />
effectiveness of the routine utilization of zidovudine to reduce mother-to-child transmission of<br />
HIV-1 in West Africa. AIDS 2002;16(17):2323-2328.<br />
115. Temmerman M, Quaghebeur A, Mwanyumba F, Mandaliya K. Mother-to-child HIV<br />
transmission in resource poor settings: how to improve coverage AIDS 2003;17(8):1239-42.<br />
116. Sylla-Koko F, Anglaret X, Traoré-Anaky M. Seropreva<strong>le</strong>nce de l'infection <strong>à</strong> VIH dans <strong>le</strong>s<br />
consultations prénata<strong>le</strong>s d'Abidjan, Côte d'Ivoire, 1995. Med Mal Infect 1997;27:127-28.<br />
117. Ekouevi DK, Leroy V, Viho A, Bequet L, Horo A, Rouet F, et al. Acceptability and uptake of<br />
a package to prevent mother-to-child transmission using rapid HIV testing in Abidjan, Cote<br />
d'Ivoire. AIDS 2004;18(4):697-700.<br />
118. Méda N, Leroy V, Viho I, Msellati P, Yaro S, Mandelbrot L, et al. Acceptability and field<br />
efficacy of a routine utilisation of zidovudine to reduce mother-to-child transmission of HIV-1<br />
in West Africa. AIDS 2002;16(17):2323-2328.<br />
119. WHO. Prevention of mother-to-child transmission of HIV. Use of Nevirapine among women<br />
of unknown serostatus. Geneva, WHO,2001. Technical Report.<br />
(http://www.who.int/hiv/pub/mtct/en/isbn9241562129.pdf, accessed 30 October 2004)<br />
120. Diaby L, Boni-Ouattara E, Roels T, Maurice C, Nkengasong J, Kouassi M, et al. The<br />
evaluation of a mother-infant HIV prevention program that includes an HIV rapid-test<br />
algorithm and free replacement feeding: RETRO-CI experience in Abidjan, Côte d'Ivoire. 13th<br />
International Conference on AIDS & STIs in Africa. December 9-13, 2001; Ouagadougou,<br />
Burkina-Faso; 2001(abstract xxx).<br />
121. Saman M, Kruy LS, Glaziou P, Rekacewicz C, Leng C, Min DC, et al. Feasibility of antenatal<br />
and late HIV testing in pregnant women in Phnom Penh Cambodia: the<br />
PERIKAM/ANRS1205 study. AIDS 2002;16(6):950-1.
180<br />
122. Gaillard P, Melis R, Mwanyumba F, Claeys P, Muigai E, Mandaliya K, et al. Vulnerability of<br />
women in an African setting: <strong>le</strong>ssons for mother-to-child HIV transmission prevention<br />
programmes. AIDS 2002;16(6):937-9.<br />
123. Kanshana S, Simonds RJ. National program for preventing mother-child HIV transmission in<br />
Thailand: successful imp<strong>le</strong>mentation and <strong>le</strong>ssons <strong>le</strong>arned. AIDS 2002;16(7):953-959.<br />
124. Pockok S. Clinical trials: a pratical approach. New-York: John Wi<strong>le</strong>y & Sons; 266 pages,<br />
1983.<br />
125. WHO. Integration of vitamine A supp<strong>le</strong>mentation in immunization. Wkly Epidemiol Rec<br />
1999;74:1-6.<br />
126. Alioum A, Dabis F, Dequae-Merchadou L, Haverkamp G, Hudgens M, Hughes J, et al.<br />
Estimating the efficacy of interventions to prevent mother-to-child transmission of HIV in<br />
breast-feeding populations: development of a consensus methodology. Stat Med<br />
2001;20(23):3539-56.<br />
127. Lawlor D, Davey-Smith G, Bruckdorfer K, Kundu D, Ebrahim S. Those confounded<br />
vitamins:what can we <strong>le</strong>arn from the differences between observational versus randomised<br />
trial evidence Lancet 2004;363:1724-1727.<br />
128. Vandenbroucke J. When are observational studies as credib<strong>le</strong> as randomised trials Lancet<br />
2004;363:1728-1731.<br />
129. Concato J, Horwitz R. Beyond randomised versus observational studies. Lancet<br />
2004;363:1660-1661.<br />
130. Schinazi RF. Resistance Tab<strong>le</strong>: Mutations in retroviral genes associated with drug resistance:<br />
2000-2001 update. International Antiviral News 2000;8.<br />
131. Havlir DV, Eastman S, Gamst A, Richman DD. Nevirapine-resistant human<br />
immunodeficiency virus: kinetics of replication and estimated preva<strong>le</strong>nce in untreated patients.<br />
J Virol 1996;70(11):7894-9.<br />
132. Molla A, Korneyeva M, Gao Q, Vasavanonda S, Schipper PJ, Mo HM, et al. Ordered<br />
accumulation of mutations in HIV protease confers resistance to ritonavir. Nat Med<br />
1996;2(7):760-766.<br />
133. Bache<strong>le</strong>r LT, Anton ED, Kudish P, Baker D, Bunvil<strong>le</strong> J, Krakowski K, et al. Human<br />
immunodeficiency virus type 1 mutations se<strong>le</strong>cted in patients failing efavirenz combination<br />
therapy. Antimicrob Agents Chemother 2000;44(9):2475-2484.<br />
134. Richman DD, Havlir D, Corbeil J, Looney D, Ignacio C, Spector SA, et al. Nevirapine<br />
resistance mutations of human immunodeficiency virus type 1 se<strong>le</strong>cted during therapy. J Virol<br />
1994;68(3):1660-1666.<br />
135. Hirsch MS, Brun-Vezinet F, Clotet B, Conway B, Kuritzkes DR, D'Aquila RT, et al.<br />
Antiretroviral drug resistance testing in adults infected with human immunodeficiency virus<br />
type 1: 2003 recommendations of an International AIDS Society-USA Panel. Clin Infect Dis<br />
2003;37(1):113-128.<br />
136. Mil<strong>le</strong>r V. Interpretation of resistance assay results. Antivir Ther 2001;6 Suppl 2:1-9.
181<br />
137. Martinson N, Morris L, Gray G, Mood<strong>le</strong>y D, Lupondwana P, Chezzi C, et al. HIV Resistance<br />
and Transmission following Sing<strong>le</strong>-dose Nevirapine in a PMTCT Cohort. 11 th Conference on<br />
Retroviruses and Opportunistic Infection; February 8-11, 2004; San Francisco, USA (abstract<br />
38)<br />
138. Delfraissy JF. Prise en charge thérapeutique des personnes infectées par <strong>le</strong> VIH. Médecine-<br />
Science Flammarion ed. Paris; 2004.<br />
139. Chaix M, Montcho C, Ekouevi D, Rouet F, Bequet L, Viho I, et al. Genotypic Resistance<br />
Analysis in Women Who Received Intrapartum Nevirapine Associated to a Short Course of<br />
Zidovudine to Prevent Perinatal HIV-1 Transmission: The Ditrame Plus ANRS 1201/02<br />
Study, Abidjan, Côte d'Ivoire. 11 th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infection;<br />
February 8-11, 2004; San Francisco, USA (abstract 657).<br />
140. Jackson JB, Becker-Pergola G, Guay LA, Musoke P, Mracna M, Fow<strong>le</strong>r MG, et al.<br />
Identification of the K103N resistance mutation in Ugandan women receiving nevirapine to<br />
prevent HIV-1 vertical transmission. AIDS 2000;14(11):F111-F115.<br />
141. Adje-Toure C, Bi<strong>le</strong> CE, Borget MY, Hertog K, Maurice C, Nolan ML, et al. Polymorphism in<br />
protease and reverse transcriptase and phenotypic drug resistance of HIV-1 recombinant<br />
CRF02_AG isolates from patients with no prior use of antiretroviral drugs in Abidjan, Cote<br />
d'Ivoire. J Acquir Immune Defic Syndr 2003;34(1):111-113.<br />
142. Bonard D, Rouet F, Toni TA, Minga A, Huet C, Ekouevi DK, et al. Field evaluation of an<br />
improved assay using a heat-dissociated p24 antigen for adults mainly infected with HIV-1<br />
CRF02_AG strains in Cote d'Ivoire, West Africa. J Acquir Immune Defic Syndr<br />
2003;34(3):267-273.<br />
143. Sawadogo S, Adje-Toure C, Bi<strong>le</strong> CE, Ekpini RE, Chorba T, Nkengasong JN. Field evaluation<br />
of the gag-based heterodup<strong>le</strong>x mobility assay for genetic subtyping of circulating recombinant<br />
forms of human immunodeficiency virus type 1 in Abidjan, Cote d'Ivoire. J Clin Microbiol<br />
2003;41(7):3056-3059.<br />
144. Toni TD, Recordon-Pinson P, Minga A, Ekouevi D, Bonard D, Bequet L, et al. Presence of<br />
key drug resistance mutations in isolates from untreated patients of Abidjan, Cote d'Ivoire:<br />
ANRS 1257 study. AIDS Res Hum Retroviruses 2003;19(8):713-717.<br />
145. Chaix ML, Descamps D, Harzic M, Schneider V, Deveau C, Tama<strong>le</strong>t C, et al. Stab<strong>le</strong><br />
preva<strong>le</strong>nce of genotypic drug resistance mutations but increase in non-B virus among patients<br />
with primary HIV-1 infection in France. AIDS 2003;17(18):2635-2643.<br />
146. Masquelier B, Race E, Tama<strong>le</strong>t C, Descamps D, Izopet J, Buffet-Janvresse C, et al. Genotypic<br />
and phenotypic resistance patterns of human immunodeficiency virus type 1 variants with<br />
insertions or de<strong>le</strong>tions in the reverse transcriptase (RT): multicenter study of patients treated<br />
with RT inhibitors. Antimicrob Agents Chemother 2001;45(6):1836-1842.<br />
147. Blanche S, Tardieu M, Rustin P, Slama A, Barret B, Firtion G, et al. Persistent mitochondrial<br />
dysfunction and perinatal exposure to antiretroviral nuc<strong>le</strong>oside analogues. Lancet<br />
1999;354(9184):1084-1089.<br />
148. Barret B, Tardieu M, Rustin P, Lacroix C, Chabrol B, Desguerre I, et al. Persistent<br />
mitochondrial dysfunction in HIV-1-exposed but uninfected infants: clinical screening in a<br />
large prospective cohort. AIDS 2003;17(12):1769-1785.
182<br />
149. Brinkman K. Editorial response: hyperlactatemia and hepatic steatosis as features of<br />
mitochondrial toxicity of nuc<strong>le</strong>oside analogue reverse transcriptase inhibitors. Clin Infect Dis<br />
2000;31(1):167-169.<br />
150. Alimenti A, Burdge DR, Ogilvie GS, Money DM, Forbes JC. Lactic acidemia in human<br />
immunodeficiency virus-uninfected infants exposed to perinatal antiretroviral therapy. Pediatr<br />
Infect Dis J 2003;22(9):782-789.<br />
151. Giaquinto C, Torresan S, Rampon O, Ruga E, Fregonese F, Eseme Esoka F, et al. Lactic acid<br />
in infants perinatally exposed to antiretrovirals. XIV international AIDS Conference. 7-12 July<br />
2002; Barcelona, Spain (abstract WePeB5940).<br />
152. Rouet F, Coulibaly N, Ekouevi D, Chaix M, Burgard M, Bequet L, et al. Real-time PCR<br />
technology developed for the detection of HIV-1 RNA and HIV-2 DNA permits an<br />
inexpensive and early diagnosis of HIV infection in African neonates from Côte d'Ivoire. The<br />
13th International Conference on AIDS & STIs in Africa. September 2003; Nairobi, Kenya.<br />
(abstract 879186).<br />
153. Rouet F, Coulibaly N, Ekouevi D, Chaix M, Burgard M, Bequet L, et al. Real-time PCR<br />
technology developed for the detection of HIV-1 RNA and HIV-2 DNA permits an<br />
inexpensive and early diagnosis of HIV infection in African neonates from Côte d'Ivoire. The<br />
2nd IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment.13-16 July 2003; Paris, France;<br />
(abstract 277). Antiviral Therapy 2003; 8 (Suppl1):S252.<br />
154. Noguera A, Perez-Duenas B, Tello L, Artuch R, Garcia-Fructuoso M, Munoz M. Lactic<br />
acidosis in newborns exposed to HIV and antiretrovirals.. XIV International AIDS<br />
Conference. 7-12 July 2002; Barcelona, Spain; (abstract WePeB5951)<br />
155. Cote HC, Brumme ZL, Craib KJ, A<strong>le</strong>xander CS, Wynhoven B, Ting L, et al. Changes in<br />
mitochondrial DNA as a marker of nuc<strong>le</strong>oside toxicity in HIV-infected patients. N Engl J<br />
Med 2002;346(11):811-20.<br />
156. Piot P. Peter Piot-executive director of UNAIDS. Interview by Pam Das. Lancet Infect Dis<br />
2003;3(12):809-13.<br />
157. Med<strong>le</strong>y A, Garcia-Moreno C, McGill S, Maman S. Rates, barriers and outcomes of HIV<br />
serostatus diclosure among women in developing countries: implications for prevention of<br />
mother-to-child transmission programmes. Bull World Health Organ 2004;82(4):299-307.<br />
158. De Cock KM, Mbori-Ngacha D, Marum E. Aids in Africa V: Shadow on the continent: public<br />
health and HIV/AIDS in Africa in the 21st century. Lancet 2002;360(9326):67-72.<br />
159. Cartoux M, Meda N, Van de Perre P, Newell ML, de Vincenzi I, Dabis F. Acceptability of<br />
voluntary HIV testing by pregnant women in developing countries: an international survey.<br />
Ghent International Working Group on Mother-to-Child Transmission of HIV. AIDS 1998;<br />
12(18):2489-93.<br />
160. Cartoux M, Msellati P, Meda N, Welffens-Ekra C, Mandelbrot L, Leroy V, et al. Attitude of<br />
pregnant women towards HIV testing in Abidjan, Cote d'Ivoire and Bobo-Dioulasso, Burkina<br />
Faso. DITRAME Study Group (ANRS 049 Clinical Trial). Diminution de la Transmission<br />
Mere Enfant du VIH. Agence Nationa<strong>le</strong> de Recherches sur <strong>le</strong> SIDA. AIDS 1998;12(17):2337-<br />
44.<br />
161. Walms<strong>le</strong>y S. Opt in or opt out: What is optimal for prenatal screening for HIV infection Can<br />
Med Assoc J 2003;168(6):707-708.
183<br />
162. Mossman CL, Ratnam S. Opt-out prenatal HIV testing in Newfoundland and Labrador. Can<br />
Med Assoc J 2002;167(6):630.<br />
163. Jayaraman GC, Preiksaitis JK, Larke B. Mandatory reporting of HIV infection and opt-out<br />
prenatal screening for HIV infection: effect on testing rates. Can Med Assoc J 2003 ;<br />
168(6):679-682.<br />
164. Csete J, Sch<strong>le</strong>ifer R, Cohen J. "Opt-out" testing for HIV in Africa: a caution. Lancet 2004;<br />
363(9407):493-494.<br />
165. Esh<strong>le</strong>man SH, Jackson JB. Nevirapine resistance after sing<strong>le</strong> dose prophylaxis. AIDS Rev<br />
2002;4(2):59-63.<br />
166. Esh<strong>le</strong>man SH, Krogstad P, Jackson JB, Wang YG, Lee S, Wei LJ, et al. Analysis of human<br />
immunodeficiency virus type 1 drug resistance in children receiving nuc<strong>le</strong>oside analogue<br />
reverse-transcriptase inhibitors plus nevirapine, nelfinavir, or ritonavir (Pediatric AIDS<br />
Clinical Trials Group 377). J Infect Dis 2001;183(12):1732-1738.<br />
167. Sinkala M, Stout JP, Vermund SH, Goldenberg RL, Stringer JS. Zambian women's attitudes<br />
toward mass nevirapine therapy to prevent perinatal transmission of HIV. Lancet<br />
2001;358(9293):1611-2.<br />
168. Stringer JS, Sinkala M, Goldenberg RL, Kumwenda R, Acosta EP, Aldrovandi GM, et al.<br />
Universal nevirapine upon presentation in labor to prevent mother-to-child HIV transmission<br />
in high preva<strong>le</strong>nce settings. AIDS 2004;18(6):939-943.<br />
169. Bulterys M, Jamieson DJ, OSullivan MJ, Cohen MH, Maupin R, Nesheim S, et al. Rapid HIV-<br />
1 testing during labor - A multicenter study. JAMA 2004;292(2):219-223.<br />
170. Horo A, Bequet L, Viho I, et al. Know<strong>le</strong>dge and attitudes about HIV infection amongst health<br />
professionals working in prevention of mother-to-child transmission of HIV. Abidjan, Cote<br />
d'Ivoire. [10BT5-2]. 12 th International Conference on AIDS and STDs in Africa; December 9-<br />
13, 2001; Ouagadougou, Burkina-Faso; (abstract 10BT5-2).<br />
171. Patel SM, Johnson S, Belknap SM, Chan J, Sha BE, Bennett C. Serious adverse cutaneous and<br />
hepatic toxicities associated with nevirapine use by non-HIV-infected individuals. J Acquir<br />
Immune Defic Syndr 2004;35(2):120-125.<br />
172. Baylor MS, Johann-Liang R. Hepatotoxicity associated with nevirapine use. J Acquir<br />
Immune Defic Syndr 2004;35(5):538-539.<br />
173. Miotti PG, Liomba G, Dallabetta GA, Hoover DR, Chiphangwi JD, Saah AJ. T lymphocyte<br />
subsets during and after pregnancy: analysis in human immunodeficiency virus type 1-infected<br />
and -uninfected Malawian mothers. J Infect Dis 1992;165(6):1116-1119.<br />
174. Fow<strong>le</strong>r MG, Moorman A, Tong TC, Holmberg S, Greenberg AE. Does prior short-course<br />
nevirapine reduce the effectiveness of subsequent combination treatment with efavirenz<br />
J Acquir Immune Defic Syndr 2003;34(3):348-350.<br />
175. Tonwe-Gold B, Ekouevi D, Viho I, Toure S, Koné M, Ehouo B, et al. Where are the men<br />
Involvement of ma<strong>le</strong> partners in a family centred care program in Abidjan, Côte d'Ivoire. In:<br />
XV international AIDS Conference, July 11-16, 2004; Bangkok, Thailand. (abstract<br />
ThPeD7834).
184<br />
176. Van Rompay KK, Brignolo LL, Meyer DJ, Jerome C, Tarara R, Spinner A, et al. Biological<br />
effects of short-term or prolonged administration of 9-[2-(phosphonomethoxy)propyl]adenine<br />
(tenofovir) to newborn and infant rhesus macaques. Antimicrob Agents Chemother<br />
2004;48(5):1469-1487.<br />
177. Van Rompay KK, Schmidt KA, Lawson JR, Singh R, Bischofberger N, Marthas ML. Topical<br />
administration of low-dose tenofovir disoproxil fumarate to protect infant macaques against<br />
multip<strong>le</strong> oral exposures of low doses of simian immunodeficiency virus. J Infect Dis<br />
2002;186(10):1508-1513.<br />
178. Van Rompay KK, McChesney MB, Aguirre NL, Schmidt KA, Bischofberger N, Marthas ML.<br />
Two low doses of tenofovir protect newborn macaques against oral simian immunodeficiency<br />
virus infection. J Infect Dis 2001;184(4):429-438.<br />
179. Dabis F, E<strong>le</strong>nga N, Méda N, Leroy V, Viho I, Manigart O, et al. 18-month mortality and<br />
perinatal exposure to zidovudine in West Africa. AIDS 2001;15:771-779.<br />
180. Fow<strong>le</strong>r M, Mwatha A, Guay L, Musoke P, Mmiro F, F<strong>le</strong>mming T, et al. Effect of Nevirapine<br />
(NVP) for perinatal HIV. Prevention appears greatest among women with most advanced<br />
disease. Sub group analyses of HIVNET 012. In: 9th Conference on Retroviruses and<br />
Opportunistic Infection; February 8-11, 2002; Seatt<strong>le</strong>, USA (abstract 120).<br />
181. Coutsoudis A, Pillay K, Spooner E, Coovadia HM, Pembrey L, Newell ML. Morbidity in<br />
children born to women infected with human immunodeficiency virus in South Africa: does<br />
mode of feeding matter Acta Paediat 2003;92(8):890-895.<br />
182. Coutsoudis A, Pillay K, Spooner E, Kuhn L, Coovadia HM. Influence of infant-feeding<br />
patterns on early mother-to-child transmission of HIV-1 in Durban, South Africa: a<br />
prospective cohort study. South African Vitamin A Study Group. Lancet 1999;354(9177):471-<br />
476.<br />
183. Dabis F, Leroy V, Castetbon K, Spira R, Newell ML, Salamon R. Preventing mother-to-child<br />
transmission of HIV-1 in Africa in the year 2000. AIDS 2000;14(8):1017-1026.<br />
184. Stringer JS, Rouse DJ, Vermund SH, Goldenberg RL, Sinkala M, Stinnett AA. Cost-effective<br />
use of nevirapine to prevent vertical HIV transmission in sub-Saharan Africa. J Acquir<br />
Immune Defic Syndr 2000;24(4):369-377.<br />
185. Scotland GS, vanTeijlingen ER, vanderPol M, Smith WCS. A review of studies assessing the<br />
costs and consequences of interventions to reduce mother-to-child HIV transmission in sub-<br />
Saharan Africa. AIDS 2003;17(7):1045-1052.<br />
186. Newell ML, Dabis F, Tol<strong>le</strong>y K, Whynes D. Cost-effectiveness and cost-benefit in the<br />
prevention of mother-to-child transmission of HIV in developing countries. Ghent<br />
International Working Group on Mother-to-Child Transmission of HIV. AIDS<br />
1998;12(13):1571-1780.<br />
187. Mansergh G, Haddix AC, Steketee RW, Simonds RJ. Cost-effectiveness of zidovudine to<br />
prevent mother-to-child transmission of HIV in sub-Saharan Africa. JAMA 1998;280(1):30-<br />
31.<br />
188. Marseil<strong>le</strong> E, Hofmann PB, Kahn JG. HIV prevention before HAART in sub-Saharan Africa.<br />
Lancet 2002;359(9320):1851-1856.<br />
189. Creese A, Floyd K, Alban A, Guinness L. Cost-effectiveness of HIV/AIDS interventions in<br />
Africa: a systematic review of the evidence. Lancet 2002;359(9318):1635-1643.
185<br />
190. Newell ML, Coovadia H, Cortina Borja M, Rollins N, Gaillard P, Dabis F. Mortality of<br />
infected and uninfected infants born to HIV-infected mothers in Africa: a poo<strong>le</strong>d analysis.<br />
Lancet 2004;364(9441):1236-1243.<br />
191. Abrams EJ, El Sadr W, Rabkin M, Hoos D, Berkman A, Myer L, et al. Antiretroviral therapy<br />
in low resources countries determining treatment regimens for adults, pregnant women and<br />
children in the MTCT-Plus initiative. XV International AIDS Conference; July 11-16, 2004;<br />
Bangkok, Thailand (abstract ThPeB7152).<br />
192. El Sadr W, Rabkin M, Abrams EJ, Hoos D, Berkman A, Myer L, et al. Successfull enrollment<br />
of families with HIV disease in the MTCT-Plus initiative. XV International AIDS Conference;<br />
July 11-16, 2004; Bangkok, Thailand (abstract ThPeB7061)
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES<br />
(Année 2001-2004)<br />
186
187<br />
Artic<strong>le</strong>s scientifiques<br />
• Dabis F, Bequet L, Ekouévi DK, Viho I, Rouet F, Horo A, Sakarovitch C, Becquet R,<br />
Fassinou P, Dequae-Merchadou L, Welffens-Ekra C, Rouzioux C, Leroy V for the,<br />
ANRS 1201 Ditrame Plus Study Group. Effectiveness of short course combinations of<br />
Zidovudine, Lamivudine and sing<strong>le</strong>-dose Nevirapine to prevent peripartum transmission<br />
of HIV. The ANRS 1201 Ditrame Plus Study, Abidjan, Côte d'Ivoire (AIDS 2004 In<br />
Press).<br />
• Viho I, Ekouévi DK, Bequet L, Catestbon K, Horo A, Dabis F, Leroy V pour <strong>le</strong> groupe<br />
d’étude Ditrame Plus ANRS 1201. Comportements de santé des femmes consultant en<br />
protection maternel<strong>le</strong> et infanti<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s formations sanitaires d'Abidjan, Côte<br />
d’Ivoire. Gynecol Obstet Fertil 2004; 32:409-413.<br />
• Rouet F, Ekouévi DK, Inwo<strong>le</strong>y A, Chaix ML, Burgard M, Bequet L, Viho I, Leroy V,<br />
Simon F, Dabis F, Rouzioux C. Field Evaluation of a Rapid HIV Serial Serologic<br />
Testing Algorithm for the Diagnosis and Differentiation of HIV-1, HIV-2 and HIV-1+2<br />
Dual Infections in West-African Pregnant Women. J Clin Microbiol 2004;29:4147-<br />
4153.<br />
• Ekouevi DK, Becquet R, Viho I, Bequet L, Dabis F, Leroy V. Obtaining informed<br />
consent from HIV infected pregnant women, Abidjan, Côte d’Ivoire. AIDS 2004;<br />
18:1486-1488.<br />
• Ekouévi DK, Rouet F, Bequet R, Inwo<strong>le</strong>y A, Becquet R, Viho I, Towne-Gold B, Leroy<br />
V and Dabis F for the ANRS 1201 Ditrame Plus Study Group. Immune status of HIV-1<br />
infected pregnant women and uptake of a package to prevent mother-to child<br />
transmission. JAIDS 2004; 36:755-757.<br />
• Ekouevi DK, Leroy V, Viho I, Bequet L. Rouet F, Sakarovitch F and Dabis F.<br />
Acceptability and uptake of a package to prevent mother-to-child transmission<br />
(PMTCT) using rapid HIV testing in Abidjan, Côte d'Ivoire. AIDS 2004; 18:697-700.<br />
Communications ora<strong>le</strong>s personnel<strong>le</strong>s<br />
• Ekouévi DK et al. Hyperlactatemia in neonates exposed peripartum to a short course of<br />
antiretrovirals to prevent mother-to-child transmission of HIV (PMTCT): the ANRS<br />
1209 study, Abidjan, Côte d'Ivoire. 2nd IAS Conference on HIV pathogenesis and<br />
treatment, Paris, France. July 2003 (Abstract 664).<br />
• Ekouévi DK. Prévention de la transmission du VIH-1 de la mère <strong>à</strong> l’enfant : Les<br />
avancées et <strong>le</strong>s obstac<strong>le</strong>s. Convention Nationa<strong>le</strong> de Sidaction. Hôtel de vil<strong>le</strong> de Paris, 11<br />
mars 2004.
188<br />
Conférence : Projet Ditrame Plus (Communication ora<strong>le</strong> et Poster)<br />
XV International AIDS Conference 2004: Bangkok, Thaïlande, 11-16 July 2004<br />
• Becquet R, Viho I, Ekouévi DK, Sakarovitch C, Goulheon Z, Kouadio S, Dabis F,<br />
Bequet L, Timite-Konan M, Leroy V. Uptake and determinants of exclusive<br />
breastfeeding with early cessation to prevent HIV-1 transmission through breastmilk.<br />
ANRS 1201/1202 Ditrame Plus project, Abidjan, Côte d'Ivoire (Abstract ThPeB7067).<br />
• Becquet R, Bequet L, Ekouévi DK, Sakarovitch C, Tonwe-Gold B, Viho I, Dabis F,<br />
Leroy V. Know<strong>le</strong>dge, attitudes and beliefs of health-care workers regarding alternatives<br />
to prolonged and predominant breastfeeding within a PMTCT project. ANRS<br />
1201/1202 Ditrame Plus project, Abidjan, Côte d'Ivoire (Abstract ThPeC7294).<br />
• Touré H, Ekouévi DK, Becquet R, Bequet L, Towne-Gold B, Rouet F, Viho I, Allou G,<br />
Horo A, Leroy V, Welfens-Ekra C. and Dabis F. for the ANRS 1201/1202 Ditrame Plus<br />
Study Group. Mortality and transmission of HIV-1 infection in twins pairs and trip<strong>le</strong>ts<br />
in Abidjan, Côte d’Ivoire (Abstract ThPe6941).<br />
• Tonwe-Gold B, Ekouévi DK,Viho I, Toure S, Kone M, Ehouo B, Bequet L, Sihe A,<br />
Leroy V, Dabis F, Abrams EJ, and the ANRS Ditrame Plus Study Group, ACONDA-<br />
VS Cote d’Ivoire and the MTCT-Plus Initiative. Where are the men Involvement of<br />
ma<strong>le</strong> partners in a family centred care program in Abidjan, Côte d’Ivoire (Abstract<br />
ThPeD7834).<br />
• Ekouévi DK, Touré R, Bequet L, Rouet F, Viho I, Towne-Gold B, Touré H, Becquet R,<br />
Leroy V, Blanche S and Dabis F for the ANRS Ditrame Plus Study Group.<br />
Hyperlactatemia in neonates exposed peripartum to a short course of antiretrovirals to<br />
prevent mother-to-child transmission of HIV (PMTCT): the ANRS 1209 study.<br />
Abidjan, Côte d’Ivoire (Abstract ThPeC7292).<br />
• Leroy V, Becquet R, Rouet F, Ekouévi DK, Viho I, Bequet L, Sakarovitch C, Towne-<br />
Gold B, Timite-Konan M, and Dabis F for the Ditrame Plus ANRS 1201/1202 Study<br />
Group. Posnatal transmission risk according to feeding modalities in children born to<br />
HIV-infected mothers in a PMTCT project in Abidjan, Côte d’Ivoire. Ditrame Plus<br />
ANRS 1201/1202 (Abstract MoPpB2007).<br />
• Bequet L, Becquet R, Ekouévi DK, Tijou A, Kouadio S, Tonwe-Gold B, Viho I.,<br />
Desgrees du Lou A, Dabis F.and Leroy V.1 for the Ditrame Plus ANRS 1201/1202<br />
Study Group. Two-year follow-up in a Prevention of Mother-To-Child Transmission<br />
(PMTCT) project: The women’s point of view in the Ditrame Plus Project, ANRS<br />
1201/1202, Abidjan, Côte d’Ivoire (Abstract ThPeB7067).<br />
13 th International HIV Drug ResistanceWorkshop, Tenerife, Canary Islands, Spain 8-12 June<br />
2004<br />
• Chaix ML, Ekouévi DK, Peytavin G, Rouet F, Bequet L, Montcho C, Viho I, Fassinou P,<br />
Leroy V, Dabis F, Rouzioux C and the Ditrame Plus Study Group. Persistance of NVPresistant<br />
virus and pharmacokinetic analysis in Women who Received Intrapartum<br />
Nevirapine (NVP) Associated to a Short Course of Zidovudine (ZDV) to Prevent<br />
Perinatal HIV-1 Transmission: The Ditrame Plus ANRS 1201/02 Study, Abidjan, Côte<br />
d'Ivoire (Abstract 160). Antiviral Therapy 2004; 9:S176.
189<br />
XI Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections. San Francisco, USA.<br />
Chaix ML, Montcho C, Ekouévi DK, Rouet F, Bequet L, Viho I, Fassinou P,. Welfens-<br />
Ekra C, Leroy V, Dabis F, Rouzioux C. Genotypic Resistance Analysis in Women who<br />
received Intrapartum Nevirapine (NVP) Associated to a Short Course of Zidovudine<br />
(ZDV) to Prevent Perinatal HIV-1 Transmission: The Ditrame Plus ANRS 1201/02 Study,<br />
Abidjan, Côte d’Ivoire (Abstract 657).<br />
XIII International Conference on AIDS & STIs in Africa. Nairobi, Kenya. September 2003<br />
• Dabis F, Ekouévi DK, Bequet L, Rouet F, Viho I . , Horo A, Fassinou P, Touré H,<br />
Welfens-Ekra C, Becquet R and Leroy V for the ANRS Ditrame Plus Study<br />
Group.Effectiveness of a short course of Zidovudine + Lamivudine boosted peripartum<br />
by Nevirapine to prevent HIV-1 Mother-to-Child Transmission. The ANRS 1201<br />
DITRAME-Plus Trial, Abidjan, Côte d’Ivoire (Abstract Lboa1098876).<br />
• Viho I, Rouet F, A Inwo<strong>le</strong>y, Ekouévi DK et al. Severe early immunodepression in<br />
African HIV-1-infected children as compared to uninfected children (Abstract 237456).<br />
• Rouet F, Coulibaly N, Ekouévi DK et al. Real-time PCR technology developed for the<br />
detection of HIV-1 RNA and HIV-2 DNA permits an inexpensive and early diagnosis of<br />
HIV infection in African neonates from Côte d'Ivoire (Abstract 879186).<br />
• Brou H. Zady G., Zanou B, Ekouevi DK, et al. Protection of sexual intercourse and<br />
contraceptive use after HIV testing: comparison between HIV+ and HIV- women. ANRS<br />
1253, Ditrame Plus Project, 2001-2002, Abidjan, Cote d'Ivoire (Abstract 801339).<br />
2 nd IAS Conference on HIV Pathogenesis and Treatment. Paris, France July 2003.<br />
• Dabis F, Ekouévi DK, et al. Effectiveness of a short course of Zidovudine + Lamivudine<br />
and Peripartum Nevirapine to prevent HIV-1 Mother-to-Child Transmission. The ANRS<br />
1201 Ditrame Plus Trial, Abidjan, Côte d'Ivoire (Abstract 2119). Antiviral Therapy 2003,<br />
Suppl1:S236-S237.<br />
• Becquet R, Bequet L, Ekouevi DK et al. Mortality in breastfed and formula-fed children<br />
born to HIV-infected women in a PMTCT project in Abidjan (Côte d'Ivoire): Ditrame<br />
Plus ANRS 1202 (Abstract 2490). Antiviral Therapy 2003, Suppl1:S200.<br />
• Toni TD., Recordon-Pinson P, Minga A, Ekouévi, DK.et al. Presence of key resistance<br />
mutations in CRF02_AG Recombinant strains of untreated HIV-infected patients from<br />
Abidjan, Côte d'Ivoire (Abstract 781). Antiviral Therapy 2003, Suppl1:S402-S403.<br />
• Viho I, Rouet F, Inwo<strong>le</strong>y A, Ekouévi DK et al. Severe early immunodepression in<br />
African HIV-1-infected children as compared to uninfected children (Abstract 376).<br />
Antiviral Therapy 2003, Suppl1:S280.<br />
• Montcho C, Rouet F, Ekouévi DK et al. Field use of plasma HIV-1 RNA real-time PCR<br />
assay for inexpensive and early diagnosis of pediatric HIV-1 infection in African neonates<br />
from Côte d'Ivoire, West Africa (Abstract 1032). Antiviral Therapy 2003, Suppl1:S476.
190<br />
• Rouet F, Coulibaly N, Ekouévi DK et al. Real-time PCR technology developed for the<br />
detection of HIV-1 RNA and HIV-2 DNA permits an inexpensive and early diagnosis of<br />
HIV infection in African neonates from Côte d'Ivoire (Abstract 277). Antiviral Therapy<br />
2003, Suppl1:S252.<br />
X Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections BOSTON, Massachussets, USA, 10-<br />
14 February 2003.<br />
Dabis F, Ekouévi DK, Bequet L, Rouet F, Horo A, Fassinou P, Dequae-Merchadou L., Leroy<br />
V for the ANRS-PACCI Ditrame Plus Study Group A Short Course of Zidovudine +<br />
Peripartum Nevirapine is highly efficacious in preventing mother-to-child transmission of<br />
HIV-1: the ANRS 1201 Ditrame Plus study, Abidjan, Côte d’Ivoire (Abstract 854).<br />
XIV International AIDS Conference 2002, Barcelona Espana, 7-12 July 2002<br />
• Dabis F, Leroy V, Bequet L, Ekouévi DK, Viho I, Horo A, Timite-Konan M, Welffens-Ekra<br />
C for the Ditrame Plus Study Group. Effectiveness of a short course of Zidovudine +<br />
Nevirapine to prevent mother-to-child transmission (PMTCT) of HIV-1: The Ditrame Plus<br />
ANRS 1201 Project in Abidjan, Côte d’Ivoire (Abstr ThOrD1428).<br />
• Ekouévi DK, Leroy V, Viho I, Bequet L, Sakarovitch C, Horo A, Welffens-Ekra C and Dabis<br />
F for the Ditrame Plus Study Group. Uptake of a package to prevent mother-to-child<br />
transmission (PMTCT) of HIV in Abidjan, Côte d’Ivoire. The Ditrame Plus ANRS 1201/1202<br />
Project. (Abstr ThPeD7778).<br />
• Leroy V, Bequet L, Ekouévi DK, Viho I, Castetbon K, Kassi P, Dabis F, Timité-Konan M,<br />
for the DITRAME PLUS Study Group. Uptake of infant feeding interventions to reduce<br />
postnatal transmission of HIV-1 in Abidjan, Côte d’Ivoire. Projet DITRAME PLUS ANRS<br />
1202 (Abstr MoPeD3677).<br />
XII Conférence Internationa<strong>le</strong> sur <strong>le</strong> sida et <strong>le</strong>s MST en Afrique : Ouagadougou - Burkina Faso.<br />
9 – 13 Décembre 2001<br />
• Bequet L, Leroy V, Viho I, Castetbon K, Ekouévi DK, Dabis F, Welffens-Ekra C, for the<br />
DITRAME-PLUS Study Group. Acceptability of voluntary HIV antenatal testing using rapid<br />
assays to prevent mother-to-child transmission of HIV: Ditrame Plus ANRS-1201/1202<br />
Abidjan, Côte d’Ivoire 2000-2001 (Abstract 10BT2-5).<br />
• Dabis F, Leroy V, Bequet L, Ekouévi DK, Castetbon K, Viho I, Horo A, Montcho C, Timite-<br />
Konan M, Welffens-Ekra C. for the DITRAME-PLUS Study Group. Assessment of peripartum<br />
interventions to prevent mother-to-child transmission (PMTCT) of HIV-1: The<br />
DITRAME PLUS ANRS 1201/1202 project in Abidjan, Côte d’Ivoire (Abstract 13PT2-152).<br />
• Leroy V, Bequet L, Castetbon K, Viho I, Ekouévi DK, Kassi P, Dabis F, Timité-Konan M,<br />
for the DITRAME-PLUS Study Group. Maternal behavior and practices regarding infant<br />
feeding choices within a PMTCT project proposing alternatives to breastfeeding: DITRAME<br />
PLUS ANRS 1201/1202, Abidjan, Côte d'Ivoire, March-June 2001 (Abstract 13PT2-151).
191<br />
• Viho I, Ekouévi DK, Bequet L, Catestbon K Horo A, Dabis F, Leroy V pour <strong>le</strong> groupe<br />
d’étude Ditrame Plus ANRS 1201. Comportements de santé des femmes consultant en<br />
Protection Maternel<strong>le</strong> et Infanti<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s formations sanitaires d'Abidjan, Côte d’Ivoire<br />
(Abstract 13PT2-693).<br />
• Horo A, Ekouévi DK, Bequet L, Castetbon K, Viho I, Toure H, Dabis F, Welffens Ekra C ,<br />
Leroy V pour <strong>le</strong> groupe d’étude ANRS 1201/1202 Ditrame Plus. Know<strong>le</strong>dge and attitudes<br />
about HIV infection amongst health professionals involved in prevention of mother-to-child<br />
transmission of HIV.Abidjan, Côte d’Ivoire, 2000 (Abstract 10BT5-2).
PRIX SCIENTIFIQUES<br />
(Année 2001-2004)<br />
192
ANNEXES<br />
193