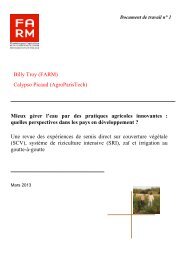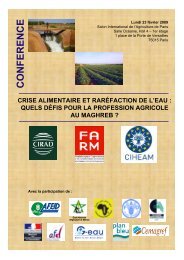2) Les étapes principales de la réformeLa première étape de la réforme a été la création de groupements de producteurs (GPC).Dès 1996, ceux-ci ont remplacé les groupements villageois, <strong>et</strong> assumé la gestion groupée ducrédit d’intrants. A partir de c<strong>et</strong>te date, les producteurs de coton s’associèrent librement <strong>et</strong>élirent un bureau de représentants (président, adjoint, secrétaire, trésorier), dont lerenouvellement périodique était prévu. Ces derniers furent responsables de la gestion dugroupement <strong>et</strong> de la coordination* <strong>des</strong> activités locales, notamment la distribution <strong>des</strong> intrants,les réunions avec les agents techniques, l’organisation <strong>et</strong> la gestion du marché local du cotongraine (collecte <strong>et</strong> pesée) <strong>et</strong> les décisions collectives les plus importantes. Ces groupements,contrairement à leurs prédécesseurs, furent libres d’accepter ou d’exclure <strong>des</strong> membres selonleurs règles internes de décision. Cela différenciait n<strong>et</strong>tement les GPC <strong>des</strong> anciens GV où tousles agriculteurs d’un même village, producteur ou non de coton, participaient au mêmegroupement. Ces nouveaux groupements furent constitués uniquement de producteurs de coton.Mais ils purent également emprunter pour financer <strong>des</strong> intrants <strong>des</strong>tinés à leurs culturesvivrières. Les producteurs de coton ne sont plus aujourd’hui garants que <strong>des</strong> crédits cotonniers,ce qui a rendu la <strong>sur</strong>veillance mutuelle plus efficace <strong>et</strong> a réduit les comportementsopportunistes*. Cependant, l’avènement <strong>des</strong> GPC ne permit pas de résoudre immédiatement lesproblèmes d’impayés <strong>des</strong> groupements envers la SOFITEX. Des me<strong>sur</strong>es complémentairesfurent mises en place les années suivantes. De plus, les GPC <strong>et</strong> leur structuration en unionsdépartementales <strong>et</strong> provinciales, à la fin <strong>des</strong> années 1990, aboutirent à l’émergence d’unvéritable syndicat cotonnier autonome <strong>et</strong> intégré : l’UNPCB devenu l’interlocuteurindispensable de la filière*, appuyée par les programmes d’appui institutionnel de l’ AFD 18 <strong>et</strong>du MAE. L’UNPCB s’est vue confier la gestion du crédit d’intrants pour les céréales, alors quela SOFITEX se recentrait <strong>sur</strong> le crédit d’intrants au coton. Au sein de chaque GPC, les besoinsen intrants coton <strong>et</strong> céréales ont été évalués séparément. Un nouveau mode de <strong>sur</strong>veillance ducrédit a été adopté par la SOFITEX <strong>et</strong> l’UNPCB au moment de la privatisation. Des comités dedécision tripartites pour l’octroi <strong>des</strong> crédits d’intrants ont été établis du niveau local au niveaunational dès 1999. Depuis c<strong>et</strong>te date, ils ont réuni les représentants <strong>des</strong> GPC, de la Banqueagricole <strong>et</strong> <strong>des</strong> techniciens de la SOFITEX. Au début de chaque campagne cotonnière, auniveau local, les producteurs de chaque groupement ont planifié leurs besoins en intrants enfonction de leurs choix d’assolement. Le réalisme de ces besoins a, ensuite, été confronté àl’avis de tout le groupement <strong>et</strong> <strong>des</strong> techniciens de la SOFITEX. Le montant <strong>des</strong> crédits alloués aété décidé en fonction de seuils de taux d’end<strong>et</strong>tements <strong>et</strong> de l’expérience de chaque membre.Ces forums locaux de crédit ont dressé <strong>des</strong> plans départementaux <strong>et</strong> régionoaux de financementconsolidés. Au niveau national, la BACB, l’UNPCB <strong>et</strong> la SOFITEX se sont accordées <strong>sur</strong> unmontant de crédit qui a été redistribué proportionnellement aux besoins exprimés par chaqueGPC.Depuis 1999, les taux de remboursement <strong>des</strong> GPC sont devenus satisfaisants. Ilsdépassent 90 % <strong>et</strong> as<strong>sur</strong>ent la viabilité financière <strong>des</strong> programmes de crédit de campagne. Ilssont la conséquence de la liberté d’association, de mécanismes de contrôle <strong>des</strong> risques* <strong>et</strong> <strong>des</strong>urveillance interne <strong>des</strong> groupements. La conjonction de groupements plus p<strong>et</strong>its <strong>et</strong> dont lacapacité d’imposer <strong>des</strong> sanctions sociales effectives <strong>et</strong> pénalisantes s’est accrûe estfondamentale. C<strong>et</strong>te première étape de la réforme a donc consisté en une refonte del’organisation du crédit au niveau local, <strong>et</strong> a débouché <strong>sur</strong> la mise en place de véritablescoopératives cotonnières (GPC) <strong>et</strong> d’un mouvement syndical unifié (UNPCB) <strong>et</strong> plusautonome. C’est même l’implication <strong>des</strong> producteurs dans les décisions de la filière* qui18 Ce programme, le PAP/OPC a permis de rendre plus autonomes <strong>et</strong> responsables les GPC <strong>et</strong> le syndicat cotonnier(UNPCB), rendant possible <strong>des</strong> autofinancements de leurs activités.Rapport <strong>FARM</strong>- Réforme de la filière cotonnière burkinabè 14
semble à l’origine de ce succès. En eff<strong>et</strong>, la relance du secteur s’est d’abord attachée àresponsabiliser les producteurs de manière croissante, leur confiant un nombre grandissant defonctions. Cela a été rendu possible par l’organisation intégrée <strong>des</strong> producteurs de coton duvillage à l’échelle nationale, ce qui est spécifique de la filière* burkinabè 19 . Ce qui a permis aumouvement cotonnier de se structurer aussi bien tient à <strong>des</strong> déterminants politiques <strong>et</strong>historiques. Cependant, c<strong>et</strong>te étude ne portera pas <strong>sur</strong> ces déterminants.Il faut néanmoins rappeler que l’AFD <strong>et</strong> les dirigeants du mouvement cotonnier onttravaillé ensemble pour que l’UNPCB puisse voir le jour, m<strong>et</strong>tre en place ses propresinstitutions <strong>et</strong> devenir un partenaire incontournable de la filière*, ayant un poids important <strong>et</strong>pouvant devenir cogestionnaire. Ces orientations ont été appuyées par l’Etat <strong>et</strong> sa confiancedans les producteurs, qui a modifié la législation <strong>sur</strong> les associations de producteurs au niveaulocal (la loi 14). C<strong>et</strong>te volonté de concertation distingue particulièrement la filière* burkinabède ses voisines malienne <strong>et</strong> béninoise. Au Mali, le mouvement syndical est plus divisé <strong>et</strong> a uneforte tradition revendicative. Les syndicats cotonniers refusent tout partenariat économiqueavec les autres acteurs de la filière <strong>et</strong> sont dans une logique d’opposition politique. De plus,l’Etat malien n’a pas la même volonté politique à transférer <strong>des</strong> responsabilités aux producteurs<strong>et</strong> perdre ses intérêts <strong>et</strong> son contrôle de la filière*. En conséquence, il n’y a pasd’environnement favorable à l’évolution <strong>des</strong> structures d’organisation <strong>des</strong> producteurs, <strong>et</strong> leprocessus de réforme se trouve bloqué 20 . Au Bénin, les mouvements syndicaux sont égalementdivisés <strong>et</strong> beaucoup moins influents politiquement <strong>et</strong> économiquement qu’au Burkina Faso.L’Etat n’a pas cherché à protéger <strong>et</strong> à structurer les mouvements de producteurs lors de lalibéralisation de la filière*. En conséquence, les coton-culteurs béninois sont insuffisammentreprésentés dans la filière*, marginalisés dans les processus de décision <strong>et</strong> déresponsabilisésdans leur fonction de production. On observera, à l’opposé, que l’émergence de l’UNPCB adonné les moyens aux producteurs de bénéficier du mouvement de privatisation de la filière*,deuxième étape de la réforme du secteur cotonnier burkinabé.La deuxième étape de la réforme a été marquée par la privatisation du secteur cotonnier.Elle a débuté en 1999, dans le cadre du PASA 21 . En vue d’assainir la situation financière de lafilière <strong>et</strong> de résorber les d<strong>et</strong>tes auprès de la Banque nationale agricole (BACB) <strong>et</strong> <strong>des</strong>groupements auprès de la SOFITEX, la Banque mondiale a proposé la privatisation de la filièrecotonnière tout en as<strong>sur</strong>ant <strong>des</strong> crédits à la société cotonnière <strong>et</strong> au syndicat de producteurs.Une solution originale a alors été proposée par le gouvernement à l’instigation <strong>des</strong> cadres de laSOFITEX <strong>et</strong> <strong>des</strong> représentants de l’UNPCB 22 . L’Etat, qui détenait les 2/3 du capital de laSOFITEX, a consenti à en céder un tiers à l’UNPCB. Les fonctions « critiques » ont étéprogressivement déléguées par l’Etat à la SOFITEX. La filière s’est réorganisée à partir de2000 autour du nouvel accord interprofessionnel, donnant naissance en 2006 à l’Associationinterprofessionnelle du coton burkinabé (AICB). L’accord incluait un programme dedéveloppement, prévoyant de nouveaux investisseurs dans l’égrenage <strong>et</strong> la commercialisationdu coton fibre, un nouveau mécanisme de prix, la prise en charge <strong>des</strong> intrants pour les céréales19 Ceci est appuyé dans un rapport de la Banque mondiale présenté à Shanghai en 2004 « Cotton cultivation inBurkina Faso- A 30 year success story »20 Le status quo politique prévaut encore aujourd’hui. Toute décision politique concernant la future organisation dusecteur cotonnier malien a été reportée à 2011.21 Programme d’ajustement sectoriel agricole élaboré dans le cadre du consensus de Washington qui a entraîné unbouleversement radical de l’environnement <strong>des</strong> producteurs agricoles : libéralisation <strong>des</strong> prix, démantèlement <strong>des</strong>caisses de stabilisation <strong>et</strong> privatisation <strong>des</strong> monopoles publics ou parapubliques de commercialisation <strong>des</strong> matièrespremières...22 La SOFITEX <strong>et</strong> l’ UNPCB ont travaillé de manière plus partenariale depuis la mise en place <strong>des</strong> GPC (déjàproposé en 1993 par les producteurs). Les programmes d’appui de l’organisation agricole, ainsi que leurémergence comme partenaire, les a inclus naturellement au centre du processus de privatisation.Rapport <strong>FARM</strong>- Réforme de la filière cotonnière burkinabè 15
- Page 2 and 3: ABREVIATIONS ET ACRONYMESAFDAFDIAIC
- Page 9 and 10: Faso ou encore le Tchad 4 . Malheur
- Page 11 and 12: difficile. En effet, la pression de
- Page 13: Néanmoins, le système de monopson
- Page 17 and 18: l’approvisionnement des différen
- Page 19 and 20: emboursement (trois ans après), la
- Page 21 and 22: dynamisme de la filière* : nouvell
- Page 23 and 24: Parmi les composants de la réforme
- Page 25 and 26: tiers du capital), qui est une soci
- Page 27 and 28: La fixation des prix en début de c
- Page 29 and 30: plan de relance de la filière* en
- Page 31 and 32: production devenir plus intensif. P
- Page 33 and 34: esteront de peu d’importance. En
- Page 35 and 36: actuelles ne permettent pas encore
- Page 37 and 38: de redistribution existe, il peut d
- Page 39 and 40: IV. L’enquête cotonnière : conc
- Page 41 and 42: puis tirés au sort parmi chaque st
- Page 43 and 44: Le GPC moyen est composé de 44 mem
- Page 45 and 46: individuelles sont souvent sanction
- Page 47 and 48: amendements organiques, encore peu
- Page 49 and 50: a) Estimation des surfaces actuelle
- Page 51 and 52: système attelé, et n’ayant pas
- Page 53 and 54: l’importance des besoins alimenta
- Page 55 and 56: travers le contrôle des risques* a
- Page 57 and 58: Richesse subjective actuelle0 2 4 6
- Page 59 and 60: Evolution de la consommation/ tête
- Page 61 and 62: Tableau 15 : Evolution des indicate
- Page 63 and 64: Améliorations des rendements par l
- Page 65 and 66:
ConclusionCette étude a permis de
- Page 67 and 68:
BibliographieAkiyama, T., Baffes, J
- Page 69 and 70:
Poulton, C. et al., 2004. Competiti
- Page 71 and 72:
Section 2 : aspects relationnels et
- Page 73 and 74:
A.2. Questionnaire de ménage 1Rens
- Page 75 and 76:
Section 2 : conditions de vie et d
- Page 77 and 78:
Q312 Dépenses en médicaments l’
- Page 79 and 80:
Q416 Relief 18 PENT1Tableau du bila
- Page 81 and 82:
Q448 Comment évaluez-vous la gesti
- Page 83 and 84:
Q482 Craignez vous les déclassemen
- Page 85 and 86:
Q72 Classez de 0 à 10 la richesse
- Page 87 and 88:
A.4. Organisation et fonctionnement
- Page 89 and 90:
A.6. Estimation de l’évolution d
- Page 91 and 92:
Regime of farmland evolution y=i y=
- Page 93 and 94:
A.7. Estimation des parts actuelles
- Page 95 and 96:
Regime of cotton shares evolution y
- Page 97 and 98:
GlossaireAléa moral : situation à