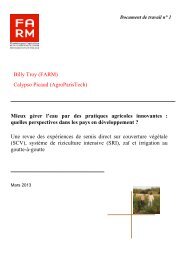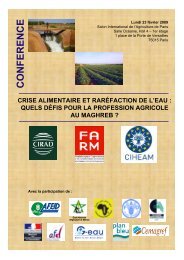Analyse des impacts économiques et sociaux sur ... - Fondation FARM
Analyse des impacts économiques et sociaux sur ... - Fondation FARM
Analyse des impacts économiques et sociaux sur ... - Fondation FARM
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
a) Estimation <strong>des</strong> <strong>sur</strong>faces actuelles cultivées par ménageLa première étape est une régression multiple de deux types de variables <strong>sur</strong> les <strong>sur</strong>facescultivées actuellement par chaque ménage 87 : <strong>des</strong> variables quantitatives (force de travail, tauxde scolarisation, taille de la famille, valeur du cheptel…) <strong>et</strong> <strong>des</strong> variables mu<strong>et</strong>tes 88 (expériencecotonnière, type de mécanisation, groupe <strong>et</strong>hnique). Quatre modèles sont analysés dans l<strong>et</strong>ableau 4 (voir annexe). Pour éviter <strong>des</strong> discussions trop techniques, une synthèse <strong>sur</strong> lesprincipales conclusions de ces 4 modèles sera présentée ici.Les différents modèles montrent le rôle prépondérant joué par le niveau de mécanisationagricole <strong>et</strong> la force de travail <strong>sur</strong> les <strong>sur</strong>faces actuelles cultivées par ménage. Cependant, leurpouvoir explicatif est moins pertinent quand on tient compte de la valeur <strong>des</strong> revenus <strong>des</strong>activités d’élevage <strong>et</strong> autres non agricoles ou du ratio de ces valeurs à la valeur <strong>des</strong> productionsvégétales. En eff<strong>et</strong>, une part de la main-d’œuvre est allouée à ces autres activités commel’élevage, le commerce, la pêche ou la chasse, alors que le degré de mécanisation peuts’expliquer partiellement par la valeur <strong>des</strong> troupeaux. De plus, on observe que les <strong>sur</strong>facesactuelles cultivées par ménage décroissent avec la valeur relative <strong>des</strong> troupeaux <strong>et</strong> <strong>des</strong> transferts(dons, subventions, r<strong>et</strong>raites…), c’est-à-dire relativement à la valeur économique totale <strong>des</strong>cultures 89 .Dans le sous-échantillon <strong>des</strong> ménages ayant <strong>des</strong> enfants scolarisables, on constate que lestaux de scolarisation ont un impact positif significatif <strong>sur</strong> les superficies agricoles. L’influencede la force de travail est plus forte que pour l’échantillon général, alors que celle du système demécanisation est plus faible. Une explication possible tient à la composition de ce souséchantillon,caractérisée par les ménages les plus nombreux où la force de travail <strong>et</strong> lamécanisation sont plus facilement substituables. La scolarisation est positivement corrélée avecles superficies cultivées, probablement en raison de son lien avec la richesse <strong>des</strong> ménages, quipeuvent substituer au travail familial de la main-d’œuvre employée salariée ou du capital. Lascolarisation a donc un eff<strong>et</strong> indirect <strong>sur</strong> la croissance <strong>des</strong> terres cultivées car elle traduit <strong>des</strong>contraintes moins fortes au niveau <strong>des</strong> besoins en travailleurs pour l’agriculture. Le taux <strong>des</strong>colarisation <strong>des</strong> enfants du ménage a une importance limitée <strong>sur</strong> la disponibilité de la maind’œuvre,car il traduit <strong>sur</strong>tout un eff<strong>et</strong> de richesse.Il existe, aussi, <strong>des</strong> contraintes d’ordre social ou <strong>et</strong>hnique. En eff<strong>et</strong>, la saisonnalité <strong>des</strong>besoins en main-d’œuvre peut être assouplie par les systèmes informels de solidarité villageoisedans lesquels les ménages du même village peuvent se rendre <strong>des</strong> services mutuels en fonction<strong>des</strong> besoins de chacun. Cependant, ces réseaux de solidarité fonctionnent plus efficacemententre personnes de même <strong>et</strong>hnie ou de même groupe social. Ainsi, certaines <strong>et</strong>hniesminoritaires dans un village se r<strong>et</strong>rouvent exclues de ces systèmes informels <strong>et</strong> subissent unplus grand nombre de contraintes ponctuelles dans leurs productions agricoles. L’appartenance<strong>et</strong>hnique est, aussi, un facteur (fixe) prédéterminant dans l’accès à la terre. Dans ces zones declimat soudano-sahélien, les droits d’accès à la terre sont relativement souples <strong>et</strong> informels. Lesnormes de propriété sont communales <strong>et</strong> l’usufruit est individuel. Le droit d’occupation du solest largement ouvert <strong>et</strong> il s’obtient par l’attribution d’une parcelle par les autoritésadministratives ou traditionnelles du village. Il n’en reste pas moins que le droit de propriétéprivée de la terre n’existe pas formellement <strong>et</strong> est peu protégé : peu de garanties, de droits ou decontrats* écrits <strong>sur</strong> la propriété foncière ni de registre cadastral. Dans ce système ouvert d’accèsà la terre, certaines <strong>et</strong>hnies peuvent être lésées dans le bénéfice <strong>des</strong> terres fertiles, accessibles ou87 Les <strong>sur</strong>faces mises en jachère <strong>sur</strong> chaque parcelle du ménage ont été déduites de la <strong>sur</strong>face totale <strong>des</strong> terres duménage.88 Une variable mu<strong>et</strong>te prend la valeur 1 quand elle est vraie <strong>et</strong> 0 le cas échéant.89 Toutes ces variables captant l’eff<strong>et</strong> <strong>des</strong> autres activités du ménage sont introduites dans les modèles 3 <strong>et</strong> 4 <strong>et</strong>contribuent à l’augmentation du R².Rapport <strong>FARM</strong>- Réforme de la filière cotonnière burkinabè 49