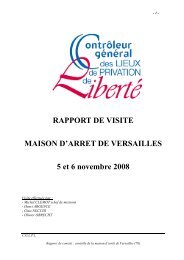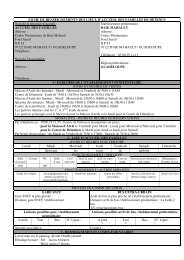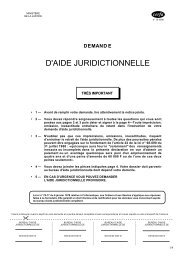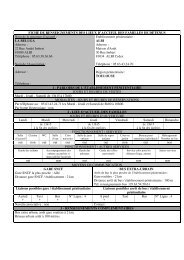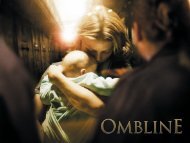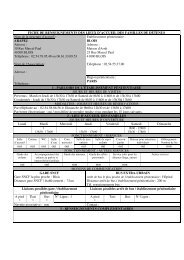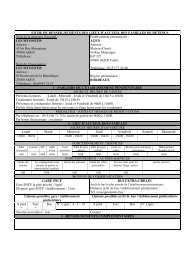- Page 1 and 2: UNIVERSITE PARIS I - PANTHEON-SORBO
- Page 3 and 4: IIRemerciementsGEORGIA BECHLIVANOU
- Page 5 and 6: IVABREVIATIONS/ ContreAJDAActualit
- Page 7: 1INTRODUCTIONGEORGIA BECHLIVANOU MO
- Page 10 and 11: 4ne sauraient causer un préjudice
- Page 12 and 13: de l’homme à l’égard des pers
- Page 14 and 15: 8dès lors qu’il s’épuise dans
- Page 16 and 17: liberté en matière correctionnell
- Page 18 and 19: Le rôle historique de la prison da
- Page 20 and 21: l’objet exclusif de la Convention
- Page 22 and 23: Tocqueville s’en était égalemen
- Page 24 and 25: n'est point privée de la garantie
- Page 26 and 27: 20Cette instance avait admis que, d
- Page 28 and 29: contraire : un moyen de protéger l
- Page 30 and 31: sein de cet article : « En proclam
- Page 32 and 33: 26La légalité 160 signifie que le
- Page 34 and 35: 28droits ne permettent donc pas, à
- Page 36 and 37: Outre les recours étatiques et col
- Page 40 and 41: fermée au motif que ces décisions
- Page 42 and 43: plus les droits qui ne contribuent
- Page 44 and 45: 38toute condamnation pénale. Le dr
- Page 46 and 47: 40PREMIERE PARTIEUNE PEINE A DIMENS
- Page 48 and 49: 42de liberté exécutée en prison
- Page 50 and 51: 44même si dans la prison les exige
- Page 52 and 53: 46condamnation est l'exemple type d
- Page 54 and 55: § 1. La reconnaissance du droit au
- Page 56 and 57: 50durée, les effets et les modalit
- Page 58 and 59: 52la loi, en dehors de la prison ne
- Page 60 and 61: 541. Un sens européen autonomeD’
- Page 62 and 63: 56A propos des problèmes matériel
- Page 64 and 65: 58classification des types de déte
- Page 66 and 67: une fois pour toutes, au moment de
- Page 68 and 69: 62Le gouvernement anglais a contest
- Page 70 and 71: 64catégorie des peines de type par
- Page 72 and 73: 66étendre le droit à un contrôle
- Page 74 and 75: 68décisions relatives aux réducti
- Page 76 and 77: internement... 333 », la détermin
- Page 78 and 79: 72Cette mesure est, jusqu'à prése
- Page 80 and 81: L'application de l'article 7, qui c
- Page 82 and 83: d'application du droit à la libert
- Page 84 and 85: elle n’est pas non plus synonyme
- Page 86 and 87: 80vers la mise en cause de la léga
- Page 88 and 89:
82Le fait que les conditions matér
- Page 90 and 91:
peine privative de liberté, son im
- Page 92 and 93:
86§ 3 Les garanties procédurales
- Page 94 and 95:
88à propos duquel la Cour a dû se
- Page 96 and 97:
90plusieurs de ses dispositions (ar
- Page 98 and 99:
92Pour que le recours organisé par
- Page 100 and 101:
94De même, lorsqu’une instance d
- Page 102 and 103:
96Dans tous les cas, l’appréciat
- Page 104 and 105:
98procédure peut valoir que l'int
- Page 106 and 107:
100Le droit français, bien qu’ay
- Page 108 and 109:
102Les condamnés à des peines de
- Page 110 and 111:
104l’existence des soins appropri
- Page 112 and 113:
106d. La semi-libertéElle est acco
- Page 114 and 115:
thérapie destinée à limiter les
- Page 116 and 117:
peines (art. 132-26-2 C. pén.). To
- Page 118 and 119:
112e. Les transfertsLes décisions
- Page 120 and 121:
114« mesures d'administration judi
- Page 122 and 123:
116Les décisions, ordonnances ou j
- Page 124 and 125:
118l’infraction, ou qui réclame
- Page 126 and 127:
C’est cet objectif et cette appro
- Page 128 and 129:
Soulignons à propos de l’applica
- Page 130 and 131:
Dans le cadre de la réduction de p
- Page 132 and 133:
126détenu est immédiatement infor
- Page 134 and 135:
128Concernant d’abord, les instan
- Page 136 and 137:
pas parvenir à se faire prodiguer
- Page 138 and 139:
132Pour déterminer si ce recours p
- Page 140 and 141:
de considérer toutes les peines co
- Page 142 and 143:
136physique de la personne. Ce rôl
- Page 144 and 145:
138temps de guerre ou de danger imm
- Page 146 and 147:
certaine qualité de vie 5 . La qua
- Page 148 and 149:
142impose à l'Etat une obligation
- Page 150 and 151:
144Convention. Cette disposition re
- Page 152 and 153:
En ce qui concerne les termes émeu
- Page 154 and 155:
148implique qu’il ne faut pas ten
- Page 156 and 157:
les représentants de l'application
- Page 158 and 159:
152données de ne tirer que si la v
- Page 160 and 161:
154nécessité d’intervenir pour
- Page 162 and 163:
156cette peine peut-il justifier la
- Page 164 and 165:
158(n° 2721/1999). Elle prévoit (
- Page 166 and 167:
1602. L’application nationaleL’
- Page 168 and 169:
162ou de violence grave, être soum
- Page 170 and 171:
164§§ 1, 4 C. pénit., et D 283-5
- Page 172 and 173:
des personnes. En temps de paix ég
- Page 174 and 175:
pour la vie, l'importance de cette
- Page 176 and 177:
personnes détenues implique égale
- Page 178 and 179:
complète et approfondie, publique
- Page 180 and 181:
174En effet, l’enquête indépend
- Page 182 and 183:
176Autrement, cette garantie « pou
- Page 184 and 185:
178son incarcération, était en bo
- Page 186 and 187:
vie 261 ». C’est sous cette cond
- Page 188 and 189:
182Cette obligation pèse sur les a
- Page 190 and 191:
184fragile ou fragilisé par la dé
- Page 192 and 193:
condamnation, sur le motif qu’il
- Page 194 and 195:
188Quant aux menaces proférées, l
- Page 196 and 197:
190lors qu'elles sont considérées
- Page 198 and 199:
192l'administration un acte, agisse
- Page 200 and 201:
194Mais la responsabilité de l’E
- Page 202 and 203:
196On peut enfin se demander si la
- Page 204 and 205:
198Quant aux tendances suicidaires
- Page 206 and 207:
200eu égard à cet impératif de s
- Page 208 and 209:
Toutefois l’affaire Taïs, jugée
- Page 210 and 211:
l’élargissement du champ de reco
- Page 212 and 213:
206l'infamie par l'infamie même 88
- Page 214 and 215:
208commis, ou est soupçonnée d'av
- Page 216 and 217:
210Cela dit, même limitée à l'in
- Page 218 and 219:
212savoir si la torture est accepta
- Page 220 and 221:
214La méthode propre à la CourLa
- Page 222 and 223:
216« aigu ». Ce terme désigne de
- Page 224 and 225:
218intentionnels et engageant direc
- Page 226 and 227:
220qualifiés de torture, la pendai
- Page 228 and 229:
222flagellation 985 , soit en raiso
- Page 230 and 231:
224personne. La torture est punie d
- Page 232 and 233:
226Nous constatons donc que la mét
- Page 234 and 235:
228la Cour a jugé que les infracti
- Page 236 and 237:
230des obligations également proc
- Page 238 and 239:
232médicale établi deux ans et se
- Page 240 and 241:
234Un dernier point de renforcement
- Page 242 and 243:
236assorti d’un mécanisme de pro
- Page 244 and 245:
238Cela bien que la Cour européenn
- Page 246 and 247:
240soit par des actions ou des omis
- Page 248 and 249:
Nous allons présenter les élémen
- Page 250 and 251:
leur contenu avec le récit du plai
- Page 252 and 253:
246Convention, qui consacre le droi
- Page 254 and 255:
248mesure raisonnable : « Il suffi
- Page 256 and 257:
250B. La protection nationaleLe dro
- Page 258 and 259:
2522. Les obligations positivesLes
- Page 260 and 261:
254A. La protection européenneApr
- Page 262 and 263:
256d’une certaine gravité et non
- Page 264 and 265:
258les examens médicaux 1178 . Enf
- Page 266 and 267:
260de la prison ou pour prévenir d
- Page 268 and 269:
262C’est ce que la Cour a affirm
- Page 270 and 271:
droit grec se contente d’énoncer
- Page 272 and 273:
266pendant les consultations et les
- Page 274 and 275:
268En droit français, la décision
- Page 276 and 277:
Convention 1236 » et, qu’en 1991
- Page 278 and 279:
272Enfin, la Cour a, d’une part,
- Page 280 and 281:
274nuisible surtout pour les person
- Page 282 and 283:
276ainsi que par la proximité des
- Page 284 and 285:
278d’aération (surtout en prése
- Page 286 and 287:
280dans le bruit et la lumière per
- Page 288 and 289:
282En ce qui concerne l’affectati
- Page 290 and 291:
284stabilisé autour de 58 500 dét
- Page 292 and 293:
286solution serait non pas l’exte
- Page 294 and 295:
288spéciaux, le principe adopté p
- Page 296 and 297:
290régime spécial, elle écarte l
- Page 298 and 299:
292appréciation doit être laissé
- Page 300 and 301:
294fenêtres opaques 1409 ou par la
- Page 302 and 303:
avait été déclarée zone militar
- Page 304 and 305:
mort en Ukraine 1442 , en Bulgarie
- Page 306 and 307:
300B. Les garanties lors du recours
- Page 308 and 309:
302Examen médical. Le CPT estime q
- Page 310 and 311:
304§ 2. L’application des régim
- Page 312 and 313:
306A part le placement solitaire du
- Page 314 and 315:
308du 21 mars 2006 a insisté sur l
- Page 316 and 317:
l’intéressé (art. D 283-2-3 CPP
- Page 318 and 319:
d'humain dans les opposants. Il fau
- Page 320 and 321:
chambre de la Cour dans lequel elle
- Page 322 and 323:
316aujourd’hui posée au regard d
- Page 324 and 325:
approprié à son état physique 15
- Page 326 and 327:
Convention que lorsqu’il est comb
- Page 328 and 329:
322de la loi n° 2005-102 du 11 fé
- Page 330 and 331:
324Toutefois, concernant la questio
- Page 332 and 333:
concernant les enfants. Outre qu’
- Page 334 and 335:
328Conseil des Ministres qui a, pou
- Page 336 and 337:
330l’aider à faire face à ses b
- Page 338 and 339:
332personne inapte à la détention
- Page 340 and 341:
334ces seuils vacillent entre sept
- Page 342 and 343:
336Dans la réalité, les enquêtes
- Page 344 and 345:
338comme imposant aux autorités na
- Page 346 and 347:
340contrôle et à la possibilité
- Page 348 and 349:
342dangereux du détenu ou d'un cri
- Page 350 and 351:
344bout d’un certain temps, les l
- Page 352 and 353:
346CHAPITRE 3. APPLICATION DES INTE
- Page 354 and 355:
dès 1952 par le Conseil d’Etat f
- Page 356 and 357:
350tuberculose non active, de surcr
- Page 358 and 359:
352conditions de détention adéqua
- Page 360 and 361:
354une meilleure connaissance de la
- Page 362 and 363:
constitutives de mauvais traitement
- Page 364 and 365:
358administrés, des effets des man
- Page 366 and 367:
360peut résider dans le simple con
- Page 368 and 369:
362En droit français, l’organisa
- Page 370 and 371:
364A part ce dispositif, le droit f
- Page 372 and 373:
elle ne parvient pas rapidement au
- Page 374 and 375:
clinique privée 1852 . Quant à l
- Page 376 and 377:
370Quant à l’hospitalisation en
- Page 378 and 379:
personnes alcoolo-dépendantes à l
- Page 380 and 381:
un médecin de leur choix à leurs
- Page 382 and 383:
376Quant à l’accès aux hospital
- Page 384 and 385:
378toujours tâche difficile 1905
- Page 386 and 387:
380exemple, dans l'affaire Lucanov
- Page 388 and 389:
382particulièrement difficile à s
- Page 390 and 391:
qu’une grève de la faim, n’exo
- Page 392 and 393:
386aspects éthiques et organisatio
- Page 394 and 395:
Le droit grec et le droit français
- Page 396 and 397:
390Depuis la loi n° 2331/95 contre
- Page 398 and 399:
Auparavant, des dispositions exista
- Page 400 and 401:
394en référé, a rappelé les obl
- Page 402 and 403:
396accueillir tous les malades ment
- Page 404 and 405:
398La position si extrême de la ju
- Page 406 and 407:
400général 2005 . Cette double im
- Page 408 and 409:
402L'attention sur sa violation ava
- Page 410 and 411:
physique et morale de la personne a
- Page 412 and 413:
406insistant tout particulièrement
- Page 414 and 415:
exclu 2054 » (mais non suivies d
- Page 416 and 417:
410dégradante 2059 ». S’agissan
- Page 418 and 419:
A défaut, l’alimentation forcée
- Page 420 and 421:
lorsque la personne a perdu conscie
- Page 422 and 423:
416procédé le moins dangereux et
- Page 424 and 425:
a, dans la Déclaration de Helsinki
- Page 426 and 427:
comportement ou une action thérape
- Page 428 and 429:
422au point de soulever des questio
- Page 430 and 431:
424Au niveau européen, la question
- Page 432 and 433:
426CONCLUSION PARTIE 1L’apport de
- Page 434 and 435:
428La question justement du maintie
- Page 436 and 437:
430DEUXIEME PARTIE. UNE PEINE A DIM
- Page 438 and 439:
432implique un degré d’ingérenc
- Page 440 and 441:
434TITRE 1LE SENS DE LA PEINE PRIVA
- Page 442 and 443:
CHAPITRE 1. LE SENS DE LA PEINE PRI
- Page 444 and 445:
438juillet 1999 sur la Loi portant
- Page 446 and 447:
domicile (art. 241), à l'injure et
- Page 448 and 449:
semblables et le monde extérieur -
- Page 450 and 451:
444ADN 2217 , l’usage de détecte
- Page 452 and 453:
446Hayek 2226 . Dès lors, la sanct
- Page 454 and 455:
elle atteint le panoptisme. Ainsi q
- Page 456 and 457:
exigées (A), avant d’aborder la
- Page 458 and 459:
452En droit français, le respect d
- Page 460 and 461:
la vie privée nécessite un lieu p
- Page 462 and 463:
456Ces garanties s’apprécient à
- Page 464 and 465:
458b. Non-exigence d'assentiment et
- Page 466 and 467:
460Le droit de vivre seul dans son
- Page 468 and 469:
462Qu'il soit en mouvement ou en é
- Page 470 and 471:
464doivent pouvoir exercer un recou
- Page 472 and 473:
èglement pénitentiaire précise q
- Page 474 and 475:
non imposée aux détenus et pour l
- Page 476 and 477:
pensionnaires et de ceux qui vienne
- Page 478 and 479:
privés avec autrui est un but en s
- Page 480 and 481:
électroniques et l’usage d’Int
- Page 482 and 483:
476C'est en ayant à l'esprit cet e
- Page 484 and 485:
478lors qu’elles sont publiées e
- Page 486 and 487:
480Absence de distinction entre dif
- Page 488 and 489:
482Les restrictions dans l'applicat
- Page 490 and 491:
484L’ouverture des lettres ne peu
- Page 492 and 493:
486Seulement deux types de propos o
- Page 494 and 495:
488requérante était supposé la l
- Page 496 and 497:
490avant l'emprisonnement) 2432 et
- Page 498 and 499:
492personne à l'exception d'un dé
- Page 500 and 501:
494ces droits dans toutes les circo
- Page 502 and 503:
496l'identité des correspondants 2
- Page 504 and 505:
498correspondance, occasionnelle ou
- Page 506 and 507:
maisons centrales, les conversation
- Page 508 and 509:
peines, fondées sur les nécessit
- Page 510 and 511:
« La Cour considère que dans le c
- Page 512 and 513:
506sa famille 2490 . Le contrôle e
- Page 514 and 515:
508maintenir les liens familiaux et
- Page 516 and 517:
510Si, malgré l'absence d'intimit
- Page 518 and 519:
Même si l'on ramène tous les argu
- Page 520 and 521:
514Pour l'instant, donc, les relati
- Page 522 and 523:
516En 1990, la possibilité des dé
- Page 524 and 525:
organes du Conseil de l'Europe, con
- Page 526 and 527:
520CHAPITRE 2. LE SENS DETERMINE PA
- Page 528 and 529:
522Déclaration Universelle des Dro
- Page 530 and 531:
524constance pour créer des ‘lie
- Page 532 and 533:
526marier et le droit de fonder une
- Page 534 and 535:
528limitation 2575 , et, de toute m
- Page 536 and 537:
530retardement dans l'exercice de c
- Page 538 and 539:
532Car tout en affirmant le droit d
- Page 540 and 541:
534La jurisprudence européenne a a
- Page 542 and 543:
536environnement familial et social
- Page 544 and 545:
538Seul l’intérêt de l'enfant p
- Page 546 and 547:
540européen aux droits de l’homm
- Page 548 and 549:
542la part de la famille du détenu
- Page 550 and 551:
544Ce qui caractérise la protectio
- Page 552 and 553:
546Seule la privation totale de rec
- Page 554 and 555:
548longue. Dans la réalité, 31% d
- Page 556 and 557:
550a. Les sorties familiales except
- Page 558 and 559:
552Lors des débats parlementaires
- Page 560 and 561:
554rendre visite à son père qui s
- Page 562 and 563:
556familiale et privée 2700 . Auss
- Page 564 and 565:
558b. Choix du pays de la détentio
- Page 566 and 567:
560blessure grave dont il souffre
- Page 568 and 569:
562Outre la condamnation à la pein
- Page 570 and 571:
564des familles) et des effets psyc
- Page 572 and 573:
566constituent une preuve suppléme
- Page 574 and 575:
568Toujours est-il que les obligati
- Page 576 and 577:
570accusé d’abus sexuels sur sa
- Page 578 and 579:
572condamnation à un emprisonnemen
- Page 580 and 581:
574civ.). De surcroît, le refus du
- Page 582 and 583:
576respecter le principe de personn
- Page 584 and 585:
578TITRE 2LE SENS DETERMINE AU REGA
- Page 586 and 587:
580CHAPITRE 1. L’ETENDUE DE L’E
- Page 588 and 589:
582ayant à l’esprit cette import
- Page 590 and 591:
584(shall not include ) ; il contri
- Page 592 and 593:
586L’interprétation, selon laque
- Page 594 and 595:
588Il faut également tenir compte
- Page 596 and 597:
5902. L’interprétation spéciale
- Page 598 and 599:
592Il importe également de soulign
- Page 600 and 601:
594Au regard de la protection gén
- Page 602 and 603:
596soumission des détenus à cette
- Page 604 and 605:
à l’exception de certains droits
- Page 606 and 607:
statut de salarié 2876 » et, de f
- Page 608 and 609:
Par cette approche, la Cour a pu é
- Page 610 and 611:
604l’autorisation d’exploiter u
- Page 612 and 613:
606Nous allons constater qu’encor
- Page 614 and 615:
608Une autre atteinte, officieuse
- Page 616 and 617:
610sont absentes dans les droits gr
- Page 618 and 619:
612La limitation de la liberté d
- Page 620 and 621:
Travail 2949 . La combinaison de ce
- Page 622 and 623:
616Seules quelques professions peuv
- Page 624 and 625:
618Les conditions d’accès des d
- Page 626 and 627:
620concernant : la sécurité et l
- Page 628 and 629:
622En contrepartie, la rémunérati
- Page 630 and 631:
624indifférente. Selon la Cour, la
- Page 632 and 633:
626constituent des moyens implicite
- Page 634 and 635:
628l’a souligné Jean Favard, la
- Page 636 and 637:
630nous interroger sur les raisons
- Page 638 and 639:
Nous estimons que les vraies raison
- Page 640 and 641:
statut de salarié et des garanties
- Page 642 and 643:
une expression de l’autonomie de
- Page 644 and 645:
638peine vers la fin du XVe siècle
- Page 646 and 647:
640rémunération du travail des d
- Page 648 and 649:
642fait que, depuis notamment l’a
- Page 650 and 651:
autorégulation : l’équilibre so
- Page 652 and 653:
646pivot, la clé de la voûte de t
- Page 654 and 655:
648Travailler ou suivre une formati
- Page 656 and 657:
650détenus. Il l’a étendu aux d
- Page 658 and 659:
652(comme la fin de peine, le trans
- Page 660 and 661:
654peuvent s'exercer au détriment
- Page 662 and 663:
comme des biens au sens de la Conve
- Page 664 and 665:
658Depuis la mise en vigueur des Co
- Page 666 and 667:
en mettant en avant le motif que, p
- Page 668 and 669:
662judiciaire et/ou la jouissance d
- Page 670 and 671:
664La jurisprudence européenne sur
- Page 672 and 673:
d'une transaction immobilière - po
- Page 674 and 675:
668l’argent du détenu. La gestio
- Page 676 and 677:
SECTION 2. DES RESTRICTIONS REDUISA
- Page 678 and 679:
d'un déménagement lors des transf
- Page 680 and 681:
674alimentaire » dans la mesure o
- Page 682 and 683:
676Cependant, cette évolution, si
- Page 684 and 685:
6782. Le critère de dangerositéLe
- Page 686 and 687:
680Le droit français en témoigne.
- Page 688 and 689:
682TITRE 3LE SENS DE LA PEINE PRIVA
- Page 690 and 691:
tandis que l'enseignement ou l'inst
- Page 692 and 693:
686§ 1. L’application au sein de
- Page 694 and 695:
688la Cour estime qu'elles n'enfrei
- Page 696 and 697:
Tout d'abord, le rattachement des e
- Page 698 and 699:
692Une autre précision mérite d
- Page 700 and 701:
mais aussi, en temps réel, par la
- Page 702 and 703:
696La théorie des limitations de l
- Page 704 and 705:
698Contrôle des sources et moyens
- Page 706 and 707:
700dans les trois derniers mois, et
- Page 708 and 709:
compte que, en droit français, leu
- Page 710 and 711:
de croire 3259 ». En droit pénite
- Page 712 and 713:
706liées à la protection de l’e
- Page 714 and 715:
discrimination fondée, entre autre
- Page 716 and 717:
710hebdomadaire ouvert aux autres d
- Page 718 and 719:
712Aussi, alors qu'on s'attendait
- Page 720 and 721:
déroulement des activités d'ensei
- Page 722 and 723:
716Le respect de la correspondance
- Page 724 and 725:
718CHAPITRE 2. L’EXERCICE DES DRO
- Page 726 and 727:
720et de la prison comme un lieu my
- Page 728 and 729:
protégées de manière implicite d
- Page 730 and 731:
724Réunions, manifestations et dis
- Page 732 and 733:
exigences de prévisibilité légal
- Page 734 and 735:
Il en va de même des hommes politi
- Page 736 and 737:
730de ces qualités peut justifier
- Page 738 and 739:
entreprises 3411 , l’école 3412
- Page 740 and 741:
734partialité dans le traitement d
- Page 742 and 743:
736démonstration de véracité 344
- Page 744 and 745:
et certes l’obligation de légif
- Page 746 and 747:
740l'examen éventuel de ses écrit
- Page 748 and 749:
742De manière générale, dans l
- Page 750 and 751:
744notion de « provenance étrang
- Page 752 and 753:
aisons d'ordre jusqu'à la libérat
- Page 754 and 755:
748Le droit grec est plus bref en c
- Page 756 and 757:
750autant que symbolique de la part
- Page 758 and 759:
d'autres articles de la Convention,
- Page 760 and 761:
être liée par la liste exhaustive
- Page 762 and 763:
756constitue la privation du droit
- Page 764 and 765:
758l’ouverture d’esprit, justif
- Page 766 and 767:
760l'article 3 du protocole n°1 «
- Page 768 and 769:
762électorales étaient, en vertu
- Page 770 and 771:
764détenues ont voté au 2ème tou
- Page 772 and 773:
contemporaines, « ne devrait inter
- Page 774 and 775:
768potentialité d’être source d
- Page 776 and 777:
770CONCLUSIONGEORGIA BECHLIVANOU MO
- Page 778 and 779:
772programme de réforme n'a pu jus
- Page 780 and 781:
774la peine. Alors que les griefs c
- Page 782 and 783:
776dignité, ils doivent dépasser
- Page 784 and 785:
778judiciarisation des droits de l'
- Page 786 and 787:
780Certes, note encore ce Comité,
- Page 788 and 789:
782que leurs composantes chimiques
- Page 790 and 791:
784en général des droits de l'hom
- Page 792 and 793:
786choses matérielles ou des avant
- Page 794 and 795:
788reconnaissance et de protection
- Page 796 and 797:
790passé dehors, il devrait s’é
- Page 798 and 799:
IBIBLIOGRAPHIEOUVRAGESALEXIADIS S.,
- Page 800 and 801:
IIIKOURAKIS N., Répression pénale
- Page 802 and 803:
VCOTTU M., Réflexions sur l'état
- Page 804 and 805:
VIIGAMPELL L.,« Panorama des initi
- Page 806 and 807:
IXVELLA M., « Intervention du méd
- Page 808 and 809:
XIMARX G.-T., « La société de s
- Page 810 and 811:
XIII- « Droits de l’homme et con
- Page 812 and 813:
XVTERRA J.-L., Prévention du suici
- Page 814 and 815:
XVIIRapports de visiteGrèceCPT/Inf
- Page 816 and 817:
XIXAksoy c. Turquie, n° 21987/93,
- Page 818 and 819:
XXIDudgeon c. R.U., n° 7525/76, 22
- Page 820 and 821:
XXIIIJohnson c. R.U., 24 oct. 1997,
- Page 822 and 823:
XXVMüller et autres c. Suisse, 24
- Page 824 and 825:
XXVIIShaal c. Luxembourg, n o 51773
- Page 826 and 827:
XXIXSITES ELECTRONIQUES CITEShttp:/
- Page 828 and 829:
XXXI2. Le rôle de la notion d’é
- Page 830 and 831:
XXXIIIa. Au sein du droit grec 123L
- Page 832 and 833:
XXXV1. La définition établie par
- Page 834 and 835:
XXXVIIA. Handicap physique et de d
- Page 836 and 837:
XXXIXA. Le renforcement des garanti
- Page 838 and 839:
XLIb. Les progrès en droit frança
- Page 840 and 841:
XLIIITRAVAIL PARTICULIERE§ 1. Les
- Page 842 and 843:
XLV2. La survivance d’autres cons
- Page 844 and 845:
XLVIIA. L’application assurée pa
- Page 846:
RésuméDepuis les années 1970, no