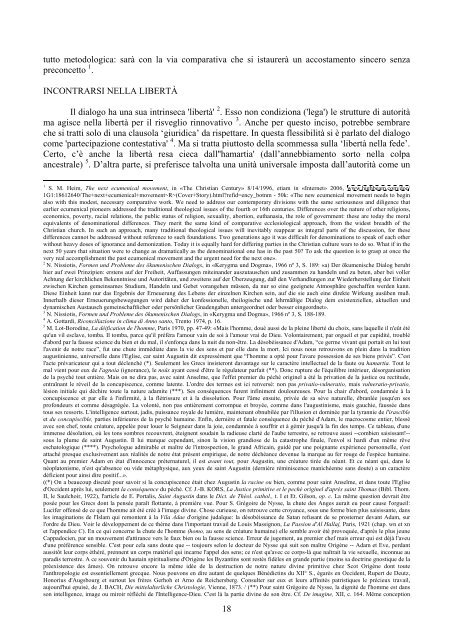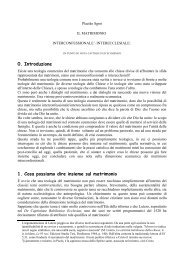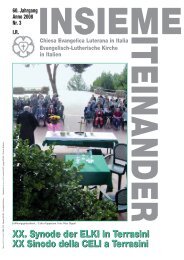Il dialogo ecumenico e interreligioso: quale futuro? - Nemesistemi
Il dialogo ecumenico e interreligioso: quale futuro? - Nemesistemi
Il dialogo ecumenico e interreligioso: quale futuro? - Nemesistemi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
tutto metodologica: sarà con la via comparativa che si istaurerà un accostamento sincero senza<br />
preconcetto 1 .<br />
INCONTRARSI NELLA LIBERTÀ<br />
<strong>Il</strong> <strong>dialogo</strong> ha una sua intrinseca 'libertà' 2 . Esso non condiziona ('lega') le strutture di autorità<br />
ma agisce nella libertà per il risveglio rinnovativo 3 . Anche per questo inciso, potrebbe sembrare<br />
che si tratti solo di una clausola giuridica da rispettare. In questa flessibilità si è parlato del <strong>dialogo</strong><br />
come 'partecipazione contestativa' 4 . Ma si tratta piuttosto della scommessa sulla libertà nella fede .<br />
Certo, c è anche la libertà resa cieca dall''hamartia' (dall annebbiamento sorto nella colpa<br />
ancestrale) 5 . D altra parte, si preferisce talvolta una unità universale imposta dall autorità come un<br />
1 S. M. Heim, The next ecumenical movement, in «The Christian Century» 8/14/1996, etiam in «Internet» 2006, www.highbeam.com/doc/<br />
1G1:18612640/The+next+ecumenical+movement~R~(Cover+Story).html?refid=ency_botnm - 50k: «The new ecumenical movement needs to begin<br />
also with this modest, necessary comparative work. We need to address our contemporary divisions with the same seriousness and diligence that<br />
earlier ecumenical pioneers addressed the traditional theological issues of the fourth or 16th centuries. Differences over the nature of other religions,<br />
economics, poverty, racial relations, the public status of religion, sexuality, abortion, euthanasia, the role of government: these are today the moral<br />
equivalents of denominational differences. They merit the same kind of comparative ecclesiological approach, from the widest breadth of the<br />
Christian church. In such an approach, many traditional theological issues will inevitably reappear as integral parts of the discussion, for these<br />
differences cannot be addressed without reference to such foundations. Two generations ago it was difficult for denominations to speak of each other<br />
without heavy doses of ignorance and demonization. Today it is equally hard for differing parties in the Christian culture wars to do so. What if in the<br />
next 50 years that situation were to change as dramatically as the denominational one has in the past 50? To ask the question is to grasp at once the<br />
very real accomplishment the past ecumenical movement and the urgent need for the next one».<br />
2 N. Nissiotis, Formen und Probleme des ökumenischen Dialogs, in «Kerygma und Dogma», 1966 nº 3, S. 189: «a) Der ökumenische Dialog beruht<br />
hier auf zwei Prinzipien: erstens auf der Freiheit, Auffassungen miteinander auszutauschen und zusammen zu handeln und zu beten, aber bei voller<br />
Achtung der kirchlichen Bekenntnisse und Autoritäten, und zweitens auf der Überzeugung, daß den Verhandlungen zur Wiederherstellung der Einheit<br />
zwischen Kirchen gemeinsames Studium, Handeln und Gebet vorangehen müssen, da nur so eine geeignete Atmosphäre geschaffen werden kann.<br />
Diese Einheit kann nur das Ergebnis der Erneuerung des Lebens der einzelnen Kirchen sein, auf die sie auch eine direkte Wirkung ausüben muß.<br />
Innerhalb dieser Erneuerungsbewegungen wird daher der konfessionelle, theilogische und lehrmäßige Dialog dem existenziellen, aktuellen und<br />
dynamischen Austausch gemeinschaftlicher oder persönlicher Gnadengaben untergeordnet oder besser eingeordnet».<br />
3 N. Nissiotis, Formen und Probleme des ökumenischen Dialogs, in «Kerygma und Dogma», 1966 nº 3, S. 188-189.<br />
4 A. Gottardi, Riconciliazione in clima di Anno santo, Trento 1974, p. 16.<br />
5 M. Lot-Borodine, La déification de l'homme, Paris 1970, pp. 47-49: «Mais l'homme, doué aussi de la pleine liberté du choix, sans laquelle il n'eût été<br />
qu'un vil esclave, tomba. <strong>Il</strong> tomba, parce qu'il préféra l'amour vain de soi à l'amour vrai de Dieu. Volontairement, par orgueil et par cupidité, troublé<br />
d'abord par la fausse science du bien et du mal, il s'enfonça dans la nuit du non-être. La désobéissance d'Adam, ce germe vivant qui portait en lui tout<br />
l'avenir de notre race , fut une chute immédiate dans la vie des sens et par elle dans la mort. Ici nous nous retrouvons en plein dans la tradition<br />
augustinienne, universelle dans l'Eglise, car saint Augustin dit expressément que l'homme a opté pour l'avare possession de ses biens privés . C'est<br />
l'acte prévaricateur qui a tout déclenché (*). Seulement les Grecs insisteront davantage sur le caractère intellectuel de la faute ou hamartia. Tout le<br />
mal vient pour eux de l'agnoia (ignorance), le noûs ayant cessé d'être le régulateur parfait (**). Donc rupture de l'équilibre intérieur, désorganisation<br />
de la psyché tout entière. Mais on ne dira pas, avec saint Anselme, que l'effet premier du péché originel a été la privation de la justice ou rectitude,<br />
entraînant le réveil de la concupiscence, comme latente. L'ordre des termes est ici renversé: non pas privatio-vulneratio, mais vulneratio-privatio,<br />
lésion initiale qui déchire toute la nature adamite (***). Ses conséquences furent infiniment douloureuses. Pour la chair d'abord, condamnée à la<br />
concupiscence et par elle à l'infirmité, à la flétrissure et à la dissolution. Pour l'âme ensuite, privée de sa sève naturelle, ébranlée jusqu'en ses<br />
profondeurs et comme désagrégée. La volonté, non pas entièrement corrompue et broyée, comme dans l'augustinisme, mais gauchie, faussée dans<br />
tous ses ressorts. L'intelligence surtout, jadis, puissance royale de lumière, maintenant obnubilée par l'illusion et dominée par la tyrannie de l'irascible<br />
et du concupiscible, parties inférieures de la psyché humaine. Enfin, dernière et fatale conséquence du péché d'Adam, le macrocosme entier, blessé<br />
avec son chef, toute créature, appelée pour louer le Seigneur dans la joie, condamnée à souffrir et à gémir jusqu'à la fin des temps. Ce tableau, d'une<br />
immense désolation, où les tons sombres recouvrent, éteignent soudain la radieuse clarté de l'aube terrestre, se retrouve aussi --combien saisissant!--<br />
sous la plume de saint Augustin. <strong>Il</strong> lui manque cependant, sinon la vision grandiose de la catastrophe finale, l'envol si hardi d'un même rêve<br />
eschatologique (****). Psychologue admirable et maître de l'introspection, le grand Africain, guidé par une poignante expérience personnelle, s'est<br />
attaché presque exclusivement aux réalités de notre état présent empirique, de notre déchéance devenue la marque au fer rouge de l'espèce humaine.<br />
Quant au premier Adam en état d'innocence préternaturel, il est avant tout, pour Augustin, une créature tirée du néant. Et ce néant qui, dans le<br />
néoplatonisme, n'est qu'absence ou vide métaphysique, aux yeux de saint Augustin (dernière réminiscence manichéenne sans doute) a un caractère<br />
déficient pour ainsi dire positif...».<br />
((*) On a beaucoup discuté pour savoir si la concupiscence était chez Augustin la racine ou bien, comme pour saint Anselme, et dans toute l'Eglise<br />
d'Occident après lui, seulement la conséquence du péché. Cf. J.-B. KORS, La Justice primitive et le peché originel d'après saint Thomas (Bibl. Thom.<br />
II, le Saulchoir, 1922), l'article de E. Portalis, Saint Augustin dans le Dict. de Théol. cathol., t. I et Et. Gilson, op. c. La même question devrait être<br />
posée pour les Grecs dont la pensée paraît flottante, à première vue. Pour S. Grégoire de Nysse, la chute des Anges aurait eu pour cause l'orgueil:<br />
Lucifer offensé de ce que l'homme ait été créé à l'image divine. Chose curieuse, on retrouve cette croyance, sous une forme bien plus saisissante, dans<br />
les imaginations de l'Islam qui remontent à la Vila Adae d'origine judaïque: la désobéissance de Satan refusant de se prosterner devant Adam, sur<br />
l'ordre de Dieu. Voir le développement de ce thème dans l'important travail de Louis Massignon, La Passion d'Al Hallaj, Paris, 1921 (chap. wn et xn<br />
et l'appendice C). En ce qui concerne la chute de l'homme (homo, au sens de créature humaine) elle semble avoir été provoquée, d'après le plus jeune<br />
Cappadocien, par un mouvement d'attirance vers le faux bien ou la fausse science. Erreur de jugement, au premier chef mais erreur qui est déjà l'aveu<br />
d'une préférence sensible. C'est pour cela sans doute que -- toujours selon le docteur de Nysse qui suit son maître Origène -- Adam et Eve, perdant<br />
aussitôt leur corps éthéré, prennent un corps matériel qui incarne l'appel des sens; ce n'est qu'avec ce corps-là que naîtrait la vie sexuelle, inconnue au<br />
paradis terrestre. A ce souvenir du hautain spiritualisme d'Origène les Byzantins sont restés fidèles en grande partie (moins sa doctrine gnostique de la<br />
préexistence des âmes). On retrouve encore la même idée de la destruction de notre nature divine primitive chez Scot Origène dont toute<br />
l'anthropologie est essentiellement grecque. Nous pouvons en dire autant de quelques Bénédictins du XII° S., égarés en Occident, Rupert de Deutz,<br />
Honorius d'Augsbourg et surtout les frères Gerhoh et Arno de Reichersberg. Consulter sur eux et leurs affinités patristiques le précieux travail,<br />
aujourd'hui epuisé, de J. BACH, Die mittelalterliche Christologie, Vienne, 1873. / (**) Pour saint Grégoire de Nysse, la dignité de l'homme est dans<br />
son intelligence, image ou miroir réfléchi de l'Intelligence-Dieu. C'est là la partie divine de son être. Cf. De imagine, XII, c. 164. Même conception<br />
18