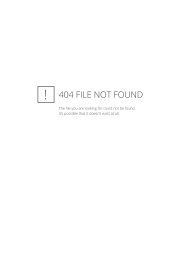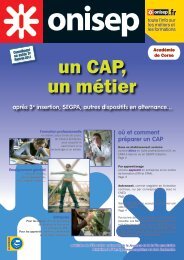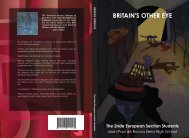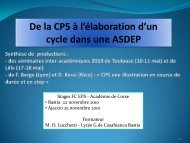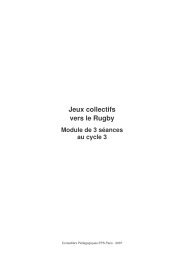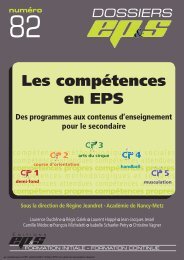Les élèves en grande difficulté au collège : Les conditions ... - Formiris
Les élèves en grande difficulté au collège : Les conditions ... - Formiris
Les élèves en grande difficulté au collège : Les conditions ... - Formiris
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3. Le point de vue du sociologue.Que peut apporter le regard du sociologue de l’éducation à une réflexion concernantl’élève <strong>en</strong> <strong>grande</strong> difficulté à l’<strong>en</strong>trée <strong>au</strong> collège ? Que peut-il apporter qui soit dans la continuitéavec les préoccupations d’<strong>en</strong>seignants réunis pour <strong>en</strong>visager les procédures les plus adéquates,du point de vue pédagogique, pour faire face <strong>au</strong>x difficultés de certains élèves ?Notre réflexion s’organisera <strong>au</strong>tour de quatre axes s’articulant sur le cont<strong>en</strong>u deséchanges observés lors de la session :- place de l’<strong>en</strong>seignant et modalités de l’action pédagogique- place du collège dans le système scolaire- le souhaitable et le possible : la question du « socle commun »- l’expéri<strong>en</strong>ce scolaire des élèvesPlace de l’<strong>en</strong>seignant et modalités de l’action pédagogiqueSelon une formule lég<strong>en</strong>daire, « le maître serait seul maître après Dieu dans sa classe ».Ce bon mot exprimerait, s’il était conforme à la réalité, à la fois la solitude et l’aspiration à latoute puissance que confère le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de n’avoir pas de compte à r<strong>en</strong>dre (s<strong>au</strong>f à l’<strong>au</strong>toritésupérieure) et surtout de n’avoir pas à se montrer <strong>au</strong>x <strong>au</strong>tres <strong>en</strong> s’<strong>en</strong>gageant dans un difficileprocessus d’échange des points de vue. L’isolem<strong>en</strong>t du maître, tel qu’évoqué, serait par là unesolution de facilité dans la mesure où il permettrait d’échapper <strong>au</strong> regard de l’<strong>au</strong>tre.Ri<strong>en</strong> de cela ne s’exprime ici. Bi<strong>en</strong> <strong>au</strong> contraire, toutes les demandes converg<strong>en</strong>t poursouligner la nécessité du « travail d’équipe » et le développem<strong>en</strong>t de la coopération afin de faireface. A supposer qu’elle ait marqué une époque, la formule de lég<strong>en</strong>de n’est donc plus de mise.Cette représ<strong>en</strong>tation appelle une réflexion qui permet de suivre l’analyse de F. Dubetqui, à l’écoute des <strong>en</strong>seignants, relève que ces derniers « décriv<strong>en</strong>t leurs pratiques non <strong>en</strong> termesde rôles mais <strong>en</strong> termes d’expéri<strong>en</strong>ce. D’un côté, ils sont pris dans un statut imposant desrègles… D’un <strong>au</strong>tre côté, les <strong>en</strong>seignants se réfèr<strong>en</strong>t sans cesse à une interprétation personnellede leur fonction à travers la construction d’un métier... » (Sociologie de l’expéri<strong>en</strong>ce p.16)Place du collège dans le système scolaire<strong>Les</strong> investigations m<strong>en</strong>ées sur les collèges par F. Dubet et M. Duru à la demande duministère aboutiss<strong>en</strong>t à un rapport <strong>en</strong> 1999. Ce qui a permis de poser, sinon de résoudre, ladélicate question de savoir si le collège constitue la dernière phase de la scolarisationobligatoire ou si, <strong>au</strong> contraire, il représ<strong>en</strong>te une propédeutique à la poursuite év<strong>en</strong>tuelled’études. Cette interrogation plonge ses racines dans l’histoire de l’institution scolaire <strong>en</strong>France. Sous la Troisième république, deux rése<strong>au</strong>x de scolarisation différ<strong>en</strong>ciés par l’originesociale de leurs publics reçoiv<strong>en</strong>t la population scolaire. Pour les <strong>en</strong>fants du « peuple », lascolarité obligatoire primaire élém<strong>en</strong>taire, év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t prolongée pour l’élite par un<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t primaire supérieur ; pour les <strong>en</strong>fants des milieux favorisés, le lycée dans sacontinuité depuis le « petit lycée ». Dans le premier cas, l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t post-élém<strong>en</strong>taire est unaboutissem<strong>en</strong>t pour quelques-uns, dans le second, ce que certains appell<strong>en</strong>t <strong>au</strong>jourd’hui« <strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t moy<strong>en</strong> » ne constitue qu’un passage vers le baccal<strong>au</strong>réat. <strong>Les</strong> racines duproblème sont à chercher à ce nive<strong>au</strong>. Avec la réalisation de l’école unique, tout se brouille etl’ambival<strong>en</strong>ce éclate <strong>au</strong> grand jour. <strong>Les</strong> sociologues de l’éducation mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> lumière cetteambival<strong>en</strong>ce qui n’est pas sans conséqu<strong>en</strong>ce sur les pratiques des <strong>en</strong>seignants, tiraillés <strong>en</strong>tre9/53