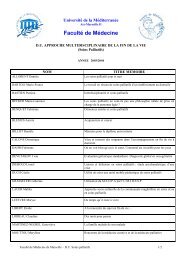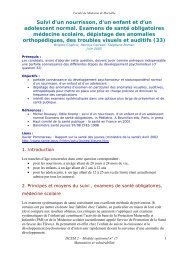Ictères (320) - Serveur pédagogique de la Faculté de Médecine de ...
Ictères (320) - Serveur pédagogique de la Faculté de Médecine de ...
Ictères (320) - Serveur pédagogique de la Faculté de Médecine de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Faculté</strong> <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Marseille<br />
efficace <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die. Après transp<strong>la</strong>ntation, <strong>la</strong> survie à 5 ans est <strong>la</strong> même que dans d’autres<br />
groupes <strong>de</strong> transp<strong>la</strong>ntés mais <strong>de</strong>s récidives tardives sont possibles.<br />
Atteintes congénitales : ce sont <strong>de</strong>s affections <strong>de</strong> l’enfant (voir plus loin). Rarement <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die<br />
d’A<strong>la</strong>gille peut être découverte chez l’adulte jeune.<br />
5.2.3.2.3. Cholestases liées à une infiltration tumorale<br />
hépatique<br />
Une cholestase anictérique peut être révé<strong>la</strong>trice <strong>de</strong> métastases hépatiques ou<br />
d’hépatocarcinome<br />
30 % <strong>de</strong>s ma<strong>la</strong><strong>de</strong>s ayant un lymphome évolué ont une cholestase en général par<br />
infiltration tumorale hépatique. Parfois <strong>la</strong> cholestase précè<strong>de</strong> les lésions lymphomateuses.<br />
5.2.3.3. Cholestase avec atteinte <strong>de</strong>s importantes voies biliaires<br />
5.2.3.3.1. Etiologies non tumorales<br />
Assez souvent <strong>la</strong> cholestase est variable et se manifeste lors <strong>de</strong> poussées d’angiocholites<br />
fréquentes en cas d’obstruction incomplète <strong>de</strong>s voies biliaires.<br />
5.2.3.3.1.1. Calculs <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie biliaire principale (voir<br />
question lithiase biliaire) :<br />
Ils représentent <strong>la</strong> cause <strong>la</strong> plus fréquente <strong>de</strong>s étiologies non tumorales <strong>de</strong>s cholestases et sont le<br />
plus souvent en rapport avec <strong>la</strong> lithiase biliaire commune. Environ 10 % <strong>de</strong>s porteurs <strong>de</strong> lithiase<br />
vésicu<strong>la</strong>ire ont <strong>de</strong>s calculs cholédociens. Dans <strong>la</strong> forme comme il est rare mais possible d’avoir<br />
un calcul cholédocien sans lithiase vésicu<strong>la</strong>ire déce<strong>la</strong>ble sans doute parce que <strong>la</strong> migration<br />
concerne un calcul unique. Après cholécystectomie pour lithiase on trouve à peu près le même<br />
pourcentage <strong>de</strong> 10 % <strong>de</strong> lithiase <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie biliaire. Ceci est du en gran<strong>de</strong> partie au risque <strong>de</strong><br />
récidive tardive post opératoire. Certain <strong>de</strong> ces calculs restent sans doute longtemps<br />
asymptomatiques. Les complications principales sont l’angiocholite et <strong>la</strong> pancréatite aiguë. Les<br />
accès répétés d’angiocholite, en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s risques infectieux, favorisent <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> calculs<br />
additionnels pigmentaires.<br />
Rarement les calculs <strong>de</strong> <strong>la</strong> voie biliaire principale se traduisent par un ictère nu pseudo<br />
néop<strong>la</strong>sique.<br />
Rarement, les calculs peuvent être intra hépatiques avec ou sans lithiase du cholédoque. Ils sont<br />
souvent liés alors à <strong>de</strong>s angiocholites à répétition liées à <strong>de</strong>s anomalies congénitales, <strong>de</strong>s<br />
parasitoses ou <strong>de</strong>s séquelles post chirurgie biliaire.<br />
La voie biliaire n’étant pas di<strong>la</strong>tée dans plus <strong>de</strong> 50 % <strong>de</strong>s cas, le diagnostic échographique est<br />
difficile. Les examens les plus performants sont <strong>la</strong> cho<strong>la</strong>ngiographie IRM et l’écho-endoscopie.<br />
5.2.3.3.1.2. Sténoses bénignes <strong>de</strong>s voies biliaires :<br />
Ce sont le plus souvent <strong>de</strong>s complications <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie biliaire : p<strong>la</strong>ie du cholédoque qui passe<br />
inaperçue en per opératoire dans 15 % <strong>de</strong>s cas, suites compliquées d’anastomoses biliodigestives.<br />
Le diagnostic est fait habituellement sur l’existence <strong>de</strong> crises d’angiocholite. Certaines bactéries<br />
hydrolysent <strong>la</strong> bilirubine conjuguée en bilirubine libre peu soluble qui précipite sous forme<br />
souvent <strong>de</strong> sels <strong>de</strong> calcium. Les crises répétées entraînent donc <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> calculs<br />
pigmentaires.<br />
En cas d’interruption complète du flux biliaire on observe un ictère nu cholestatique parfois<br />
précédé par une fistule biliaire si <strong>la</strong> sténose est secondaire à une p<strong>la</strong>ie.<br />
DCEM2 – Module 12 « Hépato-Gastro-Entérologie » 13