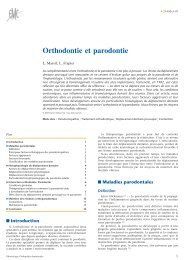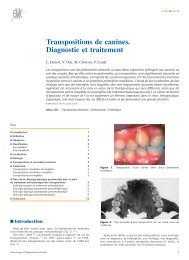Pathologie non traumatique de l'articulation ... - Belbacha Dental
Pathologie non traumatique de l'articulation ... - Belbacha Dental
Pathologie non traumatique de l'articulation ... - Belbacha Dental
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
23-446-D-10 <strong>Pathologie</strong> <strong>non</strong> <strong>traumatique</strong> <strong>de</strong> l’articulation temporomandibulaire Odontologie<br />
séquence en ouverture buccale maximale. Le maintien prolongé <strong>de</strong><br />
cette position inconfortable imposée par <strong>de</strong>s dispositifs rigi<strong>de</strong>s est<br />
source <strong>de</strong> fatigue, <strong>de</strong> spasmes musculaires, qui créent <strong>de</strong>s conditions<br />
néfastes à l’obtention d’imagerie <strong>de</strong> qualité, correspondant à la<br />
réalité. Ils pensent que l’examen <strong>de</strong>vrait être effectué en ouverture<br />
partielle, juste avant l’apparition du bruit articulaire, position où<br />
l’image du disque leur apparaît la meilleure. Il semble actuellement<br />
difficile <strong>de</strong> se passer du temps d’examen en « bouche ouverte », le<br />
<strong>de</strong>gré d’ouverture étant une affaire d’école et d’habitu<strong>de</strong>, sujet d’un<br />
débat que l’avenir arbitrera. Seuls les cas où la réductibilité est<br />
cliniquement certaine pourraient permettre <strong>de</strong> s’en dispenser.<br />
L’inci<strong>de</strong>nce frontale <strong>de</strong>vrait être systématique. Elle montre<br />
précisément l’éventuel déplacement discal en <strong>de</strong>dans ou en <strong>de</strong>hors<br />
du condyle, et révèle parfois un aspect <strong>de</strong>ntelé microgéodique <strong>de</strong>s<br />
contours <strong>de</strong> la tête condylienne, éventuellement méconnu sur le<br />
profil. L’imagerie pondérée en T2 apporte <strong>de</strong>s informations<br />
supplémentaires, notamment une meilleure appréciation <strong>de</strong> l’état<br />
méniscal, et révèle la présence <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong> intra-articulaire ou<br />
d’adhérence capsulosynoviale. Il faut convenir que, pour<br />
intéressantes qu’elles soient, ces informations n’ont, pour l’instant,<br />
qu’une valeur décisionnelle mo<strong>de</strong>ste. Les séquences d’acquisition en<br />
T2 accroissent malheureusement le temps <strong>de</strong> l’examen, donc<br />
l’occupation d’un appareillage très fortement sollicité.<br />
L’IRM doit logiquement continuer à occuper une position<br />
dominante dans l’avenir. Le raccourcissement du temps d’examen<br />
par l’utilisation <strong>de</strong> séquences nouvelles (bascule angulaire partielle,<br />
GRASS [Gradient Recall Acquisition in the Steady State]) fournira<br />
probablement dans un avenir proche <strong>de</strong>s vues dynamiques,<br />
approchant la vision articulaire en temps réel, d’une qualité<br />
satisfaisante. D’implication bien plus lointaine nous semble l’analyse<br />
spectroscopique (pH, accumulation <strong>de</strong> lactate) <strong>de</strong> la structure<br />
méniscale et <strong>de</strong> son environnement immédiat. Les problèmes<br />
majeurs consistent en une accessibilité difficile <strong>de</strong> l’IRM compte tenu<br />
du petit nombre d’appareils en service, mais aussi en la réalisation<br />
d’examens parfois <strong>de</strong> piètre qualité qui ne vont pas rendre les<br />
services attendus. Cette mauvaise qualité <strong>de</strong> bon nombre d’examens<br />
nous semble directement fonction <strong>de</strong> l’intérêt que le radiologue<br />
porte à cette pathologie.<br />
Échographie<br />
La possibilité d’exploration échographique <strong>de</strong> l’articulation<br />
temporomandibulaire a été soulignée par Stefanoff [85] . Le disque<br />
articulaire est i<strong>de</strong>ntifié par une image hypoéchogène cernée par<br />
<strong>de</strong>ux liserés hyperéchogènes, se situant au pôle supérieur du<br />
condyle. Dans les articulations normales, en position <strong>de</strong> repos,<br />
l’image discale se situe à la partie antérosupérieure du condyle.<br />
Pendant les mouvements d’ouverture-fermeture, elle suit<br />
harmonieusement et sans à-coup les mouvements <strong>de</strong> translation<br />
condyliens. Dans les luxations discales réductibles, on peut juger <strong>de</strong><br />
la position antérieure du disque ainsi que du rattrapage<br />
condyloméniscal. Dans les luxations discales irréductibles, le disque<br />
est en général <strong>non</strong> visible. Il est parfois possible d’apprécier<br />
grossièrement les anomalies structurales méniscales.<br />
Cependant, cet examen semble dans l’ensemble difficile à interpréter<br />
dans la majorité <strong>de</strong>s cas, en raison <strong>de</strong> la distinction difficile entre<br />
disque et tissus rétrodiscaux, et <strong>de</strong>s difficultés anatomiques liées à<br />
l’existence <strong>de</strong> structures osseuses. Il s’agit d’un examen très<br />
opérateur-dépendant. Des progrès technologiques doivent être<br />
réalisés avant que cet examen ne soit utilisable, surtout comme<br />
examen <strong>de</strong> dépistage (Emshoff, 1997 ; Scheffer, 1997). Son intérêt<br />
actuel semble être surtout dans les étu<strong>de</strong>s épidémiologiques.<br />
Scintigraphie<br />
La scintigraphie osseuse a été proposée pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’articulation<br />
temporomandibulaire. Ses inconvénients majeurs sont bien sûr son<br />
absence <strong>de</strong> spécificité et son manque <strong>de</strong> résolution. La plupart <strong>de</strong>s<br />
lésions peuvent être détectées par une hyperfixation, mais l’examen<br />
est incapable <strong>de</strong> déterminer s’il s’agit d’une lésion tumorale,<br />
inflammatoire, ou dégénérative. La seule indication <strong>de</strong> la<br />
14<br />
scintigraphie semble concerner certaines tumeurs bénignes osseuses<br />
où l’on recherche une forme polyostotique par un balayage corporel.<br />
Allwright a évoqué plus récemment l’intérêt d’un examen <strong>de</strong> type<br />
single photon emission computed tomography pour évaluer l’évolutivité<br />
<strong>de</strong>s hyperplasies condyliennes, Katzberg (1984) propose <strong>de</strong> l’utiliser<br />
pour détecter les atteintes osseuses dans les dysfonctionnements<br />
articulaires.<br />
AXIOGRAPHIE<br />
L’axiographie est un enregistrement graphique <strong>de</strong>s mouvements du<br />
condyle mandibulaire. C’est Slavicek [83] qui a montré son intérêt<br />
dans l’étu<strong>de</strong> spécifique <strong>de</strong> la pathologie <strong>de</strong> l’articulation<br />
temporomandibulaire. Cet examen <strong>de</strong>vrait être réalisé dans tous les<br />
cas, mais il est indispensable lorsqu’un traitement orthodontique est<br />
programmé. Avant la réalisation <strong>de</strong> l’axiographie, il est souhaitable<br />
<strong>de</strong> lever les spasmes musculaires, et donc <strong>de</strong> faire porter au patient<br />
une plaque <strong>de</strong> libération occlusale. L’avantage <strong>de</strong> l’axiographie est<br />
d’être un témoin objectif <strong>de</strong> l’évolution du fonctionnement<br />
articulaire. Il s’agit d’un document médicolégal dans les traitements<br />
prothétiques <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> envergure ou les traitements orthodontiques.<br />
L’axiographe est par conséquent un pantographe qui transcrit les<br />
mouvements <strong>de</strong>s condyles mandibulaires. Ces mouvements sont<br />
enregistrés dans les trois dimensions <strong>de</strong> l’espace. Un axiographe est<br />
donc composé <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux parties : un arc péricrânien, qui s’appuie sur<br />
la région frontonasale et supporte <strong>de</strong>s « drapeaux » d’enregistrement<br />
latéraux, et un arc mandibulaire mobile (arc d’enregistrement),<br />
solidarisé aux <strong>de</strong>nts mandibulaires au moyen d’une fourchette <strong>de</strong><br />
fixation occlusale. Cet arc d’enregistrement est relié à <strong>de</strong>ux bras<br />
latéraux qui supportent <strong>de</strong>s stylets <strong>de</strong> détermination <strong>de</strong> l’axe<br />
charnière, <strong>de</strong>s porte-mines pour tracer les mouvements condyliens<br />
dans le plan sagittal et un comparateur à cadran <strong>de</strong>stiné à<br />
enregistrer les mouvements transversaux <strong>de</strong>s condyles.<br />
L’examen débute par la localisation du point d’émergence <strong>de</strong> l’axe<br />
charnière, qui se fait par tâtonnements successifs, cette<br />
détermination nécessitant l’absence <strong>de</strong> contracture au niveau <strong>de</strong>s<br />
muscles masticateurs pour être valable. Deux séries <strong>de</strong> tracés sont<br />
effectuées <strong>de</strong> chaque côté, une série <strong>de</strong> tracés avec <strong>de</strong>s mouvements<br />
guidés par l’opérateur et une série avec <strong>de</strong>s mouvements <strong>non</strong> guidés<br />
(fig 21).<br />
Dans le plan horizontal, les tracés sont normalement rectilignes en<br />
propulsion et à l’ouverture. Une déviation supérieure à 0,5 mm<br />
montre une entrave à la translation antérieure. Lors <strong>de</strong>s<br />
mouvements <strong>de</strong> latéralité, le condyle <strong>non</strong> travaillant décrit une<br />
courbe à convexité interne qui résulte du mouvement <strong>de</strong> Bennet. Un<br />
mouvement transversal supérieur à 1 mm est considéré comme<br />
pathologique. Après 2 ou 3 mm d’excursion, le processus condylien<br />
suit une ligne orientée d’arrière en avant <strong>de</strong> 8° à 10° vers le côté<br />
médial. Toute déviation latérale du condyle évoque un processus<br />
pathologique.<br />
Dans le sens sagittal, les enregistrements décrivent une courbe à<br />
concavité supérieure. Les tracés d’ouverture <strong>de</strong> propulsion et <strong>de</strong><br />
médiotrusion sont superposés dans les 8à10premiers millimètres.<br />
Au-<strong>de</strong>là, le tracé d’ouverture remonte en direction crâniale et son<br />
rayon <strong>de</strong> courbure diminue. Les tracés d’aller et <strong>de</strong> retour sont<br />
confondus. L’amplitu<strong>de</strong> moyenne <strong>de</strong>s enregistrements est <strong>de</strong> 14 mm<br />
à l’ouverture, 11 mm en propulsion et 13 mm en latéralité. La pente<br />
<strong>de</strong>s tracés par rapport au plan axio-orbitaire <strong>de</strong> référence est<br />
comprise entre 40° et 60° dans les 5 premiers millimètres d’excursion<br />
condylienne. Les mouvements <strong>de</strong> retour doivent se terminer au<br />
point <strong>de</strong> référence.<br />
Ces tracés axiographiques peuvent subir un grand nombre<br />
d’altérations, suivant les pathologies rencontrées.<br />
– En cas <strong>de</strong> luxation discale réductible, l’amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s tracés est<br />
souvent augmentée à l’ouverture et on observe une déviation<br />
caudale du tracé signant le passage <strong>de</strong> la tête condylienne sous le<br />
bourrelet postérieur, la déviation se reproduit lors <strong>de</strong>s mouvements<br />
<strong>de</strong> fermeture. Dans le sens horizontal, les tracés indiquent les