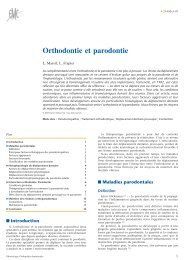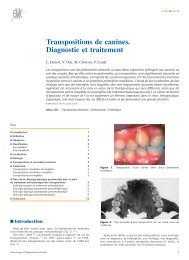Pathologie non traumatique de l'articulation ... - Belbacha Dental
Pathologie non traumatique de l'articulation ... - Belbacha Dental
Pathologie non traumatique de l'articulation ... - Belbacha Dental
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
23-446-D-10 <strong>Pathologie</strong> <strong>non</strong> <strong>traumatique</strong> <strong>de</strong> l’articulation temporomandibulaire Odontologie<br />
PATHOLOGIE DISCALE<br />
Luxation condylodiscale antérieure<br />
Incontestablement, les anomalies <strong>de</strong> l’appareil discal <strong>de</strong> l’articulation<br />
temporomandibulaire représentent, et <strong>de</strong> loin, l’atteinte la plus<br />
fréquente <strong>de</strong> cette articulation.<br />
Les atteintes <strong>de</strong> l’appareil discal ne sont certainement pas univoques,<br />
et il en existe un certain nombre d’origines intrinsèques,<br />
« constitutionnelles », ou résultant d’une perte <strong>de</strong> l’intégrité <strong>de</strong> cet<br />
appareil sous l’effet <strong>de</strong> maladies générales ou rhumatologiques. Mais<br />
l’immense majorité <strong>de</strong>s anomalies est due à <strong>de</strong>s troubles<br />
fonctionnels.<br />
Deux facteurs étiologiques sont difficilement discutables : les<br />
relations occlusales dysharmonieuses et l’hyperfonction musculaire,<br />
ces <strong>de</strong>ux facteurs étant le plus souvent intriqués entre eux, dans une<br />
relation <strong>de</strong> cause à effet qui n’est pas univoque. Le troisième facteur<br />
le plus souvent évoqué est un facteur psychique. S’il est indiscutable<br />
que ce facteur psychique joue un rôle, soit dans la perception et<br />
l’expression <strong>de</strong> la symptomatologie, soit sur le fonctionnement<br />
musculaire, on peut difficilement le considérer comme causal. Il est<br />
évi<strong>de</strong>nt qu’il convient d’en tenir compte.<br />
Ces difficultés expliquent les différentes approches <strong>de</strong> cette<br />
pathologie. Déjà au niveau <strong>de</strong> cette dénomination, il existe une<br />
gran<strong>de</strong> variété. La plus ancienne dénomination, qui reste une <strong>de</strong>s<br />
plus connues, est celle <strong>de</strong> syndrome <strong>de</strong> Costen. James Costen, en<br />
1934 [17] , avait décrit ce syndrome dû d’après lui à une « compression<br />
du toit <strong>de</strong> la fosse mandibulaire », générateur <strong>de</strong> troubles<br />
auriculaires, <strong>de</strong> douleurs du vertex, <strong>de</strong> l’occiput et <strong>de</strong> douleurs<br />
temporales, le tout provoqué par <strong>de</strong>s é<strong>de</strong>ntations partielles.<br />
Schwartz [82] , en 1956, avait parlé <strong>de</strong> syndrome algique<br />
dysfonctionnel <strong>de</strong> l’articulation temporomandibulaire, insistant sur<br />
l’incoordination musculaire dans l’étiopathogénie <strong>de</strong> ces troubles.<br />
En 1970, Rozencweig et Gosserez ont proposé le terme <strong>de</strong> SADAM,<br />
permettant <strong>de</strong> réunir les différentes variantes symptomatiques<br />
musculaires, articulaires ou musculoarticulaires. À la même époque,<br />
Farrar [28] propose le terme <strong>de</strong> troubles craniomandibulaires ou celui<br />
<strong>de</strong> désordre craniomandibulaire. Rozencweig en 1994 [77] , propose le<br />
terme générique d’« algies et dysfonctionnement <strong>de</strong> l’appareil<br />
manducateur ». On parle également habituellement <strong>de</strong><br />
dysfonctionnement discocondylien ou <strong>de</strong> « dérangement interne »<br />
<strong>de</strong> l’articulation. Aucune <strong>de</strong> ces dénominations n’est entièrement<br />
satisfaisante. Sans doute celle <strong>de</strong> Rozencweig est-elle la plus<br />
appropriée.<br />
Les différentes classifications proposées ne semblent pas<br />
satisfaisantes. Si l’on prend comme exemple celle recommandée par<br />
l’International Headache Society (Ma, 1998) ou bien la classification<br />
<strong>de</strong> Stegenga [86] , on se rend compte que ces classifications n’ont pas<br />
<strong>de</strong> connotations étiologiques ou pathogéniques et qu’elles ne<br />
peuvent prendre en charge les patients présentant <strong>de</strong>s atteintes<br />
portant sur plusieurs systèmes (musculaires, ligamentaires,<br />
osseux…). Surtout, elles ne ren<strong>de</strong>nt pas compte <strong>de</strong> l’évolution dans<br />
le temps <strong>de</strong>s différentes atteintes.<br />
Ces troubles comprennent en effet une gran<strong>de</strong> variété <strong>de</strong><br />
symptômes, car l’atteinte peut y être, temporairement ou <strong>non</strong>,<br />
musculaire, articulaire ou musculoarticulaire, et/ou osseuse.<br />
Épidémiologie<br />
Les syndromes <strong>de</strong> dysfonctionnement sont <strong>de</strong>s affections très<br />
courantes. Selon l’American Aca<strong>de</strong>my of Cranio-Mandibular<br />
Disor<strong>de</strong>rs (1990), 75 % <strong>de</strong> la population examinée présentent un<br />
signe <strong>de</strong> dysfonction <strong>de</strong> l’articulation temporomandibulaire. Sans<br />
aller jusqu’à ces chiffres, les étu<strong>de</strong>s retrouvent dans la population<br />
examinée environ 30 à 40 % <strong>de</strong> signes cliniques <strong>de</strong><br />
dysfonctionnement plus ou moins sévères chez les adultes<br />
(Axelsson, 1987 ; Locker, 1988 ; Agerberg, 1989 ; De Kanter, 1993 ;<br />
Goulet, 1995 ; Matsuka, 1996), <strong>de</strong> 30 à 40 % chez les adolescents<br />
(Ab<strong>de</strong>l-Hakim, 1996 ; Conti, 1996), <strong>de</strong> 7 % à 17 % chez les enfants<br />
(Keeling, 1994 ; Deng, 1995 ; Stockstill, 1998), les chiffres étant<br />
beaucoup plus variables, <strong>de</strong> 22 à 80 %, chez les personnes âgées (Ow,<br />
1995 ; Hiltunen, 1995).<br />
26<br />
La prédominance féminine <strong>de</strong>s patients est bien connue : les chiffres<br />
varient dans la proportion <strong>de</strong> trois pour un à neuf pour un.<br />
Cependant, dans la population courante, les signes et symptômes<br />
sont à peine légèrement supérieurs pour le genre féminin<br />
(Rozencweig). L’explication <strong>de</strong> cette prédominance féminine n’est<br />
pas claire : plus gran<strong>de</strong> fréquentation <strong>de</strong>s cabinets médicaux par les<br />
femmes ? Plus gran<strong>de</strong> attention portée à la symptomatologie ?<br />
Prédisposition génétique ? Facteurs hormonaux (Abubaker) ?<br />
Posture favorisante ? Facteurs psychiques ou psychologiques ?<br />
Infection à Chlamydia ?<br />
Facteurs étiologiques<br />
• Trouble occlusal<br />
Les idées sur l’étiologie <strong>de</strong>s dysfonctionnements discocondyliens<br />
sont passées par plusieurs sta<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>scription par Costen<br />
en 1934 <strong>de</strong> son syndrome. Dans les premières années, Costen et<br />
Sicher en 1948 (même si <strong>de</strong>s désaccords existaient entre eux sur un<br />
certain nombre <strong>de</strong> détails, en particulier sur la responsabilité <strong>de</strong><br />
l’articulation temporomandibulaire dans les troubles otologiques),<br />
Ackermann en 1953 [3] , Schwartz en 1956, étaient partisans d’une<br />
étiologie essentiellement occlusale <strong>de</strong> ces troubles. Laskin [56] en 1969,<br />
par sa théorie psychophysiologique, insiste sur l’importance <strong>de</strong><br />
l’action musculaire dans l’occlusion et différencie la malocclusion<br />
primaire, considérée comme facteur étiologique, <strong>de</strong> la malocclusion<br />
acquise, résultat d’un déséquilibre musculaire. Depuis quelques<br />
années, on a tendance à nier l’importance <strong>de</strong>s troubles occlusaux<br />
dans la genèse <strong>de</strong> ce syndrome, l’expliquant soit par <strong>de</strong>s troubles<br />
psychologiques, soit par un dysfonctionnement musculaire primaire.<br />
Les données épidémiologiques réalisées sur les liens entre troubles<br />
occlusaux et pathologie articulaire ne sont pas significatives et<br />
semblent difficiles à interpréter en raison <strong>de</strong> leur dispersion en<br />
termes d’âge, <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> variété <strong>de</strong>s troubles occlusaux<br />
susceptibles d’êtres rencontrés et qui ne sont pas tous différenciés,<br />
<strong>de</strong> la prise en compte <strong>de</strong> la symptomatologie articulaire et <strong>non</strong> <strong>de</strong>s<br />
lésions articulaires existantes, <strong>de</strong> la <strong>non</strong>-prise en compte <strong>de</strong> la<br />
pathologie <strong>de</strong> type rhumatologique ou post-<strong>traumatique</strong> <strong>de</strong><br />
l’articulation.<br />
Certaines étu<strong>de</strong>s semblent montrer <strong>de</strong>s corrélations (Egermark [23] ;<br />
Gazit, 1984 ; Brandt, 1985 ; Nesbitt, 1985 ; Thilan<strong>de</strong>r, 1985 ; Nilner,<br />
1986 ; Solberg, 1986 ; Riolo, 1987 ; Pullinger, 1988 ; Seligman, 1989 ;<br />
Fuschima, 1989 ; Blanchard, 1990 ; Kernstein, 1991 ; Motegi [68] ;<br />
Paesani, 1992 ; Wang, 1994 ; Miyazaki, 1994 ; De Clercq, 1995 ;<br />
Morrant, 1996 ; Katzberg [49] ; Pilley, 1997 ; Muto, 1998 ; Sonnesen,<br />
1998 ; Bosio, 1998 ; Liu, 1998 ; Inu, 1999 ; Koyabashi, 1999 ; Fushima,<br />
1999 ; Zhou, 1999 ; Ciancaglini, 1999). Certaines n’en trouvent pas,<br />
en particulier en ce qui concerne la responsabilité <strong>de</strong> l’extraction<br />
controversée <strong>de</strong>s prémolaires (Deboever, 1983 ; Gunn, 1988 ; Tosa,<br />
1990 ; Lipp, 1991 ; Beattie, 1994 ; Mc Namara, 1995 ; Ab<strong>de</strong>l-Hakim,<br />
1996 ; Conti, 1996 ; Rodriguez-Garcia, 1998), et d’autres<br />
reconnaissent qu’une conclusion est impossible (Eriksson, 1987 ;<br />
Wadhwa, 1993 ; Le Resche, 1997).<br />
Les étu<strong>de</strong>s cliniques impliquant les troubles occlusaux semblent<br />
confortées par un certain nombre <strong>de</strong> travaux expérimentaux<br />
(Ishimaru [44] ;Fu [31] ).<br />
Un certain nombre d’étu<strong>de</strong>s montrent qu’un nombre important <strong>de</strong><br />
signes <strong>de</strong> dysfonctionnement constatés pendant l’enfance<br />
disparaissent spontanément (et l’on peut penser qu’ils surviennent<br />
lors <strong>de</strong>s changements <strong>de</strong> <strong>de</strong>ntition, alors que l’articulation n’a pu<br />
s’adapter au même rythme) (Ko<strong>non</strong>en, 1996).<br />
Sans doute existe-t-il <strong>de</strong>s douleurs musculaires (dues à <strong>de</strong>s spasmes<br />
selon la terminologie anglo-saxonne) dues à <strong>de</strong>s parafonctions. Dans<br />
ce cadre cependant, il nous semble qu’il vaudrait mieux évoquer les<br />
conséquences musculaires <strong>de</strong>s parafonctions (y compris le<br />
bruxisme). Sans doute ces parafonctions ont-elles une composante<br />
psychique. Que ce type d’anomalie entre dans le cadre du syndrome<br />
<strong>de</strong> dérangement interne <strong>de</strong> l’articulation est hautement discutable.<br />
Que ces parafonctions aggravent un dérangement interne <strong>de</strong><br />
l’appareil manducateur paraît évi<strong>de</strong>nt. Mais l’étiologie la plus