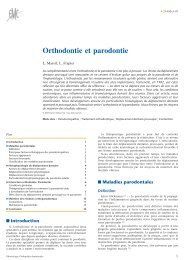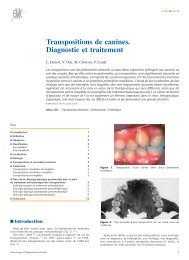Pathologie non traumatique de l'articulation ... - Belbacha Dental
Pathologie non traumatique de l'articulation ... - Belbacha Dental
Pathologie non traumatique de l'articulation ... - Belbacha Dental
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
23-446-D-10 <strong>Pathologie</strong> <strong>non</strong> <strong>traumatique</strong> <strong>de</strong> l’articulation temporomandibulaire Odontologie<br />
peut découvrir le contact prématuré car il est automatiquement<br />
contourné pour attendre l’occlusion d’intercuspidation maximale<br />
par un réflexe conditionné.<br />
Recherche <strong>de</strong>s interférences<br />
L’examen se poursuit à la recherche d’interférences, c’est-à-dire <strong>de</strong><br />
contacts <strong>de</strong>ntaires anormaux qui perturbent les mouvements <strong>de</strong> la<br />
mandibule dans le sens horizontal, soit lors <strong>de</strong>s mouvements<br />
latéraux, soit lors <strong>de</strong>s mouvements antéropostérieurs.<br />
On peut reprendre les définitions que donne Valentin (1996) pour<br />
les interférences. Ce sont :<br />
– <strong>de</strong>s rapports occlusaux qui empêchent l’accomplissement <strong>de</strong>s<br />
fonctions <strong>de</strong>ntaires ;<br />
– <strong>de</strong>s rapports occlusaux qui engendrent <strong>de</strong>s mouvements ou <strong>de</strong>s<br />
comportements délétères ;<br />
– <strong>de</strong>s rapports occlusaux qui engendrent <strong>de</strong>s adaptations <strong>de</strong>ntaires<br />
ou parodontales délétères ;<br />
– <strong>de</strong>s rapports occlusaux qui engendrent <strong>de</strong>s adaptations<br />
musculosquelettiques délétères.<br />
Examen <strong>de</strong>s contacts en protrusion<br />
Le mouvement fonctionnel <strong>de</strong> protrusion représente le trajet<br />
qu’effectue la mandibule, lorsque les incisives inférieures glissent<br />
sur les faces palatines <strong>de</strong>s incisives supérieures, <strong>de</strong>puis la position<br />
d’intercuspidation maximale jusqu’au bout à bout : c’est le trajet<br />
fonctionnel qui est à examiner. Ce trajet fonctionnel dépend <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
paramètres : le recouvrement et le surplomb. Le recouvrement est<br />
facilement déterminé : il suffit <strong>de</strong> tracer un trait sur les incisives<br />
inférieures en suivant le bord libre <strong>de</strong>s incisives centrales<br />
supérieures en position d’intercuspidation maximale, la distance du<br />
trait au bord libre <strong>de</strong>s incisives mandibulaires représente le<br />
recouvrement. L’inclinaison <strong>de</strong>s incisives supérieures se traduit,<br />
dans le plan horizontal, exception faite <strong>de</strong>s cas <strong>de</strong> classe II, par un<br />
espace entre le bord libre <strong>de</strong>s incisives supérieures et la face<br />
vestibulaire <strong>de</strong>s incisives inférieures. Cet espace, en position<br />
d’intercuspidation maximale, est appelé surplomb incisif.<br />
Tout obstacle empêchant d’aller d’une façon harmonieuse <strong>de</strong> la<br />
position d’intercuspidation maximale à la position <strong>de</strong> protrusion est<br />
appelé interférence protrusive. Les faces palatines <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux incisives<br />
centrales maxillaires (auxquelles s’ajoutent parfois celles <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
incisives latérales), <strong>de</strong>puis les points supérieurs <strong>de</strong> l’occlusion<br />
jusqu’au bord libre, constituent le gui<strong>de</strong> incisif. Ce gui<strong>de</strong> incisif doit<br />
permettre une désocclusion immédiate et totale <strong>de</strong> toutes les <strong>de</strong>nts<br />
postérieures. Il doit pouvoir conduire la protrusion sur un trajet<br />
rectiligne, dans le plan sagittal médian. Si une seule <strong>de</strong>nt entre en<br />
contact durant la protrusion, cette <strong>de</strong>nt constitue un obstacle qui<br />
peut entraîner une déviation en <strong>de</strong>hors du plan sagittal. C’est ce<br />
qu’on appelle une interférence travaillante protrusive. La localisation<br />
et la direction <strong>de</strong> ces interférences sont notées.<br />
Durant cette protrusion, la désocclusion <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts postérieures doit<br />
être immédiate et totale. Si le contact <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts antérieures est<br />
interrompu durant le glissement par un ou <strong>de</strong>s contacts postérieurs,<br />
ceci représente une interférence <strong>non</strong> travaillante protrusive.<br />
L’emplacement et la direction <strong>de</strong> ces interférences protrusives <strong>non</strong><br />
travaillantes sont notés. Elles sont généralement situées sur le<br />
versant interne distal <strong>de</strong>s cuspi<strong>de</strong>s vestibulaires supérieures.<br />
Examen <strong>de</strong>s contacts occlusaux en latéralité<br />
Le mouvement <strong>de</strong> latéralité représente le trajet qu’effectue la<br />
mandibule lorsque les <strong>de</strong>nts inférieures glissent latéralement sur les<br />
faces internes <strong>de</strong>s cuspi<strong>de</strong>s vestibulaires <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts maxillaires, et<br />
plus particulièrement sur la face palatine <strong>de</strong> la canine supérieure.<br />
Les surfaces sur lesquelles glissent les cuspi<strong>de</strong>s supéro-inférieures<br />
sont appelées surfaces <strong>de</strong> guidage. Elles comprennent la face<br />
palatine <strong>de</strong> la canine, <strong>de</strong>puis le point support jusqu’au sommet <strong>de</strong><br />
la canine, les versants internes <strong>de</strong>s cuspi<strong>de</strong>s vestibulaires<br />
8<br />
supérieures, <strong>de</strong>puis le point support jusqu’au sommet <strong>de</strong> la cuspi<strong>de</strong>.<br />
Les versants internes <strong>de</strong>s cuspi<strong>de</strong>s linguales et inférieures sont<br />
parfois appelés « surfaces <strong>de</strong> guidage », mais, en réalité, ces cuspi<strong>de</strong>s<br />
ne doivent pas participer à la fonction latérale. Lorsque la mandibule<br />
se déplace latéralement, il yauncôté travaillant et un côté <strong>non</strong><br />
travaillant. Ainsi, lorsque la mandibule se déplace vers la droite, le<br />
côté droit <strong>de</strong>vient le côté travaillant ; les cuspi<strong>de</strong>s vestibulaires <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>nts mandibulaires s’opposent aux cuspi<strong>de</strong>s vestibulaires <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts<br />
maxillaires : c’est le côté fonctionnel. Du côté gauche, les cuspi<strong>de</strong>s<br />
ne doivent pas en principe se rencontrer, c’est le côté <strong>non</strong> fonctionnel<br />
dénommé « côté <strong>non</strong> travaillant ».<br />
Du côté travaillant, on recherche la ou les surface(s) <strong>de</strong> guidage qui<br />
conduisent à cette fonction latérale :<br />
– soit fonction canine (la canine supérieure conduit seule le<br />
mouvement durant tout le trajet dès le départ et, durant tout le<br />
mouvement, la désocclusion <strong>de</strong> toutes les autres <strong>de</strong>nts est immédiate<br />
et totale) ; la fonction canine est très fréquente et peut être considérée<br />
comme la fonction latérale idéale ;<br />
– soit fonction groupe ; plusieurs <strong>de</strong>nts, y compris la canine, gui<strong>de</strong>nt<br />
la fonction latérale <strong>de</strong>puis la position d’intercuspidation maximale<br />
jusqu’au bout à bout ; les forces occlusales sont distribuées<br />
harmonieusement et il existe une désocclusion immédiate et totale<br />
du côté <strong>non</strong> travaillant.<br />
L’interférence travaillante en latéralité (fig 15) est un obstacle à ce<br />
glissement durant l’excursion latérale. Le mouvement est alors<br />
supporté par une autre <strong>de</strong>nt que la canine pendant une partie du<br />
mouvement, ou pendant la totalité du mouvement. Les interférences<br />
latérales sont généralement situées sur les versants mésiaux internes<br />
<strong>de</strong>s cuspi<strong>de</strong>s vestibulaires maxillaires.<br />
Lorsqu’il existe une fonction groupe, il faut contrôler, avec l’in<strong>de</strong>x<br />
placé sur la face vestibulaire <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts maxillaires, le déplacement<br />
que pourraient provoquer les forces latérales.<br />
De ce côté travaillant, la <strong>de</strong>rnière étape consiste à rechercher les<br />
interférences qui peuvent se produire sur les trajectoires<br />
fonctionnelles, qui peuvent être utilisées entre le mouvement <strong>de</strong><br />
protrusion et le mouvement <strong>de</strong> latéralité.<br />
Du côté <strong>non</strong> travaillant, durant l’excursion latérale, il ne doit pas y<br />
avoir <strong>de</strong> contact. Une interférence latérale du côté <strong>non</strong> travaillant<br />
détruit l’harmonie du mouvement <strong>de</strong> latéralité. Les interférences <strong>non</strong><br />
travaillantes sont généralement situées sur les <strong>de</strong>nts postérieures<br />
(troisième molaire inférieure en particulier).<br />
Évaluation <strong>de</strong> la dimension verticale<br />
15 Interférence en latéralité<br />
travaillante sur la 24<br />
(d’après Latino).<br />
« La dimension verticale d’occlusion est la hauteur <strong>de</strong> l’étage<br />
inférieur <strong>de</strong> la face quand les arca<strong>de</strong>s sont en occlusion centrée » [8] .<br />
Selon Dawson, la dimension verticale d’occlusion correspond à un<br />
positionnement musculaire <strong>de</strong> la mandibule. La position<br />
mandibulaire est déterminée par la longueur maximale <strong>de</strong><br />
contraction <strong>de</strong>s muscles élévateurs et elle est reproductible. Les<br />
<strong>de</strong>nts s’égressent jusqu’à rencontrer leurs antagonistes au point <strong>de</strong><br />
contraction musculaire optimale, déterminant ainsi la dimension<br />
verticale d’occlusion. Cette dimension est remarquablement stable,<br />
même s’il y a abrasion <strong>de</strong>ntaire (fig 16).