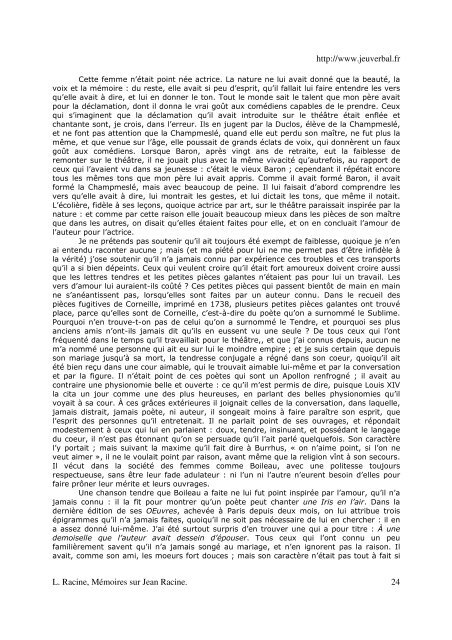http://www.jeuverbal.fr L. Racine, Mémoires sur Jean ... - le jeu verbal
http://www.jeuverbal.fr L. Racine, Mémoires sur Jean ... - le jeu verbal
http://www.jeuverbal.fr L. Racine, Mémoires sur Jean ... - le jeu verbal
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong><strong>jeu</strong><strong>verbal</strong></strong>.<strong>fr</strong><br />
Cette femme n’était point née actrice. La nature ne lui avait donné que la beauté, la<br />
voix et la mémoire : du reste, el<strong>le</strong> avait si peu d’esprit, qu’il fallait lui faire entendre <strong>le</strong>s vers<br />
qu’el<strong>le</strong> avait à dire, et lui en donner <strong>le</strong> ton. Tout <strong>le</strong> monde sait <strong>le</strong> ta<strong>le</strong>nt que mon père avait<br />
pour la déclamation, dont il donna <strong>le</strong> vrai goût aux comédiens capab<strong>le</strong>s de <strong>le</strong> prendre. Ceux<br />
qui s’imaginent que la déclamation qu’il avait introduite <strong>sur</strong> <strong>le</strong> théâtre était enflée et<br />
chantante sont, je crois, dans l’erreur. Ils en jugent par la Duclos, élève de la Champmeslé,<br />
et ne font pas attention que la Champmeslé, quand el<strong>le</strong> eut perdu son maître, ne fut plus la<br />
même, et que venue <strong>sur</strong> l’âge, el<strong>le</strong> poussait de grands éclats de voix, qui donnèrent un faux<br />
goût aux comédiens. Lorsque Baron, après vingt ans de retraite, eut la faib<strong>le</strong>sse de<br />
remonter <strong>sur</strong> <strong>le</strong> théâtre, il ne jouait plus avec la même vivacité qu’autrefois, au rapport de<br />
ceux qui l’avaient vu dans sa <strong>jeu</strong>nesse : c’était <strong>le</strong> vieux Baron ; cependant il répétait encore<br />
tous <strong>le</strong>s mêmes tons que mon père lui avait appris. Comme il avait formé Baron, il avait<br />
formé la Champmeslé, mais avec beaucoup de peine. Il lui faisait d’abord comprendre <strong>le</strong>s<br />
vers qu’el<strong>le</strong> avait à dire, lui montrait <strong>le</strong>s gestes, et lui dictait <strong>le</strong>s tons, que même il notait.<br />
L’écolière, fidè<strong>le</strong> à ses <strong>le</strong>çons, quoique actrice par art, <strong>sur</strong> <strong>le</strong> théâtre paraissait inspirée par la<br />
nature : et comme par cette raison el<strong>le</strong> jouait beaucoup mieux dans <strong>le</strong>s pièces de son maître<br />
que dans <strong>le</strong>s autres, on disait qu’el<strong>le</strong>s étaient faites pour el<strong>le</strong>, et on en concluait l’amour de<br />
l’auteur pour l’actrice.<br />
Je ne prétends pas soutenir qu’il ait toujours été exempt de faib<strong>le</strong>sse, quoique je n’en<br />
ai entendu raconter aucune ; mais (et ma piété pour lui ne me permet pas d’être infidè<strong>le</strong> à<br />
la vérité) j’ose soutenir qu’il n’a jamais connu par expérience ces troub<strong>le</strong>s et ces transports<br />
qu’il a si bien dépeints. Ceux qui veu<strong>le</strong>nt croire qu’il était fort amoureux doivent croire aussi<br />
que <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ttres tendres et <strong>le</strong>s petites pièces galantes n’étaient pas pour lui un travail. Les<br />
vers d’amour lui auraient-ils coûté ? Ces petites pièces qui passent bientôt de main en main<br />
ne s’anéantissent pas, lorsqu’el<strong>le</strong>s sont faites par un auteur connu. Dans <strong>le</strong> recueil des<br />
pièces fugitives de Corneil<strong>le</strong>, imprimé en 1738, plusieurs petites pièces galantes ont trouvé<br />
place, parce qu’el<strong>le</strong>s sont de Corneil<strong>le</strong>, c’est-à-dire du poète qu’on a <strong>sur</strong>nommé <strong>le</strong> Sublime.<br />
Pourquoi n’en trouve-t-on pas de celui qu’on a <strong>sur</strong>nommé <strong>le</strong> Tendre, et pourquoi ses plus<br />
anciens amis n’ont-ils jamais dit qu’ils en eussent vu une seu<strong>le</strong> ? De tous ceux qui l’ont<br />
<strong>fr</strong>équenté dans <strong>le</strong> temps qu’il travaillait pour <strong>le</strong> théâtre,, et que j’ai connus depuis, aucun ne<br />
m’a nommé une personne qui ait eu <strong>sur</strong> lui <strong>le</strong> moindre empire ; et je suis certain que depuis<br />
son mariage jusqu’à sa mort, la tendresse conjuga<strong>le</strong> a régné dans son coeur, quoiqu’il ait<br />
été bien reçu dans une cour aimab<strong>le</strong>, qui <strong>le</strong> trouvait aimab<strong>le</strong> lui-même et par la conversation<br />
et par la figure. Il n’était point de ces poètes qui sont un Apollon ren<strong>fr</strong>ogné ; il avait au<br />
contraire une physionomie bel<strong>le</strong> et ouverte : ce qu’il m’est permis de dire, puisque Louis XIV<br />
la cita un jour comme une des plus heureuses, en parlant des bel<strong>le</strong>s physionomies qu’il<br />
voyait à sa cour. À ces grâces extérieures il joignait cel<strong>le</strong>s de la conversation, dans laquel<strong>le</strong>,<br />
jamais distrait, jamais poète, ni auteur, il songeait moins à faire paraître son esprit, que<br />
l’esprit des personnes qu’il entretenait. Il ne parlait point de ses ouvrages, et répondait<br />
modestement à ceux qui lui en parlaient : doux, tendre, insinuant, et possédant <strong>le</strong> langage<br />
du coeur, il n’est pas étonnant qu’on se persuade qu’il l’ait parlé quelquefois. Son caractère<br />
l’y portait ; mais suivant la maxime qu’il fait dire à Burrhus, « on n’aime point, si l’on ne<br />
veut aimer », il ne <strong>le</strong> voulait point par raison, avant même que la religion vînt à son secours.<br />
Il vécut dans la société des femmes comme Boi<strong>le</strong>au, avec une politesse toujours<br />
respectueuse, sans être <strong>le</strong>ur fade adulateur : ni l’un ni l’autre n’eurent besoin d’el<strong>le</strong>s pour<br />
faire prôner <strong>le</strong>ur mérite et <strong>le</strong>urs ouvrages.<br />
Une chanson tendre que Boi<strong>le</strong>au a faite ne lui fut point inspirée par l’amour, qu’il n’a<br />
jamais connu : il la fit pour montrer qu’un poète peut chanter une Iris en l’air. Dans la<br />
dernière édition de ses OEuvres, achevée à Paris depuis deux mois, on lui attribue trois<br />
épigrammes qu’il n’a jamais faites, quoiqu’il ne soit pas nécessaire de lui en chercher : il en<br />
a assez donné lui-même. J’ai été <strong>sur</strong>tout <strong>sur</strong>pris d’en trouver une qui a pour titre : À une<br />
demoisel<strong>le</strong> que l’auteur avait dessein d’épouser. Tous ceux qui l’ont connu un peu<br />
familièrement savent qu’il n’a jamais songé au mariage, et n’en ignorent pas la raison. Il<br />
avait, comme son ami, <strong>le</strong>s moeurs fort douces ; mais son caractère n’était pas tout à fait si<br />
L. <strong>Racine</strong>, <strong>Mémoires</strong> <strong>sur</strong> <strong>Jean</strong> <strong>Racine</strong>. 24