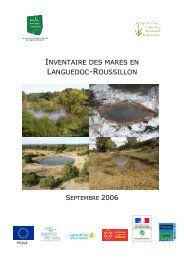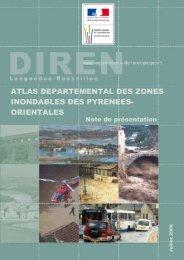ANNEXES - DREAL Languedoc-Roussillon
ANNEXES - DREAL Languedoc-Roussillon
ANNEXES - DREAL Languedoc-Roussillon
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Référentiel Oiseaux – DIREN <strong>Languedoc</strong>-<strong>Roussillon</strong> Busard Saint Martin 3 / 4<br />
majoritairement les proies les plus abondantes, comme par<br />
exemple les campagnols lors des cycles de pullulation ou<br />
des passereaux, selon l’époque de l’année. Les nombreuses<br />
études menées sur son régime alimentaire révèlent un<br />
impact tout à fait anecdotique sur les populations de Perdrix<br />
rouges et grises (Tombal, 1982 ; Grafeuille, 1983-84 ; Robert<br />
et Royer, 1984 ; Clarke et Tombal, 1989 ; Chartier, 1991 ;<br />
Farcy, 1994 ; Maurel 1995a et 1995b).<br />
Reproduction. Le Busard Saint-Martin, à l’instar des autres<br />
représentants du genre Circus, niche et dort au sol. Les<br />
oiseaux se reproduisent généralement à l’âge de 2 ans mais<br />
en cas de forte abondance de proies, la reproduction dès le<br />
premier été n’est pas rare. A l’inverse, en cas de<br />
disponibilités alimentaires peu abondantes, seule une partie<br />
des couples se reproduit. Les couples sont essentiellement<br />
monogames et nichent de façon isolée. La ponte intervient<br />
fin avril. Le nid est rudimentaire ; c’est une simple coupe au<br />
sol, dissimulée dans une végétation herbacée touffue ou<br />
épineuse. Les pontes peuvent compter jusqu’à 6 œufs mais<br />
leur taille varie de manière importante suivant la qualité des<br />
milieux et l’abondance des proies. Il en est de même pour le<br />
nombre de jeunes à l’envol. L’incubation dure 30 jours et 32-<br />
36 jours supplémentaires sont nécessaires au poussin pour<br />
quitter le nid. La dispersion des jeunes s’effectue en juilletaoût.<br />
Migration et hivernage. Une partie de la population<br />
française est migratrice. En hiver, les oiseaux sédentaires<br />
sont rejoints par des migrateurs provenant d’Europe du<br />
Nord : Pays-Bas, Allemagne, Scandinavie. La population<br />
hivernante en France a été estimée entre 6 000 et 10 000<br />
individus dans les années 1990. En <strong>Languedoc</strong>-<strong>Roussillon</strong>,<br />
l’espèce peut-être observée en hiver dans les plaines<br />
viticoles et les marais littoraux. A cette époque, et lorsque<br />
les disponibilités alimentaires et les habitats le permettent,<br />
les hivernants tendent à se regrouper pour la nuit en dortoirs<br />
collectifs dans des milieux herbacés.<br />
Causes de déclin et menaces<br />
En hiver, la diminution continue des surfaces de prairies,<br />
friches et autres terres incultes au profit des zones<br />
urbanisées et des terres cultivées, par ailleurs labourées de<br />
plus en plus précocement, a considérablement réduit la<br />
surface de ses terrains de chasse et la disponibilité en sites<br />
de repos nocturne.<br />
La réaction de l’espèce au développement de parcs éoliens<br />
industriels n’est pas documentée mais les effets de ces<br />
aménagements sur l’espèce mériteraient d’être précisés.<br />
La nidification dans des parcelles de céréales rend les<br />
nichées du Busard Saint-Martin, comme celles du Busard<br />
cendré, sensibles au risque de destruction par les machines<br />
lors des moissons. Cependant, ses exigences écologiques<br />
plus souples en font une espèce moins vulnérable semble-til<br />
que son proche parent.<br />
Dans les landes, prairies et clairières, les pontes et les<br />
oisillons peuvent être prédatés par les sangliers, les petits<br />
carnivores (Renard, Fouine…) et les oiseaux (corvidés,<br />
autres oiseaux de proies,…).<br />
Consommateur occasionnel de proies telles que cailles et<br />
perdrix, le Busard Saint-Martin fait toujours l’objet de tirs et<br />
d’actes de destructions volontaires et illégaux de la part<br />
d’agriculteurs et de chasseurs.<br />
Enfin, l’espèce reste tributaire de certaines pratiques<br />
sylvicoles et agricoles dont l’évolution imprévisible pourrait<br />
conduire à une diminution de ses habitats de nidification<br />
(jeunes plantations après coupes rases, landes à genêts<br />
colonisant les terrains en déprise agricoles, évolution de<br />
l’assolement dans les zones de grandes cultures…).<br />
Mesures de conservation<br />
Comme pour le Busard cendré, la conservation de l’espèce<br />
nécessite la localisation des couples installés dans les<br />
cultures céréalières afin d’assurer la protection des nichées<br />
au moment des moissons.<br />
Le maintien des surfaces en herbe et la préservation des<br />
friches, jachères et autres terrains incultes sont des actions<br />
importantes à mettre en œuvre dans les zones de plaine.<br />
Elles impliquent un partenariat étroit avec le monde agricole<br />
et une politique réfléchie de gestion et d’aménagement du<br />
territoire. Concernant les JEFS (jachères Environnement et<br />
Faune Sauvage), le mélange «luzerne et graminées<br />
(dactyle)» fourni une densité et une hauteur qui sont<br />
favorables à la nidification du Busard cendré. Des<br />
nidifications dans ce couvert végétal ont déjà été constatées.<br />
La période d’implantation du couvert végétal est un élément<br />
important. Les busards reviennent de leur quartier<br />
d’hivernage vers la mi avril, ils doivent trouver à cette<br />
période le couvert végétal en place. L’implantation devra être<br />
effectuée avant l’hiver précédent cette date. Le fauchage ou<br />
broyage de la jachère devra se faire après le 31 août. Les<br />
jeunes busards peuvent encore se trouver au nid en août,<br />
suite à des couvées de remplacement ou à une installation<br />
tardive (Nature Midi-Pyrénées 2003).<br />
Dans les zones de moyenne montagne, la recherche des<br />
couples nicheurs est nécessaire afin de localiser les habitats<br />
de nidification : prairies, landes ou espaces ouverts intraforestiers<br />
(clairières, zones de chablis …) occupés chaque<br />
année avec une certaine fidélité.<br />
Ces sites de nidification doivent être associés à des habitats<br />
ouverts riches en proies, dont l’existence dépend le plus<br />
souvent du maintien d’activités agro-pastorales extensives.<br />
Localement, la tranquillité des nicheurs peut nécessiter<br />
l’information et la sensibilisation des exploitants<br />
(agriculteurs, forestiers…) voire la mise en place de<br />
périmètres de quiétude. La gestion de la fréquentation<br />
humaine aux abords des sites de nidification peut dans<br />
certains cas être nécessaire afin d’éviter le dérangement des<br />
nicheurs par les pratiquants de sports de plein air, les<br />
promeneurs, les chasseurs, les ramasseurs de<br />
champignons…