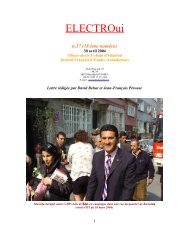institut français d'études anatoliennes georges-dumezil - IFEA
institut français d'études anatoliennes georges-dumezil - IFEA
institut français d'études anatoliennes georges-dumezil - IFEA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Laurence Astruc<br />
Rapport d'activités<br />
Laurence Astruc<br />
CNRS<br />
Affectation : du 1er Février 2008 au 31 janvier 2010, renouvellement pour deux ans accepté<br />
Disciplines : Préhistoire récente, outillages lithiques, technologie et tracéologie<br />
Laboratoire d’origine : Equipe ‘Du village à l’Etat au Proche et Moyen-Orient’, ArScan, UMR7041<br />
Demande de renouvellement d'affection<br />
Mon affectation à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes a pris effet le 1er février 2008 à la faveur d’un projet de<br />
collaboration avec la section de Préhistoire de l’Université d’Istanbul, dirigée à l‘époque par Pr. Dr. Mehmet Özdoğan.<br />
Ce projet participe d’une réflexion conduite sur la néolithisation en Anatolie, les réseaux d’échanges et les transferts<br />
techniques interculturels. Il se fonde sur l’étude des modes de fabrication, d’utilisation et d’entretien des outillages<br />
lithiques qui sont de bons révélateurs des pratiques et traditions techniques des communautés.<br />
J’ai pris les premiers contacts avec mes collègues turcs en 2006. Mon programme de recherche, soutenu par une ANR<br />
blanche de trois ans, sera difficilement réalisable sans un temps important de séjour en Turquie pour des questions à la<br />
fois scientifiques, relationnelles et diplomatiques. Les procédures de demande d’autorisation d’accès aux collections, de<br />
permis de fouilles allongent considérablement les temps de préparation et viennent parfois doubler le temps d’étude.<br />
Il est en outre impossible d’obtenir l’exportation en France de matériel archéologique, en particulier en obsidienne, à<br />
l’exception de petites collections pour l’analyse chimique des matériaux taillés. Enfin, je suis aujourd’hui persuadée que<br />
les collaborations franco-turques en Préhistoire peuvent être réinitialisées mais cela demandera nécessairement un grand<br />
investissement personnel et une présence dans le pays extrêmement importante.<br />
C’est dans ce cadre que j’ai demandé le renouvellement de mon affectation à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes,<br />
je vais maintenant présenter brièvement le bilan de ces 18 mois d’affectation dont environ 10 mois passés sur en dehors<br />
d’Istanbul en Turquie, en Syrie et en Russie (programme sur le Sinjar, Irak) pour l’analyse de collections qui<br />
comprennent toutes des industries lithiques faites d’obsidiennes <strong>anatoliennes</strong>.<br />
Programme ANR blanc ‘ObsidianUs’ (ANR-08-BLAN-0318-01)<br />
L’accueil reçu à l’Université d’Istanbul m’a permis de soumettre dès la fin du mois de février 2008, un projet ANR<br />
Blanc intitulé ‘ObsidiennesUs : Obsidiennes, Pratiques techniques et Usages en Anatolie (8500-5000 av. JC)’ qui vient<br />
soutenir cette collaboration. Les partenaires sont l’<strong>IFEA</strong> en association avec la section de Préhistoire de l’Université<br />
d’Istanbul et le Laboratoire de Tribologie et de Dynamique des Surfaces (Université de Lyon, Ecole Centrale de Lyon).<br />
Ce projet a reçu l’aval de l’ANR et le programme ‘ObsidianUs’ a débuté le 1er janvier 2009 pour une durée de trois ans<br />
(ANR-08-BLAN-0318-01). L’<strong>IFEA</strong> est porteur du projet ce qui est important non seulement pour la pérennité des<br />
collaborations franco-turques, mais, aussi pour celle d’<strong>institut</strong>ions telles que les Centres Français à l’étranger.<br />
L'utilisation de l'obsidienne par les communautés d'Anatolie entre 8500 et 5000 av. JC constitue le centre du programme<br />
'ObsidienneUs' (Obsidian Use Project). Les sources d'obsidiennes se trouvent essentiellement dans deux régions :<br />
l'Anatolie centrale (Cappadoce) et l'Anatolie orientale (Bingöl, lac de Van) et les verres volcaniques qui en sont issus<br />
étaient diffusés sur des milliers de kilomètres par voie d'échange. Ils peuvent être transformés pour la fabrication d'une<br />
large gamme d'objets : pour la période considérée, du Néolithique au Chalcolithique, non seulement des outils mais<br />
aussi, en moindre nombre, des bracelets, des pendentifs, des vaisselles et des miroirs par différentes techniques et<br />
méthodes de taille, de piquetage et de polissage dont on connaît encore peu de choses.<br />
L'obsidienne est, en outre, pour l'archéologue un élément clé pour étudier des pratiques techniques multiples liées à la<br />
subsistance ou à différents types d'artisanats: moisson, chasse, boucherie, traitement des matières végétales, animales<br />
(os, bois de cervidé, dents, peau, tendons) ou minérales. Ce matériau révèle aussi des pratiques sociales: identification<br />
des réseaux d'échanges, pratiques funéraires, rituels de fondation. Parmi les questions posées, la manière dont une<br />
communauté adopte un matériau, les rythmes et les modalités de cette adoption dépendent de la diversité régionale dans<br />
l'approvisionnement, de la variabilité économique des villages et des traditions techniques.<br />
Dans l'état actuel de la recherche, les analyses chimiques des obsidiennes permettent d'identifier les routes de diffusion<br />
du matériau mais ne permettent pas de percevoir les mécanismes sociaux qui les sous-tendent. Notre but est de mieux<br />
identifier ces mécanismes en utilisant l'approche technologique : analyser les modes de fabrication adoptés par les<br />
communautés, mieux percevoir l'organisation interne de ces dernières et les liens qui les unissent.<br />
102