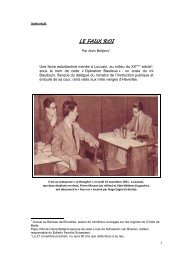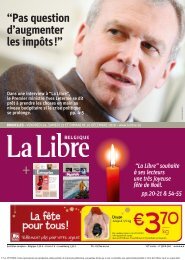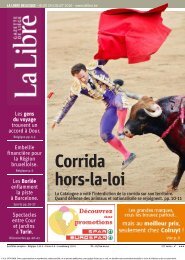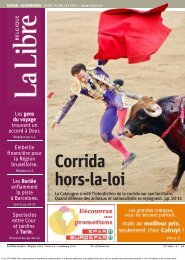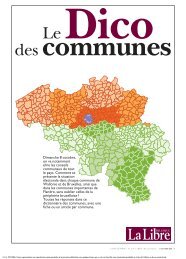Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
C U L T U R E<br />
Littérature - DÉCÈS<br />
Pinter,unevoixenragées’éteint<br />
w Le dramaturge britannique<br />
Harold Pinter est mort la<br />
veille de Noël à 78 ans.<br />
w La littérature mondiale perd<br />
l’un de ses auteurs les plus<br />
critiques et engagés.<br />
En octobre 2005, Harold<br />
Pinter recevait à 75 ans<br />
le Prix Nobel de littérature.<br />
Souffrant d’un cancer<br />
de l’œsophage depuis 2002, le<br />
célèbre dramaturge anglais ne<br />
put se rendre à Stockholm pour y<br />
prononcer son discours. Des séances<br />
de chimiothérapie qu’il qualifiait<br />
de “cauchemar personnel”, il<br />
dira : “J’ai traversé la vallée de<br />
l’ombre de la mort.”. Celle-ci l’a<br />
rattrapé la veille de Noël, à l’âge<br />
de 78 ans. Avec Pinter, disparaît<br />
l’un des auteurs les plus applaudis<br />
mais aussi un militant antiimpérialisteengagé.<br />
Ces dernières années, Pinter<br />
s’était en effet fait l’un des critiques<br />
les plus virulents du président<br />
américain George W. Bush<br />
et de l’ancien Premier ministre<br />
britannique Tony Blair – qu’il<br />
avait qualifié de “pauvre idiot”. A<br />
la fin de sa vie, l’auteur disait<br />
même vouloir se consacrer exclusivement<br />
à l’action politique :<br />
“J’utilise beaucoup de mon énergie<br />
plus particulièrement pour<br />
changer la situation politique qui<br />
est, à mon avis, très inquiétante<br />
dans l’état actuel des choses.” En<br />
2003, il publiait ainsi “War”, un<br />
recueil de poèmes contre la<br />
guerre en Irak. Et avant cela, il<br />
avait critiqué les bombardements<br />
de l’Otan au Kosovo en<br />
1999 puis l’invasion de l’Afghanistan<br />
fin 2001. Anti-système,<br />
Pinter avait même refusé d’être<br />
anobli par la reine Elizabeth.<br />
Malgré la maladie, Pinter<br />
avait néanmoins continué à travailler.<br />
En 2006, il montait même<br />
sur scène pour interpréter “La<br />
dernière bande”, monologue de<br />
son ami Samuel Beckett, un succès<br />
critique à Londres.<br />
Décrit par l’Académie Nobel<br />
comme “le représentant le plus<br />
éminent du théâtre dramatique<br />
anglais de la seconde moitié du<br />
XX e siècle”, Pinter avait vu ses<br />
pièces considérées comme des<br />
classiques. Il est ainsi le premier<br />
auteur étranger à être entré de<br />
son vivant au répertoire de la Comédie-Française.<br />
M Pinter, photographié devant chez lui à Londres le 13 octobre 2005, jour de l’annonce<br />
de son Prix Nobel de littérature.<br />
Un enfant du Blitz<br />
Harold Pinter est né dans une<br />
famille de tailleurs juifs le 10 octobre<br />
1930 dans le quartier populaire<br />
d’Hackney, dans l’East End<br />
de Londres. Chez ses parents, il<br />
n’y avait pas de livres – la famille<br />
n’avait pas les moyens d’en acheter.<br />
Après une scolarité primaire<br />
fortement perturbée par les bombardements<br />
londoniens – “J’ai été<br />
évacué trois fois, alors que tombaient<br />
les V2. Le sentiment d’être<br />
bombardé ne m’a jamais quitté”,<br />
confiera-t-il par la suite –, il rattrapa<br />
le temps perdu à partir de<br />
1944 en empruntant force ouvrages<br />
de Joyce, Lawrence, Dostoïevski,<br />
Hemingway, Rimbaud ou<br />
Yeats, à la bibliothèque municipale<br />
de son quartier natal. A 15<br />
ans, alors qu’il n’a jamais mis les<br />
pieds dans un théâtre, son professeur<br />
d’anglais le désigne pour interpréter<br />
Macbeth.<br />
Sa vocation est née. Après un<br />
passage à la Royal Academy of<br />
Dramatic Art, il fait ses débuts<br />
comme acteur. Et ce n’est que<br />
vers 1957 qu’il commence à écrire<br />
pour la scène, des saynètes et des<br />
sketches. Sa première grande<br />
pièce, “L’Anniversaire”, en 1958,<br />
fut un four retentissant, massacrée<br />
par les critiques et retirée de<br />
l’affiche du Lyric Theater après<br />
huit représentations !<br />
Un théâtre de la menace<br />
Rattachée un peu abusivement<br />
au théâtre de l’absurde, l’œuvre<br />
de Pinter relève plus justement<br />
d’un “théâtre de la menace”.<br />
D’apparence banale, le dialogue<br />
explore, à partir de situations<br />
quasi-vaudevillesques, les rapports<br />
de domination et de soumission<br />
entre des personnages sur<br />
lesquels pèse quelque inexplicable<br />
pression extérieure, comme<br />
dans “Le Gardien”, “L’anniversaire”,<br />
“Le monte-plat” ou “Le retour”.<br />
Les répliques peuvent ici<br />
faire songer, il est vrai, aux pièces<br />
de Beckett mais il est sans doute<br />
le seul auteur qui ait généré un<br />
adjectif, “pinteresque”, preuve<br />
d’une irréductible singularité.<br />
Certains aiment à voir dans la<br />
succession des pièces de Pinter<br />
une évolution vers une deuxième<br />
phase plus lyrique à la fin des années<br />
60 (“Paysage”, “Silence”),<br />
puis une troisième, plus politique<br />
(“Langue de la montagne”, “Le<br />
nouvel ordre mondial”), dans les<br />
JOHN STILLWELL/AP<br />
années 80. Cette division paraît<br />
toutefois un peu artificielle face à<br />
une écriture travaillée de manière<br />
persistante par la complexité<br />
des rapports entre la mémoire,<br />
l’identité, le langage et la<br />
réalité. Comme l’écrit le metteur<br />
en scène Sir Peter Hall, chez lui,<br />
“les mots sont des armes que les<br />
personnages utilisent pour se déstabiliser<br />
ou se détruire et, défensivement,<br />
pour dissimuler leurs<br />
sentiments”. Pinter, lui, en tant<br />
que citoyen, n’a jamais fait mystère<br />
des siens. Obsédé par la manipulation,<br />
il s’est engagé politiquement<br />
de manière très claire<br />
depuis les années 70, pour les<br />
droits de l’homme, à travers des<br />
écrits, des prises de position publiques<br />
et des films pour la BBC,<br />
dans lesquels il dénonce les impérialismes<br />
de tous bords.<br />
Pinter, côté cinéma<br />
Découvert grâce à son théâtre<br />
– on lui doit au total une trentaine<br />
de pièces –, Harold Pinter<br />
travailla en effet aussi pour la télévision<br />
et le cinéma et notamment<br />
pour Hollywood. En 1963, il<br />
collaborait ainsi au “Servant” de<br />
Jospeh Losey, cinéaste qu’il retrouvera<br />
quatre ans plus tard<br />
pour “Accident” et, en 1970, pour<br />
“The Go-Between” avec Julie<br />
Christie. On lui doit également<br />
les scénarios de “The Last Tycoon”<br />
d’Elia Kazan en 1976, de<br />
“La femme du lieutenant français”<br />
en 1981 (d’après John<br />
Fowles) ou encore du “Procès” en<br />
1993 (d’après Kafka). Tandis que,<br />
l’année dernière, il signait pour<br />
Kenneth Branagh le scénario du<br />
“Limier”, remake du chefd’œuvre<br />
de Mankiewicz resté inédit<br />
chez nous.<br />
H. H.&Ph. T.<br />
Concert<br />
Une autre<br />
Neuvième<br />
pour Langrée<br />
A BRUXELLES puis à Liège, l’Orchestre<br />
Philharmonique de Liège<br />
et de la Communauté française<br />
donnait la semaine dernière son<br />
ultime concert de l’année 2008,<br />
accueillant pour l’occasion son<br />
ancien directeur musical Louis<br />
Langrée. Programme résolument<br />
romantique, avec le concerto<br />
pour piano de Schumann<br />
et la Neuvième – et ultime –<br />
symphonie d’Anton Bruckner. A<br />
Bruxelles, la première partie de<br />
soirée put laisser le spectateur<br />
sur sa faim. Benedetto Lupo<br />
donna en effet une lecture parfois<br />
désarçonnante du concerto :<br />
fougueuse, presque brutale<br />
même, dans l’“Allegro affetuoso”,<br />
plus recherchée mais<br />
aux confins du maniérisme dans<br />
l’“Intermezzo”, tout en force et<br />
brillante dans le “Finale”, le tout<br />
avec de fréquentes cassures de<br />
rythme. Langrée et ses troupes<br />
eurent beau tenter de tracer en<br />
arrière-plan le sens de la continuité<br />
qui manquait au pianiste<br />
italien, l’ensemble laissa un sentiment<br />
mitigé. Seul à bord, le chef<br />
français put confirmer dans la<br />
Neuvième (on a gardé le souvenir<br />
d’une mémorable Septième)<br />
à quel point l’univers austère et<br />
profond du maître de Saint-Florian<br />
lui sied bien. Dans une lecture<br />
empreinte d’honnêteté, refusant<br />
tout effet facile, Langrée et<br />
ses Liégeois s’imposèrent par<br />
l’homogénéité du discours, la pureté<br />
des lignes et la plénitude<br />
d’une sonorité évoquant parfois<br />
même l’orgue, et ce nonobstant<br />
quelques défaillances du côté des<br />
cors. Si le “Misterioso” d’entrée,<br />
inexorable sans être oppressant,<br />
put donner le sentiment d’être<br />
encore en devenir, le scherzo sut<br />
combiner puissance et sens du<br />
rythme, élégance et simplicité de<br />
la danse, avec même un travail de<br />
recherche et de fraîcheur dans le<br />
trio central, tandis que l’adagio<br />
conclut la soirée par un sommet<br />
dramatique. (N. B.)<br />
Cinéma<br />
DécèsduréalisateurRobertMulligan<br />
w L’auteur américain<br />
d’“Un été 42” est mort,<br />
à 82 ans, aux Etats-Unis.<br />
Le réalisateur américain Robert<br />
Mulligan s’est éteint<br />
samedi à l’âge de 83 ans à<br />
son domicile à Lyme, dans le Connecticut,<br />
des suites d’une maladie<br />
cardiaque, a annoncé, lundi,<br />
son épouse Sandy. Le réalisateur<br />
avait décroché une nomination<br />
aux Oscars pour son film “Du silence<br />
et des ombres” (“To Kill a<br />
Mockingbird”, 1962), adapté du<br />
roman de Harper Lee, “Ne tirez<br />
pas sur l’oiseau moqueur”. Grâce<br />
à ce film, Gregory Peck avait obtenu<br />
l’Oscar pour son interprétation<br />
d’un avocat d’une petite ville<br />
du sud des Etats-Unis qui défend<br />
un Noir accusé à tort de viol.<br />
Au cours de sa carrière, débutée<br />
en 1951 à la télévision, Mulligan<br />
a également réalisé “Prisonnier<br />
de la peur” (avec Anthony<br />
Perkins, en 1957), “Le sillage de<br />
la violence” (avec Steve Mc-<br />
Queen, en 1965), “Un été 42”<br />
(1971), “L’Autre” (1972), ou encore<br />
“Un été en Louisiane”, son<br />
dernier film, qui mit le pied à<br />
l’étrier à Reese Witherspoon en<br />
1991. (AP)<br />
WWW.BEFILMFESTIVAL.BE<br />
L A L I B R E 2 VENDREDI 26 DÉCEMBRE 2008 21<br />
© S.A. <strong>IPM</strong> 2008. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.