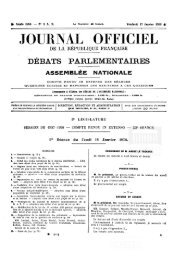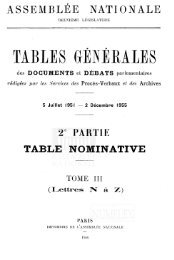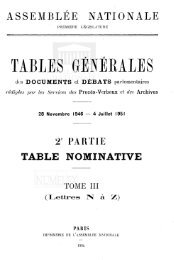JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
JOURNAL OFFICIEL - Débats parlementaires de la 4e République
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Quant aux institutions représentatives, elles n'existaient avantguerre en Tunisie qu'à l'état d'ébauche. Le Grand Conseil, crééen 1922, ne disposant d'ailleurs que d'attributions financières,était constitué essentiellement par <strong>de</strong>s représentants français —ceux-ci en majorité — et tunisiens.Une <strong>de</strong>uxième étape ne fut effectivement réalisée qu'en août1947, alors que M. Mons était <strong>de</strong>venu rési<strong>de</strong>nt général à Tunis.Elle porta à <strong>la</strong> fois sur Je gouvernement et sur l'administrationen donnant <strong>de</strong>s responsabilités plus <strong>la</strong>rges aux Tunisiens par<strong>la</strong> création <strong>de</strong>s ministères <strong>de</strong> <strong>la</strong> santé publique, du travail, <strong>de</strong>l'agriculture et du commerce, et le conseil <strong>de</strong>s ministres secomposa désormais <strong>de</strong> six ministres tunisiens et <strong>de</strong> sept hautsfonctionnaires français, y compris le rési<strong>de</strong>nt.Malgré ces réformes <strong>de</strong> 1957, on ne peut cependant affirmer— et les événements n'ont cessé <strong>de</strong> le montrer — que lemouvement nationaliste ait cessé <strong>de</strong> se développer. En fait, undivorce <strong>de</strong> plus en plus net s'est créé entre le gouvernementet l'administration, d'une part, les milieux tunisiens évolués,d'autre part, et l'opposition n'a cessé <strong>de</strong> gagner du terrain.le fonctionnement du Grand Conseil se heurtait lui-même à<strong>de</strong>s difficultés <strong>de</strong> plus en .plus gran<strong>de</strong>s. En avril 1950, sonAltesse le Bev s'adressa au Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République poursouligner l'impatience du peuple tunisien <strong>de</strong> voir réaliser <strong>de</strong>sréformes substantielles et nécessaires dans les institutions <strong>de</strong><strong>la</strong> Régence.Pour répondre au vœu <strong>de</strong> son Altesse le Bey et <strong>de</strong> 1 élitepolitique tunisienne, le gouverneront français s'st alors décidéa définir plus nettement les objectifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique en Tunisieet à accentuer l'évolution déjà en cours.Le 13 juin, dans son discours d'arrivée dans <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> <strong>la</strong>Régence, M. Périllier proc<strong>la</strong>ma solennellement Ja volonté dugouvernement français d'acheminer <strong>la</strong> Tunisie vers son autonomieinterne. . .Après <strong>la</strong> constitution d'un nouveau gouvernement tunisien ausein duquel figurait le secrétaire général du Néo-Destour, uncommuniqué commun du rési<strong>de</strong>nt général et du gouvernementtunisien fut publié, précisant que <strong>la</strong> tâche <strong>de</strong> ce gouvernementserait <strong>de</strong> négocier, au nom <strong>de</strong> son Altesse le Bey, les modificationsinstitutionnelles qui par étapes successives doivent conduire<strong>la</strong> Tunisie vers l'autonomie interne.Aussitôt les premières mesures étaient prises dans ce sens.Le 7 septembre 1950, un décret beylical supprima les c «nseillersfrançais p<strong>la</strong>cés auprès <strong>de</strong>s ministres tunisiens. Le S février1951* <strong>la</strong> structure du gouvernement tunisien fut <strong>de</strong> nouveauprofondément remaniée en vue d'accroître les responsabilitésrie l'élément tunisien et <strong>de</strong> restreindre le contrôle français.Le conseil <strong>de</strong>s ministres comprit désormais un nombre égal<strong>de</strong> membres français et <strong>de</strong> membres tunisiens. Sa piési<strong>de</strong>ncefut confiée au premier ministre. Le rési<strong>de</strong>nt général s en retiradéfinitivement. Le visa du secrétaire général sur ies arrêtésministériels fut supprimé et remp<strong>la</strong>cé par une formule d'assentimentrési<strong>de</strong>ntiel.En ce qui concerne l'accès à <strong>la</strong> fonction publique, <strong>de</strong>s contingentsfurent prévus pour le recrutement <strong>de</strong>s fonctionnairesfrançais, un quart, un tiers ou <strong>la</strong> moitié suivant les catégoriesd'emplois.A 'peine ce train <strong>de</strong> réformes avait-il été mis en p<strong>la</strong>ce quenos partenaires tunisiens <strong>de</strong>mandèrent que, conformément auxpromesses d'autonomie interne qui leur avaient été faites, l'onpassât à une é<strong>la</strong>pe nouvelle plus substantielle, et dont lemémoire <strong>de</strong> M. Chenik du 31 octobre 1951 fixant les trois pointsessentiels: d'abord <strong>la</strong> constitution d'un gouvernement tunisienhomogène ; ensuite <strong>la</strong> création d'une assemblée tunisienneélue, également homogène; enfin <strong>la</strong> « tunisification » <strong>de</strong> <strong>la</strong>fonction publique.On sait dans quelles conditions, à <strong>la</strong> «uite <strong>de</strong> <strong>la</strong> lettre du15 décembre 1951, les conversations engagées avec M. Clienikéchouèrent sur <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s Français auxnouvelles institutions tunisiennes.En insistant pour obtenir l'accord du gouvernement tunisienau principe d'une telle participation, le Gouvernementfrançais s'exposa alors au reproche <strong>de</strong> vouloir consacrer leprincipe <strong>de</strong> cosouveraineté formellement rejeté par les nationalistestunisiens et <strong>de</strong> vouloir revenir sur les promesses antérieuresd'autonomie interne.Il n'est pas nécessaire <strong>de</strong> rappeler les conséquences <strong>de</strong> cetéchec, <strong>la</strong> vague <strong>de</strong> terrorisme qui <strong>de</strong>puis <strong>de</strong> longs mois aensang<strong>la</strong>nté <strong>la</strong> Régence et a gravement menacé l'amitié francotunisienne.Après ia constitution du gouvernement BaccoucJie, en 1952,un nouveau projet <strong>de</strong> réformes fut é<strong>la</strong>boré par le Gouvernementfrançais. En en présentant les gran<strong>de</strong>s lignés au Parlement,le 19 juin le Gouvernement confirmait une fois <strong>de</strong> plus,par <strong>la</strong> bouche <strong>de</strong> M. Robert Schuman, sa volonté <strong>de</strong> voir <strong>la</strong>Tunisie s'acheminer vers l'autonomie interne. Ce p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> réformesétait présenté comme une nouvelle étape.Cependant, dès qu'ils furent connus à. Tunis, les textes <strong>de</strong>ce projet suscitèrent <strong>la</strong> plus vive opposition <strong>de</strong> l'opinion nationaliste,et dans sa lettre du 9 septembre 1952, adressée à M. lePrési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Ja République, Son Altesse le Bey se déc<strong>la</strong>ra horsd'état d'y souscrire.Seul le* sceau <strong>de</strong>s décrets concernant <strong>la</strong> réforme <strong>de</strong>s municipalitéset <strong>de</strong>s conseils <strong>de</strong> caïdat fut ol)tenue en décembre 1952,non sans peine et après une démarche exceptionnellementpressante du Gouvernement français.L'hiver <strong>de</strong>rnier, dans ia pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> détente qui a suivi sonarrivés en Tunisie, M. Voizard s'est efforcé à son tour <strong>de</strong>mettre sur pied un nouveau programme <strong>de</strong> réformes institutionnelles.Les réformes qui ont vu le jour le 4 mars <strong>de</strong>rniermarquaient à coup sûr <strong>de</strong>s progrès substantiels vers 1a réalisation<strong>de</strong> l'autonomie interne.La parité était rompue au sein du. gouvernement tunisien, quise composait désormais <strong>de</strong> huit membres tunisiens et <strong>de</strong>quatre membres français. L'assentiment du rési<strong>de</strong>nt généralsur les arrêtés ministériels était supprimé et les attributionsdu secrétaire général étaient à nouveau réduites au profit <strong>de</strong>celles du premier ministre.Une assemblée tunisienne élue au suffrage universel étaitcréée, à <strong>la</strong>quelle <strong>de</strong>vaient s'adjoindre, seulement en matièrebudgétaire, les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong>' délégation représentative <strong>de</strong>sFrançais <strong>de</strong> Tunisie, institution rési<strong>de</strong>ntielle, et les membres<strong>de</strong>s chambres économiques.Bien qu'elles eussent été acceptées par Son Altesse le Bey sces nouvelles réformes se heurtèrent aussitôt à l'oppositionquasi unanime <strong>de</strong>s milieux nationalistes.L'agitation ayant repris, le ministère M'Zali dut démissionnersans qu'un nouveau gouvernement pût être constitué, l'administration<strong>de</strong>vant être confiée à un cabinet <strong>de</strong> fonctionnaires.Quant aux élections yuévues à l'assemblée tunisienne, l'onne pouvait songer à les entreprendre dans le climat <strong>de</strong> troublesqui s'était alors instauré dans <strong>la</strong> Régence.A <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> juillet, mes chers collègues, le bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique<strong>de</strong> réformes s'avérait donc particulièrement décevant etinquiétant.Malgré les efforts entreplis par les gouvernements successifs,il fal<strong>la</strong>it bien reconnaître que l'on aboutissait à un échec dansJa mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> nouvelles institutions régulières dans <strong>la</strong>Régence. Alors que l'agitation ne cessait <strong>de</strong>" croître, aucungouvernement tunisien ne pouvait être formé. La constitutiond'assemblées représentatives, dont <strong>la</strong> Tunisie est privée <strong>de</strong>puisia disparition du grand conseil en décembre 1951, paraissaitajournée à une échéance plus éloignée que jamais.Enfin, les conseils municipaux et les conseils <strong>de</strong> caïdat élusau printemps cie 1953 ne pouvaient fonctionner dans <strong>de</strong>s conditionsnormales.A quelles raisons faut-il imputer ces échecs successifs ?Avant tout au caractère fragmentaire <strong>de</strong>s réformes entrepriseset au fait que, surtout au cours <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières années,elles ont toujours paru dépassées par les événements.Du jour où l'on avait choisi <strong>de</strong> s'orienter vers un régimed'autonomie interne et où <strong>de</strong>s promesses solennelles avaientété faites en ce sens, il était fatal que nous nous heurtions,sur le choix et le rythme <strong>de</strong>s étapes, à <strong>de</strong>s impatiences <strong>de</strong> <strong>la</strong>port d'un mouvement nationaliste qui n'a cessé d'aller eu serenforçant.De là le ma<strong>la</strong>ise qui n'a cesse <strong>de</strong> régner en Tunisie au cours<strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rnières années, même dans <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> où l'ordrepublic n'était pas menacé.Les hésitations et ies timidités <strong>de</strong> notre part ont été considéréescomme <strong>de</strong>s reculs ou <strong>de</strong>s déroba<strong>de</strong>s par rapport aux engagementsque nous avions pris. C'est cette apparence d'une politiquedite en <strong>de</strong>nts <strong>de</strong> scie, maintes fois dénoncée, qui a étédans une <strong>la</strong>rge mesure à l'origine <strong>de</strong>s troubles qui ont ensang<strong>la</strong>nteJa Régence en 1952 et qui ont si gravement compromisle climat politique <strong>de</strong> ce pays.De plus, l'autonomie interne que nous avions promise nousnous sommes abstenus <strong>de</strong> <strong>la</strong> définir. De ià, <strong>de</strong> dangereuseséquivoques. Tandis que nous nous efforcions, nous fondantsur les droits que nous tirons <strong>de</strong> <strong>la</strong> convention <strong>de</strong> <strong>la</strong> Marsa,cîe donner une nouvelle structure aux institutions tunisiennesavec <strong>la</strong> préoccupation <strong>de</strong> garantir par cette voie institutionnelleles intérêts <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fiance et <strong>de</strong>s Français <strong>de</strong> Tunisie, lesnationalistes tunisiens manifestaient <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong> hâtepour obtenir <strong>de</strong>s institutions proprement tunisiennes. Il v avaitJa une source dè conflits pratiquement insolubles.Iî convient enfin <strong>de</strong> souligner que <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> réformessuivie jusqu'à présent n'était pas sans présenter <strong>de</strong> graves dangerspour <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> <strong>la</strong> France et <strong>de</strong>s droitsces français en Tunisie.Cette politique <strong>de</strong> concessions successives avait pour effetû amenuiser toujours davantage le contrôle exercé par les