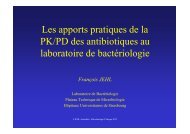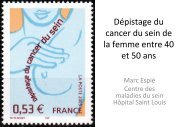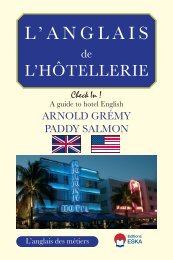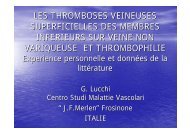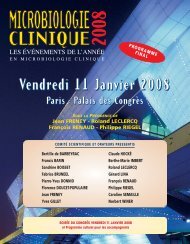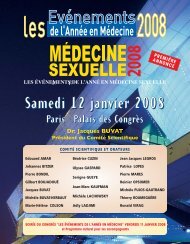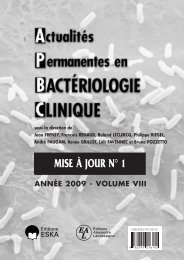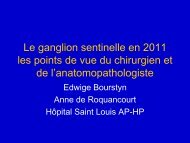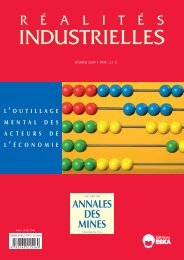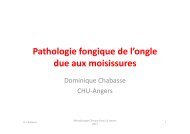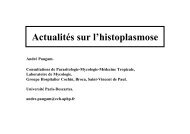R É A L I T É S
R É A L I T É S
R É A L I T É S
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
puisque l’on estime que l’investissement industriel aconnu un recul, par la suite, de 20 à 25 %. Or, sontaux, de 18-19 %, était déjà inférieur à ceux des années1980 et des années 1990 (qui était de 20 %, en moyenne).Cette donnée agrégée masque également des situationstrès différenciées selon les secteurs, ce qui est asseznaturel, mais aussi selon la taille des entreprises, ce quisignale un problème de nature plus structurelle. Ainsi,d’après les données de la Centrale des bilans de laBanque de France, l’investissement des petites etmoyennes entreprises de l’industrie manufacturières’est élevé à 12 % de la valeur ajoutée en 2008. Une tendanceidentique est observée en ce qui concerne l’effortde R&D des entreprises, qui a décliné, passant de1,5 % du PIB, en moyenne, dans les années 1990, àmoins de 1,3 % en 2007, soit un niveau inférieur de30 % à ceux de l’Allemagne ou des Etats-Unis et deuxfois moindre que celui du Japon.Ce recul continu des dépenses d’investissement corporelet de R&D ne peut être compensé par l’attractivitédu territoire français, dont on vante la deuxième outroisième place qu’il occupe régulièrement dans les destinationsdes investissements directs à l’étranger.Les deux tiers des 421 projets d’investissements recensésen 2009 par l’Agence Française pour lesInvestissements Internationaux (AFII) visent, certes, lesecteur manufacturier (principalement l’énergie etl’agroalimentaire). Mais, dans cet ensemble, la fonctionvéritablement productive ne concerne que 30 % desinvestissements.Mais surtout, le niveau élevé des investissements étrangersen France, tel que mesuré dans la balance des paiementsde la Banque de France, mérite un examendétaillé. On s’aperçoit, en effet, que les deux tiers des43 milliards d’euros comptabilisés en 2009 sont classésdans la rubrique « autres opérations ». Il s’agit dans unelarge mesure de prêts et de flux de trésorerie à l’intérieurde groupes, suite à la concentration de leurs opérationsde financement par les grandes entreprises mondialesdans des structures ad hoc implantées dans certains paysattractifs. Il s’ensuit une majoration artificielle des fluxd’investissement entrants. En suivant le principe dereclassement « directionnel étendu » proposé parl’OCDE, le niveau annuel des investissements étrangersen France passe de 57, 70, 43 et 43 milliards d’eurosrespectivement, entre 2006 et 2009, à seulement20, 32, 12 et à un déficit de 4 milliards d’euros aprèsun tel retraitement.La seconde tendance structurelle actuellement constatéeest un brouillage continu des frontières et ducontenu des investissements liés aux activités industrielles.Une première manifestation en est leur extensionsectorielle au-delà du périmètre manufacturiertraditionnel, dans le champ des services, à la suite duprocessus d’externalisation constaté au sein des entreprises.Bien que l’on considère habituellement les servicescomme des activités à faible investissement, on noteraque dans la branche des services aux entreprises, la formationbrute de capital fixe s’est élevée en 2009 à 53milliards d’euros, soit à 18,5 % de la valeur ajoutée, unniveau comparable à celui du monde industriel. Ceteffort massif d’investissement est essentiellementconcentré dans deux secteurs, celui du conseil et assistance(informatique, ingénierie) et celui des servicesopérationnels (location sans opérateur mettant demanière temporaire des équipements lourds variés à ladisposition des entreprises). Environ 40 % de l’activitéde la branche des services aux entreprises provenantd’une demande émanant des secteurs industriels, onmesure à quel point le volume des investissements liésà l’industrie est plus large que ne l’évaluent les classificationsstatistiques en usage.La seconde évolution majeure concerne la nature desinvestissements, avec un poids croissant des investissementsimmatériels, qui dépassent désormais les investissementscorporels classiques. Ces nouveaux investissementsindustriels jouant un rôle décisif dans lacompétitivité de l’offre des entreprises se déploient dansdeux domaines, de façon comparable (20 milliardsd’euros chacun) : la R&D et la mise en marché des produits(publicité, design, marketing).Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces évolutions encours, pour l’avenir des investissements industriels ? Lepremier processus mis en évidence a plusieurs conséquencesimportantes : le vieillissement de l’appareilproductif, un déficit croissant d’efficacité et d’innovationpar rapport aux concurrents et, surtout, un effortfinancier encore plus considérable à consentir dans lefutur pour rattraper ces handicaps.Compte tenu de l’intensité de la concurrence désormaismondiale, des difficultés persistantes rencontréespar les entreprises dans leur recherche de crédits et demontants en jeu qui ne cessent d’augmenter, uneinversion de tendance spectaculaire est peu probable àcourt ou moyen terme. Ce diagnostic agrégé pourracependant être infirmé pour certains secteurs particuliersou pour des groupes d’entreprises bénéficiant deperspectives prometteuses et pouvant tirer profit destrès bas taux d’intérêt à long terme, cela, au prix d’uneforte concentration et spécialisation de l’investissementindustriel.La seconde tendance identifiée (fractionnement sectorielde l’investissement industriel et poids croissant del’immatériel) devrait, pour sa part, logiquement se prolonger(voire s’intensifier) sous le double effet de la diffusionaccrue des technologies numériques et d’uneimbrication croissante entre biens et services, en particulierdans ces domaines prometteurs que sont l’environnement,la santé ou l’énergie.Une seconde approche de la prospective des investissementsindustriels consiste à partir des caractéristiquesanticipées de l’industrie future pour en déduire lesbesoins, les formes et les lieux privilégiés d’investissement.On proposera de l’organiser autour de troisgrandes variables explicatives : la nature des futures activitésindustrielles de croissance, les acteurs et le degrépossible de différenciation territoriale.GILLES LE BLANCR<strong>É</strong>ALIT<strong>É</strong>S INDUSTRIELLES • AOÛT 2010 71