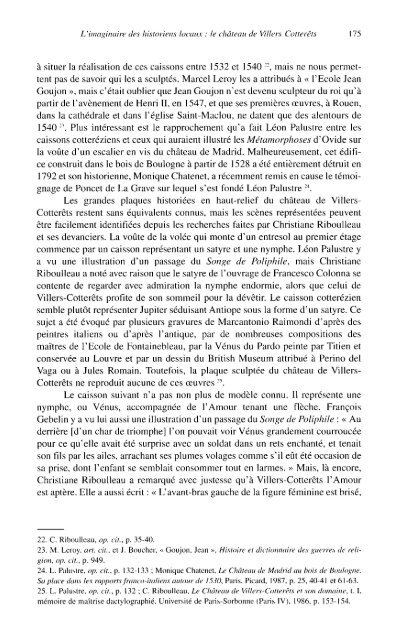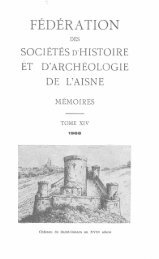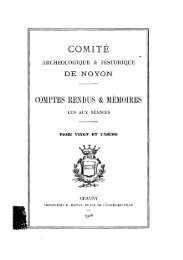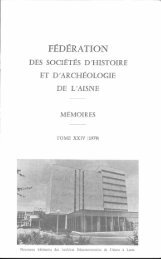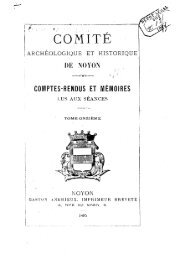L'amour de l'histoire locale
L'amour de l'histoire locale
L'amour de l'histoire locale
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
à situer la réalisation <strong>de</strong> ces caissons entre 1532 et 1540 ‘2, mais ne nous permet-<br />
tent pas <strong>de</strong> savoir qui les a sculptés. Marcel Leroy les a attribués à >, mais c’était oublier que Jean Goujon n’est <strong>de</strong>venu sculpteur du roi qu’à<br />
partir <strong>de</strong> l’avènement <strong>de</strong> Henri II, en 1547, et que ses premières œuvres, à Rouen,<br />
dans la cathédrale et dans I’église Saint-Maclou, ne datent que <strong>de</strong>s alentours <strong>de</strong><br />
1540 :‘. Plus intéressant est le rapprochement qu’a fait Léon Palustre entre les<br />
caissons cotteréziens et ceux qui auraient illustré les Mttarnorphoses d’Ovi<strong>de</strong> sur<br />
la voûte d’un escalier en vis du château <strong>de</strong> Madrid. Malheureusement, cet édifi-<br />
ce construit dans le bois <strong>de</strong> Boulogne à partir <strong>de</strong> 1528 a été entièrement détruit en<br />
1792 et son historienne, Monique Chatenet, a récemment remis en cause le témoi-<br />
gnage <strong>de</strong> Poncet <strong>de</strong> La Grave sur lequel s’est fondé Léon Palustre 24.<br />
Les gran<strong>de</strong>s plaques historiées en haut-relief du château <strong>de</strong> Villers-<br />
Cotterêts restent sans équivalents connus, mais les scènes représentées peuvent<br />
être facilement i<strong>de</strong>ntifiées <strong>de</strong>puis les recherches faites par Christiane Riboulleau<br />
et ses <strong>de</strong>vanciers. La voûte <strong>de</strong> la volée qui monte d’un entresol au premier étage<br />
commence par un caisson représentant un satyre et une nymphe. Léon Palustre y<br />
a vu une illustration d’un passage du Songe <strong>de</strong> Poliphile, mais Christiane<br />
Riboulleau a noté avec raison que le satyre <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Francesco Colonna se<br />
contente <strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r avec admiration la nymphe endormie, alors que celui <strong>de</strong><br />
Villers-Cotterêts profite <strong>de</strong> son sommeil pour la dévêtir. Le caisson cotterézien<br />
semble plutôt représenter Jupiter séduisant Antiope sous la forme d’un satyre. Ce<br />
sujet a été évoqué par plusieurs gravures <strong>de</strong> Marcantonio Raimondi d’après <strong>de</strong>s<br />
peintres italiens ou d’après l’antique, par <strong>de</strong> nombreuses compositions <strong>de</strong>s<br />
maîtres <strong>de</strong> 1’Ecole <strong>de</strong> Fontainebleau, par la Vénus du Pardo peinte par Titien et<br />
conservée au Louvre et par un <strong>de</strong>ssin du British Museum attribué à Perino <strong>de</strong>l<br />
Vaga ou à Jules Romain. Toutefois, la plaque sculptée du château <strong>de</strong> Villers-<br />
Cotterêts ne reproduit aucune <strong>de</strong> ces œuvres<br />
Le caisson suivant n’a pas non plus <strong>de</strong> modèle connu. I1 représente une<br />
nymphc, ou Vénus, accompagnée <strong>de</strong> l’Amour tenant une flèche. François<br />
Gebelin y a vu lui aussi une illustration d’un passage du Sorige <strong>de</strong> Poliphile : > Mais, là encore,<br />
Christiane Riboulleau a remarqué avec justesse qu’à Villers-Cotterêts l’Amour<br />
est aptère. Elle a aussi écrit :