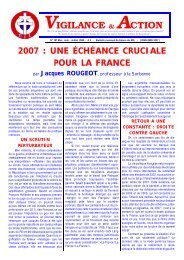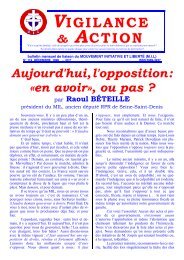M.I.L VIGILANCE - MIL la droite civique gaulliste et patriote
M.I.L VIGILANCE - MIL la droite civique gaulliste et patriote
M.I.L VIGILANCE - MIL la droite civique gaulliste et patriote
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
lectique sont réutilisées avec talent : recours à l’émotion, renversement du sens<br />
des mots, fausse symétrie (exemple : « <strong>la</strong> violence sociale est une réponse<br />
légitime à <strong>la</strong> violence exercée sur les travailleurs par le système économique<br />
»).<br />
Tous ces conflits rencontrent peu ou prou une sorte de « compréhension »<br />
popu<strong>la</strong>ire, très éloignée des mœ urs sociales de nos voisins européens.<br />
L’explication tient en grande partie à un vieux fond de révolte enraciné dans le<br />
monde ouvrier. Lorsque le syndicalisme fut reconnu en France en 1884, il<br />
sortait de près d’un siècle de c<strong>la</strong>ndestinité (depuis <strong>la</strong> loi Le Chapelier de 1791)<br />
<strong>et</strong> prit son essor au carrefour de trois conceptions de l’action militante : l’action<br />
réformiste, privilégiant <strong>la</strong> négociation <strong>et</strong> <strong>la</strong> recherche de l’accord collectif, expression<br />
de l’équilibre social ; l’action révolutionnaire (socialiste disaiton alors,<br />
quand le mot socialisme incarnait <strong>la</strong> rupture radicale), prônant une liaison forte<br />
avec l’action politique pour renverser le capitalisme ; l’action anarchosyndicaliste,<br />
pratiquant une rupture avec le capitalisme, mais sans directive ou convergence<br />
avec un parti politique.<br />
Dès sa naissance, le mouvement syndical français a été interpellé par une<br />
lecture anarchisante de l’action collective. « Comment nous ferons <strong>la</strong> Révolution<br />
» écrivent en 1911, aux Editions de La Guerre sociale, Emile Pataud <strong>et</strong><br />
Emile Poug<strong>et</strong>, préfacé par Pierre Kropotkine. Sabotage, boycottage <strong>et</strong> action<br />
directe font partie des principes d’action enseignés aux militants, dans des<br />
brochures de propagande. Dès avant <strong>la</strong> première guerre mondiale, Emile Pataud,<br />
surnommé le « roi Pataud » coupe l’éc<strong>la</strong>irage à Paris <strong>et</strong> plonge <strong>la</strong> capitale<br />
dans le noir. Objectif : créer les conditions du Grand Soir <strong>et</strong> de <strong>la</strong> Révolution<br />
sociale.<br />
L’action directe est magnifiée. Pour quelques uns, il s’agit du recours à <strong>la</strong> violence.<br />
Mais, pour <strong>la</strong> plupart, l’action directe signifie que les ouvriers de chaque<br />
métier ou profession doivent résoudre directement les questions qui leur étaient<br />
propres. L’action directe, c’est l’action professionnelle directe, loin de toute<br />
emprise politique. En 1906, le congrès de <strong>la</strong> CGT débat de ces questions <strong>et</strong><br />
tranche en faveur de l’autonomie de l’action syndicale au regard de l’action<br />
politique. Beaucoup moins présentes dans <strong>la</strong> CGT au lendemain de <strong>la</strong> Première<br />
guerre mondiale, les méthodes de sabotage <strong>et</strong> de boycottage prônées<br />
par les anarchosyndicalistes sont reprises, à leur manière <strong>et</strong> pour leur compte,<br />
par les militants communistes ayant eu à cœ ur de coloniser <strong>la</strong> CGT. L’opération<br />
ayant réussi en 1947, après deux tentatives en 1921 <strong>et</strong> 1939, <strong>la</strong> CGT est<br />
conduite, en certaines circonstances <strong>et</strong> sur ordre venu de haut <strong>et</strong> de loin, à<br />
pratiquer des grèves à vocation insurrectionnelle <strong>et</strong> des sabotages. Les années<br />
1947 ou 1953 ou encore <strong>la</strong> période de <strong>la</strong> guerre d’Indochine portent les traces<br />
de telles actions. Une autre branche du mouvement syndical, née de <strong>la</strong> CFTC<br />
pour prendre en 1964 le nom de CFDT, a elle aussi à vivre c<strong>et</strong>te culture de <strong>la</strong><br />
rupture.<br />
Au lendemain de mai 1968, <strong>la</strong> CFDT s’engage dans <strong>la</strong> voie de l’autogestion.<br />
C<strong>et</strong> engagement procède d’une lecture politique de <strong>la</strong> société. Dans La CFDT<br />
d’aujourd’hui (Le Seuil, 1975), Edmond Maire, secrétaire général <strong>et</strong> Jacques<br />
Julliard, membre du Bureau national, écrivent : « C’est indissolublement en<br />
termes d’exploitation, de domination <strong>et</strong> d’aliénation que <strong>la</strong> CFDT analyse le<br />
système contre lequel elle lutte. Et c<strong>et</strong>te lutte est bien une lutte de c<strong>la</strong>sse, dans<br />
toute <strong>la</strong> mesure où elle regroupe les victimes de c<strong>et</strong>te exploitation, de c<strong>et</strong>te<br />
domination <strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te aliénation sur <strong>la</strong> base d’un proj<strong>et</strong> commun de société.<br />
C’est en eff<strong>et</strong> à partir de <strong>la</strong> lutte que se définit <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse, <strong>et</strong> non inversement. »<br />
Abandonnant le principe syndical du respect de l’outil de travail, les militants<br />
CFDT procèdent à des occupations d’usine, à des séquestrations de dirigeants,<br />
à des actions niant propriété privée <strong>et</strong> libre concurrence. « On fabrique, on<br />
vend, on se paye » devient un des slogans de ceux qui, « sans chef, sans<br />
patron », veulent démontrer que « les luttes sociales étaient bien le moteur du<br />
changement <strong>et</strong> de <strong>la</strong> transformation sociale ». « L’affaire Lip » en 1973 symbolise<br />
c<strong>et</strong>te période de l’histoire de <strong>la</strong> CFDT que ses dirigeants actuels qualifient<br />
d’années « turbulentes ». En 1974, sous <strong>la</strong> signature de Ratgeb, le livre De <strong>la</strong><br />
grève sauvage à l’autogestion généralisée donne au sabotage sa dimension <strong>la</strong><br />
plus <strong>la</strong>rge. Il ne s’agit pas seulement de démystifier le travail, d’épargner de<br />
l’énergie au travailleur ; il faut aussi viser <strong>la</strong> révolution. L’ABCD de <strong>la</strong> révolution<br />
est ainsi présenté : « A Le but du sabotage <strong>et</strong> du détournement, pratiqués<br />
individuellement ou collectivement, est de déclencher <strong>la</strong> grève sauvage ;B<br />
Toute grève sauvage doit devenir occupation d’usine ;C Toute usine occupée<br />
doit être détournée <strong>et</strong> mise immédiatement au service des révolutionnaires ;D<br />
En élisant des délégués révocables à chaque instant, chargés d’enregistrer<br />
ses décisions <strong>et</strong> de les faire appliquer l’assemblée des grévistes j<strong>et</strong>te les<br />
bases d’une organisation sociale radicalement nouvelle : <strong>la</strong> société<br />
d’autogestion généralisée ». A <strong>la</strong> fin des années 1970, le recentrage de <strong>la</strong><br />
CFDT m<strong>et</strong> fin à ces pratiques. Cependant, de nombreux militants CFDT, déçus<br />
ou exclus de <strong>la</strong> confédération, poursuivent leur proj<strong>et</strong>, notamment dans les<br />
syndicats SUD, dont les premiers apparaissent en 1988. Le mouvement prend<br />
son réel essor avec les grèves de novembredécembre 1995 <strong>et</strong> se trouve<br />
aujourd’hui bien installé dans le paysage syndical. Si, aujourd’hui, <strong>la</strong> CFDT<br />
s’est rangée sans ambiguïté sur une ligne réformiste <strong>et</strong> si <strong>la</strong> CGT amorce, elle<br />
aussi, une évolution dans <strong>la</strong> même direction (tout au moins au niveau confédéral),<br />
les principes d’action directe ne se sont pas évanouis en France.<br />
Sur le terrain syndical, <strong>la</strong> Confédération nationale du travail (CNT) se veut<br />
l’héritière du syndicalisme révolutionnaire. Dans une brochure précisément<br />
intitulée « Nous sommes syndicalistes révolutionnaires », on lisait en 1978 (les<br />
préceptes demeurent les mêmes trente ans après) : « L’action directe, c’est<br />
l’action des travailleurs qui agissent euxmêmes, sans chefs ni bureaucrates,<br />
sans se préoccuper de savoir si c<strong>et</strong>te action est légale ou pas. Servonsnous<br />
de <strong>la</strong> légalité bourgeoise quand elle nous sert, passons outre dans le cas<br />
contraire. Longtemps enterrée par <strong>la</strong> CGT stalinienne, l’action directe a été<br />
réactualisée par des travailleurs, soutenus un temps par <strong>la</strong> CFDT qui, vers<br />
1970, put faire illusion (...). Le plus souvent, les syndicalistes révolutionnaires<br />
sont dans l’illégalité. Sans négliger l’utilité de <strong>la</strong> séquestration, du piqu<strong>et</strong> de<br />
grève offensif, de l’occupation armée capable de repousser flics <strong>et</strong> nervis, de<br />
l’expédition punitive contre les jaunes, les patrons, les boites d’intérim, de<br />
certaines formes de boycottage de patrons spécialement pourris, les syndicalistes<br />
révolutionnaires vouent un culte particulier au sabotage. Le patron ne<br />
veut pas satisfaire vos revendications ? Eh bien, sabotez <strong>et</strong> sabotez de plus<br />
belle ! Les anciens disaient : « A mauvaise paye, mauvais travail », le précepte<br />
reste vrai. Les formes de sabotage sont infinies <strong>et</strong> ne dépendent que de<br />
l’imagination de chacun. Quelques livres, notamment d’une brochure d’Emile<br />
Poug<strong>et</strong> (secrétaire adjoint de <strong>la</strong> CGT en 1902), sont de bon conseil. » Hors du<br />
strict champ syndical, les mouvements de désobéissance <strong>et</strong> de rupture avec<br />
l’économie de marché se développent depuis quelques années. Les publications<br />
<strong>et</strong> les sites intern<strong>et</strong> de ces mouvements <strong>et</strong> organisations contestataires<br />
sont abondants <strong>et</strong> riches en conseils d’action directe. La plus connue de ces<br />
publications a pour titre « L’insurrection qui vient » <strong>et</strong> a été rédigée en 2008,<br />
dans un style néosituationniste, par le « Comité invisible », proche de Julien<br />
Coupat, aujourd’hui incarcéré pour avoir été impliqué (à tort sembletil) dans le<br />
sabotage d’une ligne TGV. De son coté, le guide militant Gueril<strong>la</strong> Kit de Morjane<br />
Baba expose les « ruses <strong>et</strong> techniques des nouvelles luttes anticapitalistes<br />
». Ces méthodes sont aussi enseignées dans les stages de formation<br />
déployés par « Les désobéissants » (http://www.desobeir.n<strong>et</strong>/). La radicalité<br />
sociale que nous vivons, exception française dans une économie mondialisée,<br />
n’est pas un phénomène nouveau dans ses principes. Elle est <strong>la</strong> résurgence,<br />
avec les mots <strong>et</strong> les techniques de 2009, d’un vieux fond syndical <strong>et</strong> politique<br />
qui prend racine à <strong>la</strong> naissance même du mouvement syndical, à <strong>la</strong> fin du<br />
XIXème siècle.<br />
Bernard Vivier Institut Supérieur du Travail (istravail.com) du 27 avril 2009<br />
UN DEMI<strong>MIL</strong>LION D'ETUDIANTS OTAGES<br />
Alors que les vacances de Pâques se sont achevées sur l’ensemble du territoire,<br />
les assemblées générales ont repris de plus belle dans <strong>la</strong> vingtaine<br />
d’universités toujours bloquées par une minorité de grévistes opposés à <strong>la</strong> loi<br />
LRU (loi re<strong>la</strong>tive aux libertés <strong>et</strong> responsabilités des universités).Mais à mesure<br />
que <strong>la</strong> fin de l’année universitaire approche, le bon déroulement des examens<br />
devient de plus en plus hypothétique sur ces sites. D’autant plus que <strong>la</strong> “coordination<br />
nationale des universités” réunie <strong>la</strong> semaine dernière à <strong>la</strong> Sorbonne s’est<br />
prononcée pour un boycott des examens. Concernés, plus de 400000 étudiants<br />
risquent de devoir rattraper les cours du semestre avant l’été… ou de le perdre.<br />
Du côté des organisations étudiantes l’Uni, c<strong>la</strong>ssé à <strong>droite</strong>,« s’insurge sur<br />
l’utilisation de pratiques illégales qui consistent à prendre en otages les étudiants<br />
en boycottant les examens ». Conséquence inattendue, les universités<br />
bloquées voient désormais baisser leur nombre d’inscriptions pour l’année<br />
prochaine.À <strong>la</strong> Sorbonne,le nombre de lycéens qui souhaitent étudier à <strong>la</strong> rentrée<br />
2009 sur les bancs de <strong>la</strong> prestigieuse université parisienne est en chute de<br />
25 % par rapport à 2008.Pour le Ceru (Centre d’études <strong>et</strong> de recherches de<br />
l’Uni), « sur onze universités ayant été totalement ou partiellement bloquées en<br />
2006 <strong>et</strong> 2007 », « <strong>la</strong> chute des effectifs est 3 à 5 fois plus rapide que <strong>la</strong><br />
moyenne nationale (– 4,45%)».<br />
Chahuté en permanence par une fraction de bloqueurs, RennesII a, par exemple,<br />
vu ses effectifs baisser de plus de 5 000 étudiants en cinq ans. Mais c<strong>et</strong>te<br />
année, c’est <strong>la</strong> grève de trop pour les parents d’étudiants, qui se sont regroupés<br />
au sein d’une association : Génération Br<strong>et</strong>agne. Interrogé par le Parisien<br />
Aujourd’hui en France, Gui<strong>la</strong>ine Rimbourg, <strong>la</strong> mère de famille à l’origine de ce<br />
mouvement, s’est insurgée contre les grévistes, les renvoyant à une vérité<br />
sociale trop souvent passée sous silence : « Certains sont issus de familles<br />
aisées <strong>et</strong> sont surtout en révolte contre leur milieu. Ils n’en ont rien à faire des<br />
gens modestes qui se sont end<strong>et</strong>tés pour envoyer leurs enfants à l’université. »<br />
Valeurs Actuelles du 07 mai 2009<br />
A LA FAC DE CAEN, LA POLICE EVACUE LES BLOQUEURS<br />
La police a fait évacuer «dans le calme» des jeunes qui interdisaient depuis<br />
deux semaines l'accès à des bâtiments de l'université de Caen <strong>et</strong> a procédé à<br />
21 interpel<strong>la</strong>tions. L'ensemble des personnes interpellées, parmi lesquelles<br />
figurait «un tiers environ d'étudiants», ont été relâchées dans <strong>la</strong> journée, a dit <strong>la</strong><br />
police. Quatorze d'entre eux ont passé <strong>la</strong> journée en cellule de dégrisement.<br />
(… ) Le principal amphithéâtre de <strong>la</strong> faculté de sciences, qui avait été récemment<br />
rénové, a été entièrement recouvert de tags <strong>et</strong> d'inscriptions, de même<br />
que plusieurs salles, des couloirs, des escaliers <strong>et</strong> le hall d'accueil du bâtiment.<br />
Les locaux occupés par les squatters, où l'odeur d'alcool était encore perceptible<br />
plusieurs heures après leur expulsion, étaient jonchés de bouteilles, de<br />
verre brisé, de reliefs de nourriture ou de vêtements. L'activité du campus de<br />
Caen est perturbée depuis trois mois par des étudiants <strong>et</strong> enseignantschercheurs<br />
hostiles aux réformes de l'université.<br />
Libération du 8 mai 2009<br />
<strong>MIL</strong><strong>VIGILANCE</strong> N° 25/2009<br />
Mouvement Initiative <strong>et</strong> Liberté, 75 rue L. Rouquier 92300 Levallois<br />
Imprimerie spéciale