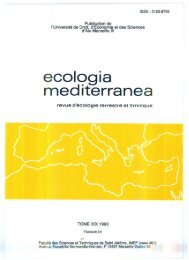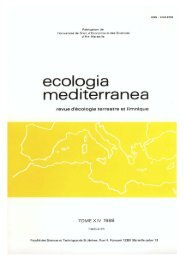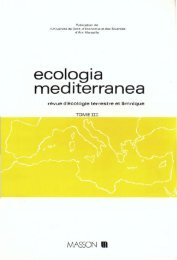Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...
Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...
Revue internationale d'écologie méditerranéenne Mediterranean ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
tative de restauration des friches a été effectuée en reconstituant<br />
les 50 % de recouvrement au sol de galets (ceux-ci<br />
ayant été retirés au moment de la mise en culture), caractéristiques<br />
de la Crau et en excluant ou pas le pâturage.<br />
Cette restauration a été effectuée sur des zones nucleus de<br />
2,25 m² en 2002. Quatre ans après, la restauration du recouvrement<br />
de galet, conjointement à une exclusion de pâturage,<br />
apparaît comme une bonne méthode pour recréer la<br />
qualité de l’habitat nécessaire à certaines espèces de coléoptères<br />
de la steppe, mais aussi pour permettre l’établissement<br />
d’une plus grande richesse de végétation.<br />
La deuxième partie de la thèse concerne l’impact de l’abandon<br />
des pratiques pastorales traditionnelles sur le long<br />
terme. Ces conséquences sur les communautés de coléoptères<br />
ont été étudiées au sein d’exclos âgés de 4 à 23 ans,<br />
ainsi que dans les zones pâturées adjacentes. Cet abandon<br />
conduit dans un premier temps à une augmentation de la<br />
richesse totale, principalement due à l’apparition d’espèces<br />
prédatrices et saprophages. Par la suite, il n’y a pas eu<br />
d’augmentation significative de la richesse et il existe une<br />
certaine stabilité dans la répartition des groupes trophiques.<br />
La diminution de richesse observée après 23 ans n’est due<br />
qu’à la perte des espèces coprophages. Ces résultats sont<br />
surprenants car différents de ce qui a été observé sur la<br />
végétation supérieure, dont la richesse diminue significativement<br />
dès 15 ans. En revanche, la composition en<br />
espèces de coléoptères se modifie significativement. Ainsi,<br />
l’arrêt du pâturage pourrait entraîner à moyen terme la disparition<br />
d’espèces typiques des milieux ouverts.<br />
En conclusion, après plus de 20 ans d’abandon des cultures<br />
ou du pâturage, les communautés de coléoptères terricoles<br />
semblent plus résilientes que les communautés végétales<br />
face à une perturbation exogène. Même si leurs densités<br />
sont encore moindres, la majorité des espèces les plus<br />
abondantes de la steppe ont pu recoloniser des friches pourtant<br />
de structures et de compositions végétales très différentes.<br />
Seules quelques espèces plus exigeantes ou inféodées<br />
à des espèces végétales propres à la steppe demeurent<br />
absentes dans les friches. De ce fait, restaurer le recouvrement<br />
de galet au sol et exclure momentanément le pâturage<br />
semble un ensemble de méthodes efficaces car il restitue<br />
un habitat favorable commun aux espèces végétales<br />
structurantes (espèces pérennes) et à certaines espèces de<br />
coléoptères de la steppe.<br />
Le pâturage constitue un élément important dans le maintien<br />
des communautés de coléoptères de la steppe car certaines<br />
espèces y semblent parfaitement adaptées et dépendantes.<br />
Même si contrairement à la végétation, une<br />
diminution significative de la richesse n’apparaît pas après<br />
25 ans d’abandon, la composition de la communauté évolue<br />
vers la perte de cet assemblage typique des milieux<br />
ouverts et pâturés.<br />
Sur le long terme, un arrêt total du pâturage pourrait donc<br />
être plus préjudiciable aux communautés de Coléoptères<br />
que la mise en culture de certaines parcelles qui maintiennent<br />
toutefois un écosystème ouvert et des zones relictuelles<br />
de steppe à proximité.<br />
ecologia mediterranea – Vol. 33 – 2007<br />
Résumés de thèses<br />
Mona COURT-PICON 2007<br />
Mise en place du paysage dans un<br />
milieu de moyenne et haute montagne<br />
du Tardiglaciaire à l’époque actuelle.<br />
Analyse du signal palynologique<br />
en Champsaur (Hautes-Alpes, France)<br />
à l’interface des dynamiques naturelles<br />
et des dynamiques sociales<br />
732 p. + annexes<br />
Thèse d’université soutenue le 13 décembre 2007 à l’université<br />
de Franche-Comté, faculté des sciences et techniques<br />
de Besançon (UMR CNRS 6565, laboratoire de chronoécologie,<br />
16 route de Gray, 25030 Besançon cedex, France).<br />
Jury – P r Marie-José GAILLARD (université de Kalmar, Suède), président<br />
et rapporteur. Freddy DAMBLON (directeur de recherche, Institut<br />
royal des sciences naturelles, Belgique), rapporteur. Josep Maria<br />
PALET-MARTINEZ (chercheur, université de Tarragona, Espagne), examinateur.<br />
Émilie GAUTHIER (maître de conférences, université de<br />
Franche-Comté), examinateur. Valérie ANDRIEU-PONEL (maître de<br />
conférences, université Paul Cézanne, Aix-Marseille III), examinateur.<br />
P r Alexandre BUTTLER (université de Franche-Comté), directeur<br />
de thèse. Jacques-Louis DE BEAULIEU (directeur de recherche 1 re<br />
classe émérite, université Paul-Cézanne, Aix-Marseille III), codirecteur<br />
de thèse.<br />
Mots clés : palynologie, relations pollen/végétation/pratiques<br />
agropastorales, histoire de la végétation, paléoenvironnements,<br />
anthropisation, Holocène, Champsaur, Alpes françaises.<br />
Dans le cadre de nouvelles études multi-proxy entreprises<br />
pour préciser comment l’action humaine a pu<br />
interférer sur les dynamiques naturelles de végétation, neuf<br />
séquences paléolacustres et tourbeuses ont été prélevées<br />
dans la vallée du Champsaur selon un transect altitudinal<br />
qui traverse différentes structures de végétation. Il s’est agit<br />
d’explorer un petit terroir en haute résolution spatiale et<br />
temporelle en vue de préciser l’histoire des variations de<br />
l’occupation des sols et des usages depuis les premiers<br />
défrichements.<br />
Une première étape de calibration de la relation pluie pollinique<br />
actuelle/végétation/pratiques sociales selon les<br />
approches comparative et indicative a conduit à la détermination<br />
d’un ensemble de taxons polliniques indicateurs<br />
des différentes utilisations du sol et d’en caractériser la<br />
représentativité.<br />
Fort de ce référentiel fin et bien documenté, l’analyse en<br />
haute résolution des données polliniques fossiles a permis<br />
de reconstruire l’évolution de la végétation dans différents<br />
secteurs de la vallée au cours de l’Holocène et de mettre<br />
en évidence les dynamiques rythmiques de l’anthropisation<br />
à l’échelle locale. Pour chaque site, les étapes de déforestation<br />
et de mise en place des systèmes agropastoraux<br />
101